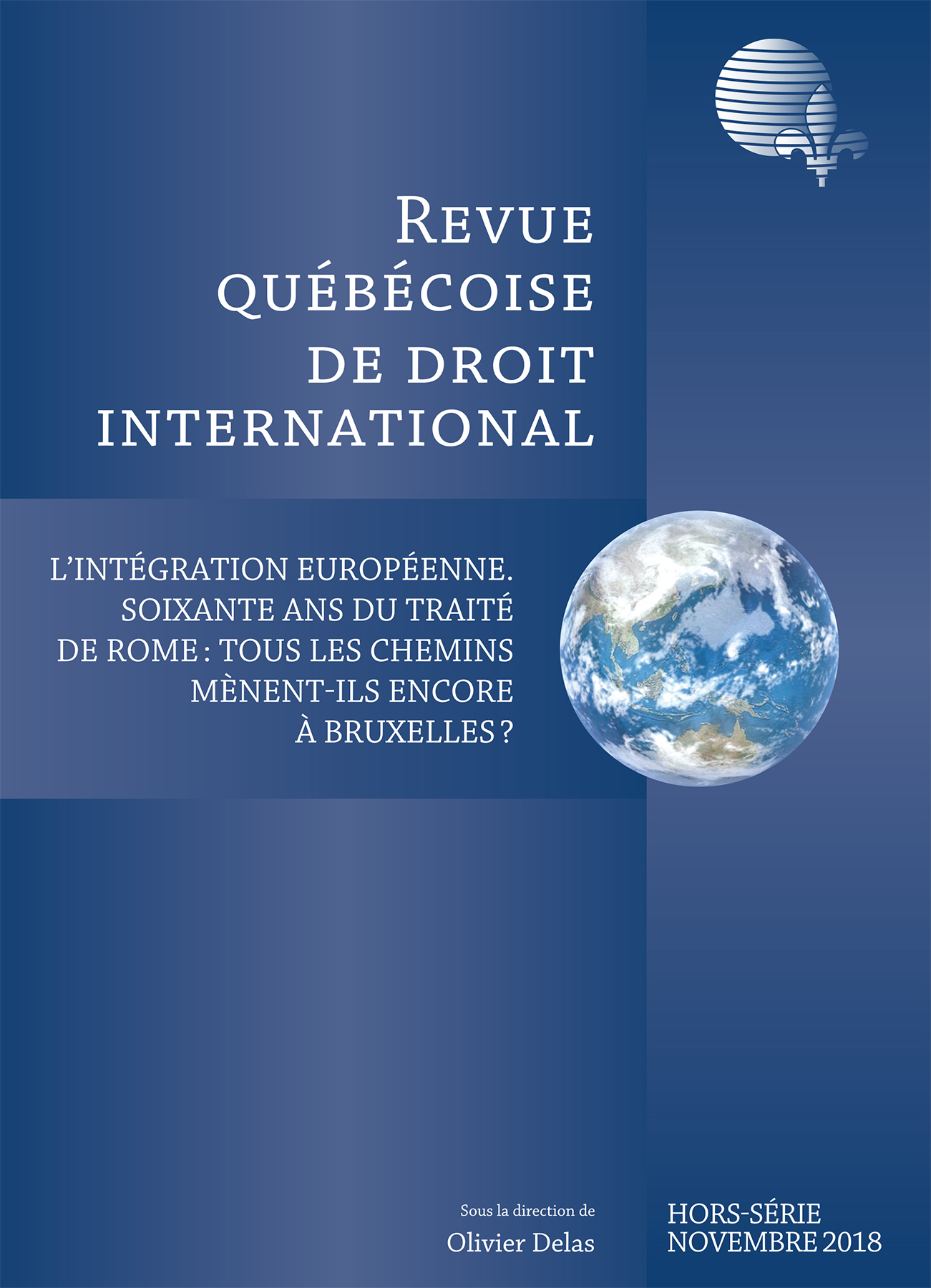Abstracts
Résumé
Le présent article entend faire le point, à jour le 28 février 2018, des négociations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni concernant la sortie de ce dernier (le processus appelé « Brexit », pour « British exit »). Après avoir retracé brièvement l’arrière-plan juridique et politique, seront présentés les principes généraux posés par l’Union européenne (et acceptés par le Royaume-Uni) pour la négociation du Brexit. Puis seront présentés les principaux éléments de l’accord de principe auquel le Royaume-Uni et l’Union européenne sont parvenus en décembre 2017 sur les points fondamentaux de l’accord portant arrangement pour un « retrait ordonné » du Royaume-Uni, à savoir, d’une part, les droits des citoyens, d’autre part, la méthode de calcul de la « facture » due par le Royaume-Uni et, enfin, l’importance de ne pas recréer une frontière « dure » entre le Royaume-Uni et l’Irlande. Pour autant que l’on puisse la dessiner en l’état des négociations, la position de l’Union européenne concernant les « relations futures » avec le Royaume-Uni sera également, brièvement, présentée.
Abstract
This article seeks to expose the state, as of February 28th, 2018, of the negotiations between the European Union and the United Kingdom on the exit of the latter (the process being called “Brexit”, in reference to the British exit). After briefly tracing its legal and political background, the general principles determined by the European Union (and accepted by the United Kingdom) for the negotiation of Brexit will be presented. Then, the article presents the main elements of the tentative agreement concluded by the United Kingdom and the European Union in December 2017, on the fundamental aspects related to an “orderly withdrawal” of the United Kingdom. This includes the rights of citizens, on the one hand, and the calculation method for the “invoice” of what is owed by the United Kingdom and Ireland, on the other hand. Inasmuch as it is possible to trace it at this stage in the negotiations, the position of the European Union as concerns its “future relations” with the United Kingdom will be also be presented.
Resumen
El presente artículo busca hacer un balance, actualizado el 28 de febrero de 2018, de las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino unido que concierne la salida de este último (el proceso llamado “Brexit”, para “British exit”). Después de analizar brevemente el marco jurídico y político, se presentarán los principios generales puestos por la Unión Europea (y aceptados por el Reino unido) para la negociación del Brexit. Luego se presentarán los principales elementos del acuerdo de principio al cual el Reino unido y la Unión Europea llegaron en diciembre de 2017 sobre los puntos fundamentales del acuerdo que llevaba arreglo para una “retirada ordenada” del Reino unido, es decir, por una parte, los derechos de los ciudadanos, y por otra parte, el método de cálculo de la “factura” debida por el Reino unido y, por fin, la importancia de no recrear una frontera “dura” entre el Reino unido e Irlanda. En la medida en que se puede analizar en el estado actual de las negociaciones, la posición de la Unión Europea que concernirá las “relaciones futuras” con el Reino unido también será, brevemente, presentada.
Article body
Le 29 mars 2017, le représentant permanent du Royaume-Uni auprès du Conseil de l’Union européenne, Tim Barrow, a notifié au Conseil européen, représenté par son Président Donald Tusk, l’intention du Royaume-Uni de quitter l’Union européenne (UE) et la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom), conformément à l’article 50 du Traité sur l’Union européenne (TUE)[1]. Neuf mois se seront donc écoulés entre le referendum du 23 juin 2016 par lequel une majorité de la population britannique a voté en faveur d’un retrait du Royaume-Uni de l'UE (désigné très couramment sous le néologisme « Brexit », mot-valise pour « British Exit », c’est-à-dire « sortie britannique ») et cette notification, qui donne effet à ce referendum. Ces neuf mois auront été émaillés de péripéties politiques, de l’annonce, dès le lendemain du referendum, de la démission du premier ministre David Cameron, qui avait organisé ledit referendum et pris parti pour le maintien du Royaume-Uni dans l’UE, au choix de Theresa May par le parti conservateur pour lui succéder. Ils auront également été émaillés de péripéties judiciaires : ainsi, le 3 novembre 2016, la Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galle rendit son arrêt Miller[2], confirmé par la Cour suprême du Royaume-Uni le 24 janvier 2017[3], obligeant le Gouvernement britannique à recueillir l’autorisation du Parlement britannique avant de procéder à ladite notification. Cette autorisation parlementaire fut obtenue avec une facilité désarmante en mars 2017 via l’adoption du European Union (Notification of Withdrawal) Act 2017[4], qui vit l’opposition parlementaire à la chambre des communes se signaler par son silence assourdissant, contrastant avec la courageuse prise de position de la Chambre des Lords qui avait amendé le texte pour y introduire une obligation de préserver le statut des citoyens de l’UE dans le Royaume-Uni post-Brexit et obliger le gouvernement à obtenir l’assentiment du Parlement à l’accord négocié avec l’UE une fois celui-ci (éventuellement) conclu.
Cette notification a eu deux effets.
Le premier, qui justifie le titre de cette contribution, est d’avoir enclenché, conformément à l’article 50 du TUE[5] qui constitue depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne[6] le 1er décembre 2009 la base juridique du droit de retrait des États membres, un compte à rebours de deux ans à l’issue duquel les traités européens (et l’ensemble du droit qui en découle) cesseront de s’appliquer au Royaume-Uni – autre façon de dire que le Royaume-Uni cessera d’être membre de l'UE. Ce délai de deux ans peut être raccourci si l'UE parvient, avant cette échéance, à conclure avec le Royaume-Uni un accord fixant les modalités de son retrait : c’est alors à la date d’entrée en vigueur dudit accord que le Royaume-Uni cessera d’être membre de l’UE. Ce délai peut en outre être prorogé, mais les conditions d’une telle prorogation la rendent assez peu vraisemblable : elle requiert en effet une décision unanime du Conseil européen en accord avec le Royaume-Uni.
Le deuxième effet de la notification est l’ouverture des négociations entre l’UE et le Royaume-Uni quant aux modalités du retrait de ce dernier. Il résulte en effet de la lecture cursive de l’article 50 du TUE que ces négociations ne peuvent être ouvertes qu’une fois cette notification accomplie. En tout état de cause, et quelle qu’en soit la véracité juridique, le mot d’ordre « pas de négociation sans ratification » s’est rapidement imposé comme une ligne politique pour la Commission européenne, empêchant ainsi le Royaume-Uni de se rajouter du « temps de négociation » en dehors du temps du compte à rebours. Ces négociations sont, bien sûr, cruciales : de leur issue dépendent les relations (ou l’absence de relations), tant économiques qu’extra-économiques, qui existeront entre l’UE et le Royaume-Uni après la sortie effective de ce dernier de l'UE.
Conformément à l’article 50 du TUE, qui renvoie en partie sur ce point à l'article 218, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne[7] relatif à l’ouverture des négociations d’un accord entre l’UE et un État tiers ou une organisation internationale, l’ouverture des négociations du Brexit se fit en trois temps. D’abord, le 29 avril 2017, le Conseil européen, regroupant les chefs d’États et de gouvernements des États membres adopta des « orientations[8] », cadre général fixant la position de l’UE relativement à la négociation. Puis, le 3 mai 2017, la Commission européenne a adressé une recommandation au Conseil[9], lequel peu de temps après, le 22 mai, autorisa l’ouverture des négociations, adopta les directives de négociations et désigna la Commission européenne comme négociateur. Conformément au souhait émis dès le 15 décembre 2016 lors d’une réunion informelle des chefs d'État ou de gouvernement de vingt-sept États membres ainsi que des présidents du Conseil européen et de la Commission européenne, l’ancien commissaire européen Michel Barnier fut désigné négociateur en chef. Les négociations sont organisées en « cycles » prévus en principe toutes les quatre semaines. Le négociateur en chef a par ailleurs adopté, conformément aux orientations du Conseil européen, une politique de transparence maximale : les « exposés de position » (« position papers ») de l’UE et les rencontres des négociateurs avec des parties prenantes sont toutes publiées sur le site de la Commission européenne[10]. Toute négociation parallèle (et a fortiori tout accord bilatéral) est interdite entre un État membre et le Royaume-Uni « sur des points entrant dans le champ d’application de l’accord de retrait ou produisant des effets sur la future relation de l’Union européenne[11] ».
Le Parlement européen n’est pas impliqué formellement dans la phase de négociations. Cependant, dans la mesure où il doit approuver l’accord de retrait – ainsi que, très probablement, l’accord définitif[12] – sa position doit être prise en compte par le négociateur. Le Parlement européen a d’ailleurs son propre « M. Brexit », en la personne de Guy Verhofstadt, ancien Premier ministre de la Belgique, député européen et président du groupe parlementaire Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe (ADLE), et a fait connaitre sa position dans une résolution du 5 avril 2017[13].
Ces positions de négociation adoptées par les différentes institutions de l’UE sont remarquablement cohérentes. Par conséquent, de manière générale, dans les lignes qui suivent, ces différents textes seront utilisés pour identifier la position de « l’Union européenne », prise dans son ensemble et de manière indifférenciée. Ce ne sera donc que lorsque telle ou telle institution a adopté une position plus spécifique ou détaillée sur un point donné qu’il en sera, le cas échéant, fait explicitement état. Par ailleurs, les lignes qui suivent ne font qu’analyser la position de l’UE et les accords de principe qui ont été arrêtés (notamment celui du 15 décembre 2017) telle qu’ils se présentent à l’heure où lesdites lignes sont écrites[14], sans préjudice donc des évolutions à venir.
En se basant sur la structure des orientations du Conseil européen, la présente analyse sera découpée en trois parties. Seront tout d’abord présentés les principes généraux de la négociation (I). Puis, seront présentés, sans exhaustivité, les principaux éléments de l’accord de retrait sur lesquels, à ce jour, le Royaume-Uni et l’UE sont tombés d’accord (II). Enfin, la position de l’UE relativement au futur accord relatif aux relations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni sera présenté de façon plus brève, eu égard au fait que les négociations sur ce dernier n’ont pas encore commencé (III).
I. Les principes généraux posés par l’Union européenne pour la négociation du Brexit
A. Une négociation « holistique »
L’un des éléments fondamentaux de la position de l’UE est son caractère, pourrait-on dire, « holistique ». Les orientations du Conseil européen[15] excluent en effet toute approche sectorielle ainsi que l’éventualité d’accords partiels (« on n’est d’accord sur rien tant qu’on n’est pas d’accord sur tout »). Elles réaffirment aussi l’indivisibilité des quatre libertés économiques fondamentales (libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux) et excluent un choix « à la carte » (« cherry-picking »).
Il faut probablement insister sur la fermeté d’une telle approche. Le Gouvernement britannique a économiquement intérêt à préserver, entre lui et l’UE, le principe de libre prestation de services, qui bénéficie à son principal secteur économique, les services financiers. La perte du bénéfice de ce principe entraînera en effet par voie de conséquence la fin du « passeport financier européen » qui permet à toute entreprise proposant légalement des services financiers dans un État membre de les proposer sur l’ensemble du territoire de l’Union[16]. En revanche, la libre circulation des travailleurs est une ligne rouge pour le gouvernement britannique. Elle était déjà l’un des cibles du mort-né « nouvel arrangement pour le Royaume-Uni dans l’Union européenne[17] », négocié par David Cameron à Bruxelles les 18 et 19 février 2016 pour convaincre le peuple britannique de voter en faveur du maintien dans l’UE. Cet "arrangement" prévoyait en effet la mise en place d’un mécanisme dit de « frein d’urgence » permettant à tout État membre, en contradiction avec le principe de non-discrimination en raison de la nationalité découlant des articles 18 et 45(2) du TFUE[18], de suspendre les prestations sociales versées aux travailleurs européens pendant un certain temps. Le referendum a encore durci cette position : la victoire du camp du retrait, corrélé avec une campagne en partie portée par les thèmes xénophobes du parti pour l’indépendance du Royaume-Uni (UKIP) a convaincu le gouvernement britannique d’adopter une ligne dure en la matière. Ce sont principalement les citoyens des États membres ayant adhéré depuis 2004 qui sont visés, la communauté polonaise étant la plus importante communauté étrangère du Royaume-Uni[19]. L’approche holistique exclut cependant que le gouvernement britannique puisse, pour reprendre une formule qui est devenue dans les médias le symbole du caractère irréaliste des exigences britanniques, à la fois avoir du gâteau et le manger (« have a cake and eat it » - équivalent britannique de l’expression française « vouloir le beurre et l’argent du beurre »).
B. Deux accords (au moins) pour un divorce
En vertu de l’article 50(2) du TUE, « l'Union négocie et conclut avec [l’État qui se retire] un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l'Union[20] ». La formule est quelque peu sibylline. Les « modalités du retrait » et les « relations futures » semblent être distinctes, mais font-elles nécessairement l’objet de deux accords distincts, voire plus[21]? Et si oui, peuvent-ils être négociés parallèlement? Cette question fondamentale fait l’objet d’une réponse claire dans tous les documents fixant la position de l’UE. D’une part, l’accord sur le retrait et l’accord sur les relations futures sont distincts l’un de l’autre. D'autre part, l’accord (ou les accords) sur les relations futures ne peu(ven)t commencer à être négocié(s) (et, a fortiori, conclu(s)) que dans une seconde phase de négociations sous l’empire de l’article 50. Cette seconde phase ne pouvait démarrer qu'une fois que des progrès « suffisants[22] » ou « substantiels[23] » auraient été accomplis dans la première phase de négociation de l’accord de retrait. Le Conseil européen a constaté le 15 décembre 2017 que ces progrès « suffisants » ont été accomplis concernant les points les plus sensibles de l’accord de retrait[24]. Sont cependant à ce jour encore en discussion les mesures transitoires, la gouvernance, le règlement des différends, un certain nombre de points techniques de l’accord de retrait, sa formalisation juridique et, surtout, le Protocole sur l'Irlande du Nord.[25]
La pluralité d’accords implique une pluralité de bases juridiques. L’accord « de retrait », s’il est conclu, le sera sur la base de l’article 50(2) du TUE[26]. Les modalités de conclusion en sont (relativement) simples et claires : cet accord doit être conclu à la majorité qualifiée du Conseil (moins le Royaume-Uni), après approbation du Parlement européen, mais, a priori, sans nécessité de ratification par les États membres[27]. En revanche, dans la mesure où en vertu de l’article 50 du TUE, la conclusion de l’accord de retrait « transforme » immédiatement l’État membre se retirant en État tiers, le ou les accords régissant les « relations futures » entre l’UE et le Royaume-Uni ne saurai(en)t être conclu(s) que sur la base de l’article 207 du TFUE[28], pour les aspects purement commerciaux, ou, pour les aspects excédant les seules relations commerciales, sur la base de l’article 218 TFUE[29] qui constitue la base juridique de droit commun pour la conclusion des accords internationaux entre l’UE et les États tiers. Or, les modalités de conclusions de tels accords dépendent de leur contenu. Ainsi, en vertu de l’article 218(8) du TFUE, si le Conseil statue normalement à la majorité qualifiée à tous les stades de la procédure (y compris, donc, la conclusion de l’accord), il statue en revanche à l'unanimité lorsque l'accord porte sur un domaine pour lequel l'unanimité est requise pour l'adoption d'un acte de l'UE. Selon l’article 218(6) du TFUE, le Parlement européen doit approuver au préalable la conclusion d’un certain nombre d’accords, en particulier les accords créant un cadre institutionnel spécifique en organisant des procédures de coopération, les accords ayant des implications budgétaires notables pour l'UE et les accords couvrant des domaines auxquels s'applique la procédure législative ordinaire ou la procédure législative spéciale lorsque l'approbation du Parlement européen est requise. Il est tout à fait improbable que l’accord « relations futures », ou l’un au moins d’entre eux, ne relève pas d’au moins une de ces catégories. Enfin, une ratification par l’ensemble des États membres est nécessaire dès lors que l’accord ne relève pas des compétences exclusives de l’UE, ce qui dépend de son contenu exact. En d’autres termes, la conclusion soit de l’accord « relations futures », en cas d’accord unique, soit de certains des accords régissant ces « relations futures », s’il y en a plusieurs, sera vraisemblablement plus complexe et plus longue que celle de l’accord « de retrait », et en toute hypothèse ne peut guère être déterminée à l’avance dans la mesure où les modalités de conclusion sont essentiellement tributaires du contenu de l’accord.
Pour cette raison, il y a un intérêt certain à ce que les négociations relatives aux « relations futures » commencent le plus tôt possible. Or, bien que le Conseil européen ait constaté des « progrès suffisants » le 15 décembre 2017, il reste encore à trancher un certain nombre de questions et à formaliser juridiquement l’accord de principe trouvé en décembre (la Commission a publié à ce titre un projet d’accord de retrait de 120 pages le 28 février 2018[30]). A moins que des discussions informelles n’aient été entamées, rien n’indique que les négociations de l’accord « relations futures » aient été amorcées. Il est donc extrêmement improbable qu’un accord « relations futures » puisse entrer en vigueur immédiatement après l’entrée en vigueur du (potentiel) accord de retrait. La "période transitoire" que devrait contenir l’accord de retrait[31] serait donc d’une très grande importance, car elle régirait les relations entre le Royaume-Uni et l'UE dans l’intervalle de temps séparant l’entrée en vigueur de l’accord de retrait de celle de l’accord ou des accords « relations futures ». Ledit accord en devient donc d’une importance cruciale. En adoptant cette politique des deux accords à négociations semi-successives, l’UE se met donc une pression – et, surtout, met la pression sur le Royaume-Uni – en vue d’arriver au plus vite à un accord, en pariant probablement sur sa position de force dans la négociation pour imposer ses vues.
C. La période transitoire
Pour les raisons qui viennent d’être énoncées, l’UE a envisagé dès le début des négociations la possibilité d’adopter un certain nombre de « mesures transitoires », qui seraient incluses dans l’accord de retrait et qui auraient pour but principal de régir les relations entre l’UE et le Royaume-Uni entre l’entrée en vigueur de l’accord de retrait (et donc, en vertu de l’article 50 du TUE[32], la sortie effective du Royaume-Uni de l’UE) et l’entrée en vigueur de l’accord « relations futures ». Ces mesures doivent être limitées dans le temps et délimitées dans leur champ d’application. Ce point est assez évident : l’accord de retrait ne saurait prolonger sine die au profit du Royaume-Uni un statut d’État membre Canada Dry, conformément à la position de principe fondamentale selon laquelle un État non-membre ne saurait bénéficier du même statut qu’un État membre. Une assez large marge d’appréciation est cependant laissée au négociateur (donc à la Commission européenne) en ce qui concerne la durée et le champ d’application exact desdites mesures. Notons toutefois que le Parlement européen a quant à lui précisé que la durée des mesures transitoires ne saurait excéder trois ans[33].
Depuis lors, et probablement consciente de ce que l’horloge tournait, la Première ministre britannique Theresa May s’est ralliée à cette option d’une période transitoire dans son discours de Florence du 22 septembre 2017[34]. La Commission européenne a publié le 7 février 2018 une proposition[35] contenant les articles qui pourraient constituer dans l’accord final la partie « Transition » (Partie IV dans le projet d’accord transitoire publié par la Commission le 28 février 2018[36]). Notons ici que ces dispositions sont toujours en discussion et n’ont pas encore fait l’objet d’un accord. La durée même de la transition ne fait pas consensus : l’UE propose de la faire durer jusqu’au 31 décembre 2020 (date de fin de la programmation financière pluriannuelle en cours) alors que le Royaume-Uni préférerait une date plus éloignée, voire une période de transition flexible, c’est-à-dire couvrant toute la durée nécessaire pour mettre en oeuvre « the new processes and new systems that will underpin the future partnership[37] » entre l’UE et le Royaume-Uni.
Le principe de cette période transitoire est relativement simple : pour toute la durée de la transition, le droit de l’UE continuerait de s’appliquer au Royaume-Uni, bien qu’il ait cessé d’être membre. Le Royaume-Uni resterait donc soumis à l’ensemble du droit de l’UE, y compris l’honnie libre circulation des personnes et la toute aussi honnie juridiction de la Cour de justice. Le Royaume-Uni perdrait en revanche dès sa sortie effective de l’UE ses droits de participation aux institutions de l’UE – de sorte que le Royaume-Uni serait lié par toute législation de l’UE adoptée pendant la période transitoire sans avoir pu participer à son adoption. De même, les citoyens britanniques demeureraient pour la durée de la transition des citoyens européens, avec cependant des droits diminués car ils perdraient eux aussi leurs droits de participation (élections européennes, élections municipales et initiative citoyenne européenne). Il est également prévu que le Royaume-Uni resterait lié par les accords internationaux de l’UE, en tout cas du point de vue de l’UE : d’un strict point de vue de droit international, il est loin d’être certain que les tiers seraient toujours liés au Royaume-Uni post-Brexit par les accords internationaux qui les lient à l’UE. Pendant la durée de la transition, le Royaume-Uni ne pourrait pas se lier avec des tiers par des accords internationaux qui relèvent de la compétence exclusive de l’UE sans l’autorisation de l’UE. Le Royaume-Uni pourrait cependant, sans autorisation de l’UE, négocier librement de tels accords, et même se lier par des accords ne relevant pas de la compétence exclusive de l’UE.
Le point le plus contentieux concernant la période transitoire, qui fait par ailleurs l’objet d’un consensus sinon total du moins global, est le pouvoir que l’UE désire s’arroger de suspendre certains bénéfices découlant, pour le Royaume-Uni, de sa participation au marché intérieur si l’UE venait à considérer qu’une saisine de la Cour de justice ne permettrait pas de remédier à la situation en temps utile. Cette proposition, initialement présentée dans une simple note de bas de page (n° 4) de l’exposé de position (« position paper ») de la Commission du 7 février 2018 relatif aux mesures transitoires de l’accord de retrait[38] a soulevé de vives protestations de la part des conservateurs britanniques[39]. Elle est formalisée à l’article 165 du projet d’accord de retrait publié par la Commission le 28 février 2018[40]. Cette suspension y est présentée comme la conséquence possible d’une inexécution, par le Royaume-Uni, d’un arrêt en manquement ou d’une mesure provisoire de la Cour de justice. Il est précisé que l’UE devrait, si elle devait adopter une telle mesure, prendre en compte les conséquences d’une telle suspension pour les personnes privées et que la suspension, d’une durée de trois mois renouvelables, devrait être proportionnée à la violation du droit de l’UE. L’UE devrait signifier son intention d’adopter une mesure de suspension vingt jours à l’avance pour laisser le temps au Royaume-Uni de remédier à la situation – ce qui donne à penser que cette suspension serait une mesure coercitive plus qu’une sanction. Il semble que ce pouvoir de suspension serait, pendant la période de transition, une « alternative » à la procédure de manquement sur manquement de l’article 260 TFUE[41]. La Commission semble craindre que la perspective d’une telle procédure, qui risquerait fort de ne pas arriver à son terme avant la fin de la période transitoire, ne serait pas suffisamment dissuasive pour inciter le Royaume-Uni à respecter ses obligations. Il y a fort à parier que ce mécanisme fera l’objet d’âpres discussions.
II. L’accord de principe de décembre 2017 entre le Royaume-Uni et l’Union européenne sur les points fondamentaux de l’accord portant arrangement pour un « retrait ordonné » du Royaume-Uni
Comme il a été dit plus haut, le Conseil européen a, le 15 décembre 2017, constaté l’existence de « progrès suffisants[42] » (et donc un accord de principe entre Royaume-Uni et l'UE) sur certains points clés de l’accord de retrait. Ces points fondamentaux, présentés dans un rapport joint du 8 décembre 2017[43], sont le règlement du statut des citoyens (A), le règlement financier du retrait (la « facture ») (B) et la frontière irlandaise (C). Notons toutefois, d’une part, que d’autres aspects de l’accord restent à déterminer définitivement (notamment un certain nombre de questions de droit transitoire, ainsi que la fameuse période transitoire[44], et la question sensible du règlement des différends). D’autre part, cet accord de principe n’est pas toujours exempt d’ambiguïtés, de sorte que leur formalisation juridique ne sera pas aisée et a déjà commencé à raviver certains débats. À ce jour, l’accord « de principe » de décembre n’est donc que cela : un accord de principe, et en aucun cas un accord juridiquement contraignant ou même doté du moindre effet juridique.
A. Le règlement du statut des citoyens
De manière claire, explicite et univoque, l’UE a donné dès le début priorité au règlement du statut des citoyens, qu’elle considère comme un préalable à toute autre discussion. Il s’agit de sécuriser la situation des citoyens de l’UE qui ont émigré au Royaume-Uni et y ont construit une vie, dans l’espérance légitime que leur statut migratoire continuerait d’être protégé par le droit de l’UE, et réciproquement celle des citoyens britanniques qui ont émigré dans l’UE. L’UE a donc souhaité donner des garanties juridiquement contraignantes fondées sur les principes de réciprocité, d’équité, de symétrie et de non-discrimination. Globalement, les discussions sur ce point avec le Royaume-Uni n’ont pas soulevé de graves problèmes, le gouvernement britannique ayant tout autant intérêt à protéger ses citoyens résidant dans l’UE.
Il résulte de l’accord de principe trouvé entre l’UE et le Royaume-Uni au moins de décembre que le champ d’application personnel des mesures relatives aux citoyens est calqué sur le droit de l’UE, et en particulier la Directive 2004/38/CE[45]. Les bénéficiaires de droits seraient alors non seulement les citoyens de l’UE économiquement actifs, mais également les citoyens inactifs et les membres de la famille des citoyens de l’UE, fussent-ils ressortissants d’États tiers.
Les droits garantis seraient également les droits protégés par la législation de l’UE, notamment le droit de séjour (y compris le droit permanent acquis au bout de cinq ans de résidence ininterrompue), la portabilité des droits de sécurité sociale, la libre circulation des travailleurs salariés et indépendants et la reconnaissance des diplômes et qualifications. D’autres questions restent en suspens, notamment celle de savoir si les citoyens britanniques résidant sur le territoire d’un État membre de l’UE bénéficieront du droit d’entrer, de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire des autres États membres. Le projet d’accord publié par la Commission le 28 février 2018 ne comprend pas, en tout cas, un tel droit[46].
L’État hôte pourra conditionner le bénéfice de ces droits à la possession d’une attestation de résidence, mais cette possibilité (que jusqu’à présent seul le Royaume-Uni a manifesté le souhait d’utiliser) est conditionnée de façon à ne pas occasionner pour les citoyens concernés, le cas échéant, une charge administrative excessive.
Le principe retenu est celui d’une cristallisation des droits, pour toute la durée de la vie des personnes concernées, sauf si elles venaient à ne plus remplir les conditions prévues pour la possession des droits en question. La cristallisation bénéficierait non seulement aux résidents, mais également aux citoyens de « l’UE-27 » (c’est-à-dire de l’UE moins le Royaume-Uni) qui travaillent ou ont travaillé au Royaume-Uni à la date de cristallisation, bien que résidant sur le territoire de l’UE-27, et vice-versa. Cela soulève deux questions.
La première est celle du moment de la cristallisation. C’est là encore un point contentieux entre l’UE et le Royaume-Uni. En effet, l’UE souhaite retenir la date de fin de la période transitoire, alors que le Royaume-Uni souhaite retenir la date de sortie effective du Royaume-Uni en arguant, non sans raison, qu’à partir de cette date il est raisonnable de considérer que les attentes de citoyens migrant entre le Royaume-Uni et l’UE ne sauraient être les mêmes que celles des citoyens qui y ont migré à une époque où ils pouvaient nourrir une espérance légitime que leur situation migratoire serait garantie indéfiniment.
La deuxième question posée par cette cristallisation est celle des droits en cours d’obtention (par exemple le droit de résidence permanente au bout de cinq ans de résidence ininterrompue) et les droits dont la jouissance n’interviendra qu’à une date future, comme les droits à pension de retraite. Le rapport joint du 8 décembre 2017 formalisant l’accord de principe prévoit ici que ces droits en cours d’acquisition sont également couverts : c’est ainsi, par exemple, que le calcul de la période de cinq ans ininterrompus de résidence pour obtenir le droit de résidence permanente doit inclure les périodes de résidence postérieures à la date de cristallisation (date de retrait du Royaume-Uni ou date de fin de la période transitoire, selon l’accord qui sera trouvé).
Le rapport joint formalisant l’accord de principe de décembre 2017 prévoit que les citoyens devraient pouvoir se prévaloir directement des droits découlant de l’accord de retrait, y compris contre des dispositions nationales contraires. Ces droits seraient donc, en d’autres termes, d’effet direct et dotés de la même primauté que celle dont est doté le droit de l’UE. Les juges britanniques devraient respecter la jurisprudence de la Cour de justice pré-Brexit, et « tenir dûment compte » (« having due regard ») de la jurisprudence post-Brexit. Ces mêmes juges pourraient continuer de poser une question préjudicielle en interprétation des dispositions relatives aux droits des citoyens à la Cour de justice de l’UE à l’occasion de tout litige initié dans les huit ans à compter de la fin de la période transitoire. Par ailleurs, le Royaume-Uni devrait se doter d’une autorité indépendante chargée de veiller à l’application de la partie de l’accord de retrait concernant les droits des citoyens. Conçue comme un équivalent « national » de la Commission européenne prise en son rôle de gardienne des traités, elle aurait, selon l’article 152 du projet d’accord de retrait publié par la Commission le 28 février 2018[47], le pouvoir d’instruire des plaintes et de conduire des enquêtes de sa propre autorité sur le respect de ces dispositions par le Royaume-Uni, de publier ses conclusions et, éventuellement, de saisir la justice britannique, en liaison avec la Commission européenne.
B. Le règlement financier (la « facture »)
L’UE et le Royaume-Uni doivent tous les deux respecter les obligations financières résultant de la période durant laquelle le Royaume-Uni a été membre de l’UE. L’accord de retrait doit dès lors prévoir un « règlement financier » permettant de liquider lesdites obligations.
Le principe même de la « facture » n’est pas allé de soi. Politiquement, l’acceptation du principe d’une telle facture était en effet risquée pour le Gouvernement britannique. La question de la contribution du Royaume-Uni au budget de l’UE a en effet été un élément important de la campagne en faveur du retrait du Royaume-Uni de l’UE. On se souvient en particulier du bus rouge, affrété par la plate-forme officielle de campagne en faveur du Brexit et vu un peu partout au Royaume-Uni, sur lequel était inscrit en grandes lettres blanches que celui-ci donnait chaque semaine 350 millions de livres sterling à l’UE, lesquels pourraient être mieux employés au profit du système britannique d’assurance maladie (National Health Service (NHS)). Ce chiffre était tout à fait fallacieux[48], puisqu’il ne prenait en compte ni les subventions européennes perçues par le Royaume-Uni, ni le rabais dont ce dernier bénéficie depuis 1985[49], mais il illustrait bien un refus catégorique de toute solidarité budgétaire avec les « cigales » continentales. On pouvait dès lors estimer qu’il serait difficile pour le Gouvernement britannique de faire accepter à la population que la nouvelle ère de renationalisation budgétaire qu’ouvre le Brexit soit au prix d’une facture adressée au contribuable britannique. Il aura fallu attendre le 13 juillet 2017 pour que le gouvernement britannique, en la personne de David Davis, secrétaire d’État britannique au Brexit, reconnaisse que « the U.K. has obligations to the EU, and the EU obligations to the U.K., that will survive the U.K.’s withdrawal – and that these need to be resolved[50] ».
L’accord de principe de décembre, mis en forme par le projet d’accord de retrait publié par la Commission européenne, pose non pas un chiffre mais la méthodologie à retenir pour calculer la « facture ».
Il faut ici distinguer la période transitoire de la période « post-transition ». Durant la période transitoire, le Royaume-Uni continuerait de contribuer au même titre qu’un État membre, étant précisé cependant qu’aucune modification du cadre financier de l’UE (notamment le cadre financier pluriannuel et les ressources propres) adoptée postérieurement au début de la période transitoire (c’est-à-dire après que le Royaume-Uni aura perdu son droit de participer aux décisions de l’UE) ne s’appliquerait au Royaume-Uni.
Pour la facture proprement dite, c’est-à-dire le règlement financier hors période transitoire, les deux points importants sont, d’une part, la détermination des obligations qui doivent être prises en compte et, d’autre part, la détermination du ratio incombant au Royaume-Uni quant à ces obligations.
Pour la première question, l’accord de décembre inclut notamment comme bases de calcul :
-
le reste à liquider des programmations financières pluriannuelles (budgets de moyen terme de l’Union) successives pour toute la période durant laquelle le Royaume-Uni a été membre de l’Union;
-
les pensions de retraites et autres avantages financiers du personnel de l’UE;
-
les différentes provisions engagées par l’UE (par exemple celles nécessaire au démantèlement des installations nucléaires du Centre commun de recherche);
-
les passifs financiers hors emprunts;
-
les créditeurs et charges à payer autres que le reste à liquider (par exemple les ressources propres restant à payer);
-
les amendes éventuellement dues par le Royaume-Uni à la fin de la période transitoire;
-
les passifs éventuels résultant des comptes annuels consolidés.
Quant au ratio supporté par le Royaume-Uni sur ces sommes, le rapport joint formalisant l’accord de principe du mois de décembre le définit comme étant le ratio entre l’ensemble des ressources propres transférées par le Royaume-Uni au budget de l’UE et le total des ressources propres transférées par l’ensemble des États membres sur la période 2014-2020. Ce mode de calcul est assez sévère pour le Royaume-Uni, puisqu’il appliquera un ratio mécaniquement élevé (le Royaume-Uni étant un contributeur brut important) sur une base large.
Enfin, le paiement serait libellé en euros, mettant le risque de change à la charge du Royaume-Uni.
C. La frontière irlandaise
Il existe depuis 1923 une zone commune de voyage entre la République d’Irlande et le Royaume-Uni (elle inclut aussi l'île de Man, Jersey et Guernesey). Les frontières internes de cette zone font l’objet d’un contrôle réduit – voire pas de contrôle du tout, le franchissement de la frontière entre Royaume-Uni et Irlande étant en pratique proprement imperceptible – et peuvent normalement être franchies par tout citoyen britannique ou irlandais muni de simples documents d’identité. L’existence de cette zone assure une continuité de l’île d’Irlande et une libre circulation en son sein, malgré la partition de l’île entre République d’Éire et Royaume-Uni. Cependant, le retrait du Royaume-Uni de l’UE affectera nécessairement cette situation puisque ce retrait fera de la frontière irlandaise une frontière extérieure de l’UE.
Certes, ni le Royaume-Uni ni la République d’Irlande ne font partie de l’espace Schengen, au sein duquel les frontières sont abolies. Il en résulte que la République d’Irlande ne sera pas tenue de rétablir des contrôles aux frontières puisque la frontière irlandaise ne deviendra pas une frontière extérieure de l’espace Schengen[51]. Elle deviendra, en revanche, une frontière extérieure au sens de l’UE douanière. L’administration douanière irlandaise sera donc, à cette frontière, chargée de la surveillance du commerce international de l'UE[52] (incluant le commerce avec le Royaume-Uni) afin notamment de s’assurer que les marchandises importées dans l’UE s’acquittent bien du tarif douanier commun et de procéder aux contrôles sanitaires exigés par la réglementation de l’UE. D’une façon ou d’une autre, par conséquent, un certain degré de contrôle douanier devra être exercé à la frontière irlandaise.
La sensibilité de la question est reconnue tant par l’UE que par le Royaume-Uni. L’Irlande du Nord – qui, incidemment, a voté majoritairement pour le maintien dans l’UE lors du referendum – est en paix avec le reste du Royaume-Uni depuis les accords du Vendredi saint du 10 avril 1998. Mais cette paix est récente et, ne serait-ce qu’à ce titre, fragile. La perspective d’une frontière irlandaise « dure » pourrait raviver les tensions entre républicains et unionistes. L’UE a donc toujours estimé qu’il fallait s’employer à trouver des solutions « flexibles et imaginatives » pour empêcher une telle frontière dure. Ces solutions pourraient impliquer le recours aux nouvelles technologies pour suivre les véhicules transportant des marchandises (évitant ainsi un contrôle physique à la frontière) ou encore la détermination de transporteurs « de confiance[53] ».
C’est probablement sur ce point que l’accord de principe de décembre est le plus flou. Toutes les parties s’accordent sur la nécessité de prendre en compte les circonstances uniques de la frontière irlandaises, de préserver les principes de l’accord du vendredi saint et d’éviter tout rétablissement d’une frontière « dure ». Force est pourtant de constater qu’aucune solution concrète n’est présentée – ce point, et en particulier la responsabilité d’articuler les fameuses solutions « flexibles et imaginatives » étant laissée en réalité au Royaume-Uni. Si le Royaume-Uni et l’UE échouaient à s’accorder sur de telles solutions, le Royaume-Uni s’engage, dans le rapport joint qui formalise l’accord de principe de décembre, à « maintenir un plein alignement avec celles des règles du marché intérieur et de l’Union douanière qui, maintenant et dans le futur, sous-tendent la coopération Nord-Sud, l’économie de l’île dans son ensemble et l’accord de 1998 » [notre traduction][54]. Le Royaume-Uni semble donc envisager, comme scénario du pire, un alignement réglementaire unilatéral sur la réglementation de l’UE pour éviter le rétablissement de contrôles douaniers.
Le caractère extrêmement vague et, pour tout dire, procrastinateur de l’accord de décembre sur ce point devait fatalement conduire à une résurgence des tensions à un moment. Ce fut chose faite lorsque, dans son projet d’accord de retrait du 28 février 2018, la Commission proposa la mise en place d’un espace réglementaire commun entre l’UE et… la seule Irlande du Nord. Il ne s’agirait de rien de moins qu’une union douanière entre l’UE et l’Irlande du Nord, créant alors mécaniquement une frontière douanière interne au Royaume-Uni, entre l’Irlande du Nord et le reste du pays. Il va sans dire que cette option a été immédiatement rejetée avec la dernière fermeté par la Première ministre Theresa May[55].
III. La position de l’Union européenne concernant les « relations futures » avec le Royaume-Uni
Les négociations de cet accord n’ayant pas commencé, pour les raisons mentionnées précédemment[56], la position de l’UE sur ce point est nécessairement plus sommaire. L’on se contentera donc d’en exposer les points saillants.
Selon l’UE, l’accord sur les relations futures entre le Royaume-Uni et l’UE doit être, sur le plan économique, équitable et équilibré. Le leitmotiv, tel qu’il apparaît dès les orientations du Conseil européen, est que cet accord ne pourra pas donner au Royaume-Uni les mêmes avantages que l’appartenance à l’UE. Tant que le Royaume-Uni rejette la libre circulation des personnes, cet accord ne peut d’ailleurs pas étendre le marché intérieur au Royaume-Uni (à l’instar de ce que l’accord sur l’Espace économique européen fait vis-à-vis de l’Islande, du Liechtenstein et de la Norvège) puisque l’UE considère que les quatre libertés économiques qui fondent le marché intérieur (personnes, marchandises, capitaux et services) sont indivisibles. En l’état (mais les choses peuvent changer), c’est plutôt vers un accord de libre-échange que les négociations pourraient tendre.
Cet accord serait cependant vraisemblablement unique en son genre. Dans la période contemporaine, les accords de libre-échange négociés par l’UE contiennent toujours un volet de convergence réglementaire, destiné à assurer une certaine homogénéité du cadre juridique applicable, en particulier, aux biens, afin de s’assurer au maximum de ce qu’ils soient commercialisables légalement sur le territoire de chaque partie. C’est le cas de l’accord de libre-échange entre l’UE et le Canada, mais aussi de l’accord transatlantique entre l’UE et les États-Unis ou encore de l’accord de libre-échange avec Singapour, récemment examiné par la Cour de justice[57]. La situation est différente pour le Royaume-Uni. En tant que membre de l’UE, sa réglementation est déjà compatible avec la réglementation de l’UE. L’accord devra donc plutôt limiter les divergences réglementaires qui ne deviendront possible qu’à compter du retrait du Royaume-Uni ou à la fin de la période transitoire.
Une concurrence équilibrée implique également un environnement juridico-politique neutre. De ce point de vue, le Conseil européen, dans ses orientations, mentionne la nécessité d’inclure dans l’accord des garanties contre les avantages anticoncurrentiels, notamment en matière fiscale, sociale, environnementale et réglementaire[58], ainsi que des garanties pour la stabilité financière de l’UE et le respect des normes, règles et mécanismes de supervision qui y sont en vigueur en la matière[59] – autrement dit l’Union bancaire, mécanisme de surveillance des banques destiné à empêcher les faillites systémiques. Le Parlement européen va sur ce point plus loin dans sa résolution. Il ne se cantonne pas à exiger, pour résumer, des « mesures anti-dumping » mais estime que
tout accord futur entre l’Union Européenne et le Royaume-Uni est subordonné au respect par le Royaume-Uni des normes instaurées par les obligations internationales, dont les droits de l’homme, ainsi que la législation et les politiques de l’Union, notamment dans les domaines de l’environnement, du changement climatique, de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, de la concurrence loyale, du commerce et des droits sociaux, en particulier les mesures de protection contre le dumping social[60].
Il apparaît aussi dans les documents de négociation que la relation future entre le Royaume-Uni et l’UE ne se limitera pas à l’économie et au commerce. Le champ des domaines de coopération future change cependant d’une institution à l’autre. Dans ses orientations, le Conseil européen mentionne la lutte contre le terrorisme, la sécurité, la défense et la politique étrangère. Le Premier ministre Theresa May a elle aussi insisté sur ce point dans un discours du 17 février 2018[61], et le projet d’accord de retrait publié par la Commission le 28 février 2018[62] prévoit en son article 122(2) la possibilité d’une interruption anticipée de la période transitoire limitée aux seules questions de politique étrangère et de sécurité commune et de défense si un accord en la matière devenait applicable avant la fin de ladite période. Le Parlement européen mentionne la mobilité universitaire, et en particulier la mobilité étudiante (programme Erasmus). La coopération dans ces domaines sera probablement peu problématique, étant dans l’intérêt de toutes les parties. Ces domaines ne sont pas limitatifs : ainsi, Michel Barnier, dans un discours adressé au Comité des régions le 22 mars 2017, a-t-il également mentionné la recherche, le changement climatique et l’aide au développement. Le Parlement européen a cependant insisté sur le fait – probablement acceptable assez facilement par le Royaume-Uni, ne serait-ce que sur le principe – que ces différentes coopérations futures avec le Royaume-Uni doivent avoir pour contrepartie des contributions budgétaires appropriées, lorsque lesdites coopérations pèsent sur le budget de l’Union. Tous ces partenariats ne seraient cependant pas forcément inclus dans le même accord.
Si la position de l’UE est très ferme quant aux droits des citoyens qui auront déjà exercé leur liberté de circulation au moment du Brexit[63], elle est en revanche très effacée sur la question des droits futurs des citoyens – laquelle est, en réalité, très fortement liée au type de partenariat économique que l’UE conclura éventuellement avec le Royaume-Uni. Les orientations du Conseil européen n’en font pas mention. Seul le Parlement européen, dans sa résolution, prend note que :
de nombreux citoyens britanniques ont exprimé leur ferme opposition à la perte des droits dont ils bénéficient actuellement en vertu de l’article 20 du [TFUE et] propose que l’UE-27 examine la façon d’atténuer ce problème dans les limites du droit primaire de l’Union, tout en respectant pleinement les principes de réciprocité, d’équité, de symétrie et de non-discrimination[64]
Un autre aspect de la position de l’UE qui doit être signalée, ne serait-ce qu’eu égard aux réactions qu’elle a suscitées, concerne Gibraltar. Ce « caillou », d’une superficie inférieure à 7 km² et situé au sud de l’Espagne, a été conquis en 1704 par les forces anglo-hollandaises et l’amiral Rooke. En 1793, par l’article X du Traité d’Utrecht[65], Philippe d’Espagne a cédé à la reine Anne la pleine propriété sur la ville et le château, avec port, défense et forteresse. Depuis lors, Gibraltar fait l’objet d’une controverse territoriale récurrente entre le Royaume-Uni et l’Espagne. Cette dernière conteste la nature des droits dont dispose le Royaume-Uni sur Gibraltar (qui seraient, selon l’Espagne, de simples droits de propriété et non de souveraineté) et, surtout, la portée géographique du traité : la zone de l’aéroport de Gibraltar et les eaux territoriales sont au coeur de cette contestation. Le droit de l’UE a intégré cette controverse. C’est en raison de cette dernière que, par exemple, la législation de l’UE en matière de services aériens renvoie toujours aux arrangements conclus de manière bilatérale entre l’Espagne et le Royaume-Uni concernant l’aéroport de Gibraltar[66]. En effet, comme l’a affirmé la Cour de justice en 1993,
eu égard au différend […] opposant le royaume d’Espagne et le Royaume-Uni au sujet de la souveraineté sur le territoire où est situé l'aéroport de Gibraltar et aux difficultés d’exploitation qu’entraîne ce différend, le développement des services aériens entre cet aéroport et les autres aéroports de la Communauté est subordonné à la mise en application du régime de coopération convenu entre les deux États[67].
Dans ce contexte, il était assez naturel que les orientations du Conseil européen précisent que, lorsque le Royaume-Uni aura quitté l'UE, aucun accord entre l'UE et le Royaume-Uni ne pourra s'appliquer au territoire de Gibraltar sans accord entre le Royaume d'Espagne et le Royaume-Uni. Il n’en aura pourtant pas fallu davantage pour que, de façon aussi irresponsable qu’incendiaire, Michael Howard, ancien leader du parti conservateur, appelle à mots à peine couverts Theresa May à se préparer à une action militaire si cela s’avérait nécessaire pour protéger la population de Gibraltar contre l’Espagne[68]. Cette réaction va-t’en-guerre, dont le ridicule le dispute à l’excès, n’appelle aucun commentaire et ne mérite que l’oubli.
Enfin, un mécanisme de règlement des différends devra être instauré pour garantir la bonne application de l’accord. Ce point, comme pour l’accord de retrait, sera probablement l’objet de discussions et de controverses. Le Conseil européen n’a donné aucune précision, dans ses orientations, sur les caractéristiques de ce mécanisme, si ce n’est qu’il ne doit pas affecter l’autonomie de l’Union et en particulier ses procédures décisionnelles. Le Parlement européen va à peine plus loin en estimant que « si le Royaume-Uni demandait à participer à certains programmes de l’Union européenne, ce serait en tant que pays tiers, ce qui s’accompagnerait […] d’un contrôle exercé par la juridiction existante ». La question du mécanisme de règlement des différends risque cependant de s’avérer assez cruciale. Dans son Avis 2/15 du 16 mai 2017 relatif à l’accord de libre-échange avec Singapour[69], la Cour de justice a estimé que le mécanisme de règlement des différends prévu par cet accord, et en particulier le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États, ne relevait pas de la compétence exclusive de l’Union. Dans la mesure où un tel mécanisme soustrait des différends à la compétence juridictionnelle des États membres, ceux-ci doivent y consentir. Ce mécanisme est donc l’un des éléments qui nécessitent que cet accord soit ratifié par les États membres de l’Union. Une telle ratification retarde inévitablement l’entrée en vigueur de l’accord. Or, comme on l’a évoqué précédemment[70], eu égard au cadre de négociation imposé par l’UE, le facteur temps sera un élément primordial pour l’entrée en vigueur de l’accord sur les relations futures, sauf à accepter la perspective d’une rupture totale de toute relation économique et/ou juridique entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, soit lors du retrait effectif du Royaume-Uni (en l’absence d’accord de retrait) soit à échéance des mesures transitoires prévues par l’accord de retrait (si celui-ci est conclu et est contient). A minima, pour éviter une telle configuration, les négociateurs devront donc éviter tout mécanisme soustrayant des différends à la compétence des juridictions nationales.
***
La position de l’UE dans les négociations du Brexit, telle qu’elle se dessine à ce jour au regard des documents de négociation accessibles au public, présente deux caractéristiques essentielles. D’une part, elle est très cohérente. L’Union parle d’une seule voix, sans cacophonie interinstitutionnelle ou interétatique, et refuse de diviser les questions. D’autre part, elle est très ferme. Que ce soit la position de l’UE sur la séquence des négociations, la « facture », le refus d’intégrer les services dans la première phase de négociation ou encore le rôle dévolu post-Brexit aux institutions de l’UE et en particulier à la Cour de justice, l’UE semble bien décidée à dicter son agenda et à ne pas laisser le Brexit porter atteinte à l’autonomie de l’ordre juridique de l’UE. La position du Royaume-Uni, par contraste, est peu lisible et très contingente. L’accord de principe de décembre sur la « première phase » des négociations est un pas important, mais elle n’est qu’un pas, beaucoup d’autres restant à accomplir. Reste à voir comment les rapports de force évolueront dans cette négociation unique en son genre (en tout cas pour l’instant, et espérons pour longtemps) dont la pression est nécessairement accentuée par l’incessant « tic-tac » du compte à rebours vers le Brexit.
Appendices
Notes
-
[1]
Traité sur l'Union européenne (version consolidée), [2012] JO C 326/13, art 50 [TUE].
-
[2]
R (Miller) v Secretary of State for Exiting the European Union, [2016] EWHC 2768 (Admin).
-
[3]
R (Miller and another) v Secretary of State for Exiting the European Union, [2017] UKSC 5.
-
[4]
Bill 5, European Union (Withdrawal) Bill, sess 2017-2019, 2017 (sanctionné le 26 juin 2018: European Union (Withdrawal) Act 2018 (R-U), c 16).
-
[5]
TUE, supra note 1, art 50.
-
[6]
Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, 13 décembre 2007, 2702 RTNU 3 (entré en vigueur : 1er décembre 2009) [Traité de Lisbonne].
-
[7]
Version consolidée du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, [2012] JO, C 326/49, art 218(3) (entré en vigueur : 1er janvier 1958, modification 13 décembre 2007) [TFUE].
-
[8]
CE, Secrétariat général du Conseil, Note de transmission, Réunion extraordinaire du Conseil européen (article 50) (29 avril 2017) - Orientations, [2017] JO C XT 20004/17 [Les orientations du Conseil européen].
-
[9]
CE, Recommandation de Décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations en vue de la conclusion d'un accord avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord fixant les modalités du retrait de celui-ci de l'Union européenne, [2017] JO C 218 final.
-
[10]
CE, Négociations sur le Brexit : Processus et principes de négociation au titre de l'article 50 pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, en ligne : La Commission et ses priorités <ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations_fr>.
-
[11]
CE, Résolution du Parlement européen du 5 avril 2017 sur les négociations avec le Royaume-Uni après la notification de son intention de se retirer de l'Union européenne (2017/2593(RSP)), [2017] JO, C 298 au para 7 [Résolution du Parlement européen].
-
[12]
Voir la distinction entre ces deux accords et l’implication du Parlement européen, ci-dessous partie I-B.
-
[13]
Résolution du Parlement européen, supra note 11.
-
[14]
Le 28 février 2018.
-
[15]
Précitées, § 1.
-
[16]
CE, Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, [2013] JO, L 176/338.
-
[17]
CE, Un nouvel arrangement pour le Royaume-Uni dans l'Union européenne, [2016] JO C 69 I/1.
-
[18]
TFUE, supra note 7, arts 18, 45.
-
[19]
D’après l’observatoire des migrations de l’Université d’Oxford, la communauté polonaise constituait, en 2013 le groupe de nationaux étrangers le plus importants du Royaume-Uni (15% de l’ensemble des personnes de nationalité étrangère présentes sur le territoire) : Cinzia Rienzo et Carlos Vargas-Silva, « Briefing, Migrants in the UK : An Overview » 6e éd, en ligne : (2017) The Migration Observatory at the University of Oxford <migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/briefings/migrants-in-the-uk-an-overview/>.
-
[20]
TUE, supra note 1, art 50.
-
[21]
Dans un discours du 17 février 2018, le Premier ministre britannique Theresa May a insisté sur l’importance d’un traité entre l’UE et le Royaume-Uni sur les questions de sécurité. Voir Prime Minister's Office, 10 Downing Street et The Rt Hon Theresa May Prime Minister, « Prime Minister Theresa May's speech at the 2018 Munich Security Conference », GOV.UK (17 février 2018) [non publiée], en ligne : <www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-at-munich-security-conference-17-february-2018> [Prime Minister's office, « Speech at the Munich Security Conference »]. Le projet d’accord de retrait publié par la Commission le 28 février 2018 prévoit en son article 122(2) la possibilité d’une interruption anticipée de la période transitoire (voir infra) limitée aux seules questions de politique étrangère et de sécurité commune et de défense si un accord en la matière devenait applicable avant la fin de ladite période. Voir CE, Commission, Draft Withdrawal Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community, Commission to EU 27 (2018), en ligne : <ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_withdrawal_agreement.pdf> [CE, Draft Withdrawal Agreement].
-
[22]
Les orientations du Conseil européen, supra note 8 au point 4.
-
[23]
Résolution du 5 avril 2017, supra note 11 au point 14.
-
[24]
Les orientations du Conseil européen, supra note 8 au point 14. Voir la partie II, ci-dessous.
-
[25]
Voir ci-dessous partie II-C.
-
[26]
TUE, supra note 1, art 50(2).
-
[27]
Ce point est cependant incertain : en fonction du contenu de l’accord, il est envisageable qu’une ratification par les États membres selon leurs procédures constitutionnelles respectives soit nécessaire. Voir Hugo Flavier et Sébastien Platon, « Brexit: A Tale Of Two Agreements? » (30 août 2016), European Law Blog, News and comments on EU law (blogue), en ligne : <europeanlawblog.eu/2016/08/30/brexit-a-tale-of-two-agreements/>.
-
[28]
TFUE, supra note 7, art 207.
-
[29]
Ibid, art 218.
-
[30]
CE, Draft Withdrawal Agreement, supra note 20.
-
[31]
Voir ci-dessous partie I-C.
-
[32]
TUE, supra note 1, art 50.
-
[33]
Résolution du 5 avril 2017, supra note 11 au point 28.
-
[34]
Prime Minister's Office, 10 Downing Street, « PM's Florence speech: a new era of cooperation and partnership between the UK and the EU », GOV.UK (22 septembre 2017) en ligne : <www.gov.uk/government/speeches/pms-florence-speech-a-new-era-of-cooperation-and-partnership-between-the-uk-and-the-eu>.
-
[35]
CE; Transitional Arrangements in the Withdrawal Agreement, TF50 (2018) 30 – Commission to EU 27, en ligne : <ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/transition.pdf> [CE, Transitional Arrangements].
-
[36]
CE, Draft Withdrawal Agreement, supra note 21.
-
[37]
« The UK believes the Period’s duration should be determined simply by how long it will take to prepare and implement the new processes and new systems that will underpin the future partnership. The UK agrees this points to a period of around two years, but wishes to discuss with the EU the assessment that supports its proposed end date. ».Voir R-U, Department for Exiting the European Union, Draft Text For Discussion : Implementation Period , en ligne : (21 février 2018) à la p 2 <www.gov.uk/government/publications/draft-text-for-discussion-implementation-period>.
-
[38]
CE, Transitional Arrangements, supra note 35 à la p 6, n 4.
-
[39]
Voir notamment Jon Stone, « Brexit: EU Defends Plan to Impose Sanctions on Britain in Event of 'Foul Play' », The Independent (7 février 2018), en ligne : <www.independent.co.uk/news/uk/politics/ brexit-sanctions-agreement-talks-single-market-michel-barnier-theresa-may-a8198876.html>.
-
[40]
CE, Draft Withdrawal Agreement, supra note 20.
-
[41]
TFUE, supra note 7, art 260.
-
[42]
Les orientations du Conseil européen, supra note 8.
-
[43]
CE, Commission, Joint report from the negotiators of the European Union and the United Kingdom Government on progress during phase 1 of negotiations under Article 50 TEU on the United Kingdom's orderly withdrawal from the European Union, Commission to EU 27 (2018), en ligne : <ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/joint_report.pdf> [CE, Joint report from the negotiators].
-
[44]
Ibid.
-
[45]
CE, Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, [2004] JO, L 158 à la p 77.
-
[46]
CE, Draft Withdrawal Agreement, supra note 21.
-
[47]
Ibid, art 152.
-
[48]
En 2015, la contribution nette après rabais du Royaume-Uni était de 8,473 milliards de livres sterling, soit environ 163 millions de livres sterling par semaine. Voir R-U, HM Treasury et the RT Hon David Gauke MP, European Union finances 2015 : statement on the 2015 EU Budget and measures to counter fraud and financial mismanagement (Official Statistics), en ligne : décembre 2015 à la p 14 <www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/483344/EU_finances_2015_final_web_09122015.pdf>.
-
[49]
CE, Décision 85/257/CEE Euratom du Conseil du 7 mai 1985 relative au système des ressources propres des Communautés, [1985] JO, L128/1 (abrogée le 1ͤ ͬ janvier 1988) à la p 15.
-
[50]
« The government recognizes that the U.K. has obligations to the EU, and the EU obligations to the U.K., that will survive the U.K.’s withdrawal – and that these need to be resolved ». Voir Alex Morales, « Finally in writing: U.K. and EU will have "Financial Settlement" », Bloomberg (13 juillet 2017), en ligne : <www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-13/u-k-accepts-it-must-pay-brexit-bill-on-departing-european-union>.
-
[51]
CE, Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), [2016] JO, L77/1 à la p 1.
-
[52]
CE, Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (refonte), [2013] JO, L 269/1 à la p 1.
-
[53]
Voir ici le rapport du Gouvernement au Parlement britannique d’octobre 2017. R-U, Financial Secretary to the Treasury, Customs Bill: legislating for the UK’s future customs, VAT and excise regimes (Policy Paper), Londres, Her Majesty’s Stationery Office, 2017, en ligne : <www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/650459/customs_bill_white_paper_web.pdf>.
-
[54]
Voir CE, Joint report from the negotiators, supra note 43 au para 49.
-
[55]
« Theresa May rejects EU's draft option for Northern Ireland », BBC (28 février 2018), en ligne : <www.bbc.com/news/uk-politics-43224785>.
-
[56]
Voir la partie I-B, ci-dessus.
-
[57]
CJUE, Avis rendu en vertu de l'article 218, paragraphe 11, TFUE, C-2/15 [2017] (Recueil numérique) ECLI:EU:C:2017:376 [Avis 2/15 - Accord de libre-échange avec Singapour].
-
[58]
CE, Orientations - 29 avril 2017, [2017] EUCO XT 20004/17 au para 20.
-
[59]
CE, Orientations - 23 mars 2018, [2018] EUCO XT 20001/18 au para 12.
-
[60]
Résolution du Parlement européen, supra note 11.
-
[61]
Prime Minister's Office, « Speech at the Munich Security Conference », supra note 20.
-
[62]
CE, Draft Withdrawal Agreement, supra note 20.
-
[63]
Voir la Partie II-A, ci-dessus.
-
[64]
Résolution du Parlement européen, supra note 11 (27).
-
[65]
Treaty of Peace and Friendship between Great Britain and Spain, Espagne et Royaume-Uni, 13 juillet 1713, 1 British & Foreign State Papers 611, art X [Traité d'Utrecht].
-
[66]
Voir notamment CE, Règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte), [2008] JO, L 293/3, considérant 19; CE, Règlement (CE) n° 847/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la négociation et la mise en oeuvre d'accords relatifs à des services aériens entre les états membres et les pays tiers, [2004] JO, L 157/7, art 9, considérant 15; CE, Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, [2004] JO L 46/1, considérant 24, arts 1(2), 1(3); CE, Règlement (CE) n° 437/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne, [2003] JO, L 66/1, considérant 11, art 2.
-
[67]
CJCE, Government of Gibraltar c Conseil des Communautés européennes, C-298/89, [1993] ECR I-3648 au para 22.
-
[68]
Anushka Asthana, « Theresa May would go to war to protect Gibraltar, Michael Howard says », The Guardian (2 avril 2017), en ligne : <www.theguardian.com/politics/2017/apr/02/britain-and-eu-worse-off-without-brexit-deal-says-michael-fallon>.
-
[69]
CJUE, Avis 2/15 - Accord de libre-échange avec Singapour, supra note 57.
-
[70]
Voir la partie I-B, ci-dessus.