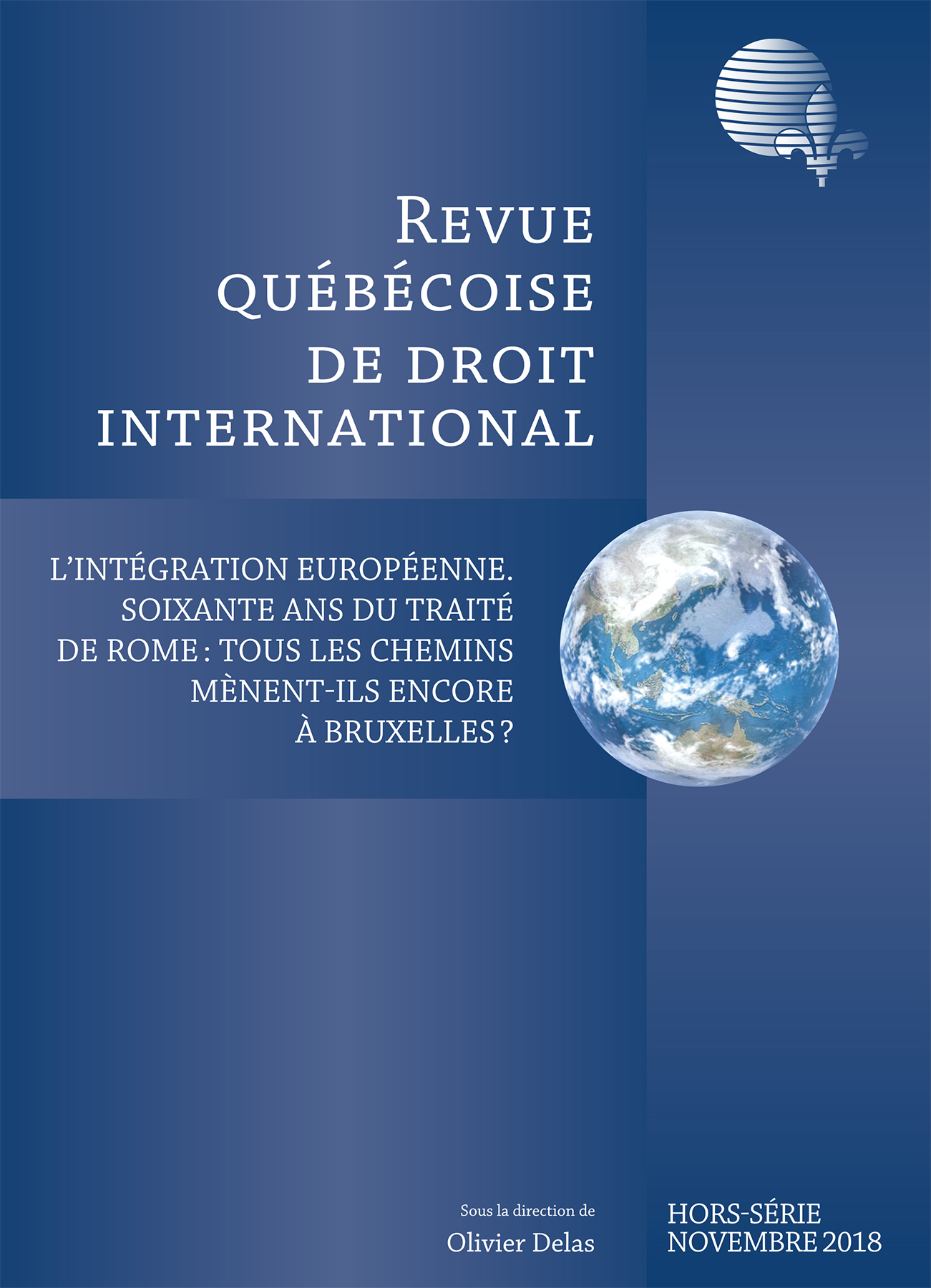Abstracts
Résumé
En raison de sa conception dualiste de l’application du droit international dans son ordre juridique interne, le Royaume-Uni s’est engagé dans deux procédures parallèles en vue de sa sortie de l’Union européenne. Sur la scène internationale, même s’il s’agit de la première notification par un État membre de sa volonté de quitter l’Union européenne sur le fondement de l’article 50 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Brexit semble poser surtout des difficultés d’ordre politique et diplomatique. En droit interne, en revanche, il pose des questions de droit constitutionnel. Certaines ont été tranchées par la Cour suprême à l’occasion de la décision Miller du 24 février 2017. D’autres ne sont pas encore réglées. Nous proposons d’analyser quatre questions : la constitution britannique prime-t-elle sur le droit de l’Union européenne ? Le résultat du référendum de 2016 est-il contraignant ? Le Cabinet peut-il notifier la sortie de l’Union européenne sans l’autorisation du Parlement ? Quelle est la part des composantes du Royaume-Uni dans le processus de sortie ? Aucune de ces questions n’appelle de réponse simple, d’abord parce que le Royaume-Uni ne dispose pas de constitution codifiée, ensuite parce que ces questions sont largement inédites. Si elles contribuent à faire évoluer la constitution britannique, elles se heurtent toutefois à un impératif temporel : deux ans de négociation pour mettre un terme à quarante-sept ans d’union politique et juridique.
Abstract
Due to its dualist conception of international law in its legal order, the United Kingdom commenced two parallel procedures for the purpose of its exit from the European Union. On the international scene, even if this is the first case of a Member state wishing to exit the European Union under article 50 of the Treaty on the Functioning of the European Union, the Brexit appears to be presenting difficulties that are mainly political and diplomatic. In domestic law, however, this situation leads to constitutional questions. Some of them have been ruled on by the Miller decision issued on February 24th, 2017. Some others have not been decided yet. This article analyses four questions: does the British Constitution supersede European Union law? Is the result of the 2016 referendum binding? Can the British cabinet notify the European Union of the country’s exit without the authorization of Parliament? What roles do the different components of the United Kingdom play for the exit process? None of these questions lead to simple answers, firstly because the United Kingdom does not have a codified Constitution, and secondly because these questions are largely unheard of. Even if they contribute to the evolution of the British constitution, they face a temporal imperative: two years of negotiations to end 47 years of political and legal union.
Resumen
Debido a su concepción dualista de la aplicación del derecho internacional en su orden jurídico interno, el Reino Unido se comprometió a dos procedimientos paralelos con vistas a su salida de la Unión Europea. En la escena internacional, aunque se trate de la primera notificación por un Estado miembro de su voluntad de dejar la Unión Europea con arreglo al artículo 50 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Brexit parece enfrentarse sobre todo a dificultades de orden político y diplomático. Sin embargo, en derecho interno esta situación plantea cuestiones de derecho constitucional. Algunas fueron decididas por la Corte suprema con ocasión del juicio Miller del 24 de febrero de 2017. Otras todavía no han sido resueltas. Proponemos analizar cuatro preguntas: ¿La constitución británica supera el derecho de la Unión Europea? ¿El resultado del referéndum de 2016 es obligatorio? ¿El Gabinete puede notificar la salida de la Unión Europea sin la autorización del Parlamento? ¿Cuál es el papel de los componentes del Reino Unido en el proceso de salida? Ninguna de estas cuestiones lleva a una respuesta simple, primero porque el Reino Unido no dispone de una constitución codificada, luego porque estas cuestiones son ampliamente inéditas. Si contribuyen a la evolución de la constitución británica, se enfrentan no obstante a un imperativo temporal: dos años de negociación para terminar cuarenta y siete años de unión política y jurídica.
Article body
Le « Brexit » est à la fois un nouveau mot et un nouveau phénomène qui suscite beaucoup d’interrogations et d’études académiques. Un rapide aperçu des définitions publiées montre qu’elles convergent toutes vers une dénotation simple : la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (UE). Mais à en croire le feuilleton politique et médiatique déclenché par les résultats du référendum du 23 juin 2016, cette « sortie » est loin d’être aisée. Le Brexit est un processus qui s’inscrit dans la durée et qui est jalonné d’événements politiques et juridiques. Une première délimitation formelle du processus pourrait le situer entre le 23 juin 2016 et le 29 mars 2019, c’est-à-dire de la date du référendum à la sortie officielle programmée pour le 29 mars 2019 à minuit, heure de Bruxelles. Or, cette délimitation ne rend pas compte de la complexité du processus qui déborde ce cadre tant au début qu’à la fin. Il est ainsi acquis que le Royaume-Uni et l’UE vont signer un accord transitoire d’une durée de deux ans avec, peut-être, un statu quo juridique. Autrement dit, même sorti, le Royaume-Uni continuera d’être régi par le droit de l’UE et relèvera de la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), le tout sans pouvoir participer aux décisions prises par l’Union. Ce n’est qu’après la fin de cette phase transitoire que la sortie prendra tout son sens, selon les termes d’un traité que les futurs partenaires se doivent encore en principe de négocier. Celui-ci pourrait tout à fait prévoir que le Royaume-Uni continue à participer à un certain nombre de politiques et de programmes portés par l’UE, ce qui diluerait un peu plus la portée de la sortie. De la même manière, le référendum du 23 juin 2016 est précédé d’événements annonciateurs. Sur le plan juridique, on pense à l’adoption du European Union Referendum Act[1] en 2015 (loi organisant la tenue du référendum) voire au discours de David Cameron du 23 janvier 2013 au cours duquel il a formulé la promesse d’un référendum. Mais comme nombre d’auteurs l’ont souligné, la volonté de sortie exprimée par le référendum n’a pas été une surprise totale pour les Européens. En tout cas, ce n’est pas comme si le scénario n’avait pas été envisagé par le passé. Lorsqu’il était premier ministre, Tony Blair a déjà pu mesurer la sensibilité de l’opinion publique britannique lorsqu’il a évoqué la possibilité d’une adhésion à l’euro[2]. Au plan juridique, la primauté du droit de l’UE a toujours soulevé des questions épineuses et donné lieu à de grands débats juridiques dont la Chambre des Lords puis la Cour suprême se sont fait les prudents arbitres. Certains font même remonter les prémices du Brexit aux années 1972-1973, c’est-à-dire au moment même de l’adhésion du Royaume-Uni aux Communautés européennes.
Pour comprendre les étapes rendues nécessaires par le référendum de 2016, il faut se rappeler les circonstances juridiques de l’adhésion aux Communautés en 1972-1973. Le Royaume-Uni a une conception dualiste de l’application du droit international dans son ordre juridique interne, en raison notamment du principe de souveraineté parlementaire. Comme les Communautés européennes reposent sur des traités internationaux, le Parlement britannique a anticipé l’adhésion (1ͤ ͬ janvier 1973) par le vote d’une loi, le European Communities Act[3] de 1972[4]. Ce texte donne une valeur juridique au droit des Communautés européennes dans l’ordre interne britannique, qu’il s’agisse du droit antérieur ou postérieur à l’adoption de l’ECA. En 1975, pour des raisons plus politiques que juridiques, un référendum a confirmé l’adhésion alors que celle-ci était déjà effective. Le processus de sortie est lui aussi frappé du sceau de ce dualisme. La différence est que tout est parti, cette fois-ci, du droit interne. Le premier ministre a promis un référendum, le Parlement a voté une loi organisant sa tenue, les électeurs ont voté en faveur de la sortie. Il ne reste plus au Parlement qu’à rendre inapplicable le droit de l’UE en droit interne, c’est-à-dire à abroger l’ECA. Au plan international, la notification a ouvert une période de négociation qui doit s’achever au bout de deux ans, qu’un accord soit conclu pour la suite ou non.
Ces deux procédés parallèles, l’un interne, l’autre international, sont en somme assez simples, mais force est de constater que le Brexit pose beaucoup plus de difficultés au plan interne qu’au plan international. La seule difficulté internationale pourrait être la question du retrait de la notification de la sortie. Que se passerait-il si, non satisfait de l’issue des négociations, Londres retirait sa notification et adressait, quelques temps plus tard, une nouvelle notification, ouvrant ainsi une nouvelle période de négociation de deux ans? La CJUE pourrait trouver cette procédure abusive, mais ce serait une situation bien incertaine. Pour le reste, le Brexit ne pose pas de difficulté juridique pour l’UE. La notification est intervenue le 23 mars 2017, les négociations sont en cours et la date du 23 mars 2019 approche très vite. Au plan interne, en revanche, les choses sont plus compliquées. Au moins deux controverses ont immédiatement vu le jour après la publication des résultats du référendum de 2016. La première porte sur le point de savoir si le Parlement pouvait empêcher le Brexit, la seconde sur la notification de la sortie aux autorités européennes. Elles ont été en partie tranchées par la Cour suprême à l’occasion du désormais célèbre arrêt Miller[5]. Quant au European Union (Withdrawal) Bill[6], le projet de loi devant abroger l’ECA, il a fait l’objet d’âpres débats au Parlement car il pose la question de son pouvoir dans le transfert des normes européennes en droit interne. Les controverses dépassent le seul cadre politique parce qu’ils soumettent la constitution britannique à un test historique. C’est en cela que le Brexit, bien qu’ayant une portée européenne et internationale évidente, est avant tout une question de droit constitutionnel. C’est l’identité même du Royaume-Uni au XXIe siècle et sa place dans le monde qui se trouve en question. Il faudra du temps pour y répondre, peut-être même une constitution écrite. À regarder de plus près cependant, ce défi masque une série de questions constitutionnelles auxquelles les institutions britanniques tentent, parce qu’elles y sont obligées, de répondre au cas par cas. Nous en avons sélectionné quatre : (I.) la constitution britannique prime-t-elle le droit de l’UE? (II.) le résultat du référendum de 2016 est-il contraignant? (III.) le Cabinet peut-il notifier la sortie de l’UE sans l’autorisation du Parlement? (IV.) quelle est la part des composantes du Royaume-Uni dans le processus de sortie?
I. La constitution britannique prime-t-elle le droit de l’UE ?
La place du droit de l’UE dans l’ordre interne britannique a posé des problèmes bien avant l’organisation du référendum de 2016. La question avait néanmoins été à peu près résolue par les juges de la Chambre des Lords à l’occasion de la célèbre affaire Factortame et des deux décisions rendues en 1990[7] et en 1991[8]. La solution britannique, qui était alors la même que celle du juge français, peut se résumer ainsi : la souveraineté britannique n’est pas affectée par la participation du Royaume-Uni à l’UE puisque cette participation est justement l’expression de la volonté souveraine du Parlement de Westminster. En France, la différence ne tient qu’à l’existence d’une constitution écrite : la souveraineté de la France n’est pas affectée par la participation de la France à l’UE parce qu’elle est l’expression de la volonté du constituant. En effet, la condition de la participation de la France à l’UE est précisée dans le titre XV de la Constitution du 4 octobre de 1958[9]. Au Royaume-Uni, elle dépend du ECA. Aucune difficulté donc à ce que le droit de l’UE prime la loi nationale. En France, si une loi est contraire au droit de l’UE, cela signifie qu’elle est contraire à la constitution. Au Royaume-Uni, cela signifie qu’elle est contraire au ECA. Mais l’absence de constitution écrite au Royaume-Uni est un problème. Un conflit entre une loi britannique et le droit de l’UE revient à un conflit entre deux lois, la loi incriminée et le ECA. Comment dès lors justifier par une raison de droit interne, c’est-à-dire sans avoir recours aux principes européens, le fait que la loi incriminée doive céder face au ECA ? En droit anglais, la loi la plus récente prime la loi plus ancienne parce qu’elle est réputée constituer l’expression la plus récente du souverain (lex posterior derogat priori). Mais qu’en est-il si la loi incriminée est justement postérieure au ECA ? Le juge Laws a proposé une solution dans la décision Thoburn[10]. Il a distingué les lois selon qu’elles ont un caractère constitutionnel ou non. Les « constitutional statutes » sont supérieures aux autres lois. La conséquence est que, dans notre hypothèse d’une loi postérieure contraire au ECA, l’ECA prime en raison de son statut de loi constitutionnelle. Or, comme il n’existe pas d’autorité au-dessus du Parlement au Royaume-Uni, si celui-ci souhaite vraiment déroger au ECA, il peut le faire par des dispositions expresses. C’est ce qui a permis au Parlement britannique de débattre puis d’adopter une loi d’abrogation du ECA : le European Union (Withdrawal) Act[11].
La solution de l’affaire Thoburn[12] a été confirmée par la Cour suprême dans l’affaire HS2[13] de 2014. Elle permet tout à la fois de justifier en droit interne le principe de primauté du droit de l’UE et sa disparition par une loi d’abrogation en cas de sortie de l’UE. Tout dépend en effet du Parlement. Il reste cependant un dernier problème. C’est l’hypothèse « Frontini-Solange-OGM[14] », pour reprendre les noms des décisions italienne, allemande et française, qui se rapporte à peu près à la même difficulté. On peut la formuler ainsi : que faire en cas de conflit entre une norme européenne et une norme constitutionnelle de droit interne ? Le principe de primauté implique que la norme constitutionnelle doit céder. Mais tous les juges, de Rome, de Karlsruhe et de Paris, ont opté pour une solution intermédiaire : le droit de l’UE prime les normes constitutionnelles sauf celles qui touchent à l’identité constitutionnelle du pays[15]. Cette réserve de souveraineté permet aux États membres de l’UE, qu’ils soient monistes ou dualistes, de conjuguer souveraineté et intégration européenne.
Naturellement, l’hypothèse « Frontini-Solange-OGM » ne se pose pas dans les mêmes termes au Royaume-Uni que sur le continent en raison de l’absence de constitution écrite, mais la décision Thoburn[16] en a fourni les données. Le conflit normatif peut se situer entre le droit de l’UE et une loi constitutionnelle. Le cas s’est présenté à la Cour suprême en 2014 dans l’affaire HS2[17], des décennies après la première affaire italienne[18]. Le conflit dont les juges ont eu à connaître était entre une directive européenne et le Bill of Rights de 1689[19], ce qui revient à un conflit entre deux lois constitutionnelles : l’ECA et le Bill of Rights. Dans une telle situation, la première réaction du juge est de chercher à concilier les textes, pour les faire coexister. Mais dans une affaire où cela n’est pas possible, il est face à un choix : soit faire primer le droit de l’UE et sacraliser, dans le droit constitutionnel du Royaume-Uni, le principe de primauté au détriment de la souveraineté du Parlement, soit identifier des normes constitutionnelles susceptibles de résister au droit de l’UE et consacrer alors un noyau normatif supérieur, qui serait l’identité constitutionnelle du Royaume-Uni. Les juges britanniques ont choisi la seconde voie.
Dans l’affaire HS2, la Cour suprême n’a pas eu besoin de choisir entre l’ECA et le Bill of Rights parce que l’hypothèse du conflit dépendait de l’interprétation de la directive incriminée exprimée par deux avocats généraux[20] de la CJUE. Mais plusieurs juges se sont interrogés sur la solution à apporter à un tel conflit pour le cas où la Cour de Luxembourg venait à faire sienne cette interprétation. Ils se sont interrogés sans dire expressément que le Bill of Rights primerait, mais la lecture de leurs opinions laisse peu de doute sur ce point. Si nous devions comparer celles-ci avec la jurisprudence continentale, nous pourrions affirmer que le Bill of Rights contient des normes essentielles à l’identité constitutionnelle britannique. La différence avec la situation française, en tout cas, est que la réserve de souveraineté est plus clairement identifiée. Dans l’affaire HS2, il s’agissait du Bill of Rights mais il est vraisemblable que d’autres normes bénéficient de la même immunité. En effet, le juge de Londres a proposé une liste de « constitutional instruments » ouverte et déjà remarquablement longue :
The United Kingdom has no written constitution, but we have a number of constitutional instruments. They include Magna Carta, the Petition of Right 1628, the Bill of Rights and (in Scotland) the Claim of Rights Act 1689, the Act of Settlement 1701 and the Act of Union 1707. The European Communities Act 1972, the Human Rights Act 1998 and the Constitutional Reform Act 2005 may now be added to this list. The common law itself also recognises certain principles as fundamental to the rule of law. It is, putting the point at its lowest, certainly arguable (and it is for United Kingdom law and courts to determine) that there may be fundamental principles, whether contained in other constitutional instruments or recognised at common law, of which Parliament when it enacted the European Communities Act 1972 did not either contemplate or authorise the abrogation.[21]
Dès lors que le juge donne valeur constitutionnelle à des principes de common law, il est difficile d’entrevoir les limites de la catégorie des « constituional instruments » et, par conséquent, les limites de la résistance juridique potentielle au droit de l’UE. À cela il faut ajouter que les juges ont affirmé sans ambiguïté que de tels conflits devaient être résolus par les cours britanniques en tant que problème de droit constitutionnel du Royaume-Uni[22].
Cette situation est une sorte de Brexit juridique avant l’heure. En tout cas, il fournit, dès 2014, le décor d’un conflit qui s’est concrétisé à la fois sur le plan politique et sur le plan juridique.
II. Le résultat du référendum de 2016 est-il contraignant ?
La pratique du référendum est relativement récente au Royaume-Uni et ne faisait pas partie de sa culture démocratique. À première vue, même, elle s’accommode mal avec le principe de souveraineté du Parlement puisqu’elle revient à enlever au Parlement, temporairement, une partie de son pouvoir. Or, le nombre de référendums est en forte augmentation, souvent même sur des questions constitutionnelles essentielles (12 consultations depuis 1973, 2 ouvertes à l’ensemble du Royaume-Uni). Parmi ceux-ci, on peut citer les référendums portant sur la dévolution en Écosse, au pays de Galles et en Irlande du Nord (1973, 1979, 1997, 2011), le référendum portant sur l’autorité du grand Londres de 1998, le référendum sur le mode de scrutin du vote alternatif de 2011, le référendum portant sur l’indépendance de l’Écosse de 2014 et, bien entendu, le référendum sur la sortie de l’UE de 2016.
Cette évolution saisissante n’est toutefois pas le signe d’un infléchissement de la souveraineté du Parlement de Westminster, car c’est à lui que revient le pouvoir de décider de la portée des référendums auxquels il consent. S’il peut décider à l’avance que le résultat sera contraignant, il peut tout aussi bien décider qu’un référendum ne sera que consultatif. Mais il reste la situation dans laquelle le Parlement n’a rien prévu, c’est-à-dire lorsque le texte organisant le référendum est silencieux sur son caractère contraignant ou consultatif. Ainsi en a-t-il été du référendum sur le maintien du Royaume-Uni dans l’UE.
Il existe donc trois types de situation :
Cas 1. Le Parlement a expressément prévu les conséquences du référendum en fonction du résultat. Dans l’affaire Miller, les juges ont énuméré les consultations pour lesquelles le Parlement avait procédé ainsi : le référendum portant sur la dévolution en Écosse de 1979 (Scotland Act 1978[23]), le référendum britannique sur le mode de scrutin (United Kingdom Alternative Vote Referendum) de 2011 (Parliamentary Voting Systems and Constitutencies Act de 2011, section 8[24]) et le référendum portant sur le statut de l’Irlande du Nord (Northern Ireland Act 1998[25]).
Cas 2. Le Parlement a expressément prévu que le référendum ne sera que consultatif. Il s’agit, en principe, d’une hypothèse d’école car les consultations sont présumées consultatives en cas de silence du Parlement.
Cas 3. Le Parlement est silencieux sur la portée du référendum. C’est le cas du Referendum Act[26] de 1975 et du European Union Referendum Act[27] de 2015. Il n’y a pas eu de difficulté en 1975 parce que les électeurs ont confirmé la participation du Royaume-Uni aux Communautés européennes. Les choses sont très différentes avec le référendum de 2016 notamment parce que le résultat n’était pas celui escompté par le Cabinet, en tout cas pas par le Premier ministre.
La doctrine semble unanime pour considérer que le Parlement est contraint dans le cas 1 et qu’il ne l’est pas dans le cas 2. C’est ce qui semble ressortir de l’arrêt Miller :
117-118. Le référendum est une chose relativement nouvelle dans la pratique constitutionnelle du Royaume-Uni (…) L’effet de chaque référendum doit dépendre des termes de la loi qui l’a autorisé. Qui plus est, la législation autorisant les référendums a en général prévu quelles en seraient les conséquences [à savoir si les effets seraient seulement facultatifs ou au contraire obligatoires, mais la loi de 2015] ne contient aucune disposition relative à la question des conséquences juridiques du résultat [du référendum sur la sortie de l’Union européenne][28].
Le cas 3, qui est celui du référendum sur la sortie de l’UE, est plus problématique. À première vue, considérer que silence vaut contrainte serait illogique car cela reviendrait à présumer que le Parlement est contraint sauf mention contraire de sa part, ce qui n’est guère compatible avec le principe de sa souveraineté. L’arrêt Miller n’offre pas de réponse décisive sur ce point parce que la question posée n’était pas exactement celle-là. Il s’agissait de savoir si le gouvernement pouvait notifier lui-même en conséquence du référendum ou s’il lui fallait une autorisation de la part du Parlement. Les juges sont restés divisés sur cette question même si la majorité a tranché en faveur de la nécessité pour le gouvernement de passer par le Parlement. Une telle solution donne à penser que le Parlement n’intervient pas seulement pour la forme. Autrement dit, en obligeant le gouvernement à consulter le Parlement, il s’expose, en théorie du moins, à ce que le Parlement lui refuse l’autorisation de notifier, c’est-à-dire qu’il ne suive pas l’avis du peuple. C’est de cette façon qu’est né un débat politique entre les partisans de l’UE et les « Brexiters » sur le point de savoir si le Parlement pouvait « inverser » le résultat du référendum. Si les juges n’ont pas eu à se prononcer sur ce point, c’est sans doute parce qu’ils ont considéré qu’il s’agissait d’une question plus politique que juridique. Un consensus semble même s’être fait jour dans la classe politique sur le fait que le Parlement avait le pouvoir, en droit strict, de refuser le Brexit mais que cette voie était politiquement impossible. Cela pourrait expliquer que les travaillistes s’accordent désormais massivement avec les conservateurs sur la nécessité d’aller « au bout du Brexit[29] ».
Ce raisonnement pose, selon nous, plusieurs difficultés :
1. S’il est admis qu’un Parlement en exercice peut lier un Parlement futur (entrenchment), ce dernier peut en principe toujours se délier, faute de quoi le Parlement perdrait sa souveraineté. Cela signifie que même dans le premier cas cité plus haut (le Parlement annonce qu’il suivra le résultat), il lui serait toujours théoriquement possible de se délier. Il lui suffirait de revenir expressément sur la portée obligatoire assignée au référendum. La situation est, mutatis mutandis, comparable à une révision constitutionnelle interdite par une constitution écrite. Il est, en effet, théoriquement possible pour un pouvoir constituant de lever une interdiction constitutionnelle pour ensuite faire adopter un amendement constitutionnel dont la portée était auparavant interdite. Dans les deux cas, il est évident que la démarche serait politiquement explosive et pourrait entraîner une crise profonde.
2. Si l’on suit ce raisonnement, un Parlement ne serait jamais tenu par un référendum pour la raison qu’il demeure souverain. Cette conclusion ne paraît pas acceptable. Nous pensons que lorsque le Parlement britannique organise un référendum sur une question constitutionnelle essentielle, il ne se lie pas seulement politiquement mais aussi juridiquement. C’est, à notre sens, la raison profonde qui a conduit la majorité des parlementaires britanniques à accepter le caractère inéluctable du Brexit.
Sur le plan juridique, la question est incertaine, mais elle mérite un peu d’attention. Aurélien Antoine s’est ainsi interrogé sur l’existence possible d’une convention de la constitution qui lierait le Parlement quant au résultat d’un référendum portant sur une question constitutionnelle essentielle[30]. Selon cet auteur, il y a des précédents, c’est-à-dire des référendums consultatifs qui ont été systématiquement suivis ; les acteurs semblent se sentir tenus par l’issue du référendum (« Brexit means Brexit ») et toutes les tentatives en vue d’inverser le résultat par la voie parlementaire ou d’organiser un second référendum (private member bill du 16 juillet 2016[31], pétition par internet obligeant le gouvernement à répondre) ont échoué. Mais il conclut en affirmant que la recherche d’une telle convention est une quête vaine. Il soutient que si le référendum est obligatoire, le Parlement n’aurait pas besoin d’être consulté dans la suite de la procédure, notamment pour la notification au sujet de laquelle la Cour suprême a tranché en faveur de l’autorité du Parlement. Selon nous, cet argument est fragile. Le caractère obligatoire du référendum ne rend nullement inutile l’intervention ultérieure du Parlement. Pourquoi, même en cas de référendum obligatoire, reviendrait-il au gouvernement de décider seul des conditions de sortie de l’UE ? Le Parlement a d’ailleurs récemment obtenu de haute lutte le pouvoir de se prononcer sur la période transitoire et sur l’accord portant sur la relation future avec l’UE. Ces questions essentielles n’étaient pas comprises dans le référendum de 2016. Le mandat donné par le peuple est donc incomplet. Il existe, à notre sens, des arguments sérieux pour considérer ce type de référendum comme juridiquement obligatoire. Ces arguments découlent de l’évolution récente de la démocratie britannique.
À l’époque moderne le Parlement britannique est souverain en ce que sa partie efficiente[32] (la Chambre des communes et indirectement le Cabinet) procèdent du suffrage populaire. Lorsque le Parlement décide d’organiser un référendum sur une question constitutionnelle essentielle, il remet sa souveraineté entre les mains du peuple. Sur cette question précise, le mandat est donc impératif et il l’est d’autant plus lorsque la question est claire. D’ailleurs, sur ce point, la Commission électorale, après avoir envisagé une question appelant une réponse par « oui » ou par « non », a recommandé une question plus neutre engageant les élections de manière plus claire[33]. Le choix s’est porté sur : « Should the United Kingdom remain a member of the European Union or leave the European Union? ». Deux réponses étaient prévues sur le bulletin de vote : « Remain a member of the European Union » ou « Leave the European Union ».
Ce mandat donné par le peuple explique que les députés travaillistes et conservateurs pro-EU aient fini par accepter le résultat sorti des urnes sans guère s’y opposer (parfois à la surprise d’autres pays). Ils craignent sans doute la réaction de leurs électeurs en cas d’opposition à la sortie de l’UE. Mais nous pensons qu’il y a plus. Leur réaction peut être comparée à celle d’un joueur ou d’une équipe sportive qui, après avoir perdu un match, félicite le vainqueur en lui disant « good game ». Ainsi fonctionne la démocratie britannique, en tout cas à l’époque récente. L’obligation de respecter le résultat sorti des urnes est, pour nous, une obligation constitutionnelle nouvelle, induite par le recours accru à la pratique référendaire. Si, comme nous le pensons, un référendum portant sur une question constitutionnelle essentielle est contraignant, cela rend le recours au référendum extrêmement dangereux et les majorités futures devront en user avec prudence et modération.
Puisque la loi organisant le référendum n’a rien prévu pour la suite, il est revenu à la Cour suprême de trancher une épineuse question au début de l’année 2017 : le Cabinet peut-il notifier le Brexit sans autorisation préalable du Parlement?
III. Le Cabinet pouvait-il notifier la sortie de l’UE sans l’autorisation du Parlement?
La question de savoir si le gouvernement avait besoin ou non de l’autorisation du Parlement pour notifier la Commission européenne s’est posée en raison du silence tant de la loi du 17 décembre 2015 autorisant la tenue du référendum que de l’article 50 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne[34]. Le premier est silencieux sur les conséquences du référendum tandis que le second se borne à renvoyer aux règles constitutionnelles de l’État membre concerné.
Au Royaume-Uni, l’Exécutif est, en principe, seul compétent pour faire et défaire les traités internationaux en vertu de la prérogative royale. Depuis l’action juridictionnelle remarquable du juge Coke au début du XVIIe siècle, la prérogative a été considérablement réduite au point que l’on peut considérer, avec Lord Reed, qu’il s’agit « d’une relique du passé […] parce qu’elle ne s’impose qu’aux cas non couverts par la loi[35] ». Mais pour réduite que ce soit la prérogative royale, celle-ci demeure en droit, en particulier s’agissant des relations internationales. C’est la raison pour laquelle de nombreux observateurs ont considéré, comme le Cabinet britannique, qu’il ne devrait pas y avoir d’obstacle à ce que celui-ci puisse notifier Bruxelles de la sortie du Royaume-Uni de l’UE, sans autre formalisme. Le schéma paraît d’ailleurs complet :
-
Le Parlement prévoit la tenue d’un référendum sur la sortie de l’UE.
-
Le peuple vote en faveur de la sortie.
-
Le Cabinet notifie la sortie à Bruxelles.
Dans le contexte de la division profonde du peuple britannique que le résultat du référendum a exacerbée, il n’a pas fallu longtemps avant que des requérants ne portent le débat en justice. La première décision s’agissant de la notification a été rendue par la Haute Cour d’Irlande du Nord[36]. Les requérants contestaient le pouvoir du Cabinet pour deux raisons complémentaires : la sortie de l’UE aurait pour conséquence une perte pour les citoyens britanniques de l’acquis communautaire, ce qui n’est pas conforme au processus de paix en Irlande du Nord. Pour les requérants, de telles conséquences nécessitent une intervention du Parlement de Westminster et de l’Assemblée d’Irlande du Nord. Les juges de la Haute Cour ont rejeté ces arguments et confirmé l’usage de la prérogative. Quelques jours plus tard, la Haute Cour de l’Angleterre et du pays de Galles a cependant choisi l’option inverse (la nécessaire intervention du Parlement) dans les premiers stades de l’affaire Miller[37]. Le débat était donc lancé. Le gouvernement a saisi la Cour suprême à l’occasion de la seconde affaire pour tenter de convaincre les juges de la validité de l’usage de la prérogative royale pour la notification. La Cour s’est prononcée contre la prérogative royale à huit contre trois. La position majoritaire est assez bien résumée par le passage suivant :
Nous ne pouvons pas accepter qu’un changement majeur à l’organisation constitutionnelle du Royaume-Uni soit accompli par les seuls ministres; il doit être effectué de la seule manière reconnue par la constitution du Royaume Uni, à savoir la législation parlementaire[38].
En somme, les huit juges qui ont formé l’opinion majoritaire ont considéré que la participation du Royaume-Uni à l’UE avait un tel impact sur l’ordonnancement juridique du pays qu’un retrait devait s’analyser en une réforme constitutionnelle de grande ampleur rendant nécessaire l’intervention du Parlement. Mais la question précise que les juges ont eu à trancher portait sur l’autorité compétente pour notifier la Commission européenne. Les arguments en faveur de l’usage de la prérogative royale étaient forts et solidement appuyés sur la jurisprudence britannique. Concentrons l’analyse sur l’argument le plus redoutable, le caractère réversible de la notification. Au cours des débats devant la Cour, le gouvernement n’a pas exploité cet argument, bien au contraire, de sorte qu’une incertitude demeure, du point de vue du droit international, sur la portée d’un éventuel retrait de la notification. L’argument est fort parce que le caractère réversible de la notification empêche d’affirmer que la notification emporte, par elle-même, une perte inévitable de droits pour les citoyens britanniques, dit autrement, une altération de l’acquis communautaire. En effet, en droit strict, la notification n’emporte pas de conséquence sur la législation applicable aux citoyens britanniques. Cette altération, ou cette perte de droits, ne peut, en tout état de cause, que résulter de l’abrogation par le Parlement de l’ECA 1972 car c’est ce texte qui donne valeur législative aux règles en provenance de l’UE. Ce projet de loi, un temps appelé le Great Repeal Bill, a été adopté le 26 juin 2018 après des débats épiques[39]. Si la législation n’est aucunement affectée par la notification, il est tout à fait raisonnable de conclure qu’elle ne constitue qu’un acte de relations entre États, entre le Royaume-Uni et l’UE dans ce cas précis. C’est en suivant un tel raisonnement que Patrick Birkinshaw a pu affirmer que le gouvernement avait commis une erreur fatale en affirmant que la notification avait un caractère irréversible. Cela l’a empêché de relativiser la portée de la notification devant la cour. Son aveu, pourtant erroné, a peut-être même été déterminant dans sa défaite devant la Haute cour puis devant la Cour suprême.
Si ce point a très certainement eu une incidence sur la décision, il est néanmoins difficile de comprendre pourquoi les juges ont admis le caractère irréversible de la notification sur la seule base des déclarations du gouvernement. Il s’agit de sa part d’une posture politique et non d’une obligation juridique. C’est son interprétation du référendum. Comment la Cour suprême a-t-elle pu en conclure que la notification emporterait « un changement majeur à l’organisation constitutionnelle du Royaume-Uni[40] » ? L’analyse des actes de notification en droit international public suggère qu’une notification peut parfaitement faire l’objet d’un retrait, permanent ou temporaire[41]. Ainsi, lorsque les juges considèrent que la notification entraîne un changement majeur, c’est sans doute parce qu’ils considèrent que le retrait est impossible… politiquement !
Le juge Reed propose un autre raisonnement, assez convaincant lui aussi. Dans son opinion dissidente, il souligne que l’ECA de 1972 ne constitue pas le fondement de la participation du Royaume-Uni à l’UE. Il se contente de conférer au droit de l’UE une valeur juridique en droit interne tant que les traités européens sont applicables au Royaume-Uni. La fin éventuelle de l’application des traités est une conséquence de ce même texte et n’appelle pas, selon lui, de nouvelle loi[42]. Le seul moyen de contrer ce raisonnement est de considérer que le droit de l’UE a un statut à part, un statut exceptionnel, qui justifie l’intervention du Parlement pour tout changement.
Les juges de la Haute cour pour l’Angleterre et le pays de Galles, ainsi que la Cour suprême, ne se sont pas contentés de l’argument tiré de l’irréversibilité de la notification pour décider que celle-ci devait être autorisée par le Parlement. Leur raisonnement porte aussi sur la nature même du droit de l’UE. En effet, si celui-ci ne portait que sur les relations d’État à État, alors l’usage de la prérogative royale serait pleinement justifié. Or, il est évident que le droit de l’UE affecte les citoyens britanniques et qu’un retrait emporte des conséquences importantes pour les citoyens. Une objection se fait, toutefois, immédiatement jour. Si la prérogative est mise en échec dès lors que des traités internationaux affectent la vie des citoyens, le raisonnement n’est-il pas transposable à d’autres situations internationales? C’est la question que pose Patrick Birkinshaw dans son analyse de la décision de la Cour suprême :
qu’en est-il d’accords commerciaux avec les Etats-Unis qui imposeraient aux entreprises britanniques de respecter les décisions de parties tierces remettant en cause le NHS (le système national de sécurité sociale) en même temps que d’autres droits, qu’en est-il d’une éventuelle révocation de la notification et qu’en est-il enfin du retrait du Royaume-Uni de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme que certains à Londres appellent de leurs voeux?[notre traduction[43]]
Il n’existe que deux issues : soit l’arrêt Miller a poursuivi l’entreprise multiséculaire de réduction du champ d’application de la prérogative royale et l’autorisation du Parlement est alors nécessaire, soit le cas de l’UE est un cas particulier, unique en son genre, de nature constitutionnelle, qui justifie un traitement à part. C’est à ce deuxième point de vue que l’opinion majoritaire semble s’être ralliée en qualifiant le retrait de l’UE de « changement majeur à l’organisation constitutionnelle du Royaume-Uni[44] ». Il faut en effet bien admettre que le droit de l’UE affecte la quasi-totalité du droit interne et régit la vie quotidienne des citoyens britanniques. Les services de David Davis ont compté 12 000 règlements communautaires en vigueur, 7 900 textes de législation déléguée et 186 lois adoptées sous l’influence du droit de l’EU. Un tel constat est sans commune mesure avec les autres relatons internationales et organisations auxquelles le Royaume-Uni est partie.
IV. Quelle est la part des composantes du Royaume-Uni dans le processus de sortie?
Le référendum de 2016 n’est pas seulement un séisme politique en raison de son résultat inattendu ou de l’écart finalement assez faible entre les deux camps. Il est aussi un séisme en raison des différences de résultat entre les différentes composantes du Royaume-Uni. Si la sortie de l’UE l’a emporté en Angleterre et au pays de Galles, c’est l’inverse qui s’est produit en Écosse et en Irlande du Nord. Or, ces deux régions bénéficient d’une dévolution très importante. Le résultat géographiquement différencié a donc posé la question de la part des autorités dévolues dans le processus de sortie de l’UE. Dans l’affaire Miller, les requérants se sont appuyés sur la convention Sewel pour soutenir le principe de la consultation des autorités dévolues. La question n’est pas évidente car la dévolution a cela de particulier par rapport aux techniques du fédéralisme ou de la décentralisation que le Parlement de Westminster conserve le pouvoir d’intervenir dans les matières transférées. Cette règle est même inscrite dans les lois de dévolution[45]. La convention Sewel est un arrangement politique entre le gouvernement britannique et les autorités dévolues aux termes duquel le Parlement de Westminster se refuse à légiférer dans les matières transférées sans l’accord préalable des autorités dévolues. Cette convention a été inscrite en 2001 dans un Memorandum of Understanding conclu entre le gouvernement du Royaume-Uni et les autorités dévolues. Elle a également été ajoutée au Scotland Act en 2016 dans la section 27(8) : « il est reconnu que le Parlement du Royaume-Uni ne devra pas, normalement, légiférer sur les matières dévolues sans le consentement du Parlement écossais[46] » [notre traduction]. L’accord préalable prend la forme de motions. Cardiff et Édimbourg en ont régulièrement adoptées, notamment pour exprimer leur consentement aux lois qui ont modifié les lois de dévolution (2014 et 2016 pour le pays de Galles, 2012 et 2016 pour l’Écosse).
Dans l’affaire Miller, les requérants ont soutenu que la sortie du Royaume-Uni de l’UE aurait pour effet de priver les écossais de droits, notamment de l’acquis communautaire, y compris les droits qui tombent dans le champ des matières dévolues. Or, en vertu de la convention Sewel, Londres ne peut affecter la législation applicable dans les composantes du Royaume-Uni qu’avec leur accord. Si la convention trouve à s’appliquer dans ce cas, alors Londres ne peut faire sortir le Royaume-Uni de l’UE qu’avec l’accord préalable des autorités situées à Cardiff, à Belfast et à Édimbourg. Pour le Brexit, l’enjeu est considérable. Le pays de Galles aurait sans doute donné son accord (les Gallois ont majoritairement voté en faveur du Brexit), comme l’Irlande du Nord l’aurait peut-être donné. L’Écosse, en revanche, aurait très certainement refusé. Dans ces conditions, admettre l’application de la convention Sewel à la sortie de l’UE revient à accorder un droit de veto à l’Écosse.
Les juges de la Cour suprême n’ont pas hésité sur ce point et ont unanimement rejeté l’application de la convention Sewel au processus de sortie de l’UE. Ils soulignent que la convention opère comme une restriction de la règle prévue à la section 9 du Bill of Rights aux termes duquel « les procédures du Parlement ne peuvent être contestées ou mises en question par aucune cour ou dans quelque endroit que ce soit en dehors du Parlement[47] » [notre traduction]. En affirmant avec force que la participation à l’UE, comme pour les autres questions internationales qui touchent au Royaume-Uni, relève de la seule compétence du Parlement de Westminster, les juges ont entendu maintenir la convention Sewel dans la sphère politique.
Depuis l’arrêt Miller, les revendications des autorités dévolues ont un peu évolué. Si Édimbourg a d’abord poussé pour l’organisation d’un nouveau référendum d’indépendance en raison du Brexit, tel n’est plus guère le cas tant cette voie semble politiquement périlleuse. En revanche, entendue dans un sens large, la question territoriale posée par le Brexit est loin d’être close. Les positions du Royaume-Uni et de l’UE sur Gibraltar ont conduit à des discussions tendues. Il faut dire que 96% des électeurs de Gibraltar ont voté contre le Brexit. Mais c’est sans doute s’agissant de l’Irlande du Nord que la question constitutionnelle est la plus difficile. Des quatre composantes du Royaume-Uni, c’est la seule qui a une frontière terrestre avec l’UE et c’est aussi la seule dans laquelle la paix est fragile. Depuis le référendum de 2016, des facteurs politiques particuliers ont compliqué la donne. Londres a repris un contrôle direct sur l’Irlande du Nord en raison du désaccord entre les unionistes et le Sinn Féin tandis qu’à l’issue des élections législatives de 2017, le parti démocrate unioniste (DUP) a conclu avec les conservateurs un accord de soutien législatif au gouvernement pour permettre à Theresa May de se maintenir au 10 Downing Street. Les dix voix du DUP sont si nécessaires que les réticences du parti à l’égard du projet d’accord entre le Royaume-Uni et l’UE conclu en décembre 2017 ont même failli le faire échouer. L’objet de la querelle était la crainte de ce parti de voir l’Irlande du Nord conserver une législation proche de celle de l’UE pour éviter le retour aux barrières douanières avec pour conséquence que l’Irlande du Nord ne sorte pas de l’UE aux mêmes conditions que les autres composantes du royaume. Le conflit semblait terminé avec la signature de l’accord. Mais il a ressurgi lorsque Michel Barnier a confirmé quelques semaines plus tard que l’UE envisageait le maintien de l’Irlande du Nord dans l’union douanière comme seule solution possible après la sortie effective. Non seulement cette option relance un débat délicat entre le parti conservateur et le DUP mais il s’est aussi propagé aux autres composantes. Le Premier ministre écossais, Nicola Sturgeon, s’est ainsi empressé de réclamer le même accord pour l’Écosse. À n’en pas douter, le Brexit est un défi pour la dévolution et risque d’accentuer encore son caractère asymétrique.
***
L’actualité constitutionnelle du Brexit se porte désormais sur la question du pouvoir du Parlement s’agissant de la relation future entre le Royaume-Uni et l’UE. Le EU (Withdrawal) Bill, dans sa forme initiale, a donné l’impression d’une revanche du gouvernement après l’arrêt Miller. Une première raison tient à l’intention du gouvernement de recourir aux « clauses de Henri VIII » pour modifier la législation britannique après la sortie de l’UE. Si ce procédé a permis, par le passé, au gouvernement de recourir massivement à la législation déléguée[48], il fait débat s’agissant de la transcription en droit interne du droit de l’UE. De la même manière, l’intervention du Parlement dans les mois qui précèdent la sortie suscite des interrogations. Il devait se promoncer au moins à trois reprises : il a adopté le EU (Withdrawal) Act le 26 juin 2018 ; il lui reste à voter une résolution portant sur l’accord de retrait et à approuver la mise en oeuvre des traités. Le problème est qu’il faut tout faire d’ici le 29 mars 2919. Sur ce point, la constitution est claire.
Appendices
Notes
-
[1]
European Union Referendum Act 2015 (R-U), c 36.
-
[2]
Il s’agit même d’un objectif annoncé par les travaillistes au début de l’année 2000 en vue de la prochaine campagne législative.
-
[3]
European Communities Act 1972 (R-U), c 68 [ECA].
-
[4]
L’assentiment royal a été accordé au texte le 17 octobre 1972.
-
[5]
R (Miller and another) v Secretary of State for Exiting the European Union, [2017] UKSC 5 [Miller].
-
[6]
Bill 5, European Union (Withdrawal) Bill, sess 2017-2019, 2017 (sanctionné le 26 juin 2018 : European Union (Withdrawal) Act 2018 (R-U), c 16) [European Union (Withdrawal) Bill].
-
[7]
CJE, R (Factortame Ltd) v Secretary of State for Transport, C-213/89, [1990] ECR I-2466.
-
[8]
CJE, R (Factortame Ltd) v Secretary of State for Transport, C-221/89, [1991] ECR I-3956.
-
[9]
Constitution de la République française du 4 octobre 1958, JO, 5 octobre 1948, 9151 à la p 31.
-
[10]
Thoburn v Sunderland City Council, [2002] EWHC 195 (Admin), [2002] 4 All ER 156 (QB) [Thoburn].
-
[11]
European Union (Withdrawal) Act 2018, supra note 6.
-
[12]
Thoburn, supra note 10.
-
[13]
R (HS2 Action Alliance Ltd) v The Secretary of State for Transport, [2014] UKSC 3 [HS2].
-
[14]
Corte Costituzionale, 27 décembre 1973, Frontini Franco e dalla srl Commercio Prodotti Alimetari c Ministero delle finanze et al, (1974) Gazzetta Ufficiale no 2 du 2 janvier 1974, arrêt n° 183 [Frontini]; Bundesverfassungsgericht, 29 mai 1974, Internationale Handelsgesellschaft von Einfuhr und Vorratssetelle für Getreide und Futtermittel, 37 BVerfGE 271, [1974] CMLR 540 [Solange I]; Bundesverfassungsgericht, 22 octobre 1986, Re Wünsche Handelsgesellschaft, 73 BVerfGE 339, [1987] 3 CMLR 225, 2 Bvr 197/83 [Solange II]; Cons const, 19 juin 2008, Loi relative aux organismes génétiquement modifiés, (2008) JORF du 4 juin 2008 10228 no 3, 2008-564 DC [OGM]
-
[15]
Les termes employés par les différentes cours diffèrent. Nous nous contentons ici d’une synthèse. Pour des études plus approfondies, voir notamment Laurence Bourgogne-Larsen, dir, L’identité constitutionnelle saisie par les juges en Europe, Paris, Pedone, 2011.
-
[16]
Thoburn, supra note 10.
-
[17]
HS2, supra note 13.
-
[18]
Voir l’analyse de Paul Craig, « Constitutionalizing Constitutional Law : HS2 » (2014) PL 373; et aussi notre propre analyse : Alexandre Guigue, « L’identité constitutionnelle du Royaume-Uni et le droit de l’Union européenne dans la jurisprudence constitutionnelle du Royaume-Uni » (2016) 2 Revue du droit public 597.
-
[19]
Bill of Rights, 1688 (R-U), 1 Will & Mar Sess 2, c 2 [Bill of Rights].
-
[20]
Il s’agit de l’interprétation très stricte de la directive exprimée par les avocats généraux Kokott et Sharpston dans l’affaire Boxus et autres au sujet de l'article 1 au para 4 de la Directive de 2011 sur l'environnement. Voir CE, Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, [2012] JO, L 26/1, art 1(4) [Directive de 2011 sur l'environnement].
-
[21]
HS2, supra note 13 au para 207.
-
[22]
Ibid au para 79 : « Contrary to the submission made on behalf of the appellants, that question cannot be resolved simply by applying the doctrine developed by the Court of Justice of the supremacy of EU law, since the application of that doctrine in our law itself depends upon the 1972 Act. If there is a conflict between a constitutional principle, such as that embodied in article 9 of the Bill of Rights, and EU law, that conflict has to be resolved by our courts as an issue arising under the constitutional law of the United Kingdom. Nor can the issue be resolved, as was also suggested, by following the decision in R v Secretary of State for Transport, Ex p Factortame Ltd (No 2), [1990] UKHL 13, [1991] 1 AC 603, [1991] 1 All ER 70 (HL) since that case was not concerned with the compatibility with EU law of the process by which legislation is enacted in Parliament. ».
-
[23]
Scotland Act 1978 (R-U), c 51 [Scotland Act].
-
[24]
Parliamentary Voting Systems and Constituencies Act 2011 (R-U), c 1.
-
[25]
Northern Ireland Act 1998 (R-U), c 47.
-
[26]
Referendum Act 1975 (R-U), c 33.
-
[27]
European Union Referendum Act 2015 (R-U), c 36.
-
[28]
Miller, supra note 5, traduit par Denis Baranger; « L'arrêt Miller de la Cour suprême du Royaume-Uni : une traduction des passages principaux » (25 janvier 2017), Jus Politicum (blogue), en ligne : <blog.juspoliticum.com/2017/01/25/larret-miller-de-la-cour-supreme-du-royaume-uni-une-traduction-des-passages-principaux/> [Baranger].
-
[29]
L’expression récurrente dans le discours du Premier ministre Theresa May, est « Brexit means Brexit ».
-
[30]
Aurélien Antoine, « Le Brexit et le droit constitutionnel britannique » (2017) n°2 RDP à la p 261 et ss [Antoine, « Le Brexit »].
-
[31]
Bill 46, Terms of Withdrawal from EU (Referendum) Bill, sess 2016-2017, 2016 (1re lecture, 6 juillet 2016).
-
[32]
L’expression est de Walter Bagehot, The English Constitution, Londres, Oxford University Press, 2001 à la p 7.
-
[33]
Electoral commission, Referendum on membership of the European Union, Assessment of the Electoral Commission on the proposed referendum question, Sept. 2015, pp. 7-8.
-
[34]
Version consolidée du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, [2012] JO, C 326/49, art 50 (entré en vigueur : 1er janvier 1958, modification 13 décembre 2007) [TFUE].
-
[35]
Burmah Oil Co (Burmah Trading Ltd) v Lord Advocate [1965] AC 75, § 110. Traduit par Antoine, « Le Brexit », supra note 30.
-
[36]
McCord’s (Raymond) Application, [2016] NIQB 85.
-
[37]
R (Miller) v Secretary of State for Exiting the European Union, [2016] EWHC 2768 (Admin).
-
[38]
Miller, supra note 5, traduit par Baranger, supra note 28 au para 82.
-
[39]
Le débat le plus violent est celui qui a porté sur l’amendement défendu par le député conservateur Grieve (amendement 7 portant sur l’article 9 du projet de loi). Cet amendement qui a finalement été adopté par la chambre des communes contre l’avis du gouvernement a permis au Parlement d’obtenir l’assurance qu’il aura un vote décisif sur le projet d’accord entre le Royaume-Uni et l’UE avant la date de sortie officielle de l’UE. Voir European Union (Withdrawal) Act, supra note 6.
-
[40]
Voir Baranger, supra note 28 au para 82.
-
[41]
L’article 68 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 indique clairement qu’une notification peut être révoquée. Voir Convention de Vienne sur le droit des traités, 23 mai 1969, 1155 RTNU 354, art 68 (entrée en vigueur : 27 janvier 1980).
-
[42]
Miller, supra note 5, para 177.
-
[43]
Patrick Birkinshaw, « The Supremes Have Spoken. Silence Is Not Golden. Miller et al in the Supreme Court » (2017) 23:2 European Public Law 205.
-
[44]
Miller, supra note 5, traduit par Baranger, supra note 28 au para 82.
-
[45]
La règle figure dans plusieurs lois : Northern Ireland Act 1998 (R-U), c 47, art 5(6); Government of Wales Act 2006 (R-U), c 32, art 107(5); Scotland Act, supra note 23 section 28(7).
-
[46]
Scotland Act, supra note 23.
-
[47]
Bill of Rights, supra note 19.
-
[48]
Aurélien Antoine, « Les clauses Henry VIII : de quoi s’agit-il? » (20 juillet 2017) Observatoire du Brexit, en ligne : <brexit.hypotheses.org/861>.