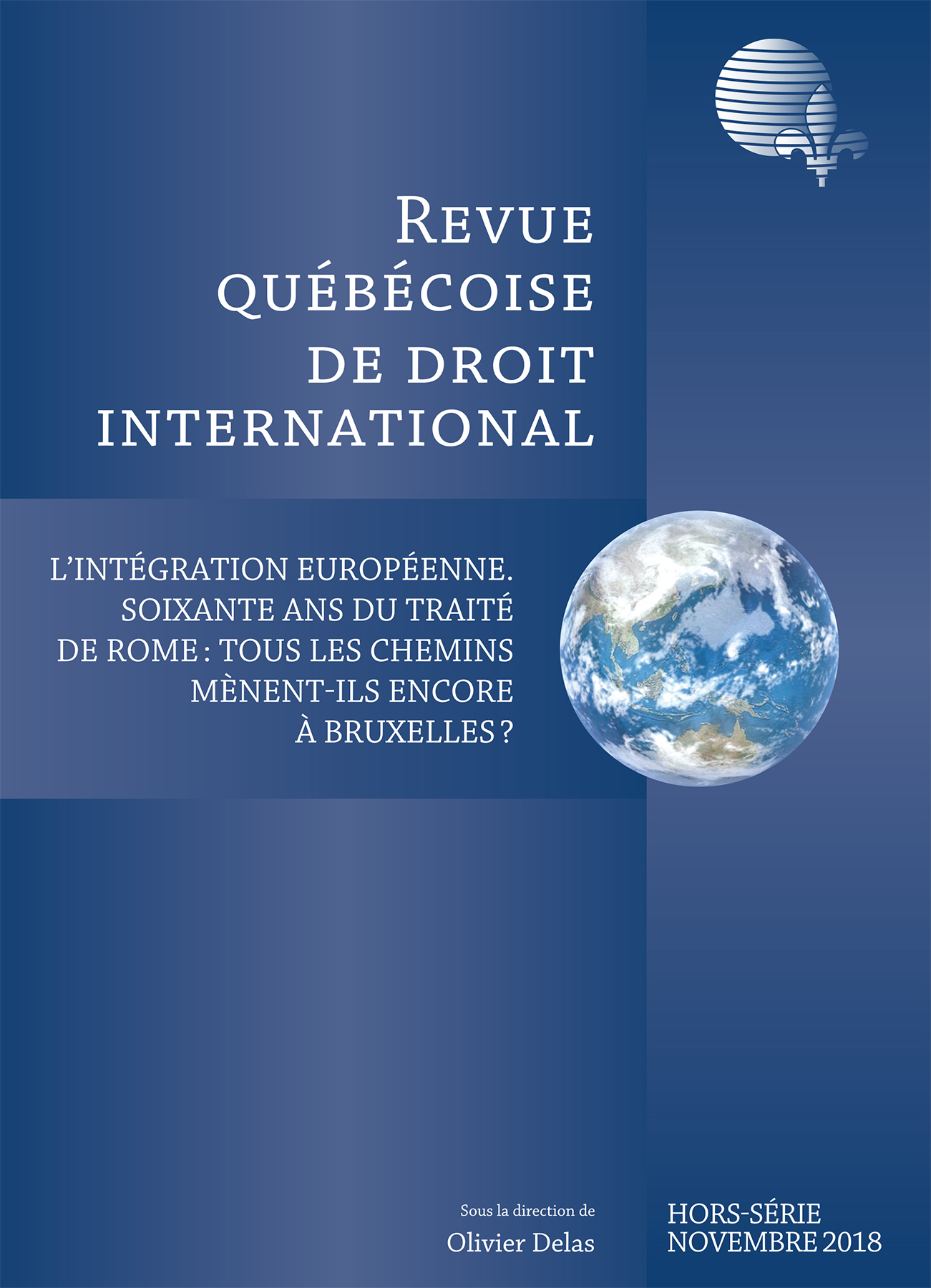Article body
Dans les sociétés historiquement constituées en États et Nations, la variété et la singularité des crises font que toute tentative de classification est impossible et vouée à l’échec. Si dans les faits, chaque crise émerge dans un contexte particulier et, quelle qu’ait été son issue, soit qu’elle ait été surmontée, soit qu’elle ait engendré une rupture brutale et définitive, elle s’inscrit toujours profondément dans l’histoire nationale et emporte souvent des conséquences durables d’ordre structurel. La crise ne doit dès lors pas être appréhendée seulement comme un fait d’exception, une interruption momentanée dans le développement ou le fonctionnement normal d’une société nationale, mais comme un élément fondateur aux incidences durables, voire même irréversibles. L’idée de perturbation ou de déséquilibre éclaire le court terme, mais ne répond pas à une analyse du long terme. Les politistes ont cependant tenté de procéder à une classification des crises dont il convient de dire quelques mots avant de se pencher sur la situation de la Communauté et de l’Union européenne. Dans l’ordre des sociétés internes, la crise peut — et cela est fréquent — s’attacher à la distribution des ressources ou des pouvoirs (tel est le cas des États fédéraux (ainsi la Confédération canadienne) ou des antagonismes entre provinces ou groupes ethniques dans des États unitaires. En Afrique, de nombreuses crises s’y apparentent.
Les crises de participation découlent quant à elles des comportements des acteurs, publics ou privés ; elles revêtent la forme de tensions sporadiques ou récurrentes que les sociétés démocratiques s’efforcent d’encadrer ou de réduire en tout ou partie. Les sociétés nationales connaissent également des crises de légitimité : le XIXe siècle français a été dominé par l’opposition entre la légitimité monarchique (initialement d’essence divine) et la légitimité républicaine (ou populaire) à partir de la Révolution française jusqu’à l’instauration de la 3e République… d’où la succession de deux cycles constitutionnels théorisés par Maurice Hauriou (école de Toulouse) et Maurice Duverger (école de Bordeaux). La crise de légitimité engendre également dans les sociétés contemporaines la critique du déficit démocratique tant l’achèvement de la démocratie demeure une asymptote jamais totalement accomplie. Assez proches, moins institutionnelles, mais encore plus graves sont les crises d’identité fondées sur la disparition ou la contestation de valeurs ou de symboles communs. L’allégeance des individus, citoyens ou des groupes est alors en question. Gramsci s’est prononcé sur les crises idéologiques des temps présents.
Cette classification est-elle transposable à la situation et à la nature de la Communauté et de l’Union européenne ? Soit à un ensemble en devenir qui ne repose pas sur un peuple unique et qui procède par voie d’intégration juridique et politique. La réponse doit être nuancée.
D’une part la crise européenne peut naître d’un seul État et ébranler les fondements de la construction européenne en mettant en péril les mécanismes et objectifs de l’intégration. Les doctrines et les théories de l’intégration ont pris acte de tels bouleversements réels ou potentiels. Ainsi les doctrines fédéralistes ont-elles glissé progressivement d’un fédéralisme quasi automatique à un fédéralisme revisité dont une forme, souvent évoquée par Jacques Delors, est l’association fédérale d’États qui conservent une large part de souveraineté. De même l’analyse fonctionnaliste, après avoir misé sur les mécanismes de « spill over » susceptibles de conduire de l’intégration économique à l’intégration politique s’est-elle orientée, sous l’influence de plusieurs évènements, vers un probabilisme, le néo fonctionnalisme. En analysant l’Europe comme un système politique, Lindberg a souligné le rôle des crises, sa facilité à changer, mais aussi sa stabilité, son évolution ponctuée de contradictions (« stop and go »). Avec l’analyse de système, la théorie se substitue à la doctrine. Aujourd’hui, le Brexit, ou les orientations politiques des dirigeants polonais et hongrois ouvrent une situation de crise globalisée.
D’autre part si l’Europe est sensible à l’influence d’un seul État, la classification précitée des crises peut lui être applicable. Elle a connu des crises fonctionnelles basées sur une thématique précise (exemple : la crise sanitaire dite de la « vache folle »). D’autres crises, parfaitement récurrentes ont un caractère institutionnel et s’attachent au fonctionnement des diverses institutions, à leur degré de légitimité ou aux frontières entre les compétences des États et celles de la Communauté ou de l’Union européenne. D’autres encore ont un caractère structurel et tournent autour de la nature de l’entreprise européenne ou de sa composition (exemple : les crises de l’élargissement passées ou actuelles). Enfin certaines crises ont un caractère idéologique, crise des soutiens que recueille (ou non) l’intégration européenne, crise du « vouloir vivre ensemble ». La crise idéologique de l’intégration européenne a été présente, sous des formes diverses et avec des acteurs différents, depuis le début des années cinquante et notamment à compter du Traité de Maastricht jusqu’au projet inabouti de constitution européenne.
On peut évoquer aussi assez, proche de la crise idéologique, la crise conceptuelle qui s’attache à la difficulté d’appréhender la nature intermédiaire de l’Europe, entre organisation internationale avancée et fédéralisme. À ces deux pôles s’arriment l’intergouvernementalisme et la supranationalité, source inépuisable de conflits et de controverses. Ainsi le déficit démocratique, si souvent allégué, est-il d’abord un déficit conceptuel. Le problème est : à quel degré d’intelligibilité se situe la construction européenne pour les élites et pour les opinions publiques ?
Dans une première partie, nous tenterons de proposer une morphologie des crises à partir de l’expérience — ou plutôt de quelques expériences — acquise(s) dans le passé ; dans une seconde partie, nous évoquerons les crises contemporaines de l’Union.
I. Morphologie des crises passées de l’Union
Les crises de l’Union que nous retenons ici présentent quelques caractéristiques, isolées parfois, conjuguées le plus souvent. Elles sont contingentes quant au moment ou aux causes immédiates de leur déclenchement. En ce sens elles font partie intégrante de l’histoire européenne dont elles forment une trame ininterrompue : l’histoire de la construction européenne, à travers la Communauté puis l’Union, c’est l’histoire des crises qui l’ont marquée, chaque crise illustrant un moment du processus d’intégration. Les échecs ou les non-réalisations du processus font partie d’une théorie positive de l’intégration, car ils en soulignent les difficultés, voire les impossibilités. De ce premier caractère en découle un second, à savoir que les crises de l’Union ont un caractère récurrent. Même dans les hypothèses (nombreuses) où elles ont été surmontées les facteurs de crise subsistent de manière permanente pour réémerger ou alimenter d’autres crises survenues ultérieurement.
Ce caractère de permanence, ou mieux de latence est au coeur de l’intégration européenne. Il est, a contrario, clairement illustré par le préambule du Traité sur l’Union européenne (TUE) : « nouvelle étape », « approfondir la solidarité », « renforcer (leurs) économies ainsi qu’à en assurer la convergence », « développement durable », « renforcement de la cohésion », au total créer « une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe ».
Chaque objectif est potentiellement porteur d’affrontements et de crises. De surcroît, les crises lorsqu’elles surviennent ont un caractère multidimensionnel, vu la pluralité et l’enchevêtrement de leurs composantes. Le président Juncker a utilisé l’expression « polycrise » qui traduit bien le caractère multidimensionnel de la crise actuelle comme de celles qui l’ont précédée. Toutes participent à un mixage des qualifications susmentionnées, accru par la pluralité des acteurs étatiques concernés et la diversité de leurs approches de l’Europe.
Par ailleurs les crises ont un caractère structurant. Leurs développements et les issues qui ont été dégagés après leur survenance influent durablement sur les structures, politiques ou institutionnelles, de la Communauté et de l’Union. Mieux encore, les crises ont eu une fonction fondatrice de la Communauté/Union ou une fonction réformatrice comme le montrent les rappels qui suivent.
A. La crise de la CED
Doublement fondatrice a été la crise de la Communauté européenne de défense (CED) de 1953-1954 à laquelle Raymond Aron et David Lerner ont consacré un ouvrage particulier, « La querelle de la CED » dans la collection Tribune Libre chez Plon. Alors que la France avec le plan Pleven avait proposé un compromis entre les demandes américaines de constituer une armée européenne et les méfiances que suscitait le projet (atteintes à la souveraineté internationale, acceptation du réarmement de l’Allemagne fédérale), l’Assemblée nationale avait voté une motion d’ajournement sine die, le gouvernement, divisé, étant présidé par Pierre Mendès-France. D’une part, à compter du refus français, la construction européenne sous la forme de communautés fonctionnelles sur le modèle de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) a été interrompue, ainsi que les projets de communautés spécialisées (agriculture, transports, santé), au bénéfice de la Communauté économique européenne qui comportait, ab initio, une dose moins importante de supranationalité, mais un domaine d’application beaucoup plus étendu. D’autre part, la construction européenne ultérieure a écarté toute compétence en matière de défense sauf deux exceptions. L’Union de l’Europe occidentale (UEO) créée en 1948 a été réaménagée en 1954 à l’issue du rejet de la CED. En dépit d’un essai de revalorisation dans le Traité de Maastricht qui envisageait une intégration de l’UEO dans l’Union européenne tout en marquant la prévalence stratégique et opérationnelle de l’OTAN, cette intégration n’a pas abouti. L’Union européenne s’est orientée de manière plus symbolique qu’effective, vers une identité « européenne de sécurité et de défense » avec le Traité de Nice, puis avec le Traité de Lisbonne qui comporte plusieurs dispositions en matière de défense : une clause de défense mutuelle (qui met fin à l’UEO), une clause de solidarité notamment en cas d’attaque terroriste, une coopération structurée permanente ouverte à certains des États à propos de laquelle certains dirigeants envisagent avec prudence qu’elle pourrait servir de base à une Europe de la défense[1]. Après l’échec du projet de Constitution, le Traité de Lisbonne a remis au Haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la Sécurité, qui fut introduit par le Traité d’Amsterdam, le statut et les prérogatives qui avaient été envisagés dans la Constitution pour le « ministre des Affaires étrangères ». Au total le rejet de la CED a durablement marqué la construction européenne. Encore que rien n’interdit de penser que la CED, à elle seule, n’aurait pu conduire à une Europe de la défense véritablement autonome vis-à-vis de l’OTAN.
B. La crise du financement
D’une intensité moindre, la crise du financement du budget communautaire a provoqué sinon un retournement du moins une inflexion significative de la notion de ressources propres qui avait émergé en 1969-1970 à l’approche de l’adhésion du Royaume-Uni à la Communauté. Dès cette adhésion, le Royaume-Uni s’opposa aux dépenses de la politique agricole commune (PAC) jugées excessives et contre-productives sur le plan économique. Or, les ressources propres étaient principalement constituées par les droits de douane et les prélèvements à l’importation des produits agricoles, le Royaume-Uni étant un gros importateur de produits agricoles issus du marché mondial. À la suite de la pression britannique, le règlement du 17 mai 1976 instaura une modulation de la participation de chaque État en fonction de l’évolution de son PIB. C’est au Conseil européen de Fontainebleau que le Royaume-Uni obtint une compensation des 2/3 de son solde négatif (différence entre sa part dans les versements et sa part dans l’affectation des dépenses) qui venait en déduction de sa part de TVA. Le « rabais » britannique fut consolidé par la suite et c’est en 1988 que le Conseil instaura une ressource dite « complémentaire » basée sur le PIB des États. Progressivement, la ressource complémentaire devint la ressource principale avec la réduction tendancielle des droits de douane, l’abaissement du taux d’appel de la TVA, puis la suppression des prélèvements à l’importation sur les produits agricoles en application des accords de l’OMC. Ainsi, la crise anglocommunautaire du financement a-t-elle contribué à réintroduire le critère classique des charges en usage dans les organisations internationales.
Le caractère structurant des deux crises précitées est manifeste et leurs conséquences sont perceptibles à l’heure actuelle, y compris à travers d’autres crises. Le Brexit a été nourri par la critique anglaise du financement de l’Union. Si Margareth Thatcher en 1984 réclamait « I want my money back », les europhobes Anglais affirmaient que la contribution britannique au budget de l’Union servait à financer les corridas en Espagne ! Le populisme actuel propage aisément des argumentations délirantes.
C. La crise dite de la « chaise vide »
Si la crise du financement a flambé sous l’impulsion du Royaume-Uni, la crise dite de la « chaise vide » (1965-1966) fut le premier affrontement entre le gouvernement de la Ve République et la Commission. Héritière de la Haute Autorité de la CECA, mais disposant de pouvoirs différents, la Commission a toujours été la cible des critiques gaullistes qui lui reprochaient son orientation supranationale et son absence de bases politiques. Comme nous le verrons plus loin[2], la critique n’est pas exclusivement française, mais elle a prospéré avec l’affrontement entre le général de Gaulle et le président de la Commission, Walter Hallstein. Outre ce facteur subjectif, le moment historique a été déterminant. La crise intervint à l’approche de la première élection du président français au suffrage universel alors que le corps électoral en milieu rural était encore large (près du quart des électeurs). Or, selon les dispositions du Traité de Rome, la politique agricole commune, qui a été mise en place sous le régime du vote à l’unanimité, pourrait être révisée, voire empêchée, par l’application du vote à la majorité qualifiée. En outre, libéré de la guerre d’Algérie, le général de Gaulle entendait initier sa grande politique étrangère (sortie de l’OTAN militaire, relations avec l’URSS, reconnaissance de la Chine de Pékin, ouverture au tiers-monde) sans compromettre avec un pouvoir qu’il considérait comme « extérieur » détenu par la Commission. La crise de la « chaise vide » peut être rapprochée du premier refus français de l’adhésion britannique, le Royaume-Uni étant considéré par Paris comme le « cheval de Troie » des États-Unis. La crise a été surmontée par une modification insidieuse du Traité, puisque le Compromis du Luxembourg du 30 janvier 1966 « au sujet du vote majoritaire » a, de facto, prolongé le vote à l’unanimité dans tous les domaines jusqu’en 1975, puis dans les domaines considérés comme d’importance majeure par les États (c’est-à-dire beaucoup) jusqu’à la conclusion de l’Acte unique en février 1986. Du Compromis du Luxembourg, il est resté un élément symbolique et même mythologique qui a été utilisé à maintes reprises par les courants eurosceptiques ou europhobes en France et aussi dans d’autres pays européens.
D. Le rejet du projet de Constitution européenne
Les deux référenda, français et néerlandais, intervenus à la fin du mois de mai 2005, ont enclenché le rejet du projet de Constitution européenne et ouvert une crise politique majeure dont les effets psychologiques et réels se font encore sentir aujourd’hui. Il est toutefois nécessaire d’observer que la crise était ouverte depuis le Traité de Maastricht fondateur de l’Union, bien que contenue par l’accomplissement des ratifications étatiques et dès lors que certains auteurs de la Constitution européenne espéraient l’effacer. Plusieurs États se saisirent du résultat négatif des référenda pour ne pas engager leurs propres processus de ratification. Commodité politique, mais surtout indice d’euroscepticisme partagé par le Royaume-Uni et certains États de l’Est !
La solution pour une sortie de crise, si elle s’inspira largement de la Constitution européenne sur le fond, comporte deux séries de modifications à travers l’élaboration du Traité de Lisbonne (aspect procédural) et au regard de son contenu (aspect matériel).
Sur le plan procédural, le Conseil européen a confié à la présidence allemande la charge d’organiser des consultations approfondies au cours du premier semestre 2007, en réalité des préconsultations à l’issue desquelles il décida la réunion d’une conférence intergouvernementale et lui confia un mandat très directif. Le mandat a été assorti d’annexes qui anticipaient les modifications que devait retenir la conférence intergouvernementale. Il s’agit donc d’une procédure de crise face à une situation exceptionnelle en rupture avec les révisions pratiquées antérieurement et, bien sûr, avec la procédure de la Convention qui avait conduit au texte constitutionnel.
Sur le plan matériel, si le Traité de Lisbonne reprend les principales modifications qui avaient été envisagées dans le projet de Constitution, certaines innovations vont dans le sens d’un ralentissement du processus d’intégration. On citera parmi celles-ci : le vote à l’unanimité assorti de la ratification par chaque État membre de l’Accord d’adhésion à la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) ; ou encore l’article 2 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) : « Les États membres exercent à nouveau leurs compétences dans la mesure où l’Union a décidé de cesser d’exercer la sienne[3] » ; et surtout l’article 5 du TUE : « En vertu du principe d’attribution, l’Union n’agit que dans les limites des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent[4]. »
En outre, le Traité de Lisbonne pousse plus loin que la Constitution les dispositions relatives au rôle des Parlements nationaux en ce qui concerne les projets d’actes législatifs (principe de subsidiarité), les domaines de l’espace de liberté, sécurité et justice (notamment les mesures relatives au droit de la famille), les procédures de révision des traités, puisque les Parlements nationaux sont tenus informés des prises de position du Conseil européen en matière de révision simplifiée et peuvent s’y opposer : la décision du Conseil européen n’est pas adoptée dès lors qu’un parlement national s’y oppose. La crise post-référendaire a donc conduit à un renforcement des États membres selon diverses modalités.
Dans le passé, d’autres crises mériteraient d’être mentionnées. Elles ont été analysées à peu près exhaustivement dans l’ouvrage dirigé par Claude Blumann et Fabrice Picod, L’Union européenne et les crises[5]. On soulignera l’interdépendance très forte entre les crises émanant d’un État et les crises de l’Union, les crises dans l’Union et les crises de l’Union. C’est un effet mécanique de la nature interactive de l’Union.
II. Systématique des crises actuelles de l’Union
La crise principale, permanente ou récurrente, englobe toutes les autres et s’avère porteuse d’autres tensions et crises : c’est la crise idéologique de l’intégration européenne dont nous pensons qu’elle a cheminé à compter du Traité de Maastricht, rompant avec l’état de grâce qu’avaient engendré l’Acte unique et la présidence Delors de la Commission. Les ambitions affichées dans le traité fondateur de l’Union ne pouvaient qu’irriter ceux qui n’étaient pas europhiles. De plus, elles risquaient de décevoir ceux qui étaient le plus attachés à la progression de la construction européenne : il faut admettre que les promesses de la politique étrangère et de sécurité commune n’ont pas été tenues et que la plupart des domaines sociaux et le domaine fiscal demeuraient verrouillés par la règle de l’unanimité, sauf quelques rares limites. La crise idéologique de l’intégration européenne revêt plusieurs aspects : crise des institutions, en dépit d’un effort de renouvellement, crise des valeurs qui surgit de manière vigoureuse dans certains États membres, crise du sens qui s’appuie sur la vague déferlante des populismes.
La crise de l’Union monétaire, et notamment son épisode grec, a constitué un déclencheur de critiques et de contestations. Des solutions partielles lui ont été données. À l’heure actuelle, l’Union monétaire constitue de manière paradoxale à la fois le point nodal de la crise et un facteur potentiel de restructuration au sein de l’Union européenne.
La crise migratoire a été un accélérateur de la crise globale (« polycrise » selon M. Juncker). Elle a été nourrie par les évènements internationaux et notamment la survenance d’un terrorisme globalisé. À cet égard l’environnement (les crises internationales) rétroagit sur l’Union, ses capacités et son fonctionnement. Une approche systémique des crises impose de prendre en compte les politiques des États tiers vis-à-vis de l’Union comme ce fut le cas pour l’ex-Communauté européenne. Le paradoxe actuel est que l’Union est sans doute plus en phase sur le seul plan politique avec la Chine (qui a toujours soutenu la construction européenne) qu’avec la Russie postcommuniste et l’Amérique de Donald Trump.
Enfin, après le référendum britannique sur l’appartenance à l’Union, la mise en oeuvre de l’article 50 du TUE : « Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l’Union[6] » a ouvert une crise inédite dont l’issue est parfaitement aléatoire.
A. La crise idéologique de l’intégration européenne
La crise idéologique de l’intégration européenne trouve ses origines lointaines dans le combat qui fut mené contre le projet de la CED. Elle a survécu à l’enterrement de la CED et a persisté de manière visible ou invisible tout au long de la construction européenne, élément d’un refoulé européen qui émerge sous la forme de débats très vifs dans des circonstances particulières : les pouvoirs de la Commission (1965), les compétences et l’élection des parlementaires au suffrage universel (1976), les élargissements de l’Union et leurs conséquences indirectes (le « plombier polonais » et la directive « travailleurs détachés »), l’éclatement de l’URSS qui prive l’Europe d’un ennemi fortement catalyseur, la libéralisation des échanges qui a un effet globalisant et réduit le protectionnisme et les instruments de défense économique dont disposait la Communauté originelle. Essayons de retracer les principales composantes de la crise idéologique.
L’Union s’efforce de renforcer sa légitimité alors que chaque État membre s’appuie sur une puissante légitimité acquise sur le long terme. La version française de l’État-nation issu de la Révolution, mais qui préexistait sous une autre forme sous la monarchie, ou la conception allemande des rapports entre l’État et le peuple illustrent cette légitimité historique. La Communauté-Union n’est pas un État, pas même fédéral, et ne s’appuie pas sur un peuple européen unitaire (demos)... d’où la devise de l’Europe : « Unie dans la diversité ». Les institutions mises en place par les traités constitutifs ont une fonction de gestion (que l’on retrouve dans toutes les organisations internationales) et une fonction de légitimation (que l’on retrouve dans toutes les organisations étatiques). Pour exercer leurs pouvoirs, elles se doivent d’être légitimes aux yeux des peuples européens sans que la légitimité naturelle des États qui les animent ne soit effacée. D’où un équilibre institutionnel et politique difficile et propice à des tensions entre l’intergouvernementalisme et la supranationalité.
Beaucoup ont pensé que l’élection des parlementaires au suffrage universel à compter de 1976 conférait au Parlement une aura démocratique telle que toute querelle sur sa légitimité deviendrait inappropriée. De plus, en droit européen, le Parlement, fort de cette nouvelle légitimité, a constamment accru ses pouvoirs au point de partager avec le Conseil à travers plusieurs étapes la fonction législative. Cependant, cette émergence démocratique n’a pas tari toutes les réserves à son encontre. La crise larvée a perduré pour des raisons d’ordre psychopolitique. Le Parlement n’a pas été perçu comme la traduction d’une allégeance communément partagée. L’élection européenne nourrit un jeu politique interne à chaque État, donc assez peu cohérent. Les modes de travail du Parlement (lieux de travail) ont pesé en ce sens. En pratique, les organisations politiques ont utilisé le scrutin européen comme un scrutin intermédiaire entre deux élections nationales (une commodité pour les candidats, un défoulement pour les électeurs). Le scrutin européen a paradoxalement favorisé l’émergence de partis ouvertement anti-européens. Cette dérive n’affecte pas à l’identique tous les États de l’Union. Il existe des modèles sérieux et d’autres qui le sont moins. La zone germano-nordique est considérée comme la plus respectueuse. L’indice de la crise a été l’augmentation des pouvoirs des parlements nationaux qui a culminé avec l’article 12, nouveau du Traité sur l’Union européenne, alors qu’auparavant ces dispositions figuraient dans des protocoles, voire des déclarations.
La Commission est au coeur du volet institutionnel de la crise idéologique. La Commission a utilisé son pouvoir de proposition et d’élaboration des actes juridiques dans le sens d’une certaine captation du pouvoir législatif attribué d’abord au Conseil puis au binôme Conseil — Parlement. Dans les hypothèses de désaccord entre le Conseil et le Parlement, elle a joué un rôle arbitral tout en préservant son pouvoir d’information et de consultation des acteurs concernés, les États, mais également les groupes publics, les acteurs privés ou les syndicats. La consultation systématique d’une pléiade d’acteurs transforme de manière mécanique la consultation en négociation. Par ailleurs, ayant acquis le pouvoir d’exécution des actes qui appellent des mesures uniformes d’exécution ou des actes déterminés par le binôme législatif, la Commission se situe en amont et en aval de la décision législative, disposant ainsi d’une capacité opérationnelle renforcée. La critique d’une « hystérie réglementaire » a été formulée à son encontre à l’expiration de l’Acte unique puisque celui-ci avait ouvert à la Commission la possibilité d’initier des mesures de rapprochement que le Conseil pouvait arrêter à la majorité qualifiée. La méfiance qui a frappé la Commission a été favorisée par la montée en puissance du Parlement européen (codécision puis procédure législative) ; elle a été accrue au tournant des années 2007-2008 par la crise du système monétaire[7] et aujourd’hui, si la Commission conserve le pouvoir d’initiative sur le plan juridique, politiquement ce pouvoir est préempté par le Conseil et, de plus en plus fréquemment, par le Conseil européen.
La crise idéologique de l’Union est aussi une crise sur les valeurs qu’elle affiche pourtant avec force. Les valeurs de l’Union (article 2 du TUE[8]) sont aujourd’hui une condition de l’adhésion (ex ante) et en outre leur violation par un État membre (ex post) peut faire l’objet de sanctions (y compris la suspension de son droit de vote), de même que le risque de leur violation peut provoquer une recommandation du Conseil. Ce dispositif, inscrit dans l’article 7 du TUE, avait été étendu à la prévention à l’occasion de la « crise autrichienne » par le Traité de Nice. Si la « crise autrichienne » a permis un développement de la norme écrite dans l’article 7, une crise des valeurs a surgi postérieurement au Traité de Lisbonne du fait des comportements de certains États de l’Europe à l’Est. Le cas de la Pologne apparaît symptomatique ; plusieurs projets de lois ont été adoptés portant sur la nomination des présidents des tribunaux ordinaires, la composition — et le choix des membres — de la Cour suprême et du Conseil national de la magistrature. En janvier 2016, la Commission a engagé une procédure originale en vue de la « sauvegarde de l’État de droit » à l’encontre de la Pologne, en quelque sorte une procédure préarticle 7 qui a pour effet d’ouvrir un dialogue entre la Commission et le gouvernement polonais. Pour l’heure le dialogue n’a pas produit d’effets positifs. En outre, le dispositif de l’article 7 n’est pas dénué d’ambiguïtés puisque, si le risque d’une violation grave doit être constaté à la majorité des 4/5e du Conseil, le constat de la violation — dès lors qu’elle s’avère « grave et persistante » ne peut être activé que par le Conseil européen statuant à l’unanimité. La Hongrie a déjà fait savoir qu’elle ne voterait pas le constat. Si le constat est effectif, la sanction éventuelle, par exemple la suspension du droit de vote au Conseil, pourrait intervenir au Conseil à la majorité qualifiée. Les rédacteurs de l’article 7 ont pris soin de rendre, sinon impossible, du moins difficile l’activation complète de l’article 7. Si l’épisode polonais illustre bien la crise des valeurs de l’Union, il démontre, une fois encore, que la source du mal-être doit être recherchée au sein même des États membres — ou de certains États membres — de telle sorte que, en matière politique comme en matière économique, la crise de l’Union européenne est un aspect de la crise plus générale de l’Europe.
Récemment c’est en septembre 2018 que le Parlement européen a pris l’initiative d’activer l’article 7 à l’encontre de la Hongrie sur la base de griefs proches de ceux adressés à la Pologne : menaces pour la liberté de la presse et pour la libre activité de certaines ONG, réformes de la justice et de la constitution…
La stratégie visant la Pologne a évolué entre temps. Compte tenu de l’incertitude quant à l’obtention de la majorité requise au Conseil et de la certitude de ne pas obtenir l’unanimité au Conseil européen dans la phase finale, la Commission s’oriente désormais sur les procédures d’infraction plus classiques notamment en cas de violation de l’accès à une « justice indépendante et impartiale » (art. 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne[9]).
Deux observations s’imposent au sujet de la crise des valeurs de l’État de droit. En premier lieu, elle est étroitement corrélée à la crise migratoire grâce à laquelle elle a pu prospérer en Pologne, en Hongrie et au-delà. En second lieu, elle traduit l’émergence (ou le retour) de deux conceptions différentes de la démocratie. D’abord une conception unidimensionnelle selon laquelle la démocratie se réduit à des consultations électorales dès lors qu’elles sont organisées régulièrement de manière libre et dans le respect du pluralisme politique. Il parait utile de constater que cette conception minimaliste est dominante dans les pays de l’Europe de l’Est où le passage du parti unique avec une problématique électorale biaisée au pluripartisme inspiré des pratiques occidentales classiques est perçu largement par les opinions publiques comme nécessaire et suffisant. En ce sens le progrès démocratique décisif serait déjà intervenu au début des années soixante-dix. La seconde conception, en quelque sorte pluridimensionnelle, intègre dans le concept démocratique une longue série d’éléments — dont la liste n’est jamais d’ailleurs définitivement close : les normes, les droits individuels, les jurisprudences nationales, internationales et européennes, les procédures administratives ou judiciaires, les voies de recours ouvertes aux citoyens. Manifestement, le droit européen s’inscrit dans les complexités de la seconde conception à tel point qu’il a pu être présenté comme le produit des élites et non des peuples eux-mêmes.
Reste la crise du sens de la construction par l’Union européenne. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’intention des pères fondateurs était claire, il s’agissait d’éviter définitivement le retour à la guerre qui avait déchiré et ruiné l’ensemble du continent. Cet objectif a été atteint avec le concours déterminant de l’Alliance atlantique et de l’équilibre de la terreur. Le Traité instituant la CECA était déjà un traité de paix avec l’Allemagne, puissance réhabilitée et placée sous contrôle par l’application des règles initiales de la concurrence. Le Traité de Rome, relancé par l’Acte unique, visait à l’accomplissement d’un marché commun, devenu marché unique, socle de l’intégration européenne et tremplin — beaucoup le pensaient — vers l’intégration politique. En dépit de son incomplétude, le Traité de Maastricht devait initier cette grande étape politique. Un paradoxe : la Communauté perd son étiquette « économique » au moment même où est mis en place le projet d’union monétaire, donc la monnaie unique. Les difficultés pour appréhender le sens de la marche en avant se sont accrues auprès des opinions publiques au fur et à mesure que les obstacles économiques traditionnels s’effaçaient avec la généralisation du libre-échange en Europe et que des défis nouveaux devenaient de plus en plus prégnants : crise de la PAC menacée d’obsolescence, faibles progrès de la politique sociale européenne, hétérogénéité fiscale persistante... Le chômage de masse et l’affaiblissement des classes moyennes ont fait entrer dans les esprits que la construction européenne, à laquelle la majorité des Européens demeure cependant attachée, doit être corrigée dans le sens d’un retour vers des régulations arrêtées nationalement. Le sens de la construction s’est égaré tendanciellement et les Européens ont mal vécu la montée des pays émergents. L’idée d’intégration a été alors fermement orientée vers la défense des acquis démocratiques européens avec le concours des juridictions européennes et nationales, et de la Convention européenne des droits de l’homme. L’Union s’efforce aussi de maintenir un équilibre entre une capacité économique, concurrencée par des centres extérieurs, et une couverture sociale, entamée par les politiques libérales et néolibérales. L’Union européenne a donc été conduite à endosser la crise de l’Europe et, dans les pays membres, les tenants du nationalisme ou du populisme en ont profité pour imputer les difficultés et les échecs économiques à l’Union européenne. Aujourd’hui le plus grand nombre s’accorde à proposer une relance de l’Europe de manière plus ou moins précise.
B. La crise du système monétaire
La crise du système monétaire a servi de déclencheur. La monnaie unique, outre ses aspects politiques, visait à consolider le marché intérieur en excluant les dévaluations compétitives et répondre à la libre circulation des capitaux. Dès l’origine elle comportait une dysfonction, un découplage entre la politique monétaire (centralisée) et les politiques économiques régies par une procédure souple dite de « coordination des politiques économiques » qui n’appelait pas de sanctions. Pour y pallier, la mise en place de la monnaie unique a été précédée par le Pacte de stabilité et de croissance, soit un ensemble de règlements qui précisait les obligations des États, de la Commission et du Conseil. Dès 2003-2004, le pacte a été suspendu de facto à la suite des positions française et allemande et le système monétaire a enregistré une série de crises : crise des subprimes (dont l’origine est américaine), crise bancaire qui a justifié des aides massives des États, crise des dettes souveraines (l’endettement en euros a été facilité pour les pays du Sud, notamment la Grèce). Diverses mesures et projets ont conduit à recourir à la technique du droit complémentaire, c’est-à-dire un accord intergouvernemental qui s’ajoute au TUE, faute d’obtenir un consensus unanime pour le réviser. C’est le Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé en mars 2012, mais refusé par le Royaume-Uni et la République tchèque. Le traité introduit la notion de déficit structurel, 0,5 % du PIB, déficit corrigé des variations de la conjoncture, il accorde à la Commission des pouvoirs nouveaux afin d’examiner les projets des budgets nationaux et proposer, s’il y a lieu, des sanctions au Conseil lequel devra réunir une majorité qualifiée pour les rejeter.
La crise du système monétaire a provoqué des modifications institutionnelles pérennes sur le sous-système monétaire et sur le système général de l’Union. Après l’épisode temporaire du fonds de stabilité, une organisation autonome a été mise en place pour venir en aide à la Grèce : le Mécanisme européen de stabilité (MES) assure des prêts aux États et aujourd’hui certains proposent de transformer le MES en un véritable Fonds monétaire européen. Par ailleurs, la Banque centrale européenne a recouru à une technique que le Traité sur l’Union européenne n’interdit pas formellement sous la forme d’un rachat des titres de dette publique sur le marché secondaire (et non pas au moment de leur émission). Afin de limiter les effets du découplage entre les « in » et les « out », c’est le président du Conseil européen qui assure la présidence du sommet des États membres de la zone euro.
Le système général de l’Union a été entraîné par les effets institutionnels de la crise. Celle-ci s’est traduite par un effacement de la Commission et la prévalence du Conseil européen. Le transfert a été favorisé par la montée en puissance des mécanismes intergouvernementaux à propos de la monnaie et, par contagion, hors monnaie. Si sur le plan juridique, la Commission conserve de jure son pouvoir de proposition, les États et surtout le Conseil européen sont aujourd’hui en situation de préempter son pouvoir de proposition et définir les orientations et même le contenu de la législation de l’Union. Au total, la crise de l’euro, ou plus exactement la crise du système monétaire européen, aboutit à une mutation/évolution du système institutionnel de l’Union favorisée par le Traité de Lisbonne, soit un renforcement du Conseil européen et des États au détriment de la Commission.
Ce n’est pas un hasard si le président Juncker a proposé en septembre 2007 de fusionner la présidence de l’Eurogroupe (les ministres des Finances de la zone euro) avec la vice-présidence (économie) de la Commission. Le projet s’inspire du modèle existant en matière de politique étrangère et de sécurité. Il s’écarte sur ce point de la préférence française actuelle pour un Parlement et un budget propres à la zone euro. La question demeure : la crise pourra-t-elle conduire à une restructuration de l’Union autour de la zone euro ? La réponse, si elle doit venir, viendra plus tard.
C. La crise migratoire
La crise migratoire a été l’accélérateur de la crise globale. L’origine des migrations tient aux situations régionales extraeuropéennes dont le développement démographique et les situations de guerre civile en Afrique (Érythrée, Soudan…) et au Moyen-Orient (Syrie, Yémen, Afghanistan...). La conjugaison de ces différents facteurs a favorisé des amalgames soigneusement entretenus en vue d’alimenter un climat anxiogène, lui-même porteur d’un anti-européanisme virulent : confusion entre les migrations endogènes (couvertes par le principe de libre circulation des personnes à l’intérieur de l’Union) et les migrations externes, estimées porteuses de terrorisme par diverses organisations politiques ; confusion entre les migrations ordinaires dont beaucoup ont un caractère économique, et les demandes d’asile, droit protégé par des dispositions du droit constitutionnel national, par des traités de droit international (Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et son protocole additionnel de 1967) et par le droit européen (article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne) qui a jeté les bases d’une possible politique commune d’asile (article 78 du TFUE).
En matière d’asile, les normes de Schengen (Convention d’application de l’Accord de Schengen) et la Convention de Dublin du 14 juin 1990 instituaient un traitement des demandes d’asile par un seul État, l’État par le territoire duquel est entré le demandeur d’asile. Ce sont donc les États périphériques qui doivent gérer les frontières extérieures de l’Union au premier rang desquels la Grèce et l’Italie, sans que soit organisée la possibilité de présenter une demande d’asile avant d’entrer sur le territoire de l’Union. Avec l’alourdissement des flux migratoires entre 2013 et 2015, un processus volontaire de relocalisation a échoué du fait des résistances des États membres du « groupe de Visegrad » (groupe originellement constitué afin d’appuyer les demandes d’adhésion à l’Union !) et des réserves des États baltes et de l’Espagne. Sur proposition de la Commission, le Conseil a adopté à la majorité qualifiée en septembre 2015 des dérogations temporaires à l’article 13 du Règlement Dublin, successeur de l’accord initial selon des critères quantitatifs extrêmement complexes : ces décisions sont présentées « au profit de l’Italie et de la Grèce ». C’est la procédure de « relocalisation d’urgence ».
En mars 2016, un accord a été passé avec la Turquie qui a réduit drastiquement les passages de la Turquie vers la Grèce. Cette sous-traitance par externalisation de la question migratoire — qui n’exclut pas un regain de tension entre l’Union et la Turquie — pourrait-elle être étendue à la Libye ? On peut en douter compte tenu de la situation politique interne en Libye, l’absence traditionnelle d’État et la coexistence de pouvoirs politiques en concurrence. La Cour de justice, dans un arrêt non encore publié du 6 septembre 2017, a jugé que le mécanisme de la relocalisation d’urgence est conforme au droit de l’Union et a réaffirmé à cette occasion que le principe de solidarité entre États membres s’avère adéquat. Dans les faits, le bilan est décevant puisque seules 30 000 demandes d’asile ont bénéficié de la « relocalisation » au lieu d’un total prévu de 160 000.
D. La crise du Brexit
La crise du Brexit[10], ouverte par le référendum britannique du 23 juin 2016, s’inscrit dans une genèse longue. En effet les fondamentaux de la crise imposent de revenir à la situation juridique du Royaume-Uni dans l’Union. Situation exceptionnelle dans la mesure où le Royaume-Uni est parvenu à négocier une série de dérogations statutaires et à en accroître l’ampleur à chaque étape de la construction européenne. Si certaines ont déjà été évoquées[11], bien d’autres indices sont à mentionner : le rejet initial de la CECA, jugée à la fois libérale sur le plan économique et supranational sur le plan politique ; la préférence pour une grande zone de libre-échange en 1955-1956 et l’hostilité au marché commun agricole (renouvelée à la veille de l’adhésion) ainsi que le maintien de l’autonomie des relations commerciales extérieures ; la non-appartenance à l’espace Schengen, droit conventionnel transformé en droit dérivé sur la base du Traité d’Amsterdam, encore que le Royaume-Uni ait obtenu la possibilité de s’associer à diverses normes relevant de Schengen et que par ailleurs certaines normes relevant de l’espace de liberté, de sécurité et de justice soient applicables au Royaume-Uni (Protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice). Le Royaume-Uni a également obtenu, sur la base d’un autre protocole (n° 15) la non-participation à la troisième phase de l’Union économique et monétaire, soit l’institutionnalisation de la monnaie unique à partir de la réalisation effective des cinq critères de convergence économique. Un protocole joint au Traité de Lisbonne précise que, en ce qui concerne le Royaume-Uni et la Pologne, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’autorise pas le juge communautaire ou les juridictions nationales à juger le droit national contraire à ses prescriptions. Pour le Royaume-Uni les droits sociaux pour être applicables doivent faire partie de son droit national.
À l’approche du référendum, et afin d’en obtenir une issue positive, un arrangement tout à fait contestable avait été conclu en février 2016 entre le Royaume-Uni et les 27 autres États membres de l’Union ainsi rédigé :
Il est admis que, eu égard à sa situation particulière en vertu des traités, le Royaume-Uni n’est pas tenu de prendre part à une intégration politique plus poussée dans l’Union européenne […] les références à une union sans cesse plus étroite ne s’appliquent pas au Royaume-Uni […] les références à une union sans cesse plus étroite entre les peuples […] n’obligent pas l’ensemble des États membres à aspirer à un destin commun[12].
L’incongruité et la lâcheté du texte de l’arrangement illustrent les manipulations politiques, et mêmes politiciennes, qui ont émaillé la préparation du référendum. Pour le premier ministre David Cameron, il s’agissait de surmonter l’opposition interne de ceux des conservateurs tout à fait ou plutôt hostiles à l’intégration européenne. Pour Boris Johnson, se hisser dans la hiérarchie politique et succéder au premier ministre (quel que soit le résultat du référendum). Pour le leader travailliste, J. Corbin, éviter de heurter de front les bataillons régionaux europhobes de son parti. L’arrangement illustrait jusqu’à la caricature la crise idéologique de l’intégration. Pour l’heure, le référendum, confirmé par une loi que les plus hautes juridictions britanniques ont jugé constitutionnellement nécessaire[13], a entraîné la mise en oeuvre de l’article 50 du TUE. Les défis sont multiples de part et d’autre. L’Union européenne doit maintenir, tout au long des négociations, une position aussi unanime que possible sauf à renforcer la position du Royaume-Uni. Par ailleurs, l’accord de retrait, s’il est conclu au nom de l’Union par le Conseil statuant à la majorité qualifiée, devra « tenir compte du cadre de ses relations futures avec l’Union[14] ». Les négociations sont alourdies par l’opposition en Angleterre entre les partisans d’une sortie relative (Brexit « mou ») et les tenants d’une rupture totale (Brexit « dur ») ainsi que par la question de la frontière irlandaise. À l’approche de l’expiration du délai de deux ans institué dans l’article 50, la perspective d’un « no deal » tend à se rapprocher d’autant que les points de vue européen et anglais diffèrent également.
C’est dire que les rédacteurs du Traité de Lisbonne ont clairement indiqué que les négociations de l’accord de retrait ne peuvent être totalement séparées des accords ultérieurs qui régiront la situation du Royaume-Uni au regard de l’Union. Le nombre des options étant élevé, il n’est pas exclu que le Conseil européen soit amené à proroger le délai au-delà de deux ans. Pour l’essentiel, il restera aux États membres de l’Union à procéder à un aggiornamento de l’Union, une véritable refondation que, paradoxalement, de nombreux dirigeants et acteurs politiques ou économiques appellent de leurs voeux. La crise est bien contingente, récurrente, multidimensionnelle et pourrait s’avérer au total (re)fondatrice. Mais cela c’est encore la musique de l’avenir.
Appendices
Notes
-
[1]
CE, Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et instituant la Communauté européenne, [2007] JO, C 306/01.
-
[2]
Voir la partie II-A, ci-dessous.
-
[3]
CE, Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, [2012] JO, C 326/01, art 2.
-
[4]
CE, Traité sur l’Union européenne (version consolidée), [2012] JO, C 326/01, art 5.
-
[5]
Claude Blumann et Fabrice Picod, dirs, L’Union européenne et les crises, Paris, Éditions Bruylant, 2011.
-
[6]
CE, supra note 4, art 50.
-
[7]
Voir la partie II-B, ci-dessous.
-
[8]
« L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes. » CE, supra note 4, art 2.
-
[9]
CE, Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, [2012] JO, C 326/02, art 47.
-
[10]
On se reportera à l’intéressant numéro 2016/4 de la Revue des affaires européennes.
-
[11]
Voir la partie I-B, ci-dessus.
-
[12]
CE, Un nouvel arrangement pour le Royaume-Uni dans l’Union européenne, [2016] JO, C69 I/01.
-
[13]
La loi a été votée le 13 mars 2017, le référendum n’ayant qu’un caractère consultatif et le European Communities Act, acte législatif doté d’un caractère constitutionnel, ayant été adopté en 1972. De ce parallélisme, il en découle que le Parlement devra examiner, voire approuver, l’accord de retrait à venir.
-
[14]
CE, supra note 4, art 50.