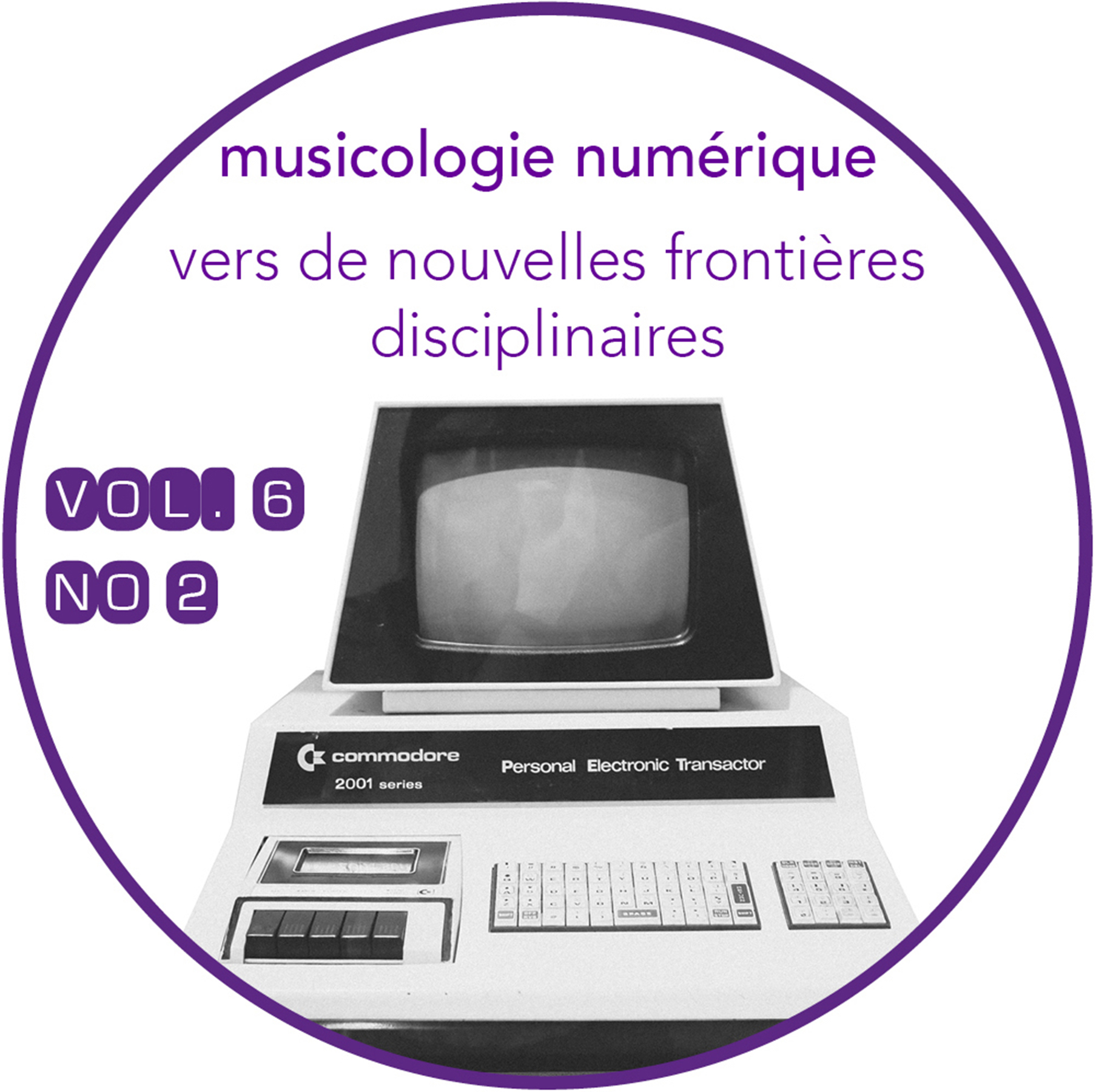Abstracts
Résumé
Des premières utilisations de base de données dans les années 1970 aux travaux récents portant sur l’analyse de fichiers audio, les musicologues ont progressivement intégré l’usage des technologies numériques dans leurs méthodes de travail. Toutefois, si quelques logiciels comme iAnalyse proposent des interfaces adaptées aux sciences humaines, force est de constater que ces technologies restent encore difficiles à manipuler sans de solides bases en informatique ou en acoustique. Dans cet article, l’auteur présente une pratique interdisciplinaire de la recherche à la base de la musicologie numérique qui couvre un champ d’activités très vaste allant de l’usage de logiciels pour améliorer les méthodes existantes au développement de nouvelles méthodes indispensables à l’étude de certains corpus. Dans ce dernier cas, la modification profonde de la nature même de la pratique musicologique, le décentrement vers une discipline hybride et le changement de perspective sur un objet musical complexe mettent en évidence une véritable rupture épistémologique.
Mots-clés :
- analyse musicale,
- interdisciplinarité,
- musicologie numérique,
- recherche d’information musicale,
- représentation graphique
Abstract
From the first uses of databases in the 1970s to recent research on the analysis of audio files, musicologists have progressively integrated digital technologies into their working methods. However, while some software such as iAnalyse offers interfaces adapted to the human sciences, it has been observed that these technologies are still difficult to manipulate without a solid knowledge of computer science or acoustics. In this article, the author presents an interdisciplinary practice of research at the heart of digital musicology that covers a very wide field of activities ranging from the use of software to improve existing methods to the development of new methods that are necessary to study specific corpus. In this case, the deep transformation of the nature of musicological practice itself, the move towards a hybrid discipline and the change of perspective on a complex musical object highlight a real epistemological rupture.
Keywords:
- digital musicology,
- graphical representation,
- interdisciplinarity,
- music information retrieval,
- musical analysis
Appendices
Bibliographie
- Bachelard, Gaston ([1938]2011), La formation de l’esprit scientifique, Paris, Vrin.
- Bachimont, Bruno (2013), « Préservation culturelle numérique », dans Évelyne Gayou (dir.), Musique et technologie. Préserver, archiver, re-produire, Portraits polychromes hors-série, Paris, Ina, p. 11-32.
- Barkati, Karim, et Francis Rousseaux (2012), « How to Understand Digital Studio Outputs. The Case of Digital Music Production », 1st ifip International Workshop on Artificial Intelligence for Knowledge Management (ai4km), août, Montpellier, p. 151-169, https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01256590, consulté le 21 janvier 2020.
- Barthes, Roland (1984), Le bruissement de la langue, Essais critiques IV, Paris, Le Seuil.
- Bayle, François (2018), « La musique concrète est un enfant du théâtre et la radio d’essai fut son berceau », dans Albane Penaranda (prod.), France Culture.
- Becker, Howard (2010), Les mondes de l’art, Paris, Flammarion.
- Besnier, Jean-Michel (2013), « Seul le désordre est créateur. Pour en finir avec les bataillons disciplinaires », Hermès, vol. 67, p. 25-31.
- Bonardi, Alain, et Francis Rousseaux (2011), « L’émergence de pratiques musicales a-musicologiques » Musiker-Cuadernos de mùsica, no 18, p. 99-115.
- Bonardi, Alain, Serge Lemouton, et Laurent Pottier (2019), « Présentation du groupe de travail afim Archivage collaboratif et préservation créative », dans Journées d’informatique musicale, Bayonne, Labri, scrime, gdrimiami, https://jim2019.sciencesconf.org/data/pages/BonardiLemoutonPottierWarnier.pdf, consulté le 15 juillet 2019.
- Charaudeau, Patrick (2010), « Pour une interdisciplinarité “focalisée” dans les sciences humaines et sociales », Questions de communication, vol. 17, p. 195-222.
- Clarke, Michael (2012), « Analysing Electroacoustic Music. An Interactive Aural Approach », Music Analysis, vol. 31, no 3, p. 347-380.
- Cook, Nicholas (2005), « Towards the Compleat Musicologist », 6th International Conference on Music Information Retrieval, London, http://ismir2005.ismir.net/documents/Cook-CompleatMusicologist.pdf, consulté le 23 juin 2019.
- Cook, Nicholas (2014), Beyond the Score, Oxford, Oxford University Press.
- Couprie, Pierre (2016a), « EAnalysis. Developing a Sound Based Music Analytical Tool », dans Simon Emmerson et Leigh Landy (dir.), Expanding the Horizon of Electroacoustic Music Analysis, Cambridge, Cambridge University Press, p. 170-194.
- Couprie, Pierre (2016b), « Voyage dans “Grandeur nature” », dans François Bayle (dir.), Son vitesse-lumière, Paris, Magisson, p. 47-57.
- Couprie, Pierre (2018a), « Methods and Tools for Transcribing Electroacoustic Music », dans Sandeep Bhagwati et Jean Bresson (dir.), Proceedings of the International Conference on Technologies for Music Notation and Representation - tenor’18, Montréal, Université Concordia, http://tenor-conference.org/proceedings/2018/02_Couprie_tenor18.pdf, consulté le 20 juillet 2019.
- Couprie, Pierre (2018b), « Nouvelles approches audionumériques pour l’analyse musicale », Musicologies nouvelles, vol. 5, p. 120-132.
- Coutellec, Léo (2015), « Pour une philosophie politique des sciences impliquées. Valeurs, finalités, pratiques », Presses de Sciences Po, no 51, p. 15-25.
- Debussy, Claude (1894a), Prélude à l’après-midi d’un Faune, Berliner Philharmoniker, Simon Rattle (chef d’orchestre), emi Classic 7243 5 58045 2 5.
- Debussy, Claude (1894b), Prélude à l’après-midi d’un Faune, Orchestre de l’Opéra National de Paris, Philippe Jordan (chef d’orchestre), Naïve V 5332.
- Debussy, Claude (1894c), Prélude à l’après-midi d’un Faune, Orchestre Nationale de Lyon, Jun Märkl (chef d’orchestre), Naxos 8.570775.
- Henry, Pierre (2012), « Le Fil de la vie. Prologue – poème », programme du concert Pierre Henry Le Fil de la vie, samedi 29 septembre 2012, Paris, Philharmonie de Paris, p. 4-6.
- Huutoniemi, Katri, et al. (2010), « Analyzing interdisciplinarity. Typology and Indicators », Research Policy, no 39, p. 79-88.
- Kasavin, Ilya T. (2008), « L’idée d’interdisciplinarité dans l’épistémologie contemporaine », Diogène, no 223, p. 38-57.
- Magas, Michela, et al. (2013), Roadmap for Music Information Research, MIReS Consortium, http://hdl.handle.net/10230/21766, consulté le 12 juillet 2019.
- Malt, Mikhail, et Emmanuel Jourdan (2015), « Le “BStD” – une représentation graphique de la brillance et de l’écart type spectral, comme possible représentation de l’évolution du timbre sonore », dans Xavier Hascher, Mondher Ayari, Jean-Michel Bardez (dir.), L’analyse musicale aujourd’hui, Paris, Delatour, p. 111- 128.
- Miller, Raymond C. (1982) « Varieties of Interdisciplinary Approaches in the Social Sciences », Issues in Integrative Studies, no 1, p. 1-37.
- Morin, Edgar (1994), « Sur l’interdisciplinarité », Bulletin interactif du Centre international de recherches et études transdisciplinaires, no 2, http://www.ciret-transdisciplinarity.org/bulletin/b2c2.php, consulté le 1er juillet 2019.
- Nattiez, Jean-Jacques (2007), « Unité de la musique… unité de la musicologie ? », dans Jean-Jacques Nattiez (dir.), Musiques. Une encyclopédie pour le xxie siècle, « Vol. 5. L’unité de la musique », Arles/Paris, Actes Sud/Cité de la musique, p. 1197-1211.
- Perriault, Jacques (2002), L’accès au savoir en ligne, Paris, Odile Jacob.
- Popper, Karl R. ([1959]1973), La logique de la découverte scientifique, Paris, Payot.
- Resweber, Jean-Paul (2011), « Les enjeux de l’interdisciplinarité », Questions de communication, vol. 19, p. 171-200.
- Risset, Jean-Claude (2010), « À propos d’interdisciplinarité. Synthèse, traitement, perception, musicologie et stic, oeuvre musicale et mixité », Journées d’informatique musicale, Rennes, Université de Rennes 2, http://jim10.afim-asso.org/actes/keynoteRisset.pdf, consulté le 28 juin 2019.
- Rosnay, Joël de (1975), Le macroscope. Vers une vision globale, Paris, Seuil.
- Schaeffer, Pierre (1966), Traité des objets musicaux, Paris, Seuil.
- Schaeffer, Pierre (1971), De l’expérience musicale à l’expérience humaine, Paris, Richard-Masse.
- Scott, Derek (1998), « Postmodernism and Music », dans Stuart Sim (dir.), The Routledge Companion to Postmodernism, Londres, Routledge, p. 106-115.
- Selfridge-Field, Eleanor (2017), « A Topography and Taxonomy of Digital Musicology », Arti Musices, vol. 2, no 2, p. 215-225.
- Serres, Michel (1992), Éclaircissements. Entretiens avec Bruno Latour, Paris, François Bourin.
- Stévance, Sophie, et Serge Lacasse (2013), Les enjeux de la recherche-création en musique. Institution, définition, formation, Laval, Presses de l’Université Laval.
- Urberg, Michelle (2017), « Pasts and Futures of Digital Humanities in Musicology. Moving Towards a “Bigger Tent” », Music Reference Services Quarterly, vol. 20, no 3-4, p. 134-150.
- Ware, Colin (2000), Information Visualization. Perception for Design, San Francisco, Morgan Kaufmann Publishers Inc.
- Zattra, Laura (2018), « Collaborating on Composition. The Role of the Musical Assistant at ircam, ccrma and csc », dans Friedemann Sallis et al. (dir.), Live-Electronic Music. Composition, Performance and Study, Abington, Routledge, p. 59-80.
- Zattra, Laura, Orio, Nicola (2006), « acame – Analyse comparative automatique de la musique électroacoustique », Musimédiane, no 4, http://www.musimediane.com/numero4/LZattra/index.html, consulté le 8 juillet 2019.