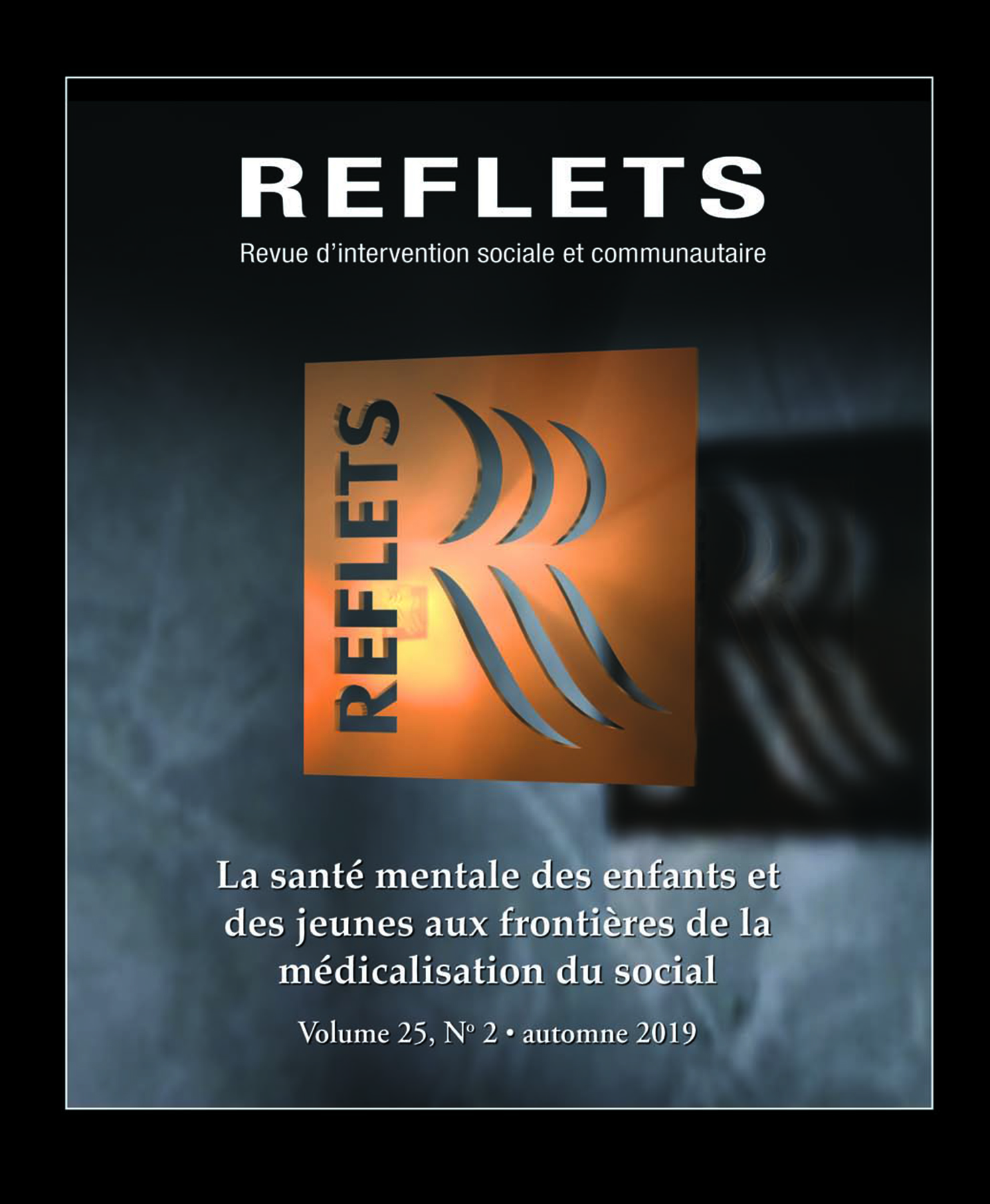Article body
Présentation
Émilie et Pierre-Étienne sont deux jeunes adultes impliqués dans le Mouvement Jeunes et santé mentale du Québec, dont les revendications sont présentées dans les Pratiques à notre image (Linhares, Ouimet-Savard et Boucher). Dans cette entrevue accordée à Reflets, Émilie et Pierre-Étienne partagent leur vécu, qui est intimement lié à leur engagement militant contre la médicalisation des problèmes de santé mentale des jeunes
Reflets : Émilie, Pierre, merci à vous deux d’avoir accepté d’échanger avec nous. Parlez-nous d’abord du Mouvement Jeunes et santé mentale.
Émilie : Le Mouvement est né en 2016. Trois organismes principaux, soit l’Association des groupes d’intervention en défense des droits du Québec (AGIDD), le Regroupement des Auberges du Coeur du Québec (RACQ) et le Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ) ont constaté qu’il y avait une problématique par rapport à la prise de psychotropes chez les jeunes. Et il y a eu une grande consultation, un forum, qui par la suite a créé le Mouvement Jeunes et santé mentale qui se bat pour les quatre revendications principales de la déclaration commune, qu’on a recueillies avec plus de 1 700 signatures.
Depuis la création du Mouvement en 2016, nous avons un comité de coordination qui inclut aujourd’hui huit jeunes militants qui ont vécu une situation en santé mentale. Nous avons également des sous-comités d’appui de mobilisation, de représentation, d’éducation populaire et de communication.
Nous promouvons les revendications issues de notre déclaration commune. Et présentement, nous sommes axés sur le souhait d’une commission parlementaire sur la médicalisation chez les jeunes. On travaille beaucoup là-dessus.
Pierre-Étienne : On peut aussi souligner que ce sont des gens qui sont la plupart en lien avec le milieu communautaire. Puis, comme le rapporte Émilie, ce fut initié par des professionnels qui côtoient des jeunes qui reçoivent des soins de santé mentale et qui se questionnent en quelque sorte sur l’efficacité de l’approche actuelle en santé mentale. Nous sommes tous un peu d’accord qu’on peut voir qu’il y a des approches autres que la médicamentation ou les traitements pharmaceutiques pour avoir une bonne santé mentale. Moi, c’est comme ça que je le vois.
Émilie : Oui. Juste une petite précision par rapport à ça : on n’est pas contre la médication en tant que telle, parce que la médication a son lieu d’être sur certains plans. Par contre, ce qu’on constate, c’est que la médication est souvent la première et seule réponse adoptée pour les jeunes. On ne va pas souvent lui proposer des ressources alternatives. C’est très important de faire la différence entre le fait qu’on n’est pas contre les médicaments, mais on est contre la médicalisation. De dire qu’un jeune est dans une classe et bouge plus qu’un autre, bien, on va lui donner une pilule, il va se calmer, ça va permettre aux autres d’étudier. Non. Ça, c’est la médicalisation. Le jeune a besoin de bouger. Donc c’est la différence. Moi, j’ai un Asperger; je prends des antidépresseurs pour m’aider à maintenir un niveau d’énergie assez élevé en même temps pour ma fibromyalgie. Je sais que j’en ai besoin. Donc je ne suis pas contre le fait de les prendre. J’amène la nuance parce qu’elle est importante. Notre combat, c’est vraiment contre la médicalisation.
Reflets : Parlez-nous maintenant de votre rôle au sein du Mouvement Jeunes et santé mentale.
Pierre-Étienne : Je m’implique avec le Mouvement depuis maintenant quatre mois. J’ai donc accompli moins d’actions concrètes. L’activité principale que j’ai faite, c’est de donner un atelier portant sur le respect des droits en santé mentale durant la rencontre nationale qu’il y a eu en décembre dernier. Et ça a vraiment bien été. Les autres choses que je fais dans le Mouvement, c’est de proposer des outils de travail qu’on puisse développer; c’est ce que j’ai comme idée d’amener dans les prochains mois. C’est ça, ma première motivation. Et ce que j’ai aussi apporté, c’est de participer aux décisions du comité de coordination auquel je participe maintenant depuis décembre.
Émilie : Moi, je suis au Mouvement depuis 2016, donc depuis sa création. J’étais là lorsqu’on a décidé du nom « Mouvement Jeunes et santé mentale » et du slogan « C’est fou la vie, faut pas en faire une maladie! ». On trouvait ça très très original, dans le sens où justement il y a des épreuves dans la vie; on trouve ça plate dans le sens que c’est normal, d’avoir des phases plus rough; la vie, ce n’est pas juste une ligne droite. Moi, je ne peux pas travailler, à la base. Donc je fais beaucoup d’implication, de participation citoyenne auprès de cinq mouvements, regroupements et organismes communautaires jeunesse au Québec. Et dans le Mouvement Jeunes et santé mentale, je siège sur le comité de coordination. J’ai fait aussi plusieurs rencontres ministérielles, des rencontres de syndicats et de fédérations pour chercher leur appui pour la déclaration commune. Je vais essayer d’être active également au niveau de la commission parlementaire parce que pour moi, c’est quelque chose de très important. J’ai vécu quatre ans au Centre jeunesse où on m’a médicamentée comme un adulte avec des psychotropes. Ça a créé chez moi un état assez instable. Je suis partie de huit médicaments psychotropes à un médicament seulement. Aujourd’hui, je suis stable, parce que j’étais instable à cause des médicaments. En plus, c’était dû à un mauvais diagnostic.
La première réponse à la détresse des jeunes c’est « Bon! bien t’es telle chose. On te donne telle pilule ». C’est quelque chose que je considère qu’il est important de faire voir aux jeunes. Le Mouvement se bat justement contre ça, contre le marquage diagnostique de la maladie chez le jeune; parce qu’il va se voir comme étant limité à cause d’un diagnostic en se disant « oui, mais de toute façon je suis TDAH. Je n’irai pas plus loin que ça de toute façon ». Donc c’est simplement des balises, des généralités statistiques. Les jeunes doivent comprendre que ça ne les définit pas.
Donc je considère mon combat comme très important. Il est très personnel. Par contre, je suis capable d’avoir une attitude très professionnelle; je comprends que dans des situations justement la médication n’est pas mauvaise; mais elle ne doit pas être utilisée de mauvaise façon.
Lors de la rencontre nationale de décembre dernier, j’ai donné un atelier sur la santé mentale à la DPJ; parce que les jeunes sous la DPJ ayant un trouble de santé mentale sont très mal pris en charge. C’est souvent la réponse automatique, c’est les médicaments. Les jeunes ne savent pas ce qu’ils prennent, ils ne savent même pas les effets à long terme. En fait, personne ne sait les effets des psychotropes à long terme chez les jeunes. L’atelier a été très, très apprécié : j’avais des jeunes qui m’ont raconté leur histoire, leur passage à la vie adulte à travers ça.
Reflets : Et qu’est-ce qui vous a amenés à vous impliquer au sein du Mouvement?
Émilie : Moi, j’étais bénévole auprès du Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec. Et l’organisme a participé au forum. Et connaissant mon histoire, la directrice m’a incitée en fait à participer. J’ai pris la parole cette fois-là justement en expliquant comment on était traité en centres jeunesse au chapitre de la santé mentale. Et quand ils ont demandé si des gens souhaiteraient créer quelque chose, automatiquement pour moi c’était là. C’était très important pour moi à travers tout ce que j’ai vécu que les droits des jeunes en santé mentale soient respectés. Aujourd’hui, je fais une fibromyalgie de haut niveau et aucun médicament ne fonctionne parce qu’on m’a tellement donné de médicaments que mon corps, à l’intérieur de trois mois, s’adapte. Tous les traitements ont échoué. Les médicaments ont détruit ma vie. J’ai réussi à la reconstruire, mais il y a des choses qui ne se reconstruiront jamais. Et moi, ma motivation à travers ça c’est de faire comprendre qu’avant de donner un médicament à un jeune, il faut s’assurer que ce médicament-là ne va pas détruire sa vie; ce jeune-là, a-t-il vraiment besoin d’un médicament ou il a juste besoin de s’asseoir dans un bureau avec quelqu’un à qui parler? Ou de faire du sport…? Il existe plusieurs alternatives.
Pierre-Étienne : Moi, ce n’est pas le même cheminement qu’Émilie. Il y a eu trois phases dans ma vie par rapport à mes questionnements, par rapport à mon cheminement dans le bien-être psychologique.
Moi, je ne crois pas que ça s’appelle « santé mentale » ou « maladie mentale », mais « mon bien-être ». En 2006, j’ai fait une dépression grave et c’était une épreuve de vie. J’avais 16 ans, puis je ne comprenais pas pourquoi je vivais ça exactement. Puis je vivais de la souffrance. Je voyais une psychologue. Puis à partir de ce moment, j’ai vu un psychiatre.
On me disait que je n’étais pas capable de comprendre les nuances, que j’étais très rigide, que je n’étais pas capable de socialiser. Je trouvais ça un peu faux en fait. Moi, je ne croyais pas à ça. J’ai pris le temps de penser pendant un bon sept ans sur la nature de ma souffrance. Puis au bout du compte, j’ai réalisé que c’était peut-être plus parce que je ne connaissais pas bien mon fonctionnement psychologique que j’ai appris à construire en voyant mes psychologues.
Peut-être aussi que c’était dû à des relations que j’avais durant cette période-là de ma vie. Ce n’était pas des relations qui étaient saines, positives et avec lesquelles je me sentais bien.
Une autre phase a été quand j’ai voulu partir de chez mes parents, rompre un peu mieux le contexte familial qui ne me convenait pas, donc prendre mon envol, devenir un adulte. Mais il y a eu des problèmes. Il y a eu un médicament qui n’a pas fait. J’ai changé de médicament et ça m’a fait faire une psychose. Alors j’ai vraiment eu une situation de vie compliquée à partir de ce moment-là. Donc, c’était une nouvelle période de crise dans ma vie.
Il n’y a pas seulement eu une psychose qui y est liée, mais c’est aussi la façon dont mon entourage a réagi, puis à la façon que l’hôpital a compris le contexte. À partir de là, il y a eu une période où j’ai été victime de violence. C’est quelque chose que j’ai vraiment trouvé très difficile. Sans nommer quoi que ce soit, j’ai été dans une situation où j’ai été abusé dans mes droits et dans mon intégrité à différents niveaux.
Donc à ce moment-là, moi j’ai choisi de m’opposer aux choses qui me paraissaient violentes. Mon parcours comme militant au CAVAC a commencé là, en quelque sorte. Je suis allé voir la police comme on doit faire quand on est victime de quelque chose d’inacceptable. Mais je n’ai pas vraiment eu d’aide. Non plus au CLSC, non plus à CAVAC (Centre d’aide aux victimes d’actes criminels). C’est à partir de ça que j’ai décidé de revendiquer que donner des médicaments n’est pas la seule façon d’aider les personnes qui souffrent. C’est ça que j’ai trouvé troublant en fait, c’est que personne ne m’a permis de refuser les soins. Donc le consentement, ça n’a pas été comme quelque chose d’acceptable.
J’ai trouvé ça tellement difficile que je me suis dit que je ne vais pas me taire. Donc j’ai décidé de parler de ça. Quand tu veux remettre en question la psychiatrie et ce que tu vis en psychiatrie, bien, les gens ne t’appuient pas vraiment. Souvent, dans mon entourage, les gens ne sont pas capables de me dire genre « ça fait du sens que tu veuilles pas ». Les gens ne veulent pas dire ça.
Reflets : Quels sont les enjeux et les défis que vous avez rencontrés comme membres de ce Mouvement?
Pierre-Étienne : Moi, avant, j’étais tout seul. Il n’y a personne qui comprenait mes motivations à vouloir défendre mes droits. C’était comme trop pour tout le monde; j’étais complètement isolé. C’est ça au départ que je vivais. Personne ne voulait m’aider. J’étais complètement seul. Donc, il fallait que je m’accroche juste au fait que j’ai un droit de parole. Puis je suis parti de ça. Ça a été long là, mais après ça, à force de me construire, d’essayer de comprendre pourquoi. Quel sens je donne à cette violence-là? Pourquoi je ne suis pas d’accord? Qu’est-ce qui est arrivé dans ce contexte-là?… À un moment donné j’ai commencé à écrire, je me suis exprimé plus ouvertement et ça m’a apporté des choses plus heureuses à vivre.
Il y avait un psychologue qui m’appuyait, puis c’est tout, là. Donc, quand j’ai découvert que le Mouvement Jeunes et santé mentale existait, puis qu’il y avait un peu les mêmes visions, qu’il y avait les mêmes objectifs… Je me disais c’est donc bien le fun. Puis depuis, ma vie est beaucoup plus facile, en fait.
Reflets : Et de ton côté, Émilie, quels sont les enjeux et les défis que tu rencontres par rapport à ton engagement?
Émilie : Bien c’est sûr qu’à la base déjà j’avais une certaine expérience. Donc, j’étais déjà consciente de l’importance de l’expression des histoires, et tout ça. Ce que j’ai vécu en centre jeunesse au niveau de la médicamentation m’a beaucoup motivée dans le Mouvement Jeunes et santé mentale. Également le masquage diagnostique que je dois vivre tous les jours... Il y a beaucoup de rapprochements à travers le Mouvement.
Ça donne aussi une certaine — comment je pourrais dire? — une certaine notoriété à ce que je vais dire dans le sens où est-ce qu’on me prend plus justement pour une « folle » quelque part qui annonce des faits. Les gens justement ne me considèrent plus à travers ça. Maintenant, ils prennent le temps d’écouter, ils prennent le temps de comprendre. Ils posent des questions et puis je me fais un plaisir de leur répondre. Mon histoire est devenue très, très publique; je dirais que je n’ai plus vraiment une vie privée à ce niveau-là, mais je crois que c’est par choix. Ce n’est pas quelque chose qui me dérange, parce que je comprends que plus de gens vont prendre la parole, plus que d’autres vont comprendre qu’ils ne sont pas seuls, qu’ils vont prendre la parole à la suite des autres. À un moment donné, les gens vont s’ouvrir les yeux, et vont dire « OK! Oui! Ce n’est peut-être pas juste des cas isolés. »
Ce que le Mouvement m’a amené, c’est vraiment l’espoir de voir les jeunes s’ouvrir à travers leur problématique ― pas nécessairement de manière autant publique que moi. Mais déjà à travers leurs familles, tu sais de dire à leur médecin « bien écoute, ce médicament-là, il ne me fait pas. Il me fait dégueuler tous les matins. » Dire aux jeunes qu’ils sont capables de tenir tête à leur médecin pour avoir soit un autre médicament, soit revoir les médicaments qu’il prescrit. C’est la plus belle chose qui peut exister là.
Donc, je grandis énormément à travers le Mouvement. J’ai fait des acceptations aussi sur mon passé. Entre autres, j’avais beaucoup de frustrations parce que j’ai vécu énormément d’isolement en centre jeunesse. Je pouvais passer des heures et des jours, j’ai même passé trois semaines [en isolement]. Les trois quarts du temps, j’étais dans le noir. Ils disaient que ça calmait les crises. C’est sûr que ça l’a amené des traumatismes chez moi. J’avais beaucoup de colère envers ça.
Aujourd’hui, je te dirais qu’à travers tout ça, ce n’est pas tant la colère, mais plus le moteur que ça m’amène d’en parler, le moteur que quand on rencontre une personnalité, que ce soit un ministre ou des fédérations, et tout ça, de pouvoir leur dire « mais écoutez, ce que je vous dis là ce n’est pas des statistiques. C’est ce que moi j’ai vécu. C’est des choses concrètes qui déjà se faisaient et se font encore à d’autres jeunes. » Puis tu le vois dans leur regard qu’ils font : « Oui, peut-être que finalement on devrait penser à ça. » Ça fait que c’est vraiment une grande gratification de voir que malgré que je n’ai pas de diplôme sur un mur, qu’on reconnaît l’acquis, puis de savoir que je peux faire voix pour changer les choses.
Reflets : Y a-t-il une ouverture de la part des décideurs par rapport à votre message?
Émilie : Oui, il y a une ouverture. C’est sûr qu’ils sont conscients de certaines problématiques au niveau de la société. C’est sûr que là, ce qu’on n’a pas eu comme chance, c’est qu’on est tombés un peu lors de nos rencontres sur les présélections.
Déjà là, personne ne pouvait vraiment s’engager ou il y avait comme, bon, tout le principe un peu du discours pré-électoral. Donc, oui, ils sont conscients de la situation. Mais ils ne peuvent prendre aucun engagement tant que les élections ne sont pas passées. Là, on va recommencer des rencontres ministérielles. Entre autres, il va y en avoir deux autres sûrement avec Mme McCann [ministre de la Santé et des Services sociaux, Gouvernement du Québec] qui a également parlé d’une commission itinérante sur les problèmes de santé mentale chez les jeunes et de la médicamentation.
Lorsqu’elle a émis cette suggestion, nous, directement, on est entrés en contact avec elle. Et c’est un très très bon partenariat, parce qu’effectivement c’est ce qu’on demande, une commission sur les jeunes. Mais nous, c’est sûr qu’on a certains critères aussi dans le sens où ce qu’on veut, ce n’est pas juste des médecins devant la commission. Nous, ce qu’on veut, c’est qu’il y ait des jeunes qui viennent parler de leur expérience; qu’il y ait des gens du communautaire. Donc, on veut vraiment que ce soit la situation des jeunes qui soit exprimée et non juste des professionnels de la santé.
Mais oui, il y a une ouverture au niveau du gouvernement. Mais comme j’ai dit, la situation en était une pré-électorale, malheureusement. Après ça, on tombait en élections. Là, on est en postélectoral. Donc on va recommencer une plus grande présence auprès des instances gouvernementales pour demander une commission sur la médicamentation chez les jeunes.
Reflets : Passons maintenant à une question qui porte plutôt sur la médicalisation des problèmes sociaux. On entend ce terme-là véhiculé et on voudrait savoir ce que ça signifie pour vous.
Pierre-Étienne : La médicalisation des problèmes sociaux, c’est de prioriser le médical. Ça parle du fait que c’est toujours vers le médical qu’on oriente les ressources, les besoins en problèmes sociaux. C’est toujours dans cette optique-là qu’on oriente les moyens, alors qu’il y en a d’autres. Il y a beaucoup d’autres choses à faire que juste prendre un médicament parce que, par exemple, souvent ce qu’ils font en médecine c’est de donner un médicament. C’est normal qu’ils donnent un médicament.
En santé mentale, ce n’est pas juste de dire que c’est ton pied qui fait mal, puis il faut que tu prennes un médicament. Ce n’est pas comme ça que ça marche. Il faut que tu dormes bien, etc. Il faut juste apprendre à le faire, à mon avis. C’est juste que c’est compliqué, c’est un apprentissage. Puis moi, c’est ça que j’ai fait pour m’en sortir; puis ça fonctionne bien. Je me sens beaucoup mieux qu’il y a quatre ans… Puis j’ai fait ça moi-même en travaillant sur moi, puis c’est comme ça que j’ai appris à travailler sur moi avec la psychothérapie. Donc, il n’y a pas que les médicaments qui peuvent aider. Des contextes d’efficacité, d’urgence ponctuelle, peut-être, comme un hôpital. C’est souvent dans l’urgence, mais à long terme, c’est peut-être une autre façon de faire qui serait aussi utile.
Émilie : Par rapport au Mouvement Jeunes et santé mentale, c’est surtout l’effet « société ». La médicalisation, c’est pour adapter la personne à la société. Donc, comme l’exemple que je donnais tantôt, le jeune garçon de sept ou huit ans qui dérange dans sa classe parce qu’il bouge tout le temps, on lui donne du Ritalin. Bien, OK, il va fitter dans la classe. Mais ce jeune-là n’a pas besoin de Ritalin. Ce jeune-là a juste besoin d’aller à la récréation; il a juste besoin de sortir dans le corridor et faire deux, trois fois la course dans le corridor, il revient s’asseoir et il ne dérange plus. Il écoute.
C’est ce qu’on appelle la médicalisation des problèmes sociaux chez les jeunes. Autant au niveau du système de performance qu’on demande énormément aux jeunes, donc au niveau de l’anxiété et tout ça. Tu n’es pas capable d’être assez concentré pour faire tes travaux, bien on va te donner ceci. Ce n’est pas d’aller chercher une problématique chez le jeune, mais d’aller régler un problème sociétal chez le jeune à travers la médicalisation. La médicalisation, c’est très subjectif. C’est quelque chose plus difficile à prouver, dans le sens où on doit prouver qu’un enfant n’a pas besoin de ces médicaments-là pour vivre, qu’il lui est simplement donné pour qu’il fitte dans sa classe.
Par contre, si les médicaments le rendaient malade, le principe de médicamentation serait qu’on dirait ce médicament-là ne lui fait pas. Pourquoi est-ce que vous lui donnez? C’est un peu le principe justement de la médicalisation des problèmes sociaux chez les jeunes justement où est-ce qu’on prend des problèmes qui sont de la société et pour que la société fonctionne bien, on applique aux jeunes un système de médicalisation.
Reflets : Et c’est un petit peu là que votre slogan « C’est fou la vie, pourquoi en faire une maladie! » prend tout son sens aussi. Ça rejoint beaucoup cette définition-là.
Émilie : Exactement. Surtout si on considère qu’au primaire, la plupart des enfants qui sont turbulents dans les classes se font retirer leur récréation. Alors, ça, c’est une aberration totale.
C’est « tiens-toi tranquille, sinon tu n’iras pas à la récréation! » Ce jeune-là en a besoin de sa récréation. Au contraire, envoie-le tout de suite en récréation. Ce n’est pas un bénéfice, c’est un bienfait. C’est le fait de dire que ce jeune-là, peut-être qu’il ne cadre pas dans le système éducatif qu’on a, mais ça ne veut pas dire qu’il a un problème en santé mentale. C’est simplement que ce jeune-là, il a de l’énergie.
Reflets : On voit des éléments dans vos réponses qui rejoignent beaucoup de nos observations aussi. On voit ces tendances-là de prendre des choses qui sont individuelles, les amener dans le social, dans le collectif et de dire qu’on répond au collectif. Plutôt que de s’intéresser aux besoins concrets du jeune, on s’intéresse sur le comment faire pour qu’il fitte dans un moule.
Émilie : C’est ça, donc on oublie l’individualité de la personne pour la mettre dans un groupe.
Reflets : Conséquemment, quelle serait d’après vous la façon de déconstruire ce discours-là, celui de la médicalisation des problèmes sociaux?
Pierre-Étienne : J’ai un concept à suggérer que je trouve super pertinent. Il y a un enjeu qui est relationnel, une lutte de pouvoir entre les personnes. Dans toutes les situations sociales, il y a un enjeu de pouvoir entre les personnes, toujours. On ne peut pas se sortir d’un enjeu de pouvoir entre deux personnes. Tu sais, quand tu joues une game de hockey, tu ne peux pas arrêter de jouer parce que tu ne veux pas déranger l’autre. Ça ne marche pas comme ça. Donc, il faut bien interagir, et à mon avis c’est ça l’enjeu qui crée le malaise. J’ai lu un article dans la Presse très récemment qui disait qu’il y avait un malaise tabou, de la discrimination, de la stigmatisation. Plusieurs de ces choses-là, c’est tous des enjeux de lutte de pouvoir. Quand tu te fais stigmatiser, c’est quelqu’un qui prend du pouvoir sur toi puis que tu n’es pas capable de te défendre parce que tu as un enjeu de santé mentale.
Mais à mon avis là, les médecins ne font pas nécessairement la bonne chose dans cet enjeu-là. Ça répond à la question « comment on déconstruit ça? », c’est-à-dire que si on permet aux gens de choisir ce qu’ils pensent, peut-être qu’ils vont agir autrement. Avec leur maladie, les gens se voient comme étant inaptes. C’est un modèle dans lequel le médecin a nécessairement raison. À mon avis, il y a des enjeux relationnels de pouvoir.
Donc, ces luttes sociales sont centrales, c’est-à-dire autant entre les professionnels qu’entre le professionnel et le patient, il y a un enjeu de pouvoir qui est important. Ça crée une contrainte qui mène au tabou, qui mène à la honte. Pourquoi ça arrive? Un médecin qui fait une chirurgie du coeur, c’est normal qu’il ait raison. Il faut qu’il fasse la bonne chose. Il y a une différence de nature entre l’enjeu social et un problème de coeur. Alors quand ils font une chirurgie du coeur, bien, j’espère qu’ils ont raison. Mais quand ils me disent que ma maladie est liée à un trouble chimique, moi, je n’ai pas envie qu’ils aient raison. Et ça, ils n’acceptent pas vraiment ce propos-là, ils n’acceptent pas vraiment cette position-là. Puis c’est le fait qu’ils aient nécessairement raison dans leur façon de faire, ça mène à ce qu’ils ne comprennent pas vraiment les enjeux relationnels entre les personnes. C’est là qu’ils n’arrivent pas à agir.
Puis moi, c’est ça que je vivais dans ma vie. C’est que je ne m’entendais pas nécessairement bien avec mon entourage parce que mon entourage n’était pas toujours dans une façon de vivre qui était saine pour moi. Donc, quand j’ai voulu me protéger, avoir des bonnes habitudes, ça ne plaisait pas à tout le monde. Je me suis chicané, mais ce sont des enjeux de relations de pouvoir. À mon avis, la meilleure explication pour changer ces choses-là, c’est d’admettre le fait qu’il y a des relations de pouvoir autant entre le médecin que le patient.
Donc d’accorder un pouvoir au patient, pour expliquer ses besoins de différentes façons, de comprendre ses malaises selon sa propre histoire, autant entre les personnes, le patient et son entourage, c’est-à-dire que si une personne souffre, qu’elle se fait attaquer, c’est souvent la personne qui est malade qui se fait habituellement attaquer. Ce n’est pas l’inverse. Et justement, si on lui dit qu’il ne peut pas se défendre, qu’il est malade, qu’il va toujours être souffrant, bien il n’apprendra pas à se défendre.
Moi, c’est ce que j’essaie de faire, de montrer que moi aussi j’ai un pouvoir sur ma vie et que j’ai le droit de prendre la parole. C’est le moyen que je me suis donné pour surmonter cette situation très pénible qu’on m’imposait. En fait, je me suis plaint d’avoir été victime de violence, puis on m’a imposé des traitements pour cette raison-là.
Ça fait que dans le fond j’ai préféré me faire entendre par les bons moyens plutôt que de me taire.
Reflets : Enfin, pour toi il y a vraiment un gros travail à faire pour sensibiliser les professionnels de la santé par rapport au pouvoir qu’ils détiennent auprès des gens qu’ils sont censés accompagner, qu’ils sont censés aider. Tu touches vraiment à quelque chose d’essentiel.
Pierre-Étienne : Oui, puis il est difficile de contredire les médecins parce qu’ils ont vraiment beaucoup de pouvoir. Je ne dis pas qu’ils sont tous comme ça, qu’ils ont tous le même point de vue. Mais souvent, quelqu’un qui a toujours raison, bien il n’aime pas se faire contredire. Je ne généralise pas pour toutes les personnes. Moi, je n’attaque pas les personnes, pas du tout. Je dis juste que quelqu’un qui a nécessairement raison dans son préjugé professionnel, c’est délicat de changer sa position de travail. Je pense que le meilleur moyen de changer quelque chose est de questionner cela : si le médecin se trompe, on fait quoi? C’est une sphère qui tolère mal l’erreur.
Reflets : Et toi, Émilie, as-tu quelque chose à dire à ce sujet?
Émilie : Bien moi, en fait, je le vois d’une autre manière, un peu dans le sens où c’est difficile de faire reconnaître une erreur chez un médecin. Il existe des recours, il existe des comités, des choses comme ça pour faire valoir une plainte au niveau de l’ordre professionnel, quelque chose de déjà très compliqué à la base. Moi, ce sur quoi je travaille depuis plusieurs années déjà, puis même le Mouvement prône, c’est le savoir expérientiel des jeunes. De leur apprendre leurs droits, c’est de leur apprendre qu’ils ont le droit de refuser un médicament s’il ne fait pas; ils ont le droit de savoir quel est ce médicament-là. Le traitement, qu’est-ce que ça amène comme conséquence à court terme, moyen ou long terme?
À la base, il y a toute cette éducation qui je crois devrait être plus encouragée, parce que déjà d’essayer de retirer un pouvoir à quelqu’un c’est quelque chose de difficile. Mais d’en donner à quelqu’un, c’est quelque chose qui est très facile dans un sens où j’ai déjà plus de pouvoir grâce à mon savoir.
Moi, j’ai un médecin qui a des difficultés un peu parce qu’avec ma fibromyalgie, on a essayé plusieurs médicaments. À un moment donné, j’étais tannée qu’elle fasse juste des suppositions. Donc, j’arrivais avec des propositions de traitement discutées avec ma pharmacienne. On avait regardé selon mes dossiers ce que j’avais déjà pris, ce qui existait, ce qui était possible, la manière d’introduction du traitement ou de voir ses effets, et tout ça. Quand j’arrivais devant mon médecin, le plan de traitement était prêt et je lui expliquais clairement le plan de traitement avec les possibilités qu’il y avait de modification ou non, d’introduction, et tout ça.
Et je vous dirais que c’est arrivé à 99 % du temps que je ressortais avec ce traitement-là qui était déjà établi, parce qu’il ne faut pas oublier que le médecin, c’est le spécialiste au niveau des maladies et que le spécialiste au niveau des médicaments, c’est le pharmacien. Moi, quand je vois beaucoup de jeunes à travers des consultations, je leur dis « Écoute, si t’as des doutes sur ton médicament, demande à ton pharmacien ». Je dis c’est nono, mais tu t’assis avec lui, puis tu lui demandes. Puis regarde, si tu consommes du pot, ou peu importe la drogue, dis-le à ton pharmacien. Lui, il va te dire exactement ce que ça peut causer.
Donc, moi je considère que l’éducation chez les jeunes va être un plus grand apport parce que ces jeunes-là aujourd’hui vont être les médecins de demain. Il ne faut pas oublier que le temps de déconstruire un pouvoir, ces gens-là ne seront plus en termes de pouvoir rendu au moment où on pourrait en avoir. Donc, de donner le pouvoir aux jeunes qui présentement sont en train de recréer la société, de leur faire connaître leurs droits à travers des situations X, Y, Z ça va leur permettre à travers leur savoir expérientiel plus tard d’appliquer des procédures qui vont être plus humaines envers les autres.
C’est sûr que s’il y a une chose que j’ai comprise, c’est que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. C’est quelque chose qui va prendre du temps; et quand ça prend du temps, il faut voir à long terme. Et à long terme, je considère que ce sont nos jeunes qui sont notre futur; c’est nos jeunes qui vont devenir demain les supporteurs de nos jeunes de ce temps-là. Donc, je me dis, il vaut mieux axer sur l’éducation de nos jeunes aujourd’hui au niveau des droits, des connaissances et même, je vous dirais, de la solidarité, pour que ces jeunes-là, plus tard, puissent appliquer ces méthodes-là en descendant également.
Pierre-Étienne : Pour finir ma réflexion, on parle souvent de la maladie mentale. En fait, un médecin, il diagnostique des troubles, des maladies, des problèmes. Il voit ton genou, puis il va dire « ah! bien, t’as mal au genou. C’est tel problème. » Alors que la santé mentale, bien, ce n’est pas nécessairement un problème. Ça peut être positif aussi.
Moi j’aime mieux définir la santé mentale comme une aptitude à tenir compte de ses besoins de façon saine tout simplement, ou de la construire, d’apprendre à le faire. Donc c’est ça pour ma santé mentale. Ce n’est pas une absence de maladie. C’est vraiment qu’on doit apprendre pour soi.
Si on base la santé mentale sur un principe d’inaptitude, bien nécessairement les gens vont croire qu’ils ne sont pas capables et ils n’essaieront pas de s’en sortir. C’est ça le problème souvent, qu’ils disent tu ne seras pas capable. C’est comme là, tu as été malade. Mais si tu crois que tu peux construire ton bien-être autrement, bien tu le fais, puis ça marche!
Émilie : C’est ça! Et par rapport à ça également, c’est sûr qu’il faut donner de l’espoir, mais il faut donner un espoir aussi qui est réel. Donc si je reprends l’exemple de Pierre-Étienne, ce n’est pas pour déconstruire ce que tu dis du tout, au contraire, je suis entièrement d’accord avec toi. Par contre, l’espoir est de se servir selon ses capacités.
Et je crois que Pierre-Étienne va être d’accord avec moi là-dessus, c’est que chacun découvre ses propres capacités, non selon une généralité ou un diagnostic, puis qu’on donne l’espoir à ce jeune-là selon sa capacité à faire ce qu’il souhaite faire.
Pierre-Étienne : Oui, je suis bien d’accord que c’est vraiment en termes d’aptitude qu’il faut penser et non d’inaptitude. Exactement.
Reflets : Du côté des professionnels, du côté des jeunes, comment est-ce qu’on peut éduquer les deux? Comme on dirait que les deux vont vraiment de pair. Chaque personne, chaque individu est unique, et il faut respecter ça.
Émilie : Oui, effectivement, je vous dirais que même quand on parle de capacité, les gens qui aujourd’hui me côtoient me disent « Pourquoi tu ne t’en vas pas en politique? Pourquoi tu ne deviens pas travailleuse sociale? » Ou tu sais, toutes des choses comme ça. Bien, parce que je ne peux pas. Je ne peux pas le faire. Par contre, ce que je peux faire, c’est de m’impliquer et de permettre à d’autres de se découvrir pour qu’ils le fassent eux-mêmes. Il y a toujours la capacité, mais il y a aussi l’acceptation de la situation. Toujours se connaître, s’accepter. Je crois que c’est la plus grande question, de s’accepter.
Reflets : Reflets, c’est une revue d’intervention sociale. C’est beaucoup des travailleurs sociaux, des étudiantes en travail social qui vont lire ça. Donc, qu’est-ce que les travailleurs sociaux ou les travailleuses sociales pourraient faire pour donner une voix plus forte aux jeunes quant à leurs problèmes de santé mentale?
Émilie : Si tu me permets de commencer, Pierre-Étienne… Au niveau du travail social, des données dont on est certains, c’est que les travailleurs sociaux ont trop de dossiers. Ils ne peuvent pas accompagner adéquatement chaque jeune. C’est une impossibilité statistique. Si le travailleur social a 30 dossiers de jeunes — et là je ne suis pas généreuse parce que des fois, ça peut aller au-dessus de ça. Donc, de dire que le travailleur social va accompagner le jeune quand il va chez le médecin, quand le jeune a des difficultés avec ses amis ou des choses de même, c’est toutes des situations où le travailleur social peut être interpelé. Je me souviens d’essayer de contacter ma travailleuse sociale quand j’étais au centre jeunesse, ça peut prendre deux jours avant qu’elle me rappelle. C’est parce que dans ces deux jours-là, la crise était faite. Il y avait eu les conséquences et tout ça. Quand elle rappelait, elle ne servait plus à rien. Ce n’est pas parce qu’elle n’était pas compétente. C’est qu’il y a trop de dossiers à sa charge.
Je dirais que si la travailleuse sociale pouvait faire un peu d’éducation populaire avec ces jeunes, ça aiderait dans le sens d’exprimer au jeune ses droits déjà en partant, pas juste les droits qui vont faire affaire dans le dossier. Si c’est un jeune sous la protection de la jeunesse, tu ne fais pas juste lui renseigner ses droits de base. Donne-lui des dépliants qui existent, des endroits où est-ce qu’il peut se renseigner. Donc d’expliquer au jeune ses droits à travers ça.
Moi, je dirais que ce serait irréaliste de dire que les travailleurs sociaux doivent être plus présents dans la vie du jeune. Leur capacité reste réduite avec le nombre de dossiers qu’ils ont. Ce qui est possible, c’est que les travailleurs sociaux s’assurent que le jeune est bien outillé. Ils peuvent avoir recours au communautaire. Ils peuvent aider le jeune à être respecté à travers tout ça, que ce soit en santé mentale même ou autre, mais surtout en santé mentale.
Je pense que le travailleur social ne doit pas nécessairement déléguer un dossier, mais déléguer des tâches ou des particularités de certains points du dossier à une coopération avec des agents externes. Je dirais le communautaire, parce que je crois que c’est à travers le communautaire qu’on pourrait plus s’en sortir parce que là, on a beaucoup de listes d’attente. Mais de dire à une jeune : « Bien écoute, à la maison des jeunes de ton quartier, il y a tel et tel intervenant. Si tu ne feel pas, est-ce que tu peux l’appeler? » Ou bien : « Regarde, dans ton plan d’action, si tu veux sortir le vendredi pour aller à la maison des jeunes pour te défouler, te décontracter. Bien tu as le droit. » Pas qu’à chaque fois, il faut qu’il demande la permission.
Donc d’établir des bases avec le jeune où il va voir qu’il n’y a pas juste sa travailleuse sociale qui peut l’aider ou pas juste la travailleuse sociale qui peut décider, mais qu’il y a un partenariat avec d’autres organismes ou d’autres personnes autour d’elle.
Reflets : Travailler un petit peu à l’intérieur des contraintes qu’on a, trouver des façons d’éduquer les jeunes, puis d’amener d’autres professionnels aussi…
Émilie : Oui, parce que c’est sûr que les travailleurs sociaux ont trop de dossiers. Ça, on le voit. Ils sont épuisés, ils sont surchargés. Donc, pouvoir coopérer entre les secteurs publics et les secteurs communautaires dans le sens où un travailleur social, supposons de la DPJ, autorise le travailleur de rue, de la maison des jeunes, de la ressource du jeune de dire : « Bien écoutez, on a une activité spéciale. On voudrait amener le jeune. » Que l’éducateur en centre jeunesse sache que ce jeune-là, il a le droit d’y aller, parce qu’il n’y a pas besoin automatiquement de l’autorisation de sa travailleuse sociale, parce qu’il y a une entente avec la ressource. Donc que le jeune soit invité, supposons un jeudi, à une partie de baseball, bien le jeune a le droit d’y aller sans avoir le stress de l’attente parce que c’est une pré-entente déjà établie. Ce sont tous des moyens, des partenariats, des coopérations à travers un dossier des jeunes, puis en même temps le jeune à travers le communautaire va découvrir les valeurs sociales. Donc le jeune va se développer.
Reflets : Pierre-Étienne?
Pierre-Étienne : Bien, je vous avoue que ce n’est pas une question à laquelle je suis capable de répondre facilement, parce que je ne connais pas bien les enjeux des travailleurs sociaux. Je dirais que ce sont des professionnels que j’ai trouvé les plus utiles. Ceux qui m’ont plus donné d’outils dans le milieu médical. Donc moi, j’ai un mot d’encouragement que c’est vraiment un professionnel qui est utile.
Reflets : En terminant, quelles sont les suites du Mouvement Jeunes et santé mentale? Vous avez parlé de la commission parlementaire qui s’en vient. Quelles sont les prochaines étapes?
Émilie : Bien, à court terme, c’est de reprendre vraiment des comités actifs parce qu’on a été beaucoup axés sur la rencontre nationale. À court terme, on veut vraiment remettre en marche à 100 % tous les comités et sous-comités. Il va y avoir des représentations. On va aller chercher des appuis encore plus importants dans tous les environnements qui sont au niveau des jeunes. Il va y avoir bien sûr la commission qui va être mise en premier plan et on continue le travail d’éducation et de sensibilisation auprès des jeunes et de tout intervenant dans les milieux jeunesse.
Reflets : Pierre-Étienne, as-tu quelque chose à ajouter?
Pierre-Étienne : Oui, bien moi, parler pour le groupe parce que c’est quand même nouveau, mais ce que je pourrais dire par rapport à mon implication dans le mouvement, pour le mouvement, c’est de continuer d’avoir du plaisir. Puis l’autre chose, c’est de continuer à construire les outils. Moi, c’est ce que je leur suggère dernièrement, c’est qu’on développe des outils pour s’améliorer.
Reflets : Merci énormément. Vous n’avez pas vécu des choses faciles… Et le fait que vous soyez capables d’avoir pris ces expériences-là puis essayer de changer des choses, on vous lève vraiment notre chapeau. On est super contentes de vous avoir rencontrés aujourd’hui.
Pierre-Étienne : Est-ce que je peux dire un dernier mot par rapport à ça? C’est que pour moi c’est vraiment un objectif dans ma vie de pouvoir m’exprimer, exprimer mon propos. Puis là, bien, c’est comme un accomplissement. Ça m’a pris cinq ans à y arriver. Je suis vraiment très très fier, puis je n’arrive pas à y croire encore.
Reflets : Félicitations à vous deux et merci encore.