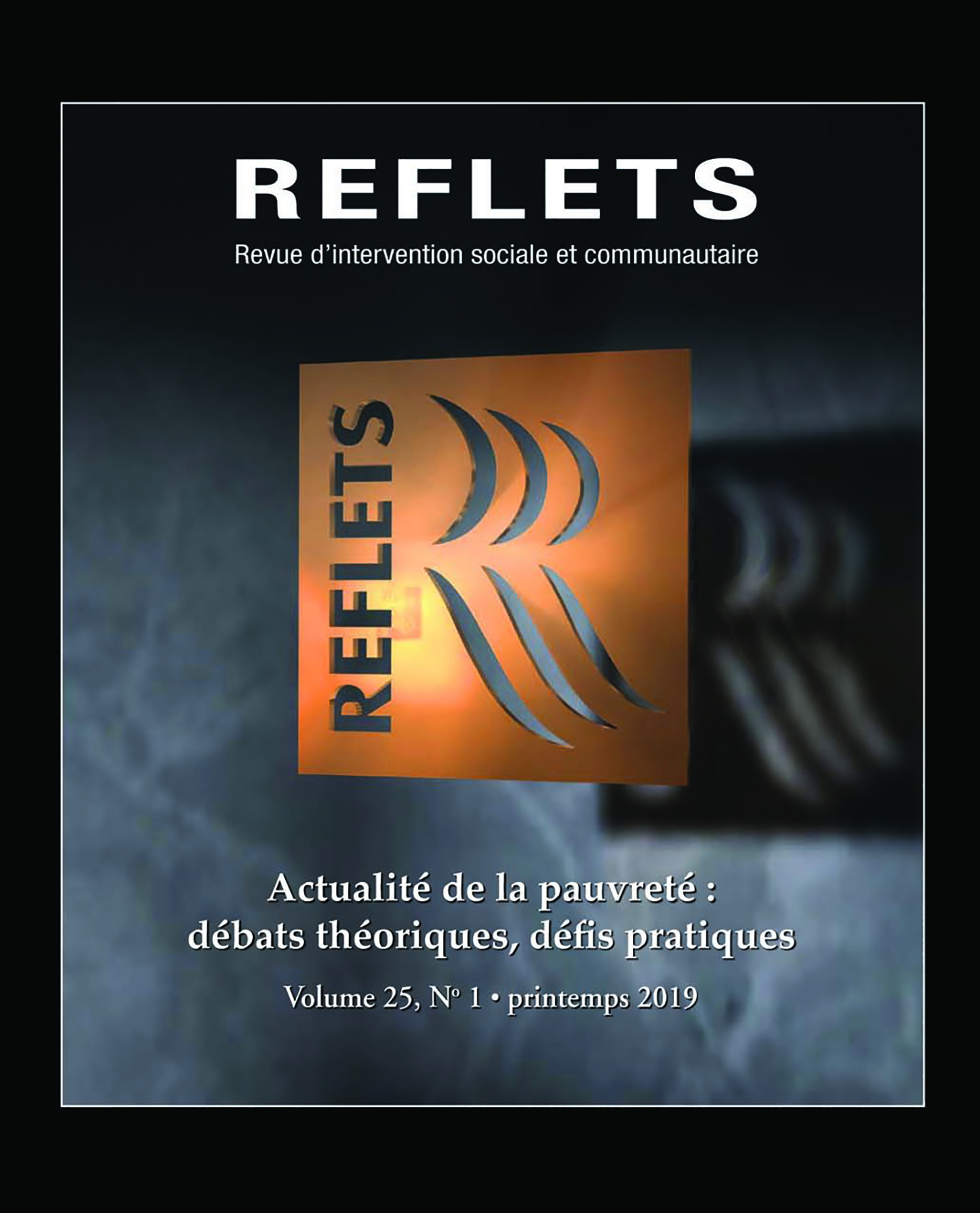Article body
Utopies réalistes se penche avec optimisme sur des enjeux d’actualité faisant l’objet de nombreuses controverses entre la gauche et la droite. Historien néerlandais, essayiste et chroniqueur, son auteur est l’un des premiers à populariser l’idée d’un revenu de base. Au moyen d’une méticuleuse démarche historique et d’arguments soutenus par la rigueur scientifique, Bregman se porte à la défense d’idées souvent réfutées pour leur caractère utopique. Dans un vocabulaire coloré, accessible et stimulant, il nous invite à penser les grandes questions contemporaines avec un brin d’utopie. « [L]’incapacité d’imaginer un monde où les choses seraient différentes indique un défaut d’imagination, pas l’impossibilité du changement. » (p. 188) L’ouvrage nous présente alors une série d’idées, a priori utopiques, pour relancer la société contemporaine sur le chemin du progrès. « Le Progrès est la réalisation des Utopies» commence l’auteur en citant Oscar Wilde dès les premières lignes de son ouvrage.
Intitulé Le retour de l’Utopie, un premier chapitre installe un fil conducteur qui lie entre eux les suivants et propose de concevoir l’utopie comme une invitation au changement. À travers un détour historique, l’auteur soutient que le progrès existe depuis toujours en symbiose avec la pensée utopique. C’est parce que nous avons cru au progrès que le monde est ce qu’il est aujourd’hui. À une ère de richesse et de surabondance, il se dissocie de la vision peu ambitieuse de la société contemporaine qu’il explique par l’impression que l’amélioration est impossible. Ne nous cachons pas que le monde est meilleur que ce qu’il a toujours été, nous dit-il, mais il faut continuer de se demander comment les choses pourraient encore s’améliorer et ne pas cesser d’espérer mieux. Tandis que le monde d’aujourd’hui est l’utopie d’autrefois, l’auteur nous amène à constater la face cachée de ce monde d’abondance et à croire en de nouvelles utopies.
Si pour plusieurs, le projet de mettre fin à la pauvreté en donnant de l’argent aux pauvres semble une idée absurde et farfelue, le deuxième chapitre, Pourquoi il faut donner de l’argent à chacun, porte à croire que « l’argent gratuit, ça marche » (p. 34) et que l’histoire du progrès est prête à accueillir le projet autrefois utopique d’un revenu pour tous et sans contrepartie. De l’exemple de la petite ville manitobaine qui faillit éradiquer la pauvreté, à celui du projet de loi proposé sous le gouvernement Nixon en 1970, ce chapitre déconstruit les discours dominants qui soutiennent que les pauvres sont paresseux et révèle les avantages méconnus qui entourent le projet d’un revenu de base.
Dans le troisième chapitre, La fin de la pauvreté, Bregman précise que « la pauvreté n’est pas un manque de caractère », mais plutôt « un manque d’argent » (p. 73). Il s’appuie sur l’explication proposée par la psychologie de la rareté (Mullainathan et Shafir, 2013) pour soutenir que de nombreuses problématiques perçues comme à l’origine de la pauvreté sont en réalité des conséquences de celle-ci et que les inégalités constituent un facteur qui contribue largement à leur expansion. En ce sens, il appelle à combattre la pauvreté et l’itinérance plutôt que leurs symptômes et démontre qu’il s’agit d’un objectif réalisable. S’il semble désormais évident qu’il est possible de résoudre le problème de la pauvreté, ce chapitre met en lumière les avantages économiques d’un tel projet.
Le quatrième chapitre, L’étrange conte du président Nixon et de son projet de loi sur le revenu de base, raconte le rôle qu’a joué la loi de Speenhamland dans la distinction que l’on opère encore aujourd’hui entre les pauvres méritants et les pauvres non méritants et qui constitue un obstacle majeur à un monde sans pauvreté. Bregman y explique que le mythe de Speenhamland « scella le destin de la première tentative de transfert d’argent » (p. 91). Il invite à faire usage de cette leçon d’histoire pour éclairer le recul de l’État-providence au profit d’un État de surveillance plus coûteux et cloîtrant les gens dans une pauvreté persistante.
Dès les premières pages du cinquième chapitre, De nouveaux chiffres pour une nouvelle ère, Bregman affirme que le PIB, « critère ultime » censé évaluer le progrès de la société, est un outil de mesure inefficace dans la quête du bien-être social. Partant du principe que « chaque époque a ses idées sur ce qui définit la richesse d’un pays » (p. 108), l’auteur lance la discussion sur des critères alternatifs pour penser autrement le progrès d’une société moderne. S’il est difficile de nier l’utilité du PIB en temps de guerre, il nous faut un indicateur plus adapté aux crises contemporaines, entre autres, chômage, dépression et changements climatiques. Ce chapitre nous invite à chercher les indicateurs qui permettraient de mesurer «ce qui fait que la vie vaut d’être vécue » (p. 119) : l’argent, oui, mais aussi les emplois, les savoirs et, pourquoi pas, même le temps?
La semaine de quinze heures, sixième chapitre, porte sur un plaidoyer en faveur de la réduction des heures de travail au profit du loisir. En mobilisant les idées de Marx, Mill, Keynes et Ford qui avaient prédit un « avenir de loisir », Bregman nous explique ce qui a conduit à l’abandon de cette utopie. Si certains pensaient qu’une semaine de travail plus courte était synonyme de vice, l’auteur affirme que le nombre d’heures de travail n’est pas garant de la productivité. Alors que l’histoire nous enseigne l’importance du temps libre, ce chapitre montre comment la croissance économique a apporté plus de consommation en dépit du loisir. En plus de présenter la semaine de quinze heures comme un projet à la fois désiré et réalisable, l’auteur nous montre de quelle manière elle peut s’avérer une solution à de nombreux fléaux contemporains.
Le septième chapitre a pour titre Pourquoi il n’est pas payant d’être banquier. On nous y invite à cesser de calculer la valeur de nos occupations en termes de salaire. Pour ce faire, Bregman met de l’avant des solutions qui permettraient d’accroître les richesses tout en favorisant le bien-être de chacun. Comme l’évoque le titre du huitième chapitre, l’avènement des technologies a mené les gens à se lancer dans La course contre la machine. L’auteur y soutient que le progrès technologique accentue les inégalités et propose de repenser le système de manière à ce que chacun puisse en profiter. Il invite à rejeter « le dogme selon lequel il faut travailler pour vivre » (p. 188) et à renoncer à l’idée du rapport incessant du capital au travail. Opter pour la redistribution paraît être le meilleur moyen de prémunir la société contemporaine contre la croissance des inégalités que promettent les avancements technologiques.
Au neuvième chapitre, Par-delà les portes du pays d’abondance, Bregman soutient que c’est dans l’aide au développement que s’inscrivent les mesures anti-pauvreté les plus efficaces. Parmi elles, ouvrir les frontières à l’immigration est une arme puissante dans la lutte contre la pauvreté à l’échelle mondiale. Déconstruisant un à un les arguments fallacieux qui s’opposent à l’immigration, ouvrir les portes du pays d’abondance apparaît comme une solution envisageable permettant d’accroître les richesses dans le monde entier.
Comment les idées changent le monde, dixième chapitre, semble servir de conclusion à cet ouvrage. Selon Bregman, lorsque des évènements viennent contredire nos profondes convictions, « nous préférons réévaluer la réalité que modifier notre vision du monde » (p. 223). Comment des idées neuves peuvent-elles alors changer le monde? Suivant l’exemple de Hayek et Friedman qui ont fondé la pensée néolibérale, l’auteur argumente qu’il nous faut poser les fondations d’idées alternatives pour qu’en temps de crise elles apparaissent disponibles, voire inévitables.
Avec Utopies réalistes, Bregman nous livre un récit d’espoir et développe un argumentaire qui surpasse l’opposition entre la droite et la gauche pour penser autrement le progrès et faire place à de nouvelles idées. Si ces dernières peuvent parfois nous sembler radicales, l’ouvrage nous démontre qu’elles sont corroborées par des études scientifiques et il propose des moyens concrets pour y parvenir. Appuyés par des exemples structurés, clairs et simples, les arguments de l’auteur rendent son récit accessible et permettent d’entrevoir un monde meilleur et plus égalitaire. Des idées telles que le revenu de base ou la semaine de travail raccourcie se dessinent dans ce livre comme des moyens progressistes, efficaces et réalisables pour sortir du conflit entre le capital et le travail. Alors que d’autres auteurs appellent à la prudence en nous rappelant que ces idées ne doivent pas servir d’échappatoire pour simplifier les politiques sociales et déresponsabiliser l’État, Bregman se montre plus optimiste. Son ouvrage se veut une tentative de « débloquer » l’avenir, nous dit-il (p. 17). À travers les 247 pages de son ouvrage, l’auteur se met au défi d’élaborer sur des idées susceptibles de changer le monde et il ouvre grande la porte à des possibilités oubliées sous prétexte qu’elles étaient utopiques.
Appendices
Bibliographie
- MULLAINATHAN, Sendhil, et Eldar SHAFIR (2013). Scarcity: Why having too little means so much, Henry Holt & Company, 304 p.