Abstracts
Résumé
Entre 1989 et 2005, le régime d’aide sociale au Québec comportait des obligations relatives à l’occupation d’un emploi ou à la participation à des mesures de développement de l’employabilité. Durant cette période, des dizaines de milliers de prestataires ne s’étant pas conformés aux prescriptions de leur agent ou agente du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale ont vu leur prestation réduite. À partir d’une analyse des décisions rendues en appel par le Tribunal administratif du Québec à l’égard des prestataires sanctionnés, cet article propose de mettre en lumière l’irruption du virage néolibéral dans le dispositif de l’aide sociale, en s’attardant à la façon dont l’injonction à l’emploi est mise en oeuvre par les acteurs et actrices de ce dispositif.
Mots-clés :
- aide sociale,
- activation,
- workfare,
- État,
- néolibéralisme,
- emploi,
- politiques sociales,
- services publics
Abstract
Between 1989 and 2005, the social assistance system in Quebec included obligations relating to the occupation of a job or participation in employability measures. During this period, tens of thousands of claimants saw their benefits reduced for failing to comply with certain behaviors expected or prescribed by a Ministry official. This article proposes an analysis of the decisions rendered on appeal by the Administrative Tribunal of Québec towards sanctionned recipients, highlighting the irruption of neoliberal order in the social assistance system, and looking at the way in which the new injunction to work take shape in the practices of State officers.
Keywords:
- social assistance,
- welfare recipients activation,
- workfare,
- state,
- neoliberalism,
- employment,
- social policies,
- public services
Article body
Introduction
Entre la fin des années 1980 et la fin des années 1990, la plupart des pays industrialisés mènent des réformes visant « l’activation » de leurs régimes d’assistance sociale. Ces réformes constituent la réponse des gouvernements en place à un diagnostic d’essoufflement ou même d’échec de l’État social, dit « État-providence », face à la montée du chômage, à la cristallisation de la pauvreté et à la « crise » des finances publiques. Dans le contexte sociopolitique du tournant néolibéral, initié une dizaine d’années plus tôt, il s’agit pour les pouvoirs publics de transformer les dépenses sociales « passives » en leviers pour favoriser la participation du plus grand nombre au marché de l’emploi. Dans le champ de l’assistance sociale, l’ampleur et les modalités des changements ont varié considérablement d’un pays à l’autre, selon les modèles d’État-providence et la diversité des coutumes assistancielles (Morel, 2003), du workfare à l’insertion, le curseur étant plus ou moins avancé sur l’échelle de la coercition et de la répression. Il existe néanmoins une certaine convergence dans la logique sous-tendant ces politiques d’activation, promues notamment par l’OCDE depuis au moins un quart de siècle (Raffass, 2017; Barbier, 2009; Dufour, Boismenu et Noël, 2003).
Quand elle concerne spécifiquement le dispositif de l’assistance sociale, « l’activation » vise à lutter contre une prétendue « dépendance » des prestataires, qu’il s’agit de transformer en agents économiques à l’affût du marché de l’emploi. Concrètement, elle prend la forme d’obligations nouvelles, de contreparties qui introduisent la notion de conditionnalité dans une politique qui était fondée, dans la période précédente, sur les principes du besoin et du droit (Dufour, Boismenu et Noël, 2003, p. 12). On assiste alors à l’émergence et bientôt à la généralisation de la notion « d’employabilité », désormais au centre du champ lexical de l’aide sociale, notion qui renvoie à un « jugement social sur la capacité des individus de gagner eux-mêmes leur vie par le travail salarié » (Morel, 2002, p. 176). Dans le sillage de l’activation, l’objet principal du dispositif législatif de l’aide sociale devient l’intégration en emploi.
Au Québec, la réforme entrée en vigueur en 1989 est considérée comme un moment charnière dans l’histoire récente de l’assistance sociale, interprétée comme le véritable virage vers le workfare après une phase d’expérimentation ciblée auprès des jeunes (Jetté, Brunet et Martineau, 2011). Le principal coup de force de cette politique a été d’introduire une nouvelle norme juridique, celle de « l’aptitude au travail » (Lamarche, 1991; Normand, 1998). À partir de ce moment, le montant des prestations des personnes qui ne seront pas jugées médicalement « inaptes au travail » sera déterminé en fonction de leur participation à des mesures de développement de l’employabilité. Par ailleurs, en plein coeur des débats et de la polémique entourant le projet de loi sur la sécurité du revenu en 1988, le ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu annonce que le refus d’un emploi entraînera une pénalité financière[1]. Pour légitimer ce tour de vis, le ministre Bourbeau présente au même moment la création d’un vaste programme d’emplois subventionnés, soit le Programme d’aide à l’intégration à l’emploi (PAIE). Selon la logique rapportée par les médias de l’époque, les prestataires n’auront donc qu’à accepter les emplois qui leur seront offerts sur un plateau d’argent :
« M. Bourbeau se dit convaincu qu’en bout de course, c’est une proportion négligeable d’assistés sociaux qui refusera ces emplois, payés approximativement $7 l’heure, prévoit-on. […] Le ministre n’a pas voulu préciser le nombre d’emplois qu’il espérait ainsi créer. « On a 200, 000 bénéficiaires « aptes »; mon objectif, c’est 20 0000 », a-t-il dit. »
Lessard, 1988
Face à l’ampleur des changements apportés par cette réforme et sa charge idéologique, les groupes de défense des droits se sont fortement mobilisés. Toutefois, dans ce contexte d’ébullition, l’enjeu spécifique des pénalités relatives à l’emploi est passé relativement sous le radar à l’époque de la réforme et dans les années qui ont suivi. Pourtant — et c’est la position défendue dans ce présent article — ces obligations constituent bien davantage qu’un volet parmi d’autres dispositions d’une loi de plus en plus restrictive. Il s’agit d’un révélateur central des mutations de l’État social en contexte néolibéral.
Cet article se situe dans le champ de la sociologie critique de l’État social. Le virage vers l’activation s’inscrit clairement dans le programme économique néolibéral — qui se caractérise notamment par la remise en cause des programmes de redistribution du revenu —, mais il participe tout autant au changement paradigmatique de rationalité politique, qui consiste, comme l’explique Brown (2004, p. 87), en « l’extension et la dissémination des valeurs du marché à la politique sociale et à toutes les institutions ». Derrière le recul graduel de l’idée de responsabilité collective et de protection sociale et la généralisation d’une rhétorique politique de la responsabilité individuelle et de l’investissement social, c’est donc toute une vision de l’individu, du lien social et du rôle de l’État qui est en jeu (Dardot et Laval, 2009). Notre but est d’examiner comment les politiques d’aide sociale s’inscrivent dans ce virage néolibéral de l’État, mais en nous attardant à la façon dont celles-ci sont mises en oeuvre par les acteurs et actrices du dispositif que sont les agentes et agents du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (qui appliquent les sanctions) et les juges du Tribunal administratif du Québec (TAQ) (qui entendent les recours judiciaires). Comment s’incarne cette logique prescrite de l’activation dans les pratiques concrètes des « street-level bureaucrats » (Lipsky, 2010), qui sont les véritables visages de l’État pour les prestataires d’aide sociale? Comment, à ce niveau d’observation, la normativité des politiques se confronte-t-elle au « réel » des conditions de vie et des rapports sociaux?
Le présent article se divise en deux parties. Dans la première, nous discuterons brièvement de l’ampleur du phénomène des sanctions relatives à l’emploi pour la période précédant 2005 au Québec, et nous présenterons le corpus de données analysées dans le cadre de cet article ainsi que la méthodologie privilégiée. La deuxième partie sera consacrée à deux pistes d’analyse inspirées par le traitement judiciaire de ces sanctions : premièrement, que les politiques d’activation reposent sur une vision à la fois théorique et idéalisée de l’emploi au bas de l’échelle; deuxièmement, qu’elles visent la disciplinarisation davantage que l’intégration à l’emploi des prestataires d’aide sociale. Cet article propose en quelque sorte de faire oeuvre de mémoire en revenant sur une dimension relativement méconnue de l’histoire récente de l’aide sociale au Québec. Une mémoire qu’il est particulièrement important de raviver à l’heure actuelle, alors que les sanctions relatives à l’emploi viennent tout juste d’être réintroduites dans la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles[2], à peine plus d’une dizaine d’années après leur abolition.
Quand le Tribunal tranche: une fenêtre sur les pratiques répressives à l’aide sociale
Les pénalités considérées dans cet article concernent deux types d’obligations relatives à l’emploi, en vigueur dans la Loi jusqu’en 2005. Premièrement, il s’agit de l’obligation d’accepter ou de conserver un lien d’emploi, une disposition ancienne qui sera explicite dans la Loi de 1988 et reprise à l’identique dans la mouture subséquente entrée en vigueur en 1999 (Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale, chapitre S-32.001) :
L’adulte apte à occuper un emploi ne doit pas, sans motif sérieux, refuser un emploi ou l’abandonner ni le perdre par sa faute de manière à se rendre, ou, le cas échéant, à rendre sa famille admissible à un programme ou de manière à ce que leur soient accordées des prestations supérieures à celles qui leur auraient autrement été accordées
Loi sur la sécurité du revenu, chapitre S-3.1.1, article 29
Le montant de la pénalité passera en 1996 de 100 $ à 150 $ par mois pour une durée de douze mois, cumulable si un nouveau manquement est constaté (en 1990, la prestation de base pour un adulte seul était de 441 $ et de 537 $ en 2005). Cette sanction pouvait s’appliquer aussi bien à une perte ou à un refus d’emploi survenu au moment où la personne était déjà prestataire, qu’à une situation antérieure à la demande d’aide sociale. Par exemple, une personne ayant perdu son emploi « par sa faute » se voyait non seulement refuser des prestations d’assurance-chômage,[3] mais pouvait également être pénalisée pour les douze premiers mois de prestations d’aide sociale. Deuxièmement, il s’agit de l’obligation de se conformer aux instructions du ministre, exprimées par l’agente ou l’agent d’aide sociale, à savoir celles de réaliser les démarches prescrites pour la recherche d’emploi ou le développement de l’employabilité :
L’adulte apte à occuper un emploi, s’il n’est pas visé aux articles 16 et 18, doit entreprendre des démarches appropriées à sa situation afin de trouver un emploi rémunéré et se conformer aux instructions que peut lui donner le ministre à cette fin
Loi sur la sécurité du revenu, chapitre S-3.1.1, article 28
Il pouvait s’agir de se présenter à une convocation à une entrevue d’employabilité, de fournir des preuves de démarches d’emploi à son agente ou agent, ou encore de participer à une activité prévue dans le cadre d’un plan d’action, ou, à partir de 1999, d’un « parcours individualisé vers l’insertion, la formation et l’emploi ».
Il n’existe pas de données officielles permettant de mesurer l’ampleur de l’application des sanctions relatives à l’emploi[4]. En outre, le Ministère n’a publié aucune évaluation portant sur ces aspects particuliers de la Loi. Les seules données directement accessibles permettant d’avoir un aperçu du nombre de pénalités appliquées se trouvent dans les documents fournis par ce dernier dans le cadre de l’étude des crédits budgétaires. Ainsi, en réponse à des demandes écrites de l’opposition officielle, le Ministère affirme en 2004 avoir effectué annuellement dans les années précédentes plus de 15 000 « réductions d’aide pour refus d’emploi ou de démarches »[5]. Quoique ponctuelle, cette donnée est un indicateur du caractère non marginal du phénomène de l’application des pénalités, sans toutefois nous éclairer sur le profil des personnes touchées ou sur la nature plus précise des comportements sanctionnés. Par ailleurs, cette question est plutôt absente des écrits portant sur l’aide sociale au Québec. Même si quelques auteures et auteurs ont abordé cet aspect dans leur critique de la Loi (Lamarche, 1991; Normand, 1998), il ne ressort pas des études empiriques portant sur l’expérience de l’aide sociale, ni de celles, peu nombreuses, relatives aux pratiques des agentes et agents au sein de l’administration publique et à sa périphérie. De leur côté, Desgagnés et Villeneuve (1996), qui ont participé à une vaste enquête portant sur les trajectoires de prestataires d’aide sociale, laquelle abordait également la réalité des intervenantes et intervenants (McAll et White, 1996), constatent que les « agentes/agents ont une certaine marge de manoeuvre dans [l’]application » des sanctions relatives à l’emploi (Desgagnés et Villeneuve, 1996, p. 175).
Bref, si quelques données éparses nous permettent d’affirmer qu’avant 2005 des dizaines de milliers de personnes prestataires d’aide sociale ont été pénalisées financièrement pour avoir failli à leurs obligations relatives à l’emploi, il est néanmoins impossible de tracer un portrait exhaustif du phénomène. Socialement invisible, parce que vécue individuellement et privément par des personnes particulièrement désavantagées, cette répression spécifique n’a pas non plus suscité l’intérêt des chercheuses et des chercheurs en sciences sociales, même si d’autres aspects de la situation des prestataires d’aide sociale ont été documentés. En conséquence, les pratiques concrètes associées à ces dispositions et leurs effets individuels et collectifs restent à documenter.
Dans ce contexte de rareté des données, le traitement judiciaire des décisions contestées constitue l’une des seules traces du phénomène des sanctions relatives à l’emploi appliquées aux prestataires de l’aide sociale au Québec. Le TAQ[6] constitue le tribunal de dernière instance pour les prestataires de l’aide sociale dont les demandes de révision ont précédemment été déboutées. Bien sûr, une infime minorité de tous les cas de sanctions pécuniaires relatives à l’emploi se retrouvent au TAQ. Néanmoins, d’un point de vue qualitatif, ces documents sont fort éclairants. Bien que le phénomène de « pénalisation du droit social » s’inscrit dans l’agenda néolibéral de « punition et d’exclusion » des populations marginalisées, en rupture avec la logique préventive et inclusive caractéristique de l’État-providence (Robert, 1997), l’analyse ici ne porte pas sur les implications juridiques comme telles des décisions du TAQ, qui sont plutôt appréciées pour la fenêtre qu’elles ouvrent d’une part sur les pratiques des agents et agentes de l’État et d’autre part sur les conditions sociales des prestataires sanctionnés. Par ailleurs, le discours du Tribunal sur les situations en jeu est également intéressant d’un point de vue sociologique, dans la mesure où l’institution judiciaire fait partie intégrante du dispositif de l’aide sociale, lequel s’articule sur différents plans.
Le corpus comprend 364 décisions rendues par le TAQ entre le 7 avril 1998 et le 25 mai 2011, mais qui renvoient à des sanctions appliquées par le Ministère entre 1995 et 2005[7] (c’est-à-dire jusqu’à l’abolition des obligations relatives à l’emploi dans la Loi). Il s’agit de l’ensemble des décisions disponibles en ligne concernant ces dispositions précises de la Loi. Elles touchent quatre types de situations sanctionnées : un abandon d’emploi; un refus d’emploi; un congédiement; et un refus de se conformer aux instructions (voir tableau ci-dessous). Les informations factuelles disponibles dans ces documents ont été compilées à des fins de comparaison et d’analyse (sexe de la personne, situation d’emploi, présence à l’audition, représentation par un avocat ou une avocate, témoignage d’un tiers, etc.). Le texte des décisions a ensuite fait l’objet d’une analyse qualitative, portant une attention particulière aux motifs invoqués par les prestataires, à la description, parfois sommaire, de leurs conditions de vie et aux justifications exposées par les juges pour confirmer ou infirmer la sanction. Le but de cette démarche, qui combine — tout en étant exploratoire — analyse de contenu et de discours, est de mettre en relief les logiques implicites ou explicites des actions et les visions du monde qui les sous-tendent, d’une part, et leur articulation avec l’expérience sociale des personnes visées par ces actions, d’autre part.
Quelques mots d’abord sur le caractère genré du phénomène de l’injonction au travail, les obligations s’étant toujours conjuguées différemment pour les hommes et pour les femmes dans l’histoire de l’aide sociale (Morel, 2002). Dans notre corpus, 21 % des prestataires ayant contesté leur pénalité sont des femmes, ce qui pourrait laisser croire qu’elles ont été relativement moins sanctionnées que les hommes. Entre 1990 et 2005 en effet, les femmes représentent entre 39 % et 45 % des personnes à l’aide sociale susceptibles d’être sanctionnées, soit les personnes jugées sans « contrainte à l’emploi », temporaire ou non. Les raisons de cette disparité restent cependant à élucider, les données disponibles permettant difficilement de confirmer des hypothèses sur les pratiques répressives selon le sexe. Les femmes auraient-elles subi moins de sanctions parce qu’elles auraient été plus sujettes à se conformer aux injonctions? Auraient-elles tout simplement été moins nombreuses à contester les pénalités subies? Les agentes et les agents se seraient-ils montrés moins stricts envers les femmes pour ce qui concerne l’emploi, alors qu’inversement, à la même époque les pratiques répressives concernant la présomption de vie maritale pénalisent très majoritairement les femmes (Lamarche, 2000, p. 103-104)? Peu documenté au Québec, l’aspect genré des politiques d’activation a cependant été analysé ailleurs (Kuehni, 2017; Gazso, 2015; Modak, et collab., 2013). Ces études montrent que malgré l’apparente neutralité de ces politiques, les pratiques d’orientation et de placement diffèrent en fonction du sexe des prestataires. Notamment, les programmes d’insertion ont tendance à renforcer l’assignation des femmes au travail domestique, par effet de relégation dans certains secteurs d’emploi et par la réaffirmation de normes genrées via l’accompagnement personnalisé (Talbot, 2017).
Tableau 1
Décisions du Tribunal administratif du Québec (TAQ) touchant des prestataires d’aide sociale sanctionnés
Injonction à l’emploi et appareil punitif de l’aide sociale : un regard sociologique
Le texte du jugement résume la situation en cause et expose le raisonnement des juges, dont le rôle est d’évaluer la décision rendue en révision par le Ministère. Les faits sont examinés par le Tribunal et des témoins peuvent venir expliquer leur version. Une fois sur deux, un représentant ou une représentante de l’employeuse ou employeur vient témoigner, alors que la personne requérante est absente à l’audition dans le tiers des cas (le recours est alors rejeté dans 97 % des cas). Le Tribunal examine les motifs dans les situations de refus ou d’abandon d’emploi. Dans les cas de perte d’emploi, les juges cherchent avant tout à mesurer la faute de la requérante ou du requérant. Comme le précise un juge :
À cet effet, le Tribunal doit ici apprécier non pas s’il s’agit d’un congédiement justifié ou non, mais plutôt si le requérant a perdu son emploi par sa faute, de manière à se rendre admissible à des prestations supérieures à celles qui lui auraient autrement été accordées »
SAS-Q-052871-9909
Dans les autres cas, les juges établissent s’il s’agit bien d’un refus de se conformer aux instructions de l’agente ou de l’agent et, le cas échéant, en soupèsent le motif.
Outre les situations clairement exposées dans la Loi comme motifs valables d’abandon ou de refus d’emploi, c’est le personnel de première ligne du Ministère — et ensuite les juges — qui doivent déterminer si la personne a agi raisonnablement, dans une logique de sens commun faisant une large place à l’interprétation. Les directives données aux fonctionnaires pour évaluer les motifs d’un abandon d’emploi sont rappelées par un juge :
Il faut évaluer si l’adulte a agi comme l’aurait fait une personne raisonnable et responsable dans les mêmes circonstances. […] La notion de motifs sérieux pour refuser ou abandonner un emploi convenable réfère à des circonstances particulières qui, compte tenu de la situation personnelle de l’adulte, font en sorte : qu’il ne pouvait agir autrement sans encourir de préjudices ou inconvénients importants pour lui-même ou sa famille et qu’il n’y avait pas d’autres solutions raisonnables pour régler la situation que de refuser ou d’abandonner son emploi
SAS-Q-097021-0304
Les balises pour déterminer les motifs sont souples. Ainsi, selon le contexte, des problèmes de transport ou une dépendance à l’alcool peuvent être ou non considérés comme des motifs valables. Moins rigoureuse que dans le domaine pénal, la procédure entourant la présentation de la preuve est assez variable, et la propension des juges à accorder le bénéfice du doute à la personne requérante apparaît fortement contingente. Par exemple, plusieurs juges estiment que le fardeau de la preuve repose sur le Ministère dans les situations de perte d’emploi par congédiement, et sur le requérant ou la requérante dans les cas d’abandon ou de refus d’emploi (par exemple SAS-M-062968-0011). D’autres considèrent en revanche que le fardeau de la preuve revient toujours au Ministère lorsqu’une pénalité est appliquée (SR-21023). Dans les faits, plusieurs juges imposent à la personne requérante la responsabilité de prouver, par prépondérance de preuve, la validité de ses motifs ou son absence de faute.
Ainsi, les auditions du TAQ sont la plupart du temps le lieu d’une confrontation entre différentes rationalités : celle des juges qui ont le mandat d’appliquer la Loi, celle des agentes ou agents du Ministère qui cherchent à décrédibiliser la personne sanctionnée, et celle de la requérante ou requérant qui expose ses « bonnes raisons » (Dubet et Vérétout, 2001) d’avoir manqué à ses obligations. Le texte du jugement constitue l’exposé clinique de cette rencontre.
Invisibilité de la réalité concrète du travail
La notion d’activation repose sur un modèle d’incitation au travail ayant émergé dans les années 1980, dans un contexte de fort chômage, et basé sur une analyse économétrique comparant mécaniquement volume d’emploi et volume de chômeurs (Dubet et Vérétout, 2001). Cette vision de l’emploi fait du chômage essentiellement un problème technique, où il s’agit de trouver un mécanisme pour amener les sans-emploi vers l’activité. Elle est aveugle à la réalité concrète du travail, qui se transforme considérablement au cours des dernières décennies (Boucher et Noiseux, 2018). Pourtant, comme le rappellent Dubet et Vérétout (2001, p. 423), ce qui est en jeu, ce n’est pas simplement un emploi abstrait, mais une offre concrète de travail avec un « contenu social et subjectif », en l’occurrence des boulots précaires, temporaires, sur appel, des emplois sans avenir, des univers de travail hétéronomes et aliénants. Les emplois que les personnes prestataires d’aide sociale sanctionnées ont perdus, quittés ou refusés, ce sont notamment des emplois de caissière, d’aide à domicile, de vendeuse, de serveuse chez les femmes, ou des emplois de manoeuvre, de journalier, de plongeur ou dans l’entretien commercial chez les hommes. Les marchés du travail au bas de l’échelle auxquels ont accès les personnes sur l’aide sociale — dont environ la moitié ne détient pas de diplôme d’études secondaires — offrent non seulement du travail peu rémunérateur et de mauvaise qualité, ils sont en effet fortement ségrégués selon le sexe et particulièrement inégalitaires (Legault, 2011). Lorsqu’elle vise les personnes assistées sociales, l’« incitation » prend souvent le visage coercitif de l’injonction au salariat précaire, même si elle s’accompagne également de mesures fiscales destinées à favoriser le maintien dans l’emploi.
À travers leurs décisions, les juges reproduisent en partie cette vision idéalisée issue de l’analyse économique orthodoxe, considérant le travail comme une abstraction, à moins que durant l’audition la requérant ou requérant arrive par son éloquence ou son argumentaire à offrir un portrait vivant et convaincant de ses « bonnes raisons ». Cette situation est assez rare, surtout lorsque la personne n’est pas représentée par un avocat, ce qui est le cas dans 37 % des causes de notre corpus. Comme le constatent Bernheim, Laniel et Jannard (2018, p. 100-101), à la suite d’une observation ethnographique réalisée notamment au TAQ, « la pratique du rite judiciaire, l’utilisation de techniques et d’un jargon, la délimitation des questions juridiques au coeur du litige, ont pour effet de déposséder les justiciables non représentés de leurs histoires ». Le cadre juridique vient donc ici renforcer le désavantage épistémique des requérantes et des requérants dans la représentation de leur propre réalité. Par exemple, un requérant est pénalisé pour avoir laissé un emploi de boulanger. Les juges estiment qu’il n’avait « aucun motif sérieux » de le faire, vu qu’il s’agissait d’un emploi permanent et dans son domaine de formation; tout ça en dépit du fait que les heures de travail étaient très irrégulières (dépassant « largement » les 40 heures certaines semaines et, plusieurs autres, variant entre 20 et 30 heures), que l’entreprise était sujette à des fermetures temporaires, que l’été finissant, le nombre d’heures allait baisser et, qu’âgé de plus de 50 ans, le requérant se disait épuisé (SR-20091). Dans un autre cas, invoquant des problèmes de santé et le fait qu’elle ne pouvait pas voir sa fille le soir parce qu’elle devait se reposer, une requérante a quitté un emploi de nuit qu’elle occupait depuis deux ans en entretien ménager. Elle avait demandé de travailler de jour, mais cela lui avait été refusé pour la raison qu’il n’y avait pas de poste disponible. L’avocate du Ministère plaide qu’« en ce qui a trait à la fille de la requérante, il était possible pour cette dernière d’agencer son horaire de travail ou de s’organiser d’une autre façon », ce que retiennent les juges en affirmant dans leur rejet de l’appel que la requérante « aurait pu tenter de trouver une autre solution » (SAS-Q-097021-0304). Ou encore ici, alors que le requérant, dépressif et « sur le point de craquer », explique avoir quitté son emploi dans une buanderie parce qu’il le jugeait « aberrant, trop bruyant et routinier », et où ses relations avec les autres employés étaient médiocres, le Tribunal maintient la sanction, considérant qu’il « avait la possibilité de chercher un autre travail convenant davantage à ses aptitudes tout en conservant celui qu’il avait. » (SR-63498).
En général, la personne sanctionnée est surtout considérée comme soit trop sélective, désorganisée, ou insouciante dans son rapport à l’emploi, ce qui amène dans la majorité des cas les juges à confirmer la pénalité appliquée sur la prestation mensuelle. Par ailleurs, les situations de vie complexes des personnes à l’aide sociale, dont l’expérience de la pauvreté entraîne une spirale de difficultés de différents ordres (entre autres, problèmes de santé, endettement, isolement social, obstacles au transport, logement inadéquat) sont peu mises en relief. Le fait d’invoquer plusieurs motifs pour justifier un abandon d’emploi apparaît souvent contradictoire aux yeux des juges, qui cherchent à aplanir les situations afin d’identifier les chaînes de causalité ayant mené à la perte d’un emploi. Par exemple, dans le cas d’un homme — absent à l’audition — ayant quitté un emploi dans l’entretien ménager commercial, les juges affirment que :
[…] les motifs allégués par le requérant pour quitter son emploi, changent au fil des déclarations et documents qu’il produit :
désir de travailler dans son métier en soudure;
modification et ajout de tâches;
refus de syndicalisation de l’employeur;
menaces voilées de congédiement;
conflits avec le superviseur, bouc émissaire de ce dernier, etc.
Quel était le véritable motif du requérant? Lequel était prépondérant dans sa décision?
SAS-Q-075929-0105
Les relations de travail sont également idéalisées et présentées comme essentiellement d’ordre interpersonnel. Pour ce qui est des situations conflictuelles, à défaut d’être replacées dans leur contexte de rapports de pouvoir, leur interprétation fait apparaître un parti pris pro-patronal, et ce, de façon parfois flagrante. Dans les cas de congédiement, alors que le fardeau de la preuve devrait reposer sur le Ministère, les juges ont tendance à croire a priori que l’employeuse ou employeur est de bonne foi, considérant que celui-ci « n’a [pas] avantage à congédier inutilement [un ou une employée] » (SR-19138). À plusieurs reprises, les juges reprochent aux personnes requérantes de ne pas avoir fait valoir leurs droits (par exemple en déposant une plainte à la Commission des normes du travail), de ne pas avoir exprimé directement à leur patron leurs besoins (entre autres, en termes d’horaires) ou leurs récriminations (comme demander à se faire payer ses heures supplémentaires). À titre d’exemple, ce requérant qui vivait une période de grande précarité et de confusion s’est retrouvé en situation d’itinérance, et par conséquent, s’est absenté de son travail sans prévenir. Il a été congédié. Les juges estiment que la sanction de l’aide sociale est justifiée : « S’il voulait vraiment garder son emploi, il pouvait expliquer ses problèmes ouvertement à son supérieur dans un délai raisonnable » (SAS-M-052490-9910). L’inégalité structurelle qui caractérise ces situations d’emploi, non syndiquées, où les travailleuses et les travailleurs ne connaissent souvent ni leurs droits ni leurs recours, est rarement prise en considération. Considérés hors de leur contexte social, les démissions subites ou les accès de colère menant à un congédiement apparaissent donc aux yeux des juges comme des comportements irrationnels, voire erratiques. A contrario, la sympathie que l’employeuse ou employeur peut susciter par son témoignage tranche avec la version parfois désordonnée de la requérante ou du requérant et suffit assez souvent à compenser l’absence de preuve matérielle : « Le Tribunal, après avoir entendu l’employeur, ne peut se convaincre qu’il était une personne avec qui il était impossible de traiter sans encourir une conséquence tel le congédiement » (SR-055-21201). Dans un autre cas, un requérant ayant quitté son emploi de bûcheron plaide qu’il n’aurait gagné que 300 $ et que le terrain qu’on lui avait donné était « sale ». Son patron affirme au contraire que les gains comme bûcheron se situent entre 500 $ et 800 $ et que le terrain n’est pas « sale ». Sans exiger de preuves, les juges retiennent la version de l’employeur (SR-050-21167). Difficile de ne pas déceler de façon récurrente dans cette pratique judiciaire les effets d’une proximité de classe entre employeuses ou employeurs et juges, disqualifiant d’emblée les prétentions des prestataires d’aide sociale à faire reconnaître le bien-fondé de leur recours. Par ailleurs, plusieurs causes impliquent des emplois subventionnés (dans des entreprises privées ou non), ou encore des programmes de « stages » ou d’expériences de travail créés par l’État, quoiqu’il soit impossible de déterminer précisément la fréquence de ces cas, cette information n’étant pas systématiquement mentionnée dans le texte du jugement. Les intervenantes et intervenants externes qui administrent les mesures d’employabilité ou les employeuses ou employeurs subventionnés sont régulièrement appelés par le Ministère à témoigner des manquements de leurs employées ou employés, prestataires de l’aide sociale. En 1992, à peine quelques années après la première grande réforme de l’aide sociale et le déploiement d’un important programme d’emplois subventionnés, la Commission des affaires sociales notait d’ailleurs cette proximité entre l’État et les employeuses ou employeurs, constatant que
[…] les fonctionnaires du Ministère reconduisent presque automatiquement les décisions de l’employeur et le prestataire, reconnu avoir refusé un emploi, se voit alors imposer une réduction de ses prestations. Plusieurs prestataires déplorent auprès de la Commission de ne pouvoir se faire entendre avant qu’une telle sanction ne leur soit imposée
Commission des affaires sociales (CAS), 1992, p. 43-44
Mesurer la bonne volonté des pauvres
Ce qui est en jeu dans l’application de ces dispositions punitives est plus qu’une simple obligation d’accepter ou de maintenir un lien d’emploi. En effet, c’est un certain « ethos » (Fusulier, 2011) de la travailleuse ou du travailleur, dans un contexte d’économie de marché, qu’il s’agit de susciter à travers la mécanique disciplinaire, et c’est le défaut d’adopter certains comportements — ce que Woolford et Nelund (2013) nomment les attributs de la « citoyenneté néolibérale » — qui sont sanctionnés. Non seulement les individus doivent-ils faire la preuve de leur authentique désir d’occuper un emploi, mais ils ne doivent pas laisser croire que l’aide sociale pourrait représenter un attrait à leurs yeux. La fonction implicite de ces programmes est bien politique : en plus de faire de l’État le complice des nouveaux modes opérationnels des entreprises (impartition flexible, sous-traitance), il s’agit de battre en brèche l’idée même d’un « droit » à la protection sociale (Raffass, 2017).
Ce qui est puni la plupart du temps, c’est donc l’apparente absence de bonne volonté pour se conformer aux injonctions de l’employeuse ou employeur, agente ou agent d’aide du Ministère, ou même intervenante ou intervenant externe qui gère une mesure d’employabilité, soit toute actrice ou tout acteur impliqué dans le déploiement des politiques d’activation. Par ces politiques punitives, l’État ne fait pas qu’arbitrer la relation entre employeuses ou employeurs et main-d’oeuvre, ni même que forcer le retour au travail des prestataires; il organise directement leur disciplinarisation au sein du système élargi de l’aide sociale, lequel implique des organismes à but non lucratif offrant les activités de développement de l’employabilité prescrites par un agent ou une agente de l’État, ou entreprises privées, commerciales ou non, qui bénéficient de subventions salariales pour embaucher des prestataires d’aide sociale. Par exemple, un requérant est sanctionné pour s’être montré nonchalant lors d’une « séance d’information destinée à combler une trentaine d’emplois auprès d’une entreprise importante » avec une « représentante d’une firme spécialisée » (SR-20569/SR-21328). Ne pas avoir rappelé, ne pas avoir informé son agente ou agent de ses difficultés, avoir fait preuve de « manque de motivation » ou avoir démontré une « attitude négative » lors des rencontres de groupe sont des comportements susceptibles d’être sanctionnés. Il est attendu de la personne prestataire d’aide sociale et jugée apte à l’emploi qu’elle saisisse les occasions d’augmenter son employabilité en s’engageant de façon active dans le parcours qui lui a été planifié. Elle doit « jouer le jeu », qu’elle y croie ou non. Par exemple, une femme a été exclue d’un programme d’expérience de travail par la représentante d’un organisme d’insertion en emploi sous prétexte qu’elle « était peu réceptive aux discussions portant sur les objectifs du programme de réinsertion à l’emploi particulièrement sur le cheminement et le développement de la personnalité ». Dans ce cas, le Tribunal accepte toutefois d’annuler la pénalité qui lui a été imposée en sus de son exclusion du programme, constatant des contradictions entre la version de l’employeur et celle de la responsable du programme (SAS-Q-051399-9907). Que les politiques d’activation n’aient pas rempli globalement leurs objectifs affichés de réduire le chômage et la pauvreté (Raffass, 2017), ou que les mesures ponctuelles d’employabilité n’aient pas d’effet visible sur la réintégration en emploi[8] n’ébranle pas l’argumentaire idéaliste de l’activation. Aux yeux des juges et des agentes ou agents, le fait de faillir à son obligation de participer à des rencontres de groupes, entre autres exemples, est considéré en soi comme un signe de « nonchalance à vouloir intégrer le marché du travail » (SR-21732), et même une façon délibérée de se « priv[er] d’une source potentielle d’emploi rémunérateur » (SR-60580).
Pour évaluer la crédibilité des prestataires, les juges du TAQ ne se limitent pas aux faits ou au contexte entourant le comportement sanctionné. Le passé peut toujours être invoqué contre la personne requérante, si par exemple le Ministère peut faire la démonstration de sa propension à perdre ses emplois, ou encore à se quereller avec ses supérieures ou supérieurs. De la même façon que le passé peut être retenu contre la personne, sa situation au moment de l’audition ou encore sa trajectoire après les faits évoqués peut aussi avoir un impact sur la réflexion des juges. Ces dernières ou ces derniers ne manquent pas de souligner que telle personne requérante est en emploi plutôt que sur l’aide sociale au moment de l’audience, ce qui semble constituer en quelque sorte une preuve a posteriori de sa bonne volonté vis-à-vis le travail, mais qui ne suffit pas toujours à les convaincre d’infirmer une décision du Ministère. Par exemple, confirmant une double pénalité imposée à un individu jugé réfractaire aux mesures d’employabilité, les juges mentionnent tout de même que « présentement, le requérant travaille et que de meilleures conditions de vie ont changé son attitude, qui est beaucoup plus coopérative » (SR-61744).
Pour justifier un abandon, un refus ou la perte d’un emploi, la personne doit surtout faire la démonstration qu’elle n’a jamais eu l’intention de s’extraire de l’orbite du marché du travail afin de bénéficier des prestations de l’État. La loi est d’ailleurs explicite à cet égard : le cas échéant, la personne est sanctionnée pour « s’être rendue admissible » à l’aide sociale (Loi sur la sécurité du revenu, chapitre S-3.1.1, article 29). Le droit de choisir librement son travail disparaît précisément au moment où l’aide sociale devient le moyen de l’exercice de cette liberté, conformément à une analyse économique néoclassique selon laquelle les politiques sociales ne doivent pas interférer dans le calcul « rationnel » des agents économiques. Cela signifie en vérité que toute personne devrait par une mystérieuse gymnastique de l’esprit faire abstraction de l’existence d’un système d’assistance sociale lorsqu’elle envisage de quitter une situation d’emploi oppressante. Cette rupture sans équivoque avec l’idée d’un droit à l’aide sociale est explicite dans le cas de cette requérante ayant abandonné un emploi l’occupant 9 heures par semaine, parce qu’elle devait faire à pied un trajet de deux heures, à deux reprises durant la semaine :
Or, la requérante admet avoir abandonné son emploi « parce que ça valait pas la peine ». Le Tribunal rappelle qu’il s’agit ici d’une situation de prestataire de la Sécurité du revenu. Le Tribunal convient que ce n’était pas l’emploi idéal, mais la requérante n’avait aucun motif sérieux dans les circonstances pour l’abandonner
SR-21216
À travers les sanctions relatives à l’emploi, l’activation révèle sa double fonction disciplinaire : d’une part, éteindre le sentiment d’ayant droit chez les prestataires, et d’autre part, renforcer leur assujettissement aux conditions du marché du travail salarié au bas de l’échelle. Comme l’exprime clairement le Tribunal au sujet d’un homme ayant abandonné un emploi de chauffeur sous prétexte, entre autres, qu’il n’a jamais travaillé comme chauffeur, mais qu’il a plutôt déneigé des entrées à la pelle :
De l’avis du Tribunal, le mot « emploi » désigne tout genre de travail et ne doit pas nécessairement se limiter au seul emploi habituellement occupé par une personne ou à l’emploi qu’il est qualifié de remplir. Le Tribunal pense plutôt qu’il s’agit de tout emploi, quelque qu’il soit
SR-62814
Conclusion
En 2005, les sanctions relatives à l’emploi visant les prestataires d’aide sociale ont été abolies au Québec, à la faveur d’un contexte politique particulier et dans la foulée de l’adoption en 2002 de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Ce gain des groupes sociaux n’a pourtant pas infléchi de façon sérieuse la tendance amorcée il y a maintenant plus de trois décennies avec l’émergence de « l’activation » comme logique inspirant les réformes successives de l’aide sociale. En 2015, ces sanctions ont été réintroduites — dans un libellé presque identique aux dispositions antérieures —, par le biais d’un projet de loi instaurant un programme (Objectif Emploi) qui se substitue dorénavant à l’aide sociale pour toutes les personnes dites « sans contraintes à l’emploi » qui présentent une première demande d’aide sociale. Alors qu’à la fin des années 1980, le chômage structurel et la « lutte aux fraudeurs » servaient de caution au durcissement du régime d’aide sociale, l’argument de la pénurie de main-d’oeuvre a été invoqué dans les dernières années pour justifier le retour des obligations. Au moment du dépôt du projet de loi no 70, le ministre affirmait au sujet des prestataires ciblés par le programme obligatoire Objectif Emploi : « La société les attend. Dans un contexte où nous avons des emplois disponibles, c’est encore plus facile, encourager les jeunes à l’aide sociale d’aller trouver un emploi. Nous avons une situation idéale pour aider les jeunes » (Journal des débats de l’Assemblée nationale, 2015). Aujourd’hui plus que jamais, l’État cherche à instrumentaliser l’aide sociale aux fins d’alimenter des marchés du travail au bas de l’échelle. Dans le capitalisme néolibéralisé, le « devoir d’être disponible pour occuper un emploi » s’est substitué globalement à la notion de « droit au travail », mais cette obligation ne s’applique dans les faits qu’aux personnes qui portent l’odieux de s’inscrire dans le canal de l’assistance sociale (Freyssinet, 2000, p. 43). Leur « dépendance » à l’État, rendue ultravisible et stigmatisée, trouve son remède dans une autre dépendance — celle-là complètement invisibilisée — au salariat, et plus particulièrement aux marchés de l’emploi précaire et peu rémunérateur (Fraser et Gordon, 1994).
Après plus d’un quart de siècle d’application de sanctions relatives à l’emploi au Québec, il y a peu d’études indépendantes documentant les effets de cette politique de sanctions sur différentes catégories de la population à l’aide sociale. Le présent article contribue modestement à documenter ce pan de l’histoire des pratiques répressives à l’aide sociale au Québec, dans un contexte où les données disponibles ne permettent pas de dresser un portrait exhaustif de l’étendue du phénomène. L’étude des décisions du TAQ est éclairante sur la logique normative qui se déploie à l’échelle des actrices et acteurs du dispositif de l’aide sociale, et devrait nourrir notre compréhension des changements en cours. Puisqu’elles reposent sur une vision théorique et idéalisée de l’emploi, indissociable d’une lecture néolibérale du social, les politiques d’activation impliquent l’oblitération des conditions de vie et de travail des personnes au bas de l’échelle. La portée de cette étude est bien sûr limitée. Les effets de cette répression, d’une part sur le parcours des personnes et d’autre part sur le système d’emploi, demeurent largement inconnus. Certains constats établis dans d’autres pays où des politiques punitives ont été appliquées nous donnent pourtant des pistes à explorer au Québec, notamment en ce qui concerne le sort des personnes éjectées des systèmes d’assistance sociale, qui vont grossir les rangs des travailleuses ou travailleurs pauvres et se retrouver dans des situations de dépendance personnelle — c’est le cas particulièrement des femmes —, dans l’économie informelle, ou dans des situations de pauvreté extrême et de désaffiliation sociale — notamment dans l’itinérance (Raffass, 2017, p. 358). La critique des changements à l’oeuvre au sein de l’État social doit se poursuivre, tant sur le plan des conséquences sur les trajectoires individuelles que sur celui du devenir de notre système de protection sociale. Il est grand temps de s’attaquer à la fausse neutralité des politiques d’activation, en montrant comment l’État, par le biais de l’aide sociale, participe à la fois au creusement et à la reconfiguration des inégalités sociales au XXIe siècle.
Appendices
Notes
-
[1]
Les obligations relatives à l’emploi ou au travail ont toujours fait partie des régimes d’assistance sociale dans les sociétés capitalistes. Au Québec, même pendant le relatif « âge d’or » de l’universalité de l’aide sociale entre 1969 et 1989, l’obligation d’accepter ou de conserver un emploi existait dans la Loi, et des sanctions étaient appliquées (Mallette, 1986). Dans le régime de l’activation, la nouveauté réside surtout dans la généralisation des programmes d’employabilité, dans le suivi individuel intensif des prestataires et dans l’arsenal de surveillance et de contrôle qui l’accompagne. En outre, plus récemment, il appert que de plus en plus les politiques d’aide sociale sont instrumentalisées au profit d’une stratégie de flexibilisation de la main-d’oeuvre (Morel, 2016, p. 9).
-
[2]
Selon l’OQLF, (2016, chapitre 25), Loi visant àpermettre une meilleure adéquation entre la formation et l’emploi ainsi qu’à favoriser l’intégration en emploi
-
[3]
En effet, durant la même période, le régime fédéral d’assurance-chômage subit également des assauts répétés. La réforme (C-21) adoptée en 1990 prévoit une augmentation de la durée maximale des exclusions en cas de départ volontaire ou de congédiement et une baisse du taux de prestation, tandis qu’en décembre 1992, le gouvernement annonce dans un projet de loi l’abolition des prestations en cas de départ volontaire ou de congédiement (C-105).
-
[4]
Nous avons présenté une demande au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS), en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, pour obtenir des données concernant l’application des pénalités durant la période 1990-2005. Aucun document n’a été fourni à la suite de cette demande, le MTESS plaidant « l’âge des données recherchées et la désuétude [des] systèmes informatiques ».
-
[5]
Ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille, Étude des crédits 2004-2005, Demandes de renseignements particuliers de l’opposition officielle, volet aide à l’emploi, p. 535. https://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/DepotNumerique_v2/AffichageFichier.aspx?idf=154009. Il n’est pas précisé si ce chiffre concerne l’ensemble des pénalités appliquées en vertu des articles 45, 47 et 49 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale.
-
[6]
Avant le 1er avril 1998, la Commission des affaires sociales (CAS) recevait les demandes de révision de l’aide sociale. À la création du Tribunal administratif du Québec (TAQ), les causes en attente à la CAS y ont été transférées. Toutes les décisions du TAQ depuis sa création sont disponibles en ligne.
-
[7]
Sauf un cas en 1992 et un autre en 1994. Notre corpus comprend toutes les décisions qui réfèrent aux articles concernant les obligations relatives à l’emploi dans la Loi sur la sécurité du revenu (articles 28 et 29) ou dans la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (articles 45, 47. et 49). En conséquence, on peut affirmer que la série est complète pour ce qui concerne les causes déposées après la date de création du Tribunal en 1998 jusqu’à l’abolition des pénalités; la série est par contre incomplète pour la période antérieure, et ne comprend que les causes pendantes au moment de la création du TAQ.
-
[8]
Par exemple, une étude commandée par le Ministère conclut que « la participation à la mesure [Services d’aide à l’emploi] SAEM a peu, voire pas, d’effet sur l’insertion en emploi pour les participants. Que ce soit en termes de temps passé en emploi, de nombre d’heures de travail ou de rémunération d’emplois, les participants ne s’en tirent pas mieux que les non-participants ». (SOM, 2014, p. 355)
Bibliographie
- BARBIER, Jean-Claude (2009). « Le workfare et l’activation de la protection sociale, vingt ans après : beaucoup de bruit pour rien ? Contribution à un bilan qui reste à faire », Lien social et Politiques, N° 61, p. 23-36.
- BARBIER, Jean-Claude (2011). « Activer les pauvres et les chômeurs par l’emploi ? Leçons d’une stratégie de réforme », Politiques sociales et familiales, N° 104, p. 47-58.
- BERNHEIM, Emmanuelle, Richard-Alexandre LANIEL et Louis-Philippe JANNARD (2018). « Les justiciables non représentés face à la justice : une étude ethnographique du Tribunal administratif du Québec », Windsor Review of Legal & Social Issues, Vol. 39, N° 67, p. 67-104.
- BOUCHER, Marie-Pierre, et Yannick Noiseux (2018). « Austérité, flexibilité et précarité au Québec : la fuite en avant », Labour/Le Travail, N° 81, p. 119–157. BROWN, Wendy (2004). « Néo-libéralisme et fin de la démocratie », Vacarme, Vol. 4, N° 29, p. 86-93.
- COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES (CAS) (1992). Rapport annuel 1991-1992.
- DARDOT Pierre, et Christian LAVAL (2009). La nouvelle raison du monde. Essai sur la société néolibérale, Paris, La Découverte, 504 p.
- DESGAGNÉS, Jean-Yves, et Lucie VILLENEUVE (1996). Le système de sécurité du revenu québécois et l’intégration au travail après cinq ans d’application: du discours à la réalité. [Mémoire de maîtrise], Québec, Université Laval, 317 p.
- DUBET, François , et Antoine VÉRÉTOUT (2001). « Une “réduction” de la rationalité de l’acteur. Pourquoi sortir du RMI? », Revue française de sociologie, Vol. 43, No 3, p. 407-436.
- DUFOUR, Pascale, Gérard BOISMENU et Alain NOËL (2003). L’aide au conditionnel. La contrepartie dans les mesures envers les personnes sans emploi en Europe et en Amérique du Nord, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 248 p.
- FRASER, Nancy, et Linda GORDON (1994). « A Genealogy of Dependency: Tracing a Keyword of the U.S. Welfare State », Signs, Vol. 19, N° 2, p. 309-336.
- FREYSSINET, Jacques (2000). « Plein emploi, droit au travail, emploi convenable », Revue de l’IRES, Vol. 34, N° 3, p. 27-58.
- FUSULIER, Bernard (2011). « Le concept d’ethos », Recherches sociologiques et anthropologiques, Vol. 42, N° 1, p. 97-109.
- GAZSO, Amber (2015). « Gendering Social Assistance Reform », dans Daniel Béland et Pierre-Marc Daignault (dirs.), Welfare Reform in Canada. Provincial Social Assistance in Comparative Perspective, Toronto, University of Toronto Press, p. 273-287.
- JETTÉ, Nicole, Fannie BRUNET et Véronique MARTINEAU (2011). L’histoire du droit à l’aide sociale au Québec (1969-2011). Le droit à un revenu suffisant au Québec: une réalité virtuelle?, Front commun des personnes assistées sociales, 29 p.
- JOURNAL DES DÉBATS DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE (2015). Assemblée nationale du Québec, 18 novembre 2015, réf. du 6 mai 2019, http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/journaux-debats.html
- KUEHNI, Morgane (2017). « Des expériences de pauvreté laborieuse dans un contexte d’activation sociale : une perspective de genre », Recherches féministes, Vol. 30, N° 2, p. 81-100.
- LAMARCHE, Lucie (1991). « La nouvelle Loi sur la sécurité du revenu au Québec: quelques réflexions d’actualité », Revue de droit de l’université de Sherbrooke, Vol. 21, N° 2, p. 335-366.
- LAMARCHE, Lucie (2000). « Le féminisme québécois, la crise des droits et la recherche sur le droit : quelques raisons de s’inquiéter... et quelques autres d’espérer », Cahiers de recherche sociologique, Vol. 34, p. 99-126.
- LEGAULT, Marie-Josée (2011). « La mixité en emploi au Québec... Dans l’angle mort chez les moins scolarisés? », Revue multidisciplinaire sur l’emploi, le syndicalisme et le travail, Vol. 6, N° 1, p. 20-58.
- LESSARD, Denis (1988). « [Amendements au projet de loi 37 sur la réforme de l’aide sociale] : coupure surprise de $100 pour les assistés sociaux qui refuseront un emploi », La Presse 23 novembre 1988, p. A1-A2.
- LIPSKY, Michael (2010) [1980]. Street-Level Bureaucracy. Dilemmas of the Individual in Public Services, New York, Russell Sage Foundation, 275 p.
- MALLETTE, Nicole (1986). Loi annotée sur l’aide sociale et son règlement, Montréal, Société québécoise d’information juridique, 425 p.
- MCALL, Christopher, et Deena WHITE (dirs) (1996). Structures, systèmes et acteurs: welfare et workfare comme champs d’action sociale, [rapport de recherche], Équipe de recherche sur la pauvreté et l’insertion au travail, Département de sociologie, Université de Montréal, 206 p.
- MODAK, Marianne, et collab. (2013). « Les normes d’une famille « juste » dans les interventions des assistantes et assistants sociaux de l’aide sociale publique », Nouvelles Questions Féministes, Vol. 32, N° 2, p. 57-72.
- MOREL, Sylvie (2002). « La transformation des obligations de travail pour les mères touchant l’assistance sociale : quels enseignements tirer pour les féministes? », Lien social et Politiques, N° 47, p. 171-186.
- MOREL Sylvie (2003). « La France et le Québec : des logiques de réciprocité semblables entre l’État et les pauvres ? », Santé, Société et Solidarité, N° 1, p. 55-68.
- MOREL, Sylvie (2016). L’assistance sociale : élément d’une politique de main-d’oeuvre ou d’une stratégie de sécurisation des trajectoires professionnelles ? [Mémoire déposé à la Commission de l’économie et du travail dans le cadre de l’étude du projet de loi 70], 33 p.
- NORMAND, Bernard (1998). L’obligation de travailler, l’aptitude au travail et l’employabilité trois normes au coeur du retournement de l’aide sociale au Québec au cours des années quatre-vingt, [mémoire de maîtrise], Montréal, UQAM, 139 p.
- RAFFASS, Tania (2017). « Demanding Activation », Journal of Social Policy, Vol. 46, N° 2, p. 349–365.
- ROBERT, Pierre (1997). « La gestion pénale du social. Le phénomène de la pénalisation du droit social », dans Pierre Robert (dir.), La gestion sociale par le droit pénal. La discipline du travail et la punition des pauvres, Montréal, Les éditions Yvon Blais, p. 1-31.
- RECHERCHE ET SONDAGE (SOM) (2014). Étude des effets des mesures actives offertes aux individus par Emploi-Québec. 2e cycle d’évaluation, [Rapport d’évaluation présenté à la Direction de l’évaluation], Emploi-Québec, gouvernement du Québec, 785 p.
- TALBOT, Cécile (2017). « Les politiques d’insertion comme processus d’assignation au travail domestique : l’exemple des plans locaux pour l’insertion et l’emploi français », Recherches féministes, Vol. 30, N° 2, p. 139-156.
- WOOLFORD, Andrew, et Amanda NELUND (2013). « The Responsibilities of the Poor: Performing Neoliberal Citizenship within the Bureaucratic Field », Social Service Review, Vol. 87, N° 2, p. 292-318.
List of tables
Tableau 1
Décisions du Tribunal administratif du Québec (TAQ) touchant des prestataires d’aide sociale sanctionnés

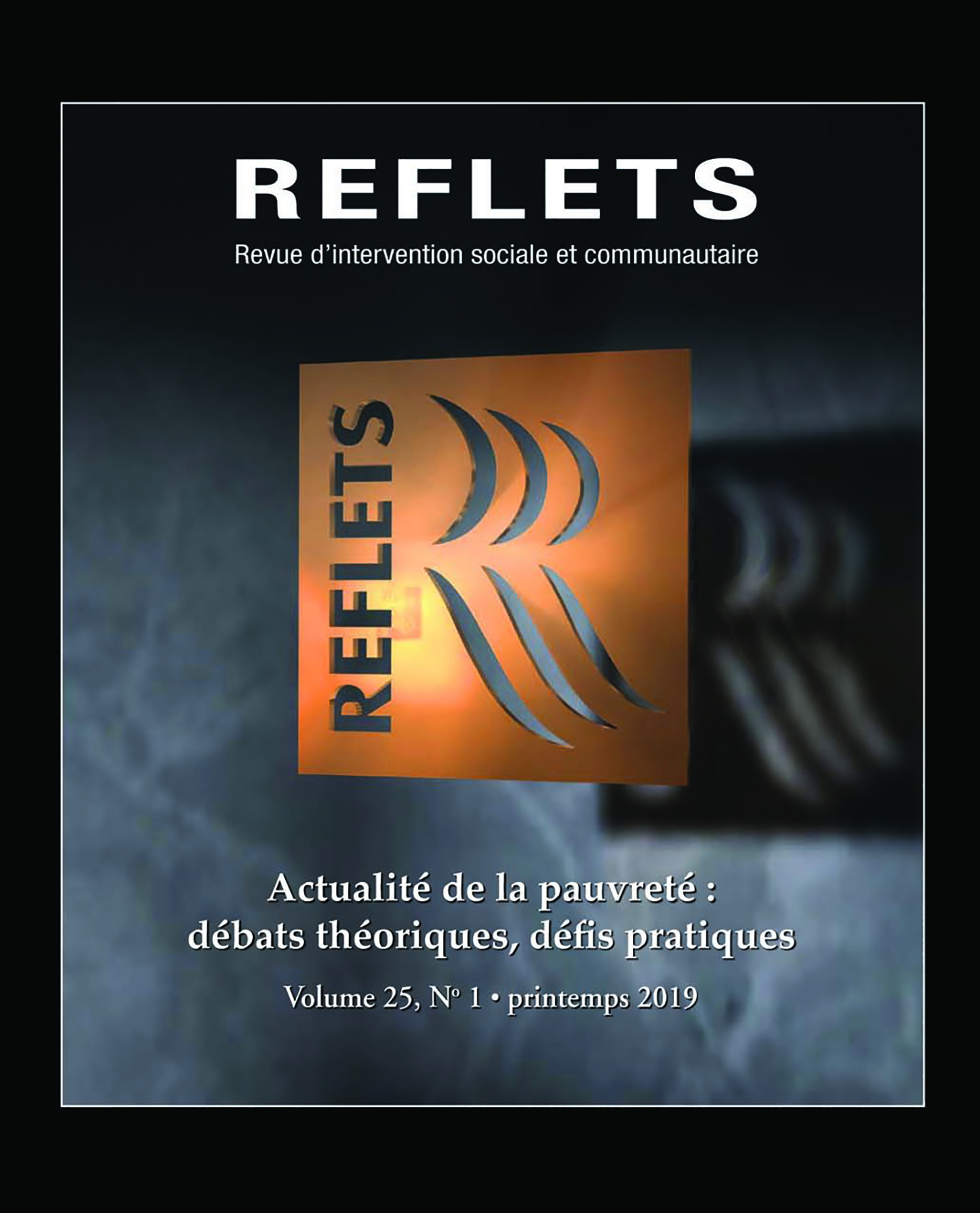

 10.7202/1002429ar
10.7202/1002429ar