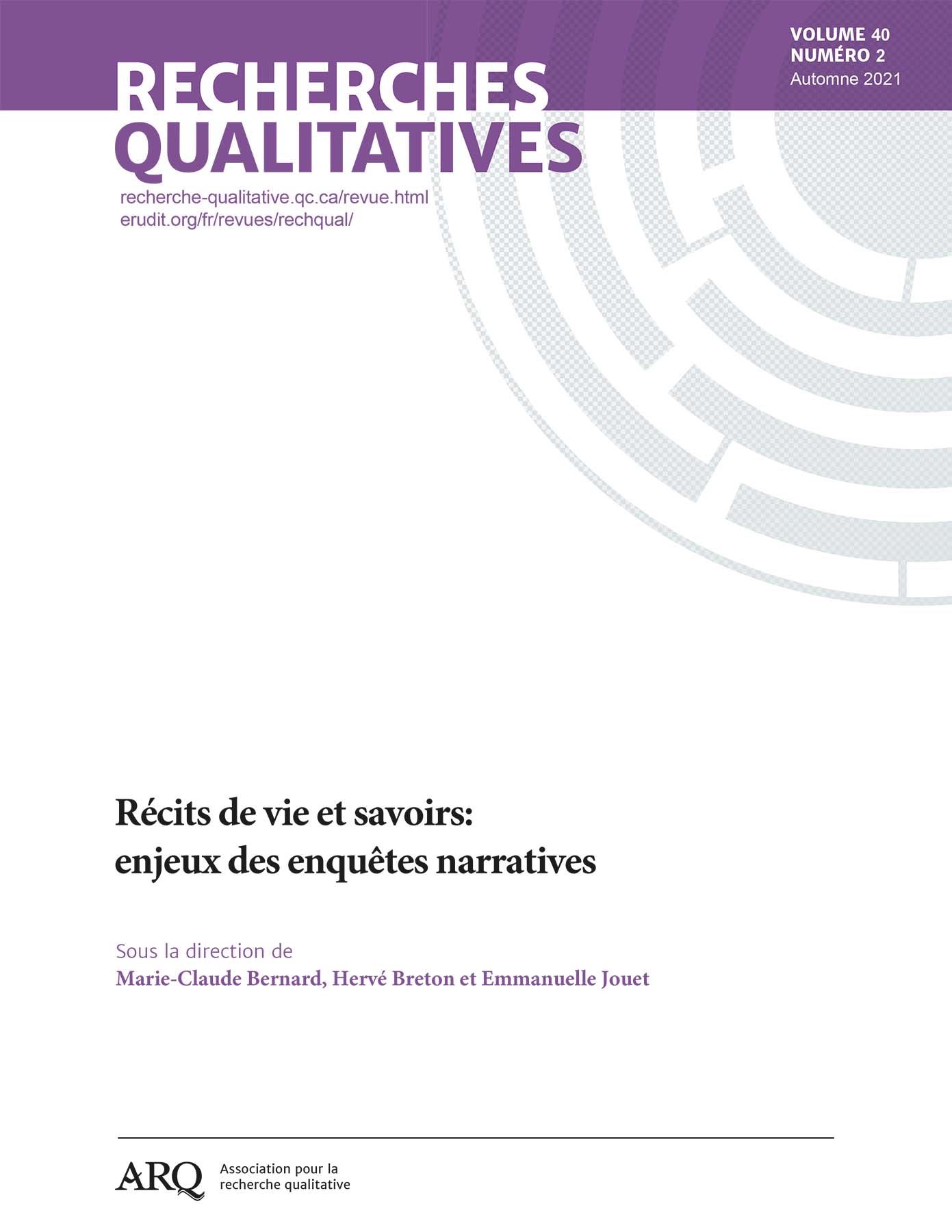Daniel Bertaux est largement reconnu en Europe et ailleurs pour avoir développé l’approche de recherche qualitative qu’il a appelé « ethnosociologie ». Cette approche donne une importance centrale aux récits de vie, dont la théorie et l’usage ont été proposés dans deux ouvrages importants : Destins personnels et structure de classe (l977) et Les récits de vie (1997). L’approche ethnosociologique de Daniel Bertaux, désormais classique en France, a, dans les années 1980 et 1990, été diffusée dans de nombreux pays en Europe et dans les Amériques même si l’intégralité de sa vision de la sociologie est parfois encore méconnue. C’est le cas au Brésil, ce qui nous a incités à vouloir conduire un entretien avec ce chercheur. Daniel Bertaux s’est montré favorable à notre demande et a bien voulu retracer son parcours et replacer ses contributions dans les différents contextes intellectuels pertinents des années 1970 à aujourd’hui. La traduction en portugais de cet entretien (qui s’est fait par échange de courriels en 2018) a été publiée en 2020 dans la revue de sociologie de l’Université de São Paulo, Tempo Social (Costa & dos Santos, 2020). Nous souhaitons aujourd’hui en faire profiter le public francophone. J’ai derrière moi une trajectoire aussi atypique que le recours aux récits de vie était atypique en sociologie empirique quand j’ai cherché à convaincre mes collègues de sa légitimité. En effet, j’ai été orienté par mes parents vers une formation scientifique de haut niveau : j’ai obtenu mon bac à 16 ans, avec deux ans d’avance sur l’âge normal (18 ans); j’ai préparé les (difficiles, très compétitifs) concours aux grandes écoles, qui constituent en France l’étage d’élite de l’éducation supérieure; j’ai réussi, à 18 ans, en 1957, le prestigieux concours de l’École Polytechnique, d’où sortent la plupart des top managers des grandes entreprises industrielles… Mais ce n’était pas du tout ma vocation. Moi, je voulais devenir écrivain. Mes parents le savaient, mais ils ne l’ont pas pris au sérieux. Qui plus est, quand je suis sorti de Polytechnique en 1959, c’était l’époque où tous les jeunes hommes de vingt ans étaient envoyés faire la guerre en Algérie (une sale guerre). Or j’étais né, pas de chance, en 1939… J’ai cherché à y échapper : la seule voie que j’ai trouvée, c’était… de choisir la carrière d’ingénieur militaire (en effet, par exception les armées n’envoyaient pas en Algérie l’élite de leurs futurs ingénieurs). Je n’aimais pas le métier d’ingénieur, et je détestais la hiérarchie militaire; mais j’ai dû, la mort dans l’âme, m’y engager pour dix ans… Quand je suis revenu à Paris, en 1963, il m’a bien fallu travailler comme ingénieur militaire; mais j’ai quand même obtenu qu’on me laisse développer les prémisses de l’intelligence artificielle. Mes supérieurs hiérarchiques n’y croyaient pas... Parallèlement je me suis inscrit à la licence de sociologie de la Sorbonne; j’étudiais le soir, tout en étant déjà marié et en élevant avec Isabelle notre premier enfant, une fille. Un an plus tard toutefois, j’ai entendu parler d’un concours offrant aux anciens élèves des grandes écoles des bourses pour faire le tour du monde. J’ai présenté mon dossier et, sur un coup de chance – sans interventions particulières –, j’ai obtenu une des quatre bourses! J’ai donc délaissé provisoirement, et avec un grand bonheur, un métier que je n’aimais pas pour voyager, grâce à la Fondation Singer-Polignac, pendant un an en Afrique de l’Est, en Inde et au Népal, puis en Chine et au Japon, en Californie et au Mexique, et enfin au Pérou, au Chili, en Argentine et en Uruguay (où j’ai de la famille, les Supervielle), au Paraguay et jusqu’au …
Appendices
Références
- Becker, H. S. (1982). Art worlds. Art worlds and collective activity. Berkeley, CA : University of California Press.
- Bertaux, D. (1976). Histoire de vies ou récits de pratiques? Méthodologie de l’approche biographique en sociologie. Paris : Maison des sciences de l’homme.
- Bertaux, D. (1977). Destins personnels et structure de classe. Paris : Presses universitaires de France.
- Bertaux, D. (1978). Destinos pessoais e estrutura de classe: para uma crítica da antroponomia. Lisboa : Moraes Editora.
- Bertaux, D. (1997). Les récits de vie : perspective ethnosociologique. Paris : Nathan Université.
- Bertaux, D. (2014). Sept propriétés des récits de vie. Dans S. Ertul, J.-Ph. Melchior, & C. Lalive d’Épinay (Éds), Subjectivation et redéfinition identitaire (pp. 29-52). Rennes : Presses universitaires de Rennes.
- Bertaux, D., Delacroix, C., & Pfefferkorn, R. (Éds.). (2014). Précarités : contraintes et résistances. Paris : L’Harmattan.
- Bertaux, D. (2016). Le récit de vie (3e éd.). Paris : Armand Colin.
- Bertaux, D., & Bertaux-Wiame, I. (1976). Une enquête sur la boulangerie artisanale par l’approche biographique. Subvention C.O.R.D.E.S. no 43/76, Rapport Final, vol. i. Repéré à http://www.daniel-bertaux.com/textes/bertauxboulangerievol-i.pdf
- Bertaux, D., & Garros, V. (1998). Lioudmilla : une Russe dans le siècle. Paris : La Dispute.
- Bertaux, D., & Malysheva, M. (1994). Le modèle culturel des classes populaires russes face au passage à l’économie de marché. Revue d’études comparatives Est-Ouest, 4(25), 197-228.
- Biografieforschung. (2020). Dans Wikipédia. Repéré à https://de.wikipedia.org/wiki/Biografieforschung
- Bourdieu, P. (1986). L’illusion biographique. Actes de la Recherche en sciences sociales, 62/63, 69-72.
- Bourdieu, P., Chamboredon, J.-C., & Passeron, J.-C. (1983). Le métier de sociologue. Paris : Mouton.
- Catani, M., & Mazé, S. (1982). Tante Suzanne, une histoire de vie sociale. Paris : Librairie des Méridiens.
- Costa, L. R., & Santos, Y. G. dos. (2020). O « relato de vida » como método das Ciências Sociais: Entrevista com Daniel Bertaux [Le « récit de vie » comme méthode des sciences sociales : entrevue avec Daniel Bertaux]. Tempo Social, 32(1), 319-346. https://doi.org/10.11606/0103-2070.ts.2020.159702
- Durkheim, E. (1968). Les règles de la méthode sociologique. Paris : Les Presses universitaires de France. (Ouvrage original publié en 1894).
- Ehrenreich, B. (1987). The hearts of men: American dreams and the flight from commitment. New York, NY : Anchor.
- Giddens, A. (1987). La constitution de la société. Paris : Presses universitaires de France.
- Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research. New Brunswick, NJ : Aldine Transaction.
- Hammersley, B., & Atkinson, P. (1990). Ethnography. Principles in practice. New York, NY : Routledge.
- Juan, S. (2015). L’école française de socioanthopologie. Auxerre : Sciences Humaines Éditions.
- Lahire, B. (1998). L’homme pluriel : les ressorts de l’action. Paris : Nathan.
- Lewis, O. (1963). Les enfants de Sanchez : autobiographie d’une famille mexicaine. Paris : Gallimard.
- Poulantzas, N. (1974). Les classes sociales dans le capitalisme aujourd’hui. Paris : Le Seuil.
- Ragin, C. C., & Becker, H. S. (1992). What is a case? Exploring the foundations of social inquiry. Cambridge : Cambridge University Press.
- Shaw, C. R., & Mckay, H. D. (1942). Juvenile delinquency in urban areas: A study of rates of delinquents in relation to differencial characteristics of local communities in american cities. Chicago, IL : University of Chicago Press.
- Thomas, W. I., & Znaniecki, F. (1996). The Polish peasant in Europe and America: A classic work in immigration history. Chicago, IL : University of Illinois Press. (Ouvrage original publié en 1918).