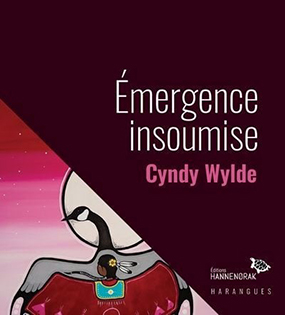Article body
Paru dans la collection « Harangues » aux Éditions Hannenorak en avril 2024, Émergence insoumise de Cyndy Wylde, Anicinapek de Pikogan et Atikamekw, professeure à la Faculté des sciences sociales de l’Université d’Ottawa, met en relief la discrimination systémique vécue par les femmes autochtones. Cyndy Wylde choisit d’embrasser son expérience personnelle et sa résistance pour écrire ce texte à la fois intime, dénonciateur et informatif. Elle amorce sa réflexion par une anecdote, lorsqu’elle se remémore le moment où elle attendait un taxi à Val-d’Or, en soirée, à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Invitée à sortir par le gardien de sécurité alors que la fermeture est imminente, elle rétorque : « Non, mais croyez-vous vraiment que moi, une femme des Premières Nations, je vais aller attendre seule, le soir, à Val-d’Or ? ». Et voilà ! Le ton est donné à la troisième publication de cette collection sans compromis.
C’est ainsi que Cyndy Wylde amorce une profonde réflexion sur les problèmes de discrimination systémique vécus par les femmes autochtones et les Autochtones en général au Canada. Elle conjugue événements marquants et récit de ses expériences personnelles dans le système éducatif non autochtone, notamment au cégep, où la solitude et le racisme la déconcertent, pendant qu’éclate la « crise d’Oka » (résistance de Kanesatake), à l’été 1990. Les personnes lectrices saisiront les discriminations systémiques qu’elle a personnellement vécues. Parmi les anecdotes choquantes, elle raconte avoir été arrêtée six fois par la Sûreté du Québec (SQ), entre Grand-Remous et Louvicourt, alors qu’elle était en direction de sa communauté, cet été-là. Pour l’autrice, il ne fait aucun doute que son profil racial la rendait suspecte aux yeux des forces de l’ordre – pour ceux et celles qui veulent les nommer ainsi.
Nous découvrons comment, au fil de son parcours, l’autrice a persévéré malgré les embûches et s’est tournée vers des études en criminologie. Elle a consacré ensuite vingt-cinq ans de sa vie à Service correctionnel Canada. Elle a tenté de transformer le milieu carcéral, dans lequel elle constatait les conséquences désastreuses de la colonisation sur les populations autochtones, surreprésentées dans les prisons du pays. Après huit ans, en 1999, on lui a offert un poste stratégique afin de remédier à la situation. Malgré cela, elle s’indigne de la lenteur des transformations des pratiques dans son milieu. Elle arrive au constat que c’est toute la structure de la société qui pose problème : « [Les] Autochtones comptaient pour 17 % de la population carcérale. Aujourd’hui, cette proportion est passée à plus de 30 % » (p. 30-31). Trop peu, trop tard, selon elle. Elle dénonce ainsi les politiques coloniales, le manque de soutien aux femmes, le peu de valeur accordé à leur parole, à leur humanité, l’absence de soutien à leur autodétermination, la prise de possession de leur territoire, etc. En un mot, si vous pensez prendre un café calmement en lisant ce bouquin, ravisez-vous. Il est bref, mais poignant.
Et, en ce sens, à la lecture, nous pouvons rester sur notre faim. Les exemples concrets des discriminations vécues dans le milieu carcéral sont lacunaires, puisque l’autrice a prêté serment et ne peut divulguer certaines informations. Il y a bien sûr le cas du « pavillon D », réservé aux délinquants sexuels, où l’on envoyait systématiquement les Autochtones sans évaluation, ce qu’elle a dénoncé à maintes reprises sans obtenir de suivi de ses supérieurs. Pour en savoir plus, il est possible de lire la thèse de doctorat de Cyndy Wylde ou se référer aux nombreux rapports publiés par le Bureau du vérificateur général du Canada. Néanmoins, cette contrainte ne mine pas le texte. L’autrice choisit d’ouvrir sa réflexion à d’autres situations, notamment les cas des femmes et des filles disparues et assassinées, les nombreux rapports qui dénoncent les manoeuvres coloniales des gouvernements au fil des années et les morts tragiques de Joyce Echaquan, de Cyndy Gladue, de Tina Fontaine, de Chantel Moore et de bien d’autres encore.
En préface, l’autrice dira s’adresser surtout aux jeunes des Premières Nations et aux autres personnes intéressées à plonger au coeur des enjeux vécus par les femmes autochtones. Elle souligne d’ailleurs que ses propres filles ont beaucoup plus de possibilités et vivent moins de discrimination que ce qu’elle a pu vivre elle-même en grandissant, ce qui donne de l’espoir. Le texte est court, équilibré entre le récit autobiographique et les informations factuelles. Sans verser dans l’analyse sociologique ni citer trop d’ouvrages, Émergence insoumise est un essai ancré dans l’expérience personnelle de l’autrice et saura assurément intéresser les jeunes des communautés, de même que beaucoup de Québécois. Le ton est bien mené entre résilience et colère contenue. Il témoigne de la lumière et de la force vive qui habitent les coeurs des femmes autochtones.