Abstracts
Résumé
La question du rapatriement des landraces (variétés paysannes) auprès des communautés autochtones et locales qui les ont domestiquées, sélectionnées et continuent encore à les cultiver, est au coeur de cet article. Ces vingt-cinq dernières années, face à des institutions internationales frileuses, différents acteurs se sont mobilisés, en dehors mais également depuis ces mêmes institutions, pour que ce terme soit adopté. L’auteure propose ici d’analyser ce processus en termes de controverse scientifique dans le cadre de laquelle les différents acteurs ont ouvert un espace de dialogue et de négociation autour de la gouvernance des ressources phytogénétiques à différentes échelles (globale, nationale, locale). La réflexion porte en grande partie sur le cas, pionnier, de la pomme de terre, mais l’auteure ne s’y est pas restreinte. Cet article s’intéresse aussi à la façon dont ces débats contribuent à déconstruire le commun global constitué pour les ressources phytogénétiques dans les domaines de l’alimentation et de l’agriculture en opérant un double processus de reterritorialisation et de rematérialisation. Ces ressources redeviennent ainsi peu à peu des semences ancrées territorialement, historiquement et culturellement.
Mots-clés :
- rapatriement,
- ressources phytogénétiques,
- semences,
- gouvernance internationale de la biodiversité,
- rematriement
Abstract
This article is about the repatriation of landraces from global gene banks to the Indigenous and local communities who have domesticated, selected and eventually continue to cultivate the germplasm conserved in these institutions. Over the past 25 years, various actors have mobilized for the recognition of this terminology, repatriation, despite the cautiousness of the relevant international institutions (TIRPAA, CDB, CGIAR and its centers). We propose to analyze this process in terms of scientific controversy in which context, the various actors have opened up a space for dialogue and negotiation around the governance of plant genetic resources at different scales (global, national, local). Much of the thinking revolves around the pioneering potato case, but it is not limited to it. We are interested in how these debates contribute to the deconstruction of the global commons constituted for plant genetic resources for food and agriculture at a global scale through a double process of reterritorialization and rematerialization, which advances the return of seeds anchored materially and territorially but also historically and culturally.
Keywords:
- repatriation,
- plant genetic resources,
- seeds,
- international governance of biodiversity,
- rematriation
Resumen
La cuestión de la repatriación de landraces (variedades agrícolas) a las comunidades indígenas y locales que las domesticaron, seleccionaron y aún las cultivan, es el núcleo de este artículo. En los últimos veinticinco años, ante las reticencias de las instituciones internacionales, diversos actores se han movilizado, tanto fuera como dentro de estas mismas instituciones, para que se adopte este término. La autora propone analizar este proceso en términos de una controversia científica en la que los diferentes actores han abierto un espacio de diálogo y negociación sobre la gobernanza de los recursos fitogenéticos a diferentes escalas (global, nacional, local). La reflexión se centra en el caso pionero de la papa, pero la autora no se limita a este caso. Este artículo también examina el modo en que estos debates contribuyen a deconstruir el patrimonio global constituido para los recursos fitogenéticos en los ámbitos de la alimentación y la agricultura, al operar un doble proceso de reterritorialización y rematerialización. Así, estos recursos se van convirtiendo en semillas ancladas territorial, histórica y culturalmente.
Palabras clave:
- repatriación,
- recursos fitogenéticos,
- semillas,
- gobernanza internacional de la biodiversidad,
- rematriación
Article body
Beaucoup des trésors génétiques les plus importants sont des landraces [des variétés paysannes] et des adventices qui sont le résultat de milliers d’années d’agriculture paysanne […]. Si les plantes font désormais partie d’un patrimoine commun de l’humanité, il reste que ceux qui les ont cultivées en premier ont sur elles des droits qui priment.
Mooney 1983, 49, notre trad.
Les ressources phytogénétiques, à l’instar des objets de la culture matérielle, ont fait l’objet de collectes depuis longtemps. La constitution de ce type de collection fait l’objet d’enjeux spécifiques dans la mesure où le matériel collecté est à la fois matériel et immatériel. En effet, les plantes contiennent des gènes qui sont autant de ressources intéressantes pour la mise au point de nouvelles variétés adaptées, par exemple, aux effets du changement climatique. Par ailleurs, les enjeux économiques sont importants, surtout pour les principales cultures vivrières comme le blé, le riz, le maïs ou la pomme de terre dont il est question dans cet article[1]. Dès la fin des années 1950, la nécessité de coordonner à l’international les efforts de collection faits par les différents États s’est manifestée sein de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)[2]. Cela a débouché sur la création de banques de germoplasmes ex situ[3] hébergées par le Groupe consultatif international de recherche internationale sur l’agriculture (CGIAR), qui en sont venues à constituer un commun global de ressources génétiques (Plucknett et al. 1986). Ce commun ayant été créé en dehors de la FAO et les intérêts privés y dominant largement, le statut des ressources qui y sont conservées est encore à ce jour source de tensions : les intérêts privés liés à l’agriculture commerciale sont confrontés aux intérêts publics des petits agriculteurs pratiquant une agriculture familiale et essentiellement vivrière. Au début des années 2000, le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (TIRPAA) a été créé afin de s’assurer de la conservation et de l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour « garantir que le monde produira à l’avenir des denrées en quantités suffisantes pour nourrir une population croissante » (http://www.fao.org/plant-treaty/overview/fr/, consulté le 5 mai 2021). À également été créé le Système multilatéral (SML)[4] afin de réguler l’accès aux ressources du commun global précédemment constitué et l’accès aux avantages issus de leur utilisation (APA) conformément aux principes de la Convention sur la diversité biologique (CDB). Au tournant du millénaire, la question de la juridiction des États sur leurs ressources incluses dans ce commun est critique (Pistorius 1997 : 57 ; voir aussi le chapitre introductif de Halewood et al. 2013a). Dans ce contexte, les centres du Groupe consultatif de recherche internationale pour l’agriculture (CGIAR) sont des acteurs essentiels (Halewood et al. 2013b : 311). Cela est d’autant plus vrai pour les centres qui sont localisés dans des centres de domestication des espèces auxquelles ils sont consacrés, où l’on trouve une grande diversité de landraces[5], ou variétés paysannes, encore souvent cultivées localement par les petits paysans. Cela s’est traduit, comme dans le cas du Centre international de la pomme de terre (CIP) et du Centre international d’amélioration du maïs et du blé(CIMMYT), dont il sera question dans ce texte, par une préoccupation plus marquée pour la conservation in situ des landraces (Brush 1995) et la protection des droits des populations qui ont domestiqué et sélectionné le matériel collecté et qui continuent de l’entretenir et de le faire évoluer dans leurs parcelles (voir Mooney 1983, Brush 2004 ; Girard 2018). La présence de chercheurs et d’employés issus du pays concerné, nous le verrons, n’est pas étrangère à cette orientation.
La question du rapatriement des ressources phytogénétiques vers les communautés qui les ont historiquement domestiquées, sélectionnées et conservées permet d’explorer les enjeux qui persistent autour du statut juridique des ressources de ce commun (qui restent critiques jusqu’à maintenant – sur ce point voir Girard et Frison 2018 : Halewood et al. 2010, 2013a et 2013b). Les négociations autour de l’usage du terme rapatriement vont permettre à certains membres de la banque de germoplasme du Centre international de la pomme de terre (CIP, membre du CGIAR) de stimuler une réflexion sur les droits des communautés locales péruviennes sur les landraces. Ce centre est spécialisé dans la conservation et recherche portant sur les tubercules et racines et il héberge la banque de germoplasme qui abrite la plus grande collection de landraces de pommes de terre au monde (sur l’histoire de la conservation de la pomme de terre et du CIP voir Devaux et al. 2019 ; concernant la banque de germoplasme, voir Ellis et al. et Huamán 2000). La grande majorité du matériel qui y est conservé provient des Andes, qui sont le centre de domestication de ce tubercule et donc le lieu où l’on trouve la plus grande diversité de landraces. La façon dont la notion de rapatriement va être imposée au CIP, en dépit d’un refus de principe de la part de cette institution, et comment celle-ci va évoluer jusqu’à aujourd’hui et être reformulée, va former le coeur de cet article. Notre hypothèse est qu’autour de l’usage du terme rapatriement, un espace de réflexion et de dialogue a été ouvert sur les droits des agriculteurs et des populations autochtones sur les ressources qu’ils ont contribué à domestiquer, ont sélectionné et continuent largement à cultiver[6]. Notre analyse va porter plus particulièrement sur la façon dont, parallèlement, une réflexion sur la nature même de ce qui est rapatrié a été menée.
Notre propos s’ancre dans la sociologie des sciences en proposant d’analyser l’émergence des rapatriements de ressources phytogénétiques en termes d’une controverse scientifique qui mobilise un forum hybride autour d’un objet-frontière (Callon 2006). Selon Haraway (Harvey et Haraway 1995 : 516) :
de tels objets sont suffisamment stabilisés au sein des différentes communautés, mais assez flexibles pour être modelés par ces différentes communautés de pratiques de différentes façons qui sont assez proches de la façon dont les praticiens les comprennent et les mobilisent déjà, de sorte qu’ils puissent effectivement les mettre en oeuvre. (notre trad.)
La notion de rapatriement permet ici la constitution d’un réseau et l’émergence d’un nouveau langage. Différents acteurs ont proposé, défini et négocié l’usage du terme rapatriement dans le domaine des semences et des ressources phytogénétiques ; en l’occurrence, dans le cas qui nous intéresse ici, il s’agit notamment, mais pas uniquement, de la Banque de germoplasme du Centre international de la pomme de terre, d’une ONG péruvienne et de communautés paysannes regroupées dans le Parc de la pomme de terre de Pisac (Pérou). Si ce cas, particulièrement important, formera le coeur de notre propos, nous prendrons également en compte d’autres acteurs qui, sur d’autres terrains, ont participé ou participent encore à la controverse, qu’ils soient issus de la société civile ou des institutions internationales. Nous identifierons ainsi une controverse autour de la question des rapatriements vers des communautés, ainsi que deux objets-frontière : le rapatriement en lui-même, et les ressources qui en font l’objet.
Nous considérons, avec de nombreux auteurs, que la constitution d’une gouvernance internationale de la biodiversité a entraîné des processus conjoints de dématérialisation et de déterritorialisation des plantes (pour le premier cas voir Harvey et Haraway 1995 : 517 : Tsing 2005 : Bonneuil et Fenzi 2011 : Girard 2019 : Ulloa 2017 ; pour le second cas voir Girard 2018 : 123). Avec l’avènement d’un discours génétique, les plantes sont devenues des « ressources biologiques » (CDB), des « ressources phytogénétiques » (TIRPAA) ou encore du germoplasme (CGIAR). Avec le discours génétique, ces ressources ont perdu leur statut de semences : elles ont été dématérialisées. Cette lecture vient imposer une lecture naturaliste (Descola 2005) des plantes, lesquelles sont supposées relever uniquement de la nature, et même plus précisément de la génétique. Les dimensions agricoles, culturelles ou mêmes affectives ou encore ontologiques sont hors champ. Par ailleurs, en entrant dans le Système multilatéral, en devenant disponibles à tout un chacun à travers le monde et en étant considérées comme un commun global, elles ont été déterritorialisées.
Notre argument est développé ici en deux temps : dans un premier temps nous montrerons comment les débats autour des rapatriements contribuent à « reterritorialiser » les ressources phytogénétiques et, dans un second temps, comment ils contribuent à les « rematérialiser ». Nous verrons aussi comment des acteurs hétérogènes, dont les points de vue et les intérêts ne concordent que partiellement, se sont mobilisés en dépit de ces différences pour contribuer à impulser ce double processus.
Notre point de départ est l’histoire des rapatriements de matériel phytogénétique auprès des communautés péruviennes par le CIP depuis la fin des années 1990, et plus particulièrement la signature d’un accord formel de rapatriement – le premier du genre – signé avec le Parc de la pomme de terre[7]. Nous avons réalisé des entretiens avec différents acteurs ayant supervisé et supervisant encore ces transferts au CIP, notamment René Gomez, actuellement curateur de la banque de germoplasme – et que nous remercions infiniment pour sa collaboration. Ces témoignages sont complétés par des entretiens complémentaires et des observations réalisées tant au CIP (Lima, Pérou) que dans le Parc de la pomme de terre (Pisac, Pérou) ainsi que dans la communauté San José de Aymara (Huancavelica, Pérou)[8]. Nous évoquerons également d’autres acteurs qui, à travers le monde, ont également oeuvré à la reconnaissance de ce type de rapatriements et que nous avons identifiés en procédant à l’identification des différents exemples de rapatriement de ressources phytogénétiques vers des communautés autochtones ou locales.
Reterritorialiser
La gouvernance internationale des ressources phytogénétiques et les transferts de matériel vers les communautés locales
Les ressources phytogénétiques pour l’agriculture et l’alimentation relèvent de deux grands régimes dont l’articulation n’est pas aisée : la Convention sur la diversité biologique (CDB) et le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (TIRPAA). Le TIRPAA a établi le Système multilatéral (SML) qui a permis la constitution d’un commun global placé sous le contrôle des États, dont les règles de fonctionnement ont été articulées à la CDB. Cela transparaît ci-dessous dans la présentation des objectifs du TIRPAA :
TIRPAA, article 1
1.1
Les objectifs du présent Traité sont la conservation et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation en harmonie avec la Convention sur la diversité biologique, pour une agriculture durable et pour la sécurité alimentaire.
1.2
Ces objectifs sont atteints par l’établissement de liens étroits entre le présent traité et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, ainsi que la Convention sur la diversité biologique.
Ni dans le TIRPAA ni dans la CDB, le terme rapatriement n’est employé pour parler du retour des ressources phytogénétiques vers les communautés. Dans le cadre du TIRPAA, le terme est utilisé avec une grande prudence et son usage tend à être restreint au rapatriement des collections vers les États[9], et essentiellement mais pas seulement dans des cas de catastrophes naturelles (article 12.6 du TIRPAA), comme ce fut le cas après un ouragan au Guatemala en 2008, ou après des tremblements de terre en 2010 en Haïti et en 2015 au Népal. Dans le cadre de la CDB, le terme rapatriement est utilisé, mais pour référer aux seuls savoirs traditionnels. Le « Rutzolijirisaxik Voluntary Guidelines » (CDB 2019) aborde même spécifiquement ce sujet. Si ces savoirs sont étroitement associés aux droits sur les ressources elles-mêmes (Frison 2018 : 272), il y a tout de même une grande différence. La question du rapatriement des ressources phytogénétiques vers les communautés n’est ainsi pas prise en charge directement par les instances internationales compétentes en matière de biodiversité cultivée. De fait, chacune de ces institutions voit ses compétences – juridiques, certes, mais également politiques – limitées sur ce sujet : selon le TIRPAA, de tels rapatriements sont de la compétence des États : quant à la CDB, elle ne peut se saisir de la question des droits sur les ressources qu’indirectement, à travers la détention de savoirs traditionnels (Filoche 2009).
Cela étant dit, les objectifs du TIRPAA étant liés à la sécurité alimentaire, des mécanismes sont prévus afin que des communautés puissent avoir accès au matériel placé dans le Système multilatéral. Mais dans ces cas-là, le terme rapatriement n’est pas utilisé, en tout cas pas jusqu’à la fin des années 2000. Sont privilégiés les termes « transfert à des agriculteurs pour usage direct », « réintroduction » (Westengen, Hunduma et Skarbø 2017, notre trad.), ou encore « redistribution » (René Gomez, curateur de la banque de germoplasme du CIP, comm. pers. 2019). Dans les années 1990, la Banque de germoplasme du CIP procédait régulièrement à ces « redistributions ». Cela correspond, en fait, au mandat de ce type d’institution qui a pour vocation de favoriser la conservation de la biodiversité cultivée et, par là-même, de favoriser la sécurité alimentaire. À l’époque, la question de l’importance de la conservation in situ des landraces est débattue (Brush 1995), cette stratégie apparaissant en effet complémentaire avec la conservation ex situ des banques de germoplasme. Dans le cas des centres localisés dans des aires de domestication (comme le CIP ou le CIMMYT), où les paysans du pays hôte continuent à cultiver in situ la plupart des variétés locales conservées dans les collections ex situ, ces transferts prennent une importance particulière car ils permettent non seulement de favoriser la conservation in situ (nous verrons que ce point est essentiel), mais également de renforcer la sécurité alimentaire des communautés concernées.
C’est à la fin des années 1990 seulement que ces pratiques de « redistribution » seront requalifiées : avant d’en arriver là, nous allons retracer la logique qui préside à ces transferts de matériel phytogénétique vers des communautés péruviennes.
Bien que ces influences n’aient pas été mentionnées et ne semblent pas avoir eu une influence directe sur ce qui s’est passé au CIP, la question des rapatriements se posait depuis les années 1980. Mooney (1983 : 4647) avait proposé de s’inspirer des textes de l’UNESCO et notamment du concept de rapatriement en matière de biens culturels. Par ailleurs, en 1994, au Brésil, des communautés krahô avaient demandé à l’EMBRAPA (organisme d’État qui dispose des collections de maïs nationales) le rapatriement de landraces de maïs (Londres et al. 2014)[10]. L’idée était donc débattue de façon théorique, et certaines communautés avaient commencé à formuler des revendications en ce sens : dans ce cas, les Krahô se sont adressés à une institution nationale (et non pas internationale).
Pour bien comprendre ce qui va suivre, il est nécessaire de revenir brièvement sur le CIP et l’histoire des collections de la banque de germoplasme qui y sont hébergées. Le CIP est l’un des centres du CGIAR créé en 1971 à Lima, au Pérou. Lorsque la banque de germoplasme est fondée, la même année, différentes institutions péruviennes sont sollicitées pour constituer une collection initiale. L’Université agraire de la Molina et l’Institut national d’innovation agraire (INIA) contribuent en donnant du matériel issu de leurs propres collections. De grandes campagnes de collecte complémentaires permettent ensuite d’enrichir la collection. Désormais, cette banque est la cinquième banque de semences ex situ de landraces de pommes de terre au niveau mondial, et c’est aussi celle qui, rappelons-le, héberge la plus grande collection au monde, c’est-à-dire près de 4000 landraces (Ellis et al. 2019). Dans la mesure où les landraces et les variétés sylvestres représentent une richesse génétique de grand intérêt pour la mise au point de nouvelles variétés résistantes à différentes maladies ou ravageurs, cette banque est très importante. Conformément aux politiques mises en oeuvre par les Centres du CGIAR, le matériel est distribué aux institutions de recherche ou aux sélectionneurs privés qui en font la demande. Il est important de préciser que ces institutions ne payent alors que les frais d’envoi, le matériel étant mis gratuitement à leur disposition. C’est ainsi que se traduit le statut de commun global de ces collections.
Parallèlement, des « redistributions » sont effectuées auprès de communautés paysannes andines. La logique à l’oeuvre n’est pas encore celle du rapatriement, mais a posteriori elles en sont les premières traces. Dans les années 1990, la logique de ces distributions est avant tout d’ordre sanitaire et productiviste. Les personnes qui collectaient le matériel sur le terrain constataient que le matériel dont disposaient les paysans était dans un mauvais état sanitaire car les tubercules ont tendance à accumuler les virus et bactéries d’une génération à l’autre du fait de leur reproduction végétative. Le matériel conservé ex situ devant être irréprochable, la Banque de germoplasme du CIP avait dû mettre en place des mesures pour nettoyer tous les échantillons avant de les incorporer aux collections. De ce fait, ceux qui procédaient aux collectes ont estimé que le matériel sain conservé dans la collection ex situ présentait un intérêt pour les paysans. En effet, ce matériel « propre » (limpio) peut permettre un gain de près de 20 % de productivité par rapport au matériel dont les paysans disposent habituellement (Huamán et al. 2000). Les landraces étant essentiellement autoconsommées et ressemées à l’échelle domestique, disséminer ce matériel permettait ainsi d’améliorer la sécurité alimentaire des populations paysannes dépendant de cette culture. Ces « redistributions », comme les qualifie René Gomez en retraçant cette histoire, s’inscrivent donc bien dans les objectifs institutionnels.
À l’époque, le CIP est très engagé auprès des petits paysans de la région andine. D’une part, à l’époque le Pérou est un pays en voie de développement et, à ce titre, ciblé par les politiques de sécurité alimentaire. Cela a changé depuis avec le boom minier dans les années 2000. Désormais, les régions cibles des CGIAR et du CIP sont l’Afrique et l’Asie, ce qui rend plus difficile la mise en place de projets au Pérou, dont les rapatriements. D’autre part, comme le centre est installé dans le centre de domestication de la pomme de terre, les paysans cultivent encore de nombreuses landraces qui sont une composante essentielle de leur production et de leur alimentation. Les paysans sont donc à la fois des usagers mais également des conservateurs du matériel phytogénétique. C’est d’ailleurs auprès d’eux que le matériel des grandes banques de germoplasme a été collecté. Dernier point, important nous allons le voir, de nombreux péruviens travaillent à la banque de germoplasme et ils ont à coeur de rendre d’une façon ou d’une autre ce que l’institution internationale a reçu sous la forme de dons des institutions nationales et des communautés.
Beaucoup d’agriculteurs perdent leurs semences de cultivars natifs [paysans] pour différentes raisons. Il est vital que les banques génétiques exsitu aient l’obligation de rapatrier les semences de variétés natives perdues par les agriculteurs qui les ont conservées. Ils continueront à les semer pendant des générations. Ces ressources ont été collectées dans les parcelles des agriculteurs lors des multiples expéditions de collectes durant les dernières décennies, que ce soit par des institutions péruviennes ou étrangères. Ce que les agriculteurs nous ont donné sans rien espérer en retour, doit être rendu avec des améliorations.
Huamán, s.d., notre trad.
Cette citation de Zosimo Huamán, alors curateur en chef de la banque de germoplasme, rend compte de son implication et de celle de son équipe. Cette sensibilité n’est pas seulement le fait du personnel local. En effet, à l’époque le CIP compte toute une équipe de chercheurs en sciences sociales, dont Stephen Brush (1974, 1996, 2000), qui montre dans ses travaux l’importance de la conservation in situ de l’agrobiodiversité, ainsi que Rhoades (Nazarea et Rhoades 2013 ; Rhoades 2004) ou encore Campos et al. (2019). Outre concernant les enjeux sanitaires ou productifs, en matière de conservation également se manifeste ainsi au CIP une sensibilité particulière envers les paysans andins.
L’adoption du terme rapatriement
En 1997, la façon de concevoir ces redistributions va changer. En effet, des paysans de la communauté de San José de Aymara (Huancavelica, Pérou) ont contacté le CIP afin de recevoir des pommes de terre des collections de la banque de germoplasme. Les paysans des communautés concernées disposaient déjà d’une grande diversité de cultivars – 380 échantillons avaient été collectés localement – mais ils souhaitaient en avoir plus. La demande a été acceptée par la Banque de germoplasme, et des pommes de terre issues de ses collections ont alors été redistribuées selon la logique précédemment exposée. Les paysans ont effectivement obtenu des rendements plus importants, qu’ils ont beaucoup appréciés. Au cours du processus, il est apparu que certains cultivars apportés par le CIP avaient disparu localement : les aînés reconnaissaient d’anciennes variétés et manifestaient leur satisfaction de les retrouver. En 1998, une banque communale de semences a été créée pour accueillir la collection locale ainsi que les cultivars envoyés depuis la banque de germoplasme du CIP (245 accessions). Dans ce contexte, le vocable « retour » (devolución) est alors venu remplacer le terme « distribution ». À San José de Aymara, la collaboration avec la Banque de germoplasme a perduré avec le temps, et des expérimentations ont été menées pour sélectionner des variétés adaptées aux conditions locales pouvant permettre de faire des chips de couleur. Une coopérative a été créée localement et, grâce à un appui international, les produits qui y sont produits sont désormais exportés jusqu’en Europe (http://www.agropiaperu.com/, consulté le 24 juin 2020).
C’est en 1999 que le terme rapatriement (repatriación) est utilisé dans des rapports internes au CIP, comme l’atteste la publication de Huamán et al. (2000). Le contexte est ici essentiel pour comprendre ce choix. D’une part, le terme circulait déjà dans l’opinion publique péruvienne du fait de débats autour d’objets archéologiques collectés au Machu Picchu et détenus par l’Université Yale (voir Swanson 2009). La question des rapatriements était discutée dans le milieu muséal depuis déjà presque vingt ans en Nouvelle Zélande, au Canada et aux États-Unis, mais c’est au début des années 80 que ce débat s’impose dans la vie publique péruvienne à la faveur d’une exposition importante d’objets appartenant à des institutions américaines. Des poursuites, entreprises en 2006, ont donné lieu au rapatriement de nombreux objets en 2011.
D’autre part, la fin des années 1990 et le début des années 2000 apparaissent comme une période de réflexion intense d’un point de vue institutionnel pour les différents centres du CGIAR et le CIP. En effet, les banques de germoplasme des CGIAR ont été sommées de se positionner quant au statut juridique des collections qu’elles détenaient (Secrétariat CGIAR 1994 ; Halewood et al. 2013a) : acceptaient-elles de placer leurs collections en « trust » sous l’autorité du TIRPAA ? Cela devait permettre de rééquilibrer les intérêts en jeu, notamment pour les pays du Sud disposant de nombreuses ressources génétiques mais ayant peu de moyens pour les exploiter, comme le Pérou. C’est en 2003 que le CIP accepte d’être placé sous l’égide du TIRPAA (conformément à l’article 15) : il aura fallu neuf ans pour que l’institution se décide. Durant cette période, c’est avant tout le rapatriement des collections vers les pays d’origine du matériel qui est posée. Aussi en 1999, le statut des collections de la banque de germoplasme du CIP reste incertain. Il n’est donc pas surprenant que le Centre international de la pomme de terre refuse d’utiliser le terme rapatriement, en particulier pour désigner le retour du matériel vers les communautés paysannes. L’usage même du mot soulevait une question hautement politique qui est loin d’être résolue encore aujourd’hui.
Dans ce contexte national et institutionnel, et en dépit de l’interdiction de sa hiérarchie, René Gomez décide d’utiliser dans ses rapports le terme rapatriement qui, explique-t-il, a « plus d’impact » (comm. pers., 2019). En tant que Péruvien issu d’une petite ville de la zone andine et ayant côtoyé des agriculteurs qui cultivaient des pommes de terre paysannes, il est important pour lui que ces ressources restent conservées et liées au Pérou et à ses paysans. Par ailleurs, les institutions péruviennes ayant contribué à cette collection, il semblait normal à Gomez (qui avait préalablement travaillé à l’Université de La Molina qui a donné ses collections au CIP) que les droits nationaux soient reconnus ainsi que ceux des paysans. En 2000 et 2001, sa hiérarchie lui demande de nouveau de ne pas employer le terme rapatriement. Cependant, l’anthropologue américaine Virginia Nazarea, qui avait mené des entretiens au CIP et s’était intéressée à ces rapatriements, reprend alors le terme en publiant un texte en ligne. Cela marque le passage du terme dans la sphère publique, validant et justifiant son usage. Nazarea publiera ultérieurement divers textes (Nazarea 2006 ; Nazarea, Rhoades et Andrews-Swann 2013) et elle prépare actuellement un ouvrage sur le sujet.
La montée en puissance des débats autour des artefacts collectés à Machu Picchu après le succès retentissant de l’exposition organisée par Yale en 2003 contribue aussi à l’adoption du terme. La question du rapatriement est alors articulée, d’une part, à la souveraineté du Pérou sur ses ressources et, d’autre part, à la sécurité alimentaire des paysans.
Après ce premier rapatriement, de nouvelles demandes arrivent à la banque de germoplasme. Elles sont motivées par différentes logiques, qui importent peu en fait car toutes sont honorées tant la volonté de rapatrier les ressources est forte. Il n’y a pas de budget spécifiquement alloué à ces activités, et ces rapatriements se font avec les moyens du bord.
Le premier accord de rapatriement formel
L’année 2002 marque un nouveau tournant. Le CIP a été contacté par six communautés paysannes de la zone de Pisac (région de Cusco) regroupées au sein de l’Association du Parc de la pomme de terre. Ce parc est consacré à la conservation de la biodiversité de la pomme de terre ; localement on en trouve en effet une grande diversité (plus de 850 entrées dans la collection locale). Les paysans sont orientés et conseillés par l’Associación para la naturaleza y el desarrollo sostenible (ANDES), une ONG péruvienne qui a organisé le Parc et procédé depuis 1998 à la collecte des landraces dans le parc ainsi qu’à la documentation des savoirs des paysans. Dans un premier temps le Parc, par l’entremise de ANDES, demande à recevoir les variétés de la région. Cette demande est examinée et acceptée par la Banque de germoplasme.
Ultérieurement, les landraces faisant partie des collections de la banque de germoplasme et ayant été collectées dans la région de Cusco sont envoyées dans le parc (410 landraces). Il s’agit d’un rapatriement et il est décidé que les 410 landraces rapatriées vont être conservées in situ avec celles de la collection locale.
ANDES, notamment du fait d’Alejandro Argumedo (l’un des codirecteurs de l’ONG – un Péruvien ayant réalisé une partie de sa formation au Canada), demande alors que l’accord de rapatriement soit formalisé. Cela conduit à la signature, en 2004, d’un accord (agreement) entre le Parc de la pomme de terre et le CIP (Suri 2005 ; Stenner et al. 2016), accord qui a été reconduit et perdure encore, en 2021. À la demande du CIP, ANDES est désormais le troisième partenaire de cet accord.
La signature de ce texte entérine le fait qu’un centre du CGIAR, le CIP, accepte formellement l’usage du terme rapatriement pour désigner les transferts de matériel phytogénétique à destination d’une communauté locale. Cela équivaut à reconnaître symboliquement la légitimité du droit des communautés locales sur les matériaux conservés ex situ par les centres du CGIAR.
Les partenaires concernés ont des visions et intérêts qui ne se recoupent que partiellement. Pour la Banque de germoplasme, cet accord permet de montrer son engagement auprès des paysans péruviens. Le Parc a une grande importance symbolique pour le CIP, à tel point que des festivités y ont été organisées pour le 45e anniversaire du CIP.
Cet accord permet également au CIP d’officialiser et de pérenniser les relations avec les communautés et l’ONG. Tout cela a permis de mener des recherches localement, les techniciens du parc et les ingénieurs de ANDES participant de façon active aux activités organisées dans le Parc. C’est ainsi qu’ont été étudiés, entre autres choses, l’impact du changement climatique sur les tubercules et l’influence de l’altitude sur la qualité des semences, ainsi que les conséquences de l’utilisation de la chaux comme moyen de lutter contre différents types de prédateurs. Par ailleurs, un projet de sélection participative est également mené. La Banque de germoplasme a non seulement reproduit le matériel à destination du parc, mais elle a apporté de l’aide dans le maintien des collections reproduites in situ dans le Parc en formant les ingénieurs de ANDES et en se rendant périodiquement sur place.
De son côté, ANDES a largement souligné dans sa communication qu’il s’agit du premier accord reconnaissant le droit des populations autochtones sur leurs ressources biologiques. Alejandro Argumendo, co-directeur de ANDES, explique qu’il s’agit là d’un « premier signe juridique de la restauration des droits que les peuples autochtones ont perdu » (propos rapportés par Suri 2015). Ce point est également soulevé par différents auteurs, que ce soit dans des réseaux activistes ou académiques (Nabhan 2016 : 245 ; Nazarea 2006 ; Nazarea, Rhoades et Andrews-Swann 2013 ; Graddy 2013). L’accent sur l’identité autochtone des populations du Parc dans le cadre de la communication de ANDES est à mettre en relation avec le fait qu’à l’époque, les questions sur les ressources génétiques des populations locales sont avant tout du ressort de la CDB. En effet, cet instrument se focalise sur des droits des populations autochtones dans l’article 8(j). Les propos d’Argumento, cités ci-dessus, reflètent la valeur toute particulière de cet accord entre le CIP et le Parc dans cette arène : il représente une victoire extrêmement importante d’un point de vue symbolique plus que juridique, en fait. À l’époque, la question du partage juste et équitable des bénéfices issus de l’exploitation des ressources génétiques est en gestation à la CBD. C’est en 2010 que des principes plus explicites sont dégagés avec l’adoption du Protocole de Nagoya (dont la mise en oeuvre reste un défi – sur ce point voir Thomas et Filoche 2015 ou Harrop 2011).
Sur des bases différentes, la Banque de germoplasme et ANDES s’accordent sur le fait que l’utilisation du terme rapatriement permet d’affirmer l’appartenance des ressources phytogénétiques à un territoire spécifique, c’est-à-dire de les reterritorialiser, pour reprendre l’expression de Girard (2018 : 123). Les dynamiques globales qui ont contribué à déterritorialiser les semences engendrent des processus complexes et dynamiques de reterritorialisation qui font écho aux processus analysés par Appadurai (2005), Gupta et Ferguson (1992) ou Tsing (2005) sur de tout autres sujets. Le processus de reterritorialisation, ici, n’est pas à interpréter comme un retour à une situation antérieure. Il s’agit de remettre en cause la gouvernance internationale des ressources mise en place et le statut de commun global qui leur a été attribué.
Dans le cas qui nous intéresse ici, les différents acteurs semblent s’accorder sur l’importance de reterritorialiser les ressources phytogénétiques, et deux processus se trouvent ici emboîtés. D’une part, à l’échelle nationale, il s’agit d’affirmer les droits du Pérou sur les ressources génétiques issues de son territoire[11]. À une échelle plus locale, il s’agit de faire valoir les droits des communautés locales. Mais sur ce point les perspectives de la Banque de germoplasme et celles de ANDES sont à distinguer. Pour la Banque de germoplasme et pour René Gomez, la logique est avant tout biologique : il s’agit de mettre à la disposition des paysans du matériel plus sain, qui permettra d’obtenir de meilleures récoltes et qui viendra renforcer la biodiversité présente localement. Pour ANDES, il s’agit de faire valoir les droits de ces populations, considérées comme « autochtones », sur leurs ressources naturelles, et ce, dans une perspective très influencée par les débats ayant lieu à l’époque au sein de la CDB. Il s’agit de faire valoir le fait que les landraces sont le produit d’une histoire ancrée dans des espaces spécifiques et résultant de pratiques agricoles, sociales et culturelles. La référence territoriale est donc non seulement nationale mais également socialement et territorialement localisée.
Les logiques du CIP et de ANDES ne convergent donc que partiellement sur la nécessité de reterritorialiser les ressources phytogénétiques. Cela sera suffisant pour que des présentations conjointes soient réalisées, par exemple lors d’événements parallèles (side events), lors des conférences des parties (COP) du TIRPAA en 2012 et en 2018. Le rapprochement a sans doute été favorisé par un concours de circonstances : les débats autour des objets muséaux au début des années 2000 et les sensibilités des personnes impliquées dans le rapatriement vers le Parc de la pomme de terre. Cette convergence a été productive, elle a débouché sur la signature de l’accord entre le Parc et le CIP, et cette étape marque officiellement l’ouverture d’un espace de dialogue et de négociation qui va perdurer.
Un point important mérite d’être précisé et discuté : le CIP n’a légalement aucune compétence à l’intérieur d’un territoire national. Depuis 1994, les États sont souverains pour décider ce qu’il doit advenir de leurs ressources. L’engagement de certains membres de la Banque de germoplasme repousse donc les compétences du CIP en confiant les rapatriements à des communautés locales. Cela permet de rendre compte de l’importance des individus dans la constitution de cette controverse : ils font évoluer l’institution en dépit des limitations institutionnelles. Mais qui est identifié comme destinataire de ce rapatriement ? Le CIP rapatrie vers le Parc le matériel collecté dans la région de Cusco. Ainsi, les paysans du Parc reçoivent-il ce matériel au nom de l’ensemble des paysans de la région. Pour ANDES, le rapatriement de la collection régionale se fait certes dans le Parc, mais la vision est plus large encore : il s’agit de défendre les droits des petits paysans andins, et même au-delà des peuples autochtones. Ainsi, le collectif n’est-il pas identifié de la même façon par les différents acteurs.
Il peut apparaître étrange que, jusqu’à présent, les populations locales n’apparaissent pas comme étant protagonistes dans l’analyse qui est proposée alors même qu’elles sont a priori les principaux protagonistes et la raison d’être de ces rapatriements, que ce soit pour la Banque de germoplasme ou pour ANDES. En fait, ces populations, du moins selon le travail d’explicitation réalisé par ANDES, n’étaient pas au courant des enjeux liés à la mise en place de ce régime de gouvernance internationale de gestion des ressources phytogénétiques qui, de fait, englobe les landraces de pommes de terre dont ils s’alimentent. L’ensemble des landraces cultivées par une famille n’est pas conçu comme un patrimoine fixe, ni identifié en termes de landraces[12]. Ainsi, si les enjeux sont réels, ils échappent largement aux paysans. Ce sont des enjeux juridiques pertinents dans les arènes globales de la biodiversité, mais largement déconnectés de l’expérience quotidienne des petits paysans producteurs de pommes de terre natives. Cela est exacerbé par le fait que ces pommes de terre sont largement autoconsommées[13] ; en effet cette production est pensée et vécue comme relevant de la sphère du proche. Ainsi, bien que les paysans andins soient, de fait, les premiers acteurs concernés, en pratique ce sont la Banque de germoplasme et ANDES qui se positionnent face à la gouvernance internationale de ressources phytogénétiques en signant ce premier accord formel de rapatriement.
Rematérialisation
Plus profondément, il y a entre les paysans et le CIP un vrai malentendu qui rend les enjeux de reterritorialisation relativement abscons pour les premiers. Il s’agit là d’un problème épistémologique et même ontologique. En effet, les paysans ne partagent pas la vision « dématérialisée » des ressources phytogénétiques qui règne au CIP ou dans les arènes internationales de la biodiversité. L’ONG ANDES joue le rôle d’intermédiaire, de traducteur. Pour faire comprendre aux paysans les enjeux juridiques globaux, ANDES a fait tout un travail d’information sur les droits nationaux et internationaux (ce qui n’est pas une mince affaire comme nous avons pu nous-même l’expérimenter). Pour les paysans, ces ressources sont en effet avant tout des plantes, des semences, des aliments auxquels sont associés des connaissances, des récits, des pratiques, voire des rituels (sur ce sujet voir Zimmerer 1996 ; Hall 2018 ; Angé 2018). Dans son travail de traduction, ANDES a pris le parti de faire connaître les conceptions locales et de les relayer dans les instances internationales, notamment à la CDB et au TIRPAA. Ce travail a rendu possible la signature de l’accord et la reconnaissance symbolique de droits des paysans.
Ce faisant, ANDES contribue à remettre en cause le statut même de « ressources phytogénétiques » et procède à leur « rematérialisation ». Il s’agit en fait de déconstruire le processus de dématérialisation des semences opéré à travers le discours génétique qui s’est imposé depuis la fin des années 1950 dans les instances de gouvernance internationales des ressources phytogénétiques. Ce débat est d’autant plus critique ces dernières années avec les avancées permises par le séquençage des génomes (digital sequence informations), ce qui signifierait l’aboutissement du processus de dématérialisation que nous évoquons. L’enjeu juridique est primordial : les informations n’étant pas assimilées à des ressources juridiques, elles échapperaient aux obligations liées aux règles d’accès et de partage des avantages de l’utilisation des ressources (phyto)génétiques laborieusement mises en place au sein de la CDB et qui peinent à être appliquées (https://www.infogm.org/6519-numeriser-genes-pour-posseder-vivant-sans-partage, consulté le 8 juin 2020). Cet enjeu est d’ailleurs au coeur des négociations qui vont avoir lieu lors de la prochaine rencontre de la 15e Conférence des Parties de la CDB, qui devait avoir lieu à l’automne 2021.
Pour ancrer dans le concret les ressources génétiques et mieux expliciter la perspective des paysans, ANDES a mis en avant deux concepts : la souveraineté alimentaire, d’une part, et le patrimoine bioculturel d’autre part. Les deux concepts sont articulés, ils ont en commun de valoriser la dimension culturelle des semences et de leur conservation, quoiqu’ils le fassent de façon différente. Si le recours au concept de souveraineté alimentaire est historiquement plus récent, eu égard à la logique démonstrative de notre argument, nous allons l’expliciter en premier lieu.
La mise en avant de la souveraineté alimentaire
Le concept de souveraineté alimentaire, comme l’explique Schanbacher (2010), s’oppose à celui de sécurité alimentaire qui prévaut notamment à la FAO, mais également au CIP et dans les CGIAR. Ce concept est issu d’un mouvement de contestation altermondialiste qui prend corps autour de l’organisation Terra Madre. Il permet de souligner le fait que l’alimentation n’est pas seulement une question nutritionnelle, mais doit nécessairement prendre en considération les spécificités locales, notamment les conditions de vie des producteurs locaux et leurs préférences alimentaires ainsi que la qualité des aliments produits. En 2009, ce concept est mis à l’honneur dans le Parc avec la tenue d’un atelier international qui donnera lieu à la Déclaration sur la conservation de l’agrobiodiversité et la souveraineté alimentaire (ANDES 2009).
Jusqu’à un certain point, le CIP, ainsi que la FAO et le TIRPAA, partagent cette préoccupation pour l’alimentation car ils ont comme objectif de contribuer à assurer la sécurité alimentaire des différentes populations à l’échelle du globe, tel que mentionné précédemment. Cependant, dans ce contexte, les landraces sont avant tout appréciées dans la mesure où elles sont porteuses de gènes intéressants pour la mise au point de nouvelles variétés par biotechnologie. Ainsi les landraces ne sont pas considérées en premier lieu comme des ressources primaires, dynamiques, mais comme des réservoirs de ressources génétiques (Bonneuil et Fenzi 2011). La perspective génétique est si prépondérante que, lors de ma première visite à la banque de germoplasme, mon accompagnateur se félicitait de l’ajout d’une collection locale en m’indiquant que cela avait permis d’ajouter deux allèles au stock de gènes de la Banque de germoplasme. Ainsi, la conception génétique domine-t-elle, en pratique, pour le CIP quand il est question de landraces.
Au niveau global, depuis les années 2000, d’autres acteurs déposent des demandes de rapatriement et argumentent leurs demandes en faisant référence à des concepts relativement proches de la souveraineté alimentaire. En 2002, aux États-Unis, la Première Nation Hopi demande la préservation et la récupération de variétés anciennes de plantes en faisant référence à la « renewing America’s food tradition » (Celi 2008). Un certain nombre d’associations s’attellent à la préservation des variétés anciennes (Heirloom Seeds and Plants), et parfois jusque depuis les années 1970, comme Seed Savers Exchange. Un lien est alors parfois fait avec la souveraineté des semences (Seed Sovereignty) chère à Kloppenburg (2010), comme dans le cas du Seed Sovereignty Project (https://panorama.solutions/en/solution/seed-sovereignty-project, consulté le 2 juin 2020) au Kenya ou le Indigenous Seed Keepers Network (https://nativefoodalliance.org/our-programs-2/indigenous-seedkeepers-network/, consulté le 2 juin 2020). Pour Hill (2017 : 94), qui s’intéresse aux dynamiques de rapatriement aux États-Unis et en Amérique centrale, « ultimement la souveraineté alimentaire n’est pas possible sans la souveraineté des semences ». La rematérialisation des ressources, dans ce contexte, passe par la prise en compte du fait qu’il s’agit d’aliments qui sont produits et consommés par des petits agriculteurs ou des communautés autochtones. La Déclaration des Nations unies de 2018 sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales (UNDROP) fait d’ailleurs référence à ces deux concepts.
L’approche bioculturelle
En parallèle, ANDES a entrepris également tout un travail d’explicitation des conceptions des paysans en mettant l’accent sur la dimension culturelle de la conservation des plantes. Il s’agit d’une approche qui a pris corps dans les années 1990 autour des propositions de Darrel Posey (Posey et Dutfield 1997) et de Luisa Maffi (2010, qui propose une synthèse), qui font tous deux la promotion d’une conservation « bioculturelle », c’est-à-dire intégrant la dimension non seulement biologique mais également culturelle de cette conservation (voir Dumoulin 2003 ; voir aussi Dunbar, https://www.thenatureofcities.com/2019/03/17/biocultural-diversity-nature-culture-alliance/, site consulté le 21 octobre 2021). Alejandro Argumedo s’est familiarisé dès le début des années 1990 avec cette approche. L’exemple du Parc de la pomme de terre est d’ailleurs paradigmatique de cette approche dans les arènes internationales.
L’approche bioculturelle développée dans le Parc va se déployer selon deux approches complémentaires. D’une part, la dimension culturelle – au sens classique du terme – de la pomme de terre va être valorisée. Les savoirs, pratiques, récits ou rituels associés aux différentes landraces vont être compilés et remémorés. La journée nationale (péruvienne) de la pomme de terre, déclarée notamment à la demande des paysans du Parc, fait désormais l’objet d’activités spécifiques appelées « Papa Watay », du nom d’un rituel domestique destiné à permettre que la nouvelle récolte de pommes de terre se conserve de façon satisfaisante jusqu’à la récolte suivante. Le rituel a pour objet, littéralement, d’arrimer [l`âme] des tubercules. Cet évènement est l’un des temps forts dans le Parc, et il sert de vitrine pour montrer l’approche bioculturelle. Le CIP a inclus cet évènement dans les activités de son 45e anniversaire, et de nombreuses équipes de tournage sont venues filmer la cérémonie (pour une ethnographie du Papa Watay, voir Hall 2021). Par ailleurs, certaines landraces faisant l’objet de récits ou de pratiques spécifiques ont été valorisées, à l’instar de la pomme de terre Qhachun Waqachiy qui « fait pleurer les belles-filles ». En effet, éplucher ce tubercule aux formes biscornues était une épreuve initiatique pour les jeunes femmes désirant se marier. Cette approche permet donc de montrer l’importance des pratiques culturelles, qui sont intrinsèquement liées à la conservation des landraces. Dans un certain nombre de cas, le retour de variétés qui avaient disparu génère des réactions émotives (Nazarea, Rhoades et Andrews-Swann 2013 ; Graddy 2013), comme René Gomez l’a constaté dès le premier rapatriement. Ce travail stimule localement un certain renouveau culturel à travers la valorisation de pratiques qui étaient réalisées discrètement, voire tombées en désuétude.
D’autre part, ANDES met en avant une cosmovision – une ontologie – spécifique à travers le modèle de l’ayllu, autrement appelé bien-vivre (Sumaq Kawsay) (Argumedo et Wong 2011 ; Argumedo et Hall, à paraître). L’ONG joue alors le rôle de diplomate ontologique (Hall 2019). Si les éléments précédents contribuent à rendre visible la dimension culturelle de la conservation, cette proposition va plus loin en faisant la promotion d’un régime ontologique différent du naturalisme dominant, c’est-à-dire qui remette en question l’opposition entre nature et culture. En effet, selon cette proposition, les paysans andins conçoivent l’agriculture comme une activité qui mobilise plusieurs communautés ou ayllu, à savoir des humains, des ressources naturelles et des entités chtoniennes (Pachamama ou Terre-Mère, notamment). Obtenir une bonne récolte de pommes de terre, dans cette optique, n’est possible qu’en instaurant des relations de réciprocité équilibrées et harmonieuses entre ces trois communautés. Ainsi, les plantes sont-elles prises dans des réseaux d’interdépendance avec des humains et d’autres qu’humains. Ce discours met en exergue une ontologie relationnelle (Poirier 2008) qui n’a que faire de l’opposition entre nature et culture si chère au naturalisme. Cette proposition s’inspire certes des conceptions des paysans, mais elle résulte également de tout un travail de traduction réalisé par l’ONG ANDES en fonction d’un contexte global (Hall 2019). En effet, à la fin de la première décennie des années 2000, la Bolivie et l’Équateur ont reconnu le bien-vivre dans leurs constitutions respectives et ces pays en font l’apologie, notamment lors des rencontres de la CDB (sur ce point voir Hall 2022).
Ainsi, l’exemple du Parc permet-il de souligner le fait que les fameuses ressources phytogénétiques sont bien plus que cela pour les paysans qui continuent à les cultiver, et montre que les conceptions naturalistes qui prévalent dans les arènes internationales sont trop restrictives, c’est-à-dire naturalistes et coloniales.
Il est à souligner que le CIP se trouve en dehors de ses compétences juridiques concernant la documentation des savoirs traditionnels sur le matériel conservé dans ses collections En effet, la détention de savoirs permettant potentiellement la reconnaissance de droits de propriété, le CIP se doit de déconnecter les ressources de leurs savoirs associés (voir Hayden 2005). La dimension culturelle des plantes est ainsi un domaine sur lequel le CIP ne peut se permettre de s’aventurer, même si l’approche de Andes est valorisée par l’institution.
Du rapatriement au rematriement
Ces dernières années, d’autres avancées ont eu lieu dans ce débat. ANDES n’a pas suivi mais certains acteurs poussent la logique encore plus loin. Cela montre que l’espace de négociation ouvert par le CIP, élargi par ANDES et les paysans du Parc, est désormais élargi par d’autres acteurs. Hill explique ainsi, dans un article dont le titre compare les semences à des ancêtres :
Les semences sont essentielles à la revitalisation des paysages autochtones, des plantes et des traditions alimentaires. Alors, dans le cadre de ce processus, de nombreuses communautés ont aujourd’hui commencé le travail de revitaliser les relations entre les humains et les plantes, mais aussi de rapatrier des semences et de les ramener dans leurs communautés d’origine.
Hill 2017 : 94
Hill reprend donc ici les deux argumentaires précédents : l’importance de la dimension culturelle des savoirs, et celle de la reconnaissance d’un régime ontologique non naturaliste. Elle associe les rapatriements à un processus de guérison des sociétés autochtones au sens large (sur ce sujet voir l’entretien mené avec Richard Kistabish, vice-président de la Fondation autochtone de guérison, dans Rachédi et Mathieu 2010 ; voir aussi Gone 2013). L’usage du terme « guérison » convoque ici une conception holistique des rapatriements, c’est-à-dire englobant des considérations médicales, sociales, culturelles et environnementales.
En ce qui concerne les Hopis, la demande de rapatriement des semences est étroitement liée à d’autres revendications concernant des chorégraphies de danses sacrées, des rituels ou la préservation des restes humains. Dans ce cas, le terme rapatriement semble donc référer plus directement aux textes de l’UNESCO que dans le cas du CIP et du Parc de la pomme de terre.
À la fin des années 2010, Sierra Seed pousse la logique encore plus loin en proposant une nouvelle terminologie : le rematriement (rematriation). Sur leur site internet on peut lire :
Le concept autochtone de Rematriement fait référence à la récupération des restes ancestraux, de la spiritualité, de la culture, des savoirs et des ressources, et non pas à de la version plus patriarcale qui lui est associée, le rapatriement. Cela signifie simplement un retour à Mère nature, un retour à nos origines, à la vie et à la co-création, plutôt qu’à la destruction et à la colonisation patriarcales, une revendication du principe de germination, de la force source de vie de la divinité féminine.
https://sierraseeds.org/seed-rematriation/, consulté le 8 juin 2020 – notre trad.
Ce nouveau terme permet ainsi d’insister sur l’importance de la figure de la Terre-Mère et sur la nécessité d’adopter une perspective féministe et décoloniale.
Le CIMMYT, le centre de recherche du CGIAR sur la conservation du maïs, boucle la boucle en quelque sorte en proposant d’adopter le terme rematriement. En effet, en 2017, Ocampo Giraldo et al. ont lancé un projet de rematriement de la landrace de maïs Jala au Mexique.
Dans un article paru en 2020, le rapatriement est qualifié de « concept », ce qui montre la reconnaissance dont il fait désormais l’objet. Et il est défini comme suit :
Rapatriement désigne le transfert formel de germoplasme entre institutions dans lequel une institution réintègre ou rend un élément ou une collection à une institution qui le reçoit, laquelle a un rôle formel comme représentante du territoire d’origine du germoplasme.
Ocampo Giraldo et al. 2017 : 950
On voit bien ici l’importance du processus de reterritorialisation, et l’on voit aussi que la référence biologique domine dans la définition du territoire de référence. Ainsi, vingt ans après avoir été proposé au CIP, l’usage du terme rapatriement est entériné officiellement par un autre centre de recherche du CGIAR. Ce qui montre le chemin parcouru depuis la fin des années 1990.
Mais les auteurs souhaitent aller plus loin – et sans doute revendiquer ainsi la maternité du concept – en présentant cette approche comme étant trop restrictive car trop associée à une conception ex situ et institutionnelle de la conservation des landraces. Les auteurs proposent de renouveler l’approche avec le « concept » de rematriement, qu’ils définissent comme suit :
Rematriement est un processus co-créatif d’engagement auprès d’une communauté de paysans (farmers) qui inclut des peuples autochtones, à transférer du germoplasme conservé dans une collection ex situ vers son lieu (place) d’origine où il peut aussi être conservé in situ, où un environnement favorable est co-créé afin d’utiliser les landraces dans le cadre d’une agriculture inclusive et soutenable, tout en prenant en considération la valeur culturelle des semences.
Ocampo Giraldo et al. 2017 : 950
Cette définition est curieuse car elle parle des « semences » tout en gardant la référence au germoplasme ; elle prend en considération la dimension culturelle et même ontologique des semences et reconnaît l’importance des paysans et des populations autochtones, mais prend comme référence le centre d’origine comme territoire de référence tout en préférant utiliser le terme « lieu » (place) qui propose ainsi une conception plus inclusive (moins biologique) de cet ancrage territorial. Sont ainsi mises en regard les conceptions du CIMMYT, qui restent ancrées dans un discours génétique, et les conceptions holistes des populations locales (paysannes et/ou autochtones). Les premières sont associées à une conservation ex situ, les secondes à une conservation in situ mais également à des pratiques agricoles. Ce qui précède permet de comprendre la difficulté de l’exercice de redéfinition, étant donné les limites d’une institution comme le CYMMIT. En fait, on sent dans ce texte une conception certes biologique et naturaliste, mais plus dynamique, de la biodiversité, qui accorde aux paysans et groupes autochtones une place plus importante. En effet en cultivant les plantes, ils contribuent à leur conservation et à leur évolution. Au-delà d’une conservation in situ, les auteurs préconisent une conservation on farm (voir Halewood et al. 2010, Brush 2000). Le CIMMYT prend donc désormais acte du fait qu’il faudrait que les centres du CGIAR poussent encore plus loin leurs démarches de rapatriement.
Dans le texte, le territoire vers lequel les semences sont rapatriées ou rematriées fait l’objet d’une discussion. En effet, au territoire officiel défini en termes étatiques et qualifié de « fatherland » est opposée une vision plus proche de celle des communautés locales constituées de paysans ou de peuples indigènes, qui prend acte du rôle de la Terre-Mère. La paternité du terme est attribuée à Martín Prechtel (2012), un citoyen américain élevé dans une réserve pueblo au Nouveau Mexique et qui a suivi les enseignements d’un chaman au Guatemala. Prechtel argumente ce choix terminologique en faisant référence aux notions nord-américaine de Mother-Earth et andine de Pachamama. Son argument principal réside dans le régime ontologique non naturaliste des peuples autochtones à travers le monde. On retrouve donc ici l’argument de ANDES avec le modèle du bien-vivre. Par l’intermédiaire du rematriement, une conception plus holistique de la conservation est ainsi promue, plus ancrée à la fois matériellement, territorialement et socialement (le territoire considéré par les communautés étant celui des communautés et non plus celui de l’État). Ces acteurs militent donc en faveur d’une ontologie politique (Blaser 2009) appliquée au domaine des semences (Müller 2014, Demeulenaere 2014). Il s’agit d’inscrire les semences dans les différents réseaux de nature-culture auxquels elles participent (Haraway 2019).
Cette façon d’aborder les pratiques de retour d’un matériel phytogénétique depuis des banques de germoplasme vers des communautés fait donc la synthèse des propositions portées initialement par le CIP, négociées avec ANDES, et que différentes communautés à travers de le monde ont contribué à faire évoluer depuis. C’est en quelque sorte l’aboutissement des processus de rematérialisation et de reterritorialisation des ressources phytogénétiques entrepris par le CIP à la fin des années 1990, même si l’un de ses instigateurs n’apprécie pas le changement de terminologie. Le changement terminologique porté par le CIMMYT peut d’ailleurs être vu comme un processus de récupération à une époque où la légitimité de ce type de demande est mieux assise.
Conclusion
La question du rapatriement apparaît donc comme une controverse qui mobilise différents types d’acteurs, soit des communautés (le Parc de la pomme de terre, les Hopis par exemple) mais également et surtout des institutions internationales (ici le CIP et le CIMMYT) ainsi que des ONG (dont ANDES en particulier, ainsi que Sierra Seed…) qui pourront d’ailleurs agir comme porte-parole. Le cas du rapatriement de matériel phytogénétique depuis la banque de germoplasme du CIP est particulièrement important. Il ne s’agit pas du premier rapatriement de ce type, mais c’est le premier qui revendique l’appellation de rapatriement. Cela a conduit ultérieurement à la signature d’un accord formel de rapatriement entre des communautés locales (représentées par le Parc de la pomme de terre) et le CIP, l’une des institutions du CGIAR. Cette étape est essentielle pour les débats concernant le retour des ressources phytogénétiques conservées ex situ dans les grandes banques de germoplasme du CGIAR vers les communautés qui ont historiquement contribué à leur domestication, sélection et conservation in situ.
Les débats ont certes lieu autour du terme rapatriement lui-même, mais plus profondément autour de ce qui est rapatrié, à savoir les « ressources phytogénétiques ». Tous deux sont des objets frontières sur lesquels les différents acteurs ont des perspectives différentes, et dont les conceptions vont évoluer conjointement au cours de la controverse, à travers les échanges et la négociation, en dépit et même à la faveur des désaccords. Le CIP, ANDES et les paysans du Parc ont des perspectives différentes, ce qui va induire justement une réflexion conjointe. Tous ces acteurs ne se mettront pas d’accord, mais ensemble ils vont faire évoluer les termes du débat, notamment en affirmant la légitimité des rapatriements vers les communautés et en stimulant une réflexion sur ce qui est rapatrié.
L’étude de cette controverse permet de montrer que, dans les échanges entre les acteurs, un double processus est à l’oeuvre : la reterritorialisation et la rematérialisation des ressources phytogénétiques. Girard qualifie ce double processus de « earthification » (2019). Les personnes du CIP qui défendent les rapatriements et ANDES sont relativement d’accord sur l’importance de reterritorialiser ces ressources (quoique le territoire de référence de chacun des acteurs ne concorde pas forcément). Sur cette base, l’ONG ANDES va oeuvrer à une requalification des ressources, remettant en cause la dématérialisation des semences opérée dans et par la gouvernance internationale de la biodiversité, laquelle est intimement liée à l’avènement d’un discours génétique. Sur ce point, le CIP et ses représentants restent très frileux, non seulement du fait de leur ancrage scientifique, mais également parce que la documentation des savoirs sur les ressources qui sont dans leurs collections est en dehors de leur compétence juridique. S’agissant de ressources végétales, alimentaires, la référence au concept de souveraineté alimentaire (et de la souveraineté des semences mais de façon plus secondaire) a été une première façon d’opérer cette rematérialisation des ressources phytogénétiques. Cela a permis de rappeler qu’il s’agit de semences et non de ressources dématérialisées, et que l’alimentation est un sujet hautement culturel. Puis, avec l’approche bioculturelle, la façon particulière dont les paysans conçoivent leur rapport au monde et à leurs semences a été explicité : il relève d’un rapport ontologique spécifique, non naturaliste.
Dans ce processus, les références à l’UNESCO ont été plutôt contextuelles dans la mesure où, au Pérou (où ont lieu les débats initialement), le rapatriement d’objets muséaux était débattu publiquement à la même époque. Initialement, les débats prennent ainsi sens essentiellement au regard du droit international concernant les ressources (phyto)génériques tel qu’inscrit dans les instruments internationaux que sont la CDB et le TIRPAA. C’est ultérieurement que d’autres acteurs, notamment nord-américains, ont mobilisé plus explicitement les débats autour des objets muséaux et de la Convention de l’UNESCO.
Une nouvelle étape a été franchie ces dernières années avec le CIMMYT qui, non seulement prend acte des rapatriements, mais se positionne de façon avantageuse dans ces débats en préférant parler de « rematriement ». Cette proposition entérine selon nous les avancées ayant eu lieu depuis la fin des années 1990 autour de la question des rapatriements de ressources phytogénétiques auprès de communautés. Cela montre l’importance des différents acteurs de la société civile, que ce soient des ONG, des communautés ou des associations, qui ont prolongé le débat au cours du temps sur des terrains très différents, aux USA et en Afrique notamment. Le fait qu’une institution équivalente au CIP – mais s’intéressant à une autre culture vivrière importante – revendique désormais cette approche est significatif du chemin parcouru. La terminologie est non seulement entérinée, mais jugée dépassée !
Quel est le résultat de ce double processus de reterritorialisation et de rematérialisation ? De ressources phytogénétiques conçues comme un commun global, elles deviennent des ressources concrètes sur lesquelles les communautés ont des droits. Cela stimule la réflexion sur les usages locaux liés à ces semences et contribue à la constitution de bio-communs (Girard 2019). Ces questions sont actuellement d’une actualité pressante, elles sont débattues âprement au TIRPAA. Il y a des résistances très fortes de la part, notamment, du secteur agro-semencier et de pays qui misent avant tout sur une agriculture intensive. Les avancées réalisées autour de la question des rapatriements restent avant tout symboliques, il ne faut pas se leurrer… Il ne s’agit que de la pointe émergée d’un iceberg, et seule une petite pointe émerge. En effet la reconnaissance des droits des communautés autochtones et des communautés locales, ou ceux des paysans (la Déclaration des droits des paysans date de 2018) sur les landraces restent embryonnaire, si ce n’est dans les textes (beaucoup de mesures ont été entérinées), du moins dans les actes…
Ces débats contribuent à décentrer le paradigme dominant de la conservation de la biodiversité (centré sur l’ex situ) afin de prendre en compte les apports des populations autochtones et paysannes. Ce faisant, ils contribuent à l’émergence d’un « monde vivable » (livable world) [Harvey et Haraway 1995 : 518], dans lequel sont prises en compte les dimensions ontologiques, sociales et culturelles des semences.
Appendices
Note biographique
Ingrid Hall est anthropologue et professeure agrégée au département d’anthropologie de l’Université de Montréal. Ses travaux relèvent de l’écologie politique et ses principaux terrains sont situés dans les Andes péruviennes. Ces dernières années, ses recherches ont porté sur les pratiques et politiques de conservation des variétés paysannes de pommes de terre par différents acteurs, depuis le local jusqu’à l’international. Elle s’est ainsi intéressée à la façon dont la catégorie de savoirs locaux est mobilisée avec la publication de l’ouvrage Les savoirs locaux en situation. Retour sur une notion plurielle et dynamique (sous la direction de F. Verdeaux, I. Hall et B. Moizo, IRD/Quae, 2019). Cette recherche se poursuit actuellement dans les instances globales dédiées à la conservation de la biodiversité. Un ouvrage sur l’émergence des droits bioculturels est à paraître au printemps 2023 avec F. Girard et C. Frison (Biocultural Rights, Indigenous Peoples and Local Communities: Protecting Culture and the Environment, Routledge).
Notes
-
[1]
Sur les marchés de la biodiversité, voir Aubertin, Pinton et Boisvert (2007) et, concernant les enjeux spécifiques pour les pays émergents, voir Thomas et Boisvert (2015).
-
[2]
Sur cette histoire, voir Pistorius (1997) et Halewood (2013). Par ailleurs, je tiens ici à remercier vivement Fabien Girard pour son aide précieuse et pour m’avoir accompagnée dans la compréhension et la restitution de ce contexte institutionnel et juridique complexe et de ses évolutions.
-
[3]
Les collections ex situ sont à distinguer des collections in situ. Contrairement à ces dernières, le matériel phytogénétique est conservé hors sol selon différentes méthodes (Ellis et al. 2019). Pour une discussion sur l’importance de la conservation in situ et sa complémentarité avec les méthodes ex situ, se référer par exemple à Brush (1995).
-
[4]
Il concerne 64 espèces de plantes qui représentent 80 % de notre consommation de cultures végétales.
-
[5]
Plus spécifiquement, Villa et al. (2005) définissent une landrace comme « une population dynamique de plantes cultivées qui a une origine historique distincte, une identité distincte, et n’a pas fait l’objet d’améliorations variétales formelles, qui est souvent génétiquement diverse, localement adaptée et associée à des systèmes agricoles traditionnels ».
-
[6]
Les paysans ont un rôle majeur dans la conservation de la biodiversité in situ (Coomes et al. 2015), Brush (2004).
-
[7]
Cette recherche a été financée par le FRQSC et le CRSH.
-
[8]
Je tiens à remercier chaleureusement tant les paysans des communautés du Parc, et en particulier les Techniciens locaux et les Papa Arariwa, de San José de Aymara, ainsi que les membres de ANDES et du CIP – en particulier de la Banque de germoplasme. Toutes et tous m’ont accueillie et guidée avec bienveillance et patience. En particulier, ce travail doit beaucoup à René Gomez, curateur de la banque de germoplasme.
-
[9]
Le terme apparaît dans la première version d’un document officiel en date de 2010 (TIRPAA 2010) : son usage y est strictement défini de façon à en restreindre l’usage pour des retours vers des États.
-
[10]
Il est difficile de savoir à partir de quand le terme s’est imposé, mais en 2014 son usage est établi.
-
[11]
Si cet enjeu est relativement important en 1999 alors que le statut des collections des banques de germoplasme était en négociation, il l’est moins en 2004 dans la mesure où le CIP a accepté de se placer sous la responsabilité (in trust) du TIRPAA.
-
[12]
En effet les familles en cultivent plusieurs en « mélange », sans les distinguer forcément avec précision. Et ce en dépit du fait que les différentes landraces sont distinguées les unes des autres.
-
[13]
Au début des années 2000 il n’existait pas de marché pour ces landraces de pommes de terre (et si aujourd’hui la situation a changé, un tel marché reste fort restreint car c’est un produit saisonnier, méconnu par les consommateurs, difficile à cuisiner, et dont le prix est plus élevé).
Bibliographie
- ANDES (Asociación para la naturaleza y el desarrollo sostenible). 2009. « Declaration on Agrobiodiversity Conservation and Food Sovereignty ». IEED. https://pubs.iied.org/g02575. (consulté le 21 octobre 2021)
- Angé, Olivia. 2018. « Interspecies Respect and Potato Conservation in the Peruvian Cradle of Domestication ». Conservation and Society 16(1) : 30-40.
- Appadurai, Arjun. 2005. « Disjuncture and difference in the global cultural economy ». Dans Modernity at large. Cultural dimensions of globalization, 27-47. Minneapolis / London : University of Minnesota press.
- Argumedo, Alejandro et Ingrid Hall. à paraître. « Sumaq Kawsay and biocultural conservation. The experience of the Potato Park (Cusco, Peru) ». Dans Indigenous Stewardship of Environment and Alternative Development. Sous la direction de C. Scott, E. Silva-Rivera et K. Sinclair. Toronto : University of Toronto Press.
- Argumedo, Alejandro et Bernard Wong. 2010. « The Ayllu System of the Potato Park, Cusco, Peru ». United Nations University Institute of Advanced Studies. The satoyama initiative (blog), 2010. http://satoyama-initiative.org/en/the-ayllu-system-of-the-potato-park/. (consulté le 21 octobre 2021)
- Aubertin, Catherine, Florence Pinton et Valérie Boisvert. 2007. Les marchés de la biodiversité. Paris : IRD éditions, Institut de recherche pour le développement.
- Blaser, Mario. 2009. « The Threat of the Yrmo: The Political Ontology of a Sustainable Hunting Program ». American Anthropologist 111(1) : 1020. https://doi.org/10.1111/j.1548-1433.2009.01073.x.
- Bonneuil, Christophe et Marianna Fenzi. 2011. « Des ressources génétiques à la biodiversité cultivée ». Revue d’anthropologie des connaissances 52(2) : 206-233. https://doi.org/10.3917/rac.013.0206.
- Brush, Stephen. 2004. Farmers’ Bounty: Locating Crop Diversity in the Contemporary World. New Haven : Yale University Press. http://public.eblib.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=3420003.
- Brush, Stephen. 2000. « Ethnoecology in Andean Potatoe Agriculture ». Dans Ethnobotany: A Reader. Sous la direction de Paul E. Minnis. Norman : University of Oklahoma Press.
- Brush, Stephen. 1996. « Whose knowledge, whose genes, whose rights? » Dans Valuing local knowledge. Indigenous people and intellectual property rights. Sous la direction de Stephen Brush et Doreen Stabinsky : 1‑24. Washington D.C., Covelo California : Island Press.
- Brush, Stephen. 1995. « In situ conservation of landraces of crop diversity ». Crop Science 35(2) : 346-354.
- Brush, Stephen. 1974. « El lugar del hombre en el ecosistema andino ». Revista del Museo Nacional 40 : 277-299.
- Callon, Michel. 2006. « Sociologie de l’acteur réseau ». Dans Sociologie de la traduction : Textes fondateurs. Sous la direction de Madeleine Akrich, Michel Callon et B. Latour : 267-276. Sciences sociales. Paris : Presses des Mines. http://books.openedition.org/pressesmines/1201.
- Campos, Hugo et Oscar Ortiz, dir. 2019. The Potato Crop: Its Agricultural, Nutritional and Social Contribution to Humankind. Cham : Springer Nature.
- CDB. 1992. « Convention sur la diversité biologique ». https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-fr.pdf. (consulté le 21 octobre 2021)
- CDB. 2019. « The Rutzolijirisaxik Voluntary Guidelines for the Repatriation of Traditional Knowledge of Indigenous Peoples and Local Communities Relevant for the Conservation and Sustainable Use of Biological Diversity ». https://www.cbd.int/doc/guidelines/cbd-RutzolijirisaxikGuidelines-en.pdf. (consulté le 21 octobre 2021)
- Celie. 2008. « Crop Repatriation ». 25 sept. https://islandpress.org/blog/crop-repatriation. (consulté le 21 octobre 2021)
- Coomes, Oliver T. et al. 2015. « Farmer Seed Networks Make a Limited Contribution to Agriculture? Four Common Misconceptions ». Food Policy 56 (octobre) : 41-50. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2015.07.008.
- Demeulenaere, Elise. 2014. « A political ontology of seeds. The transformative frictions of a farmer’movement in Europe ». Journal of global and historical anthropology 69 : 45-61.
- Descola, Philippe. 2005. Par-delà nature et culture. Paris : Gallimard.
- Devaux, André, J.-P. Goffart, et al. 2019. « Global Food Security, Contributions from Sustainable Potato Agri-Food Systems ». Dans The Potato Crop: Its Agricultural, Nutritional and Social Contribution to Humankind. Sous la direction de Hugo Campos et Oscar Ortiz : 3-35. Cham : Springer Nature.
- Dumoulin-Kervran, David. 2003. « Les politiques de conservation de la nature confrontées aux politiques du renouveau indien : une étude transnationale depuis le Mexique ». Thèse de doctorat en Science politique, Institut d’études politiques, Paris.
- Ellis, David, et al. 2019. « Ex situ Conservation of Potato [Solanum Section Pelota (Salanaceae)] Genetic Resources in Genebanks ». Dans The Potato Crop: Its Agricultural, Nutritional and Social Contribution to Humankind. Sous la direction de Hugo Campos et Oscar Ortiz : 109-138. Cham : Springer Nature.
- Filoche, Geoffroy. 2009. « Les connaissances, innovations et pratiques traditionnelles en matière de biodiversité : un kaléidoscope juridique ». Droit et Société 72(2) : 433-456.
- Frison, Christine. 2018. « Planting the Commons. Towards Redesigning an Equitable Global Seed Exchange ». Dans The Commons, Plant Breeding and Agricultural Research: Challenges for Food Security and Agrobiodiversity. Sous la direction de Fabien Girard et Christine Frison : 272-289. Abington, New York : Routledge.
- Girard, Fabien. 2018. « Composing the Common World of the Local Bio-Commons in the Age of the Anthropocene ». Dans The Commons, Plant Breeding and Agricultural Research: Challenges for Food Security and Agrobiodiversity. Sous la direction de Fabien Girard et Christine Frison : 115-144. Abington, New York : Routledge.
- Girard, Fabien. 2019. « Semences et agrobiodiversité : Pour une lecture ontologique des bio-communs locaux ». Développement durable et territoires. Économie, géographie, politique, droit, sociologie 10(1), avril. https://doi.org/10.4000/developpementdurable.13339.
- Girard, Fabien et Christine Frison, dir. 2018. The Commons, Plant Breeding and Agricultural Research: Challenges for Food Security and Agrobiodiversity. Abington, New York : Routledge.
- Gone, Joseph P. 2013. « Redressing First Nations Historical Trauma: Theorizing Mechanisms for Indigenous Culture as Mental Health Treatment ». Transcultural Psychiatry 50(5) : 683-706. https://doi.org/10.1177/1363461513487669.
- Graddy, T. Garrett. 2013. « Regarding biocultural heritage: In situ political ecology of agricultural biodiversity in the Peruvian Andes ». Agriculture and Human Values 30(4) : 587-604. https://doi.org/10.1007/s10460-013-9428-8.
- Gupta, Akhil et James Ferguson. 1992. « Beyond “Culture”: Space, Identity, and the Politics of Difference ». Cultural Anthropology 7(1) : 6-23.
- Halewood, Michael et Isabel Lapeña. 2010. « Farmers’ Varieties and Farmers’ Rights: Chalenges at the Crossroads of Agriculture, Taxonomy and Law ». Dans Farmers’ Crop Varieties and Farmers’ Rights: Challenges in Taxonomy and Law. Sous la direction de Michael Halewood : 1-24. London : Earthscan.
- Halewood, Michael, Isabel López Noriega et Selim Louafi. 2013a. Crop Genetic Resources as a Global Commons: Challenges in International Law and Governance. Abington, New York : Routledge.
- Halewood, Michael, Isabel López Noriega et Selim Louafi. 2013b. « The global crop commons and access and benefit sharing laws. Examining the limits of international policy support for the collective pooling and management of plant genetic resources ». Dans Crop genetic resources as a global commons: challenges in international law and governance. Sous la direction de M. Halewood, I. López Noriega et S. Louafi : 1-36. Abingdon, New York : Earthscan Routledge.
- Hall, Ingrid. 2018. « Les ancêtres au prisme des pommes de terre non domestiquées. Une perspective andine ». Frontières 29(2). https://doi.org/10.7202/1044161ar.
- Hall, Ingrid. 2019. « Le “bien-vivre” (Sumaq kawsay) et les pommes de terre natives. Du délicat exercice de la diplomatie ontologique ». Anthropologie et Sociétés 43(3) : 217-244.
- Hall, Ingrid. 2021. « Tying Down the Soul of a Potato in the Southern Peruvian Andes. Performance and Frictions ». Dans Contemporary Indigenous Cosmologies and Pragmatics. Sous la direction de Françoise Dussart et Sylvie Poirier, 157-186. Edmonton : University of Alberta Press.
- Hall, Ingrid. 2022. « Unmaking the Nature/Culture DivideThe Ontological Diplomacy of Indigenous Peoples and Local Communities at the CBD ». Dans Biocultural Rights, Indigenous Peoples and Local Communities: Protecting Culture and the Environment. Sous la direction de F. Girard, I. Hall I. et C. Frison, 112-140. London : Routledge.
- Haraway, Donna Jeanne. 2019. Manifeste des espèces compagnes : chiens, humains et autres partenaires. Paris : Climat.
- Harrop, Stuart R. 2011. « Living in Harmony With Nature? Outcomes of the 2010 Nagoya Conference of the Convention on Biological Diversity ». Journal of Environmental Law 23(1) : 117-128.
- Harvey, David et Donna Haraway. 1995. « Nature, Politics, and Possibilities: A Debate and Discussion with David Harvey and Donna Haraway ». Environment and Planning D: Society and Space 13 : 507-527. https://doi.org/10.1068/d130507.
- Hayden, Cori. 2005. « Bioprospecting’s representational dilemma ». Science as Culture 14(2) : 185-200. https://doi.org/10.1080/09505430500110994.
- Hill, Christina Gish. 2017. « Seeds as Ancestors, Seeds as Archives: Seed Sovereignty and the Politics of Repatriation to Native Peoples ». American Indian Culture and Research Journal 41(3) : 93-112. https://doi.org/10.17953/aicrj.41.3.hill.
- Huamán, Zosimo. s.d., « Conservacion In Situ de Cultivos Nativos ». https://sites.google.com/site/drzosimohuaman/home/mi-opinion/conservacion-in-situ-de-cultivos-nativos (consulté le 21 octobre 2021).
- Huamán, Zosimo, et al. 2000. « Conservation of Potato Genetic Resources at CIP ». Dans Potato, Global Research & Development. Vol. I. Sous la direction de S.K. Khurana, S.V. Pandey et B.P. Singh : 102-112. Shimla : Indian Potato Association.
- Kloppenburg, Jack. 2010. « Impeding Dispossession, Enabling Repossession: Biological Open Source and the Recovery of Seed Sovereignty: Biological Open Source and the Recovery of Seed Sovereignty ». Journal of Agrarian Change 10(3) : 367-388. https://doi.org/10.1111/j.1471-0366.2010.00275.x.
- Londres, Flavia, Therezinha Borges Dias, Ubiratan Piovezan et Fernando Schiavini. 2014. As Sementes Tradicionais dos Krahô: Uma experiência de integração das estratégias on farm ex situ de conservação de recursos genéticos. Sementes locais : experiências agroecológicas de conservação e uso. Rio de Janeiro : Articulação Nacional de Agroecologia (ANA), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA),– Fundação Nacional do Índio Kapéy (FUNAI), União das Aldeias Krahô Rede Ipantuw.
- Maffi, Luisa. 2010. Biocultural Diversity Conservation: A Global Sourcebook. London ; Washington, D.C. : Earthscan.
- Mooney, Pat Roy. 1983. « The law of the seed. Another Development and Plant Genetic Resources ». Development and Dialogue 1-2 : 1-173. http://www.daghammarskjold.se/wp-content/uploads/1983/08/83_1-2.pdf. (consulté le 22 octobre 2021)
- Müller, Birgit. 2014. « Introduction. Seeds and the Ontic in Political Anthropology. » Focaal 2014 (69) : 3-11. https://doi.org/10.3167/fcl.2014.690101.
- Nabhan, Gary Paul. 2016. Ethnobiology for the Future: Linking Cultural and Ecological Diversity. Tucson : University of Arizona Press.
- Nazarea, Virginia D. 2006. « Local Knowledge and Memory in Biodiversity Conservation ». Annual Review of Anthropology 35 (janvier) : 317-335.
- Nazarea, Virginia D. et Robert E. Rhoades. 2013. « Conservation beyond Design: An Introduction ». Dans Seeds of Resistance, Seeds of Hope: Place and Agency in the Conservation of Biodiversity. Sous la direction de J. Andrews-Swann, V. D. Nazarea et R. E. Rhoades : 3-18. Tucson : University of Arizona Press.
- Nazarea, Virginia D., R. E. Rhoades et J. Andrews-Swann. 2013. Seeds of Resistance, Seeds of Hope: Place and Agency in the Conservation of Biodiversity. Tucson : University of Arizona Press.
- Ocampo Giraldo, Vanessa, et al. 2020. « Dynamic conservation of genetic resources: Rematriation of the maize landrace Jala ». Food Security 12 : 945-958.
- Pistorius, Robin. 1997. Scientists, Plants and Politics: A History of the Plant Genetic Resources Movement. Rome : Bioversity International.
- Plucknett, Donald L. et Nigel J. H. Smith. 1986. Gene banks and the world’s food. Princeton : Princeton University Press. https://fr.crepuq.vdxhost.com/zportal/zengine?VDXaction=DocFetch&docfetch_key=4a9ae00009c22200&docfetch_user=adZTKSWD&docfetch_password=IhZhMoJN.
- Poirier, Sylvie. 2008. « Reflections on Indigenous Cosmopolitics-Poetics ». Anthropologica 50(1) : 75-85.
- Posey, Darrell Addison et Graham Dutfield. 1997. Le marché mondial de la propriété intellectuelle : droits des communautés traditionnelles et indigènes. Toronto/Genève : Centre de recherches pour le développement international (Canada)/WWF (Suisse), Fonds mondial pour la Nature.
- Prechtel, Martín. 2012. The unlikely peace at Cuchumaquic: The parallel lives of people as plants: Keeping the seeds alive. Berkeley : North Atlantic Books.
- Rachédi, Lilyane et Réjean Mathieu. 2010. « Le processus de guérison des Premières Nations : entrevue avec Richard Kistabish, vice-président de la Fondation autochtone de guérison ». Nouvelles pratiques sociales 23(1) : 10-25. https://doi.org/10.7202/1003164ar.
- Rhoades, Robert E. 2004. « When Seeds Are Scarce: Globalization and the Responses of Three Cultures ». https://vtechworks.lib.vt.edu/handle/10919/65525.
- Schanbacher, William D. 2010. The Politics of Food: The Global Conflict between Food Security and Food Sovereignty. Santa Barbara : Praeger Security International.
- Secretariat CGIAR. 1994. « Agreement with FAO to Place Center In-Trust Collections of Plant Genetic Resources under the Auspices of FAO ». https://cgspace.cgiar.org/handle/10947/149. (consulté le 22 octobre 2021).
- Stenner, Tammy, Alejandro Argumedo, David Ellis et Krystyna Swiderska. 2016. « Potato Park-International Potato Center-ANDES Agreement ». IIED, 2016. http://andes.center/wp-content/uploads/2019/11/Solving-%E2%80%98wIcked%E2%80%99-problems_-a-compendium-of-case-studies.pdf. (consulté le 21 octobre 2021)
- Suri, Sanjay. 2005. « ANDES-Potato Park-CIP agreement. Potato capital of the world offers up new recipe ». GRAIN. https://www.grain.org/article/entries/2165-andes-potato-park-cip-agreement. (consulté le 21 octobre 2021)
- Swanson, Stephanie. 2009. « Repatriating Cultural Property: The Dispute Between Yale and Peru Over the Treasures of Machu Picchu ». San Diego International Law Journal 10 : 469-494.
- Thomas, Frédéric et Valérie Boisvert, dir. 2015. Le pouvoir de la biodiversité : néolibéralisation de la nature dans les pays émergents. Marseille, Versailles : IRD éditions ; Éditions Quae.
- Thomas, Frédéric et Geoffroy Filoche. 2015. « Le partage des avantages, une nouvelle étique pour la biodiversité ? » Dans Le pouvoir de la biodiversité : néolibéralisation de la nature dans les pays émergents. Sous la direction de Frédéric Thomas et Valérie Boisvert : 43-64. Marseille et Versailles : IRD éditions et Éditions Quae.
- TIRPAA (Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture). 2009. FAO. http://www.fao.org/3/i0510f/i0510f.pdf. (consulté le 21 octobre 2021)
- TIRPAA (Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture). 2010. « Repatriation of germplasm – draft 2010 ». http://www.fao.org/3/a-be063e.pdf. (consulté le 21 octobre 2021)
- Tsing, Anna Lowenhaupt. 2005. Friction: An Ethnography of Global Connection. Princeton, NJ : Princeton University Press.
- Ulloa, Astrid. 2017. « Autonomie indigène et politiques globales du changement climatique : Repenser la relation avec la nature dans la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombie ». Dans Le multiculturalisme au concret : Un modèle latino-américain ? Sous la direction de Christian Gros et David Dumoulin-Kervran, 361-375. Paris : Presses Sorbonne Nouvelle (Monde hispanophone). http://books.openedition.org/psn/694.
- UNDROP. 2018. FAO. http://www.fao.org/family-farming/detail/fr/c/1197483/ (consulté le 21 octobre 2021)
- Villa, Tania, et al. 2005. « Defining and Identifying Crop Landraces », Plant Genetic resources 3(3) : 273-284.
- Westengen, Olga, T. Hunduma et K. Skarbø. 2017. « From Genebanks to Farmers. A study of approaches to introduce genebank material to farmers’ seed systems ». Noragric Repport 20. Norwegian University of Life Sciences, Faculty of Landscape and Society, Department of International Environment and Development Studies.
- Zimmerer, Karl S. 1996. Changing Fortunes: Biodiversity and Peasant Livelihood in the Peruvian Andes. Berkeley : University of California Press.

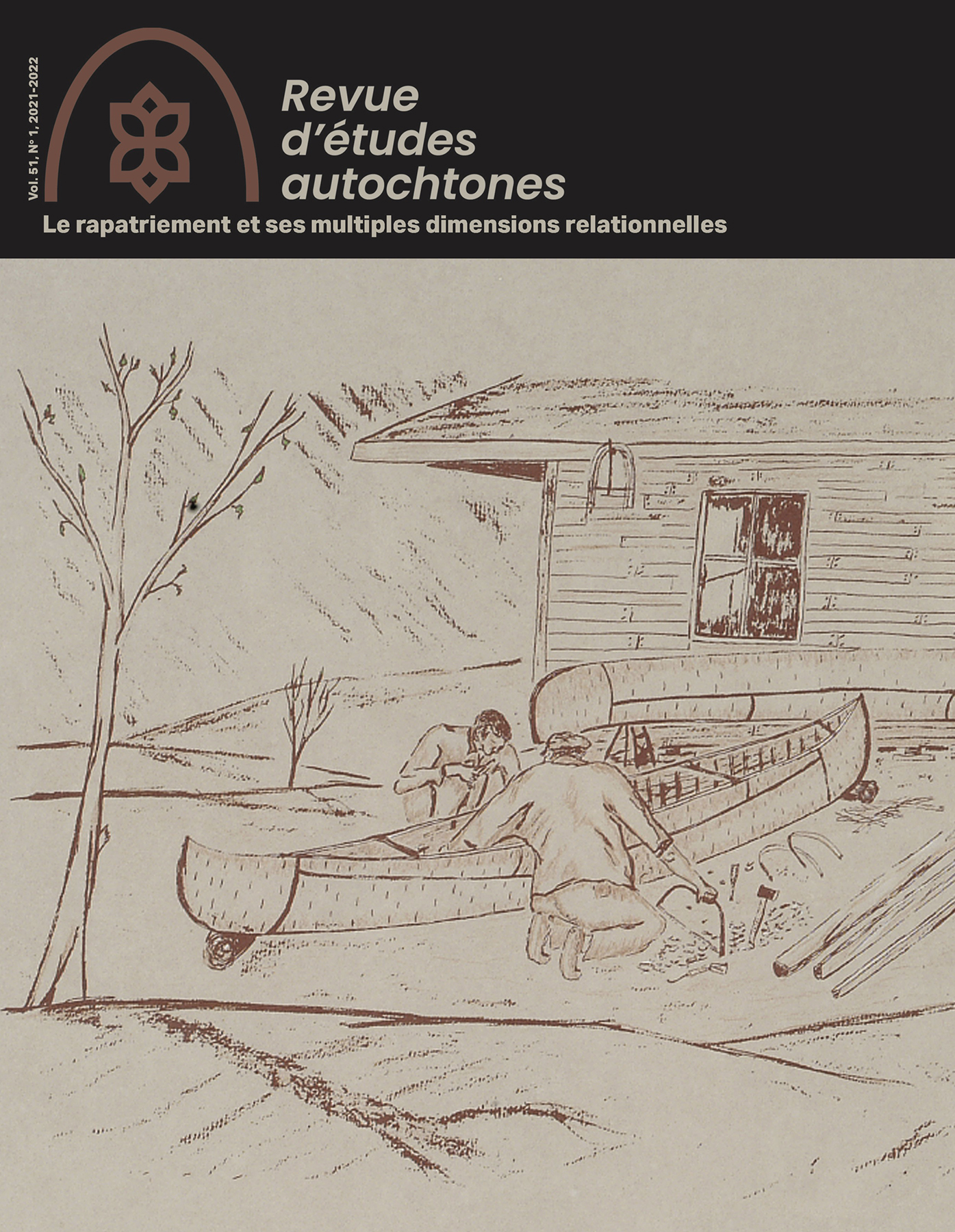

 10.7202/1044161ar
10.7202/1044161ar