Les théories du complot, comme contre-récits visant à décrire la « Vraie » réalité derrière une réalité de façade, n’ont rien de nouveau, comme l’illustrent par exemple les multiples variantes historiques de l’antisémitisme, du Protocole des Sages de Sion à la théorie du « Grand remplacement ». Mais, le contexte et l’espace narratif dans lesquels ces discours alternatifs sont désormais énoncés, relayés et mobilisés ont profondément changé. Ces récits ont notamment connu une montée en popularité à la suite des attentats du 11 septembre 2001 et à celui contre Charlie Hebdo. Quelques années avant la pandémie de Covid-19, plusieurs sondages en Amérique du Nord et en Europe signalaient déjà dans les discours lambda des hypothèses de complots cachés au sujet d’évènements officiels. C’est le cas par exemple d’un sondage Gallup aux États-Unis (2019) qui révélait que pour une majorité de citoyens américains, l’assassinat de JFK relevait toujours d’une conspiration, ou d’une enquête internationale (YouGov et Cambridge University nationally representative survey on conspiracy beliefs, 2018) indiquant que 30% des répondants Allemands, Français, Suédois et Britanniques « croyaient que leur gouvernement leur cachait la vérité à propos de l’immigration » (cité dans Harambam, 2020, p. 1-2). En catalysant les polarisations sociales et l’érosion de la confiance envers les autorités publiques (Généreux et al., 2020), la crise sanitaire de la Covid-19 a représenté un véritable moment de basculement dans la circulation des théories du complot, en favorisant à la fois leur « normalisation » et leur « stigmatisation », selon la formulation de Harambam (2020). Longtemps confinés aux marges de l’opinion publique, plusieurs de ces énoncés percolent et se normalisent en effet de plus en plus facilement au sein de divers segments de la population, de tous âges. Un sondage lancé en 2020 par l’Université de Sherbrooke suggérait par exemple qu’un Canadien sur dix croyait aux théories du complot entourant la pandémie de Covid-19, une adhésion potentiellement liée à des facteurs de stress psychosociaux (Yates, 22 avril 2020). En octobre de la même année, c’est un répondant sur quatre qui déclarait lors d’un sondage CROP être « totalement » ou « en partie » d’accord avec les thèses conspirationnistes de QAnon agrégées autour de la croyance en « un État profond, contrôlé par une clique élitiste, qui contrôle les gouvernements » et qui serait « impliqué dans le satanisme et la pédophilie » (Péloquin, 24 octobre 2020), des résultats qui n’ont pas forcément décliné au sortir de la pandémie (UNESCO, 2022). Ici comme ailleurs, l’horizontalité, l’expressivité et le « mythe démocratique » (Cardon, 2010) selon lequel « Chacun croit ce qu’il veut… » (Lecointre, 2018, p. 5) qui caractérisent l’écosystème actuel de communication numérique sont souvent perçus comme des ressorts cruciaux de cet attrait des théories du complot. Mais, peu de travaux décrivent spécifiquement les mécanismes de réception et les effets réels des discours consultés en ligne (Ducol, 2015; Alava, Frau-Meigs et Hassan, 2018). Quoi qu’il en soit, selon Brin et al. (2021), de 20 à 25 % des publications sur Facebook et Twitter concernant la COVID‑19 se seraient avérées fausses. Plus s’accentue la circulation des théories du complot sur le marché des idées, plus cette question est construite comme un problème public par les autorités politiques, voire comme un enjeu de santé publique, une « infodémie ». Ce cadrage a d’ailleurs été largement relayé par les médias traditionnels, comme l’évoquent plusieurs « Unes » de journaux en temps de Covid: « Pandémie de fausses nouvelles », « Peut-on s’extirper de la toile conspirationniste ? » (La Presse) ; « Un Québécois sur cinq serait complotiste » (Journal de Montréal …
Appendices
Bibliographie
- Alava, Serapin, Frau-Meigs, D. & Ghayda Hassan. 2018. « Comment qualifier les relations entre les médias sociaux et les processus de radicalisation menant à la violence ? : Note de synthèse internationale » Quaderni 95 : 39-52. https://doi.org/10.4000/quaderni.1137
- Becker, Howard S. [1963] 1985. Outsiders: Études de sociologie de la déviance. Paris : Éditions Métailié. https://doi.org/10.3917/meta.becke.1985.01
- Beyer, Peter et Lori G. Beaman. 2019. « Dimensions of Diversity: Toward a More Complex Conceptualization. » Religions 10 (10): 559. https://doi.org/10.3390/rel10100559
- Brin, Colette, Frédérick Durand, Julie Gramaccia et Jennyfer Thiboutot. 2021. « Portrait d’une infodémie – Retour sur la première vague de la COVID‑19.pdf. » Rapport de recherche. Centre d’études sur les médias.
- Bronner, Gérald. 2013. La démocratie des crédules. Paris : PUF.
- Cardon, Dominique. 2010. La Démocratie internet. Promesses et limites. Paris : Seuil.
- Cohen, Stanley. 2002. Folks Devils and Moral Panics. The Creation of the Mods and Rockers. London and New York: Routledge.
- Danblon, Emannuelle et Loïc Nicolas (dir.). 2010. Les Rhétoriques de la conspiration. Paris : CNRS Éditions.
- Dieguez, Sébastien et Sylvain Delouvée. 2021. Le complotisme: Cognition, culture, société. Paris : Mardaga.
- Dieguez, Sébastien, & Pascal Wagner-Egger. 2020. Réflexions sur la forme de la Terre. Actes du colloque "L'irrationalité contemporaine", Paris, 21 novembre.
- Ducol, Benjamin. 2015. Devenir jihadiste à l’ère numérique. Une approche processuelle et situationnelle de l’engagement jihadiste au regard du Web, Thèse de doctorat. Québec : Université Laval.
- Dyrendal, Asbjørn, Asprem, Egil et David G. Robertson (dir.). 2018. Handbook of Conspiracy Theory and Contemporary Religion. Leyde : Brill.
- Fabre, M. 2019. Éducation et (post) vérité: L'épreuve des faits. Paris : Hermann.
- Généreux, Mélissa. et al. 2020. “One Virus, Four Continents, Eight Countries: an Interdisciplinary and International Study on the Psychosocial Impacts of the COVID-19 Pandemic among Adults”, International Journal of Environmental Research and Public Health, Special Issue Disaster Mental Health Risk Reduction 17 (8390): 271–296.
- Giddens, Anthony. 1990. Les conséquences de la modernité. Paris : L'Harmattan.
- Giry, Julien. 2017. « Le “complotisme 2.0”, une étude de cas de vidéo recombinante : Alain
- Soral sauve Glenn et Tara dans The Walking Dead » Quaderni 94 (3): 41–52. https://doi.org/10.4000/quaderni.1112
- Harambam, J. 2020. Contemporary Conspiracy Culture: Truth and Knowledge in an Era of Epistemic Instability. New York: Routledge.
- Hasni, Abdelkrim. 2022. « Introduction. Les faits pour la construction des réalités naturelle, humaine et sociale : quel rôle pour l’école ? ». Dans L’usage des faits dans la construction de la réalité sociale et naturelle à l’école. Enjeux scientifiques et socioéducatifs. Sous la direction de A. Hasni et J. Labeaume, Éditions cursus universitaire. 10-25.
- Kaufmann, Laurence, Terzi, Cédric & Fabienne Malbois. 2021. Dégradation mimétique et crise narrative : l’expérience publique à l’épreuve des récits (anti)complotistes Sociologie et sociétés 53 (1-2) : 207–234. https://doi.org/10.7202/1097749ar
- Lecointre, Guillaume. 2018. Savoirs, opinions, croyances. Une réponse laïque et didactique aux contestations de la science en classe. Paris : Belin Éducation.
- Melley, Timothy. 2000. Empire of Conspiracy. The Culture of Paranoia in Postwar America. Cornell University Press.
- Morin, Edgar. 1969. La rumeur d’Orléans. Paris : Seuil.
- Péloquin, Tristan. 2020. « Une personne sur cinq adhère à des thèses complotistes », La Presse, 24 octobre, https://www.lapresse.ca/actualites/covid-19/2020-10-24/sondage-crop/une-personne-sur-cinq-adhere-a-des-theses-complotistes.php
- Portier, Philippe. et Jean-Paul Willaime. 2021. La religion dans la France contemporaine : entre sécularisation et recomposition. Paris : Armand Colin, coll. « U Science politique ».
- Rouiller, Sybille. 2022. Théories du complot et adolescence : enjeux sociaux et didactiques. Analyse qualitative de discours d’élèves suisses romands et français. Thèse de doctorat. Lausanne : Université de Lausanne.
- Taguieff, Pierre-André. 2021. Les théories du complot. Humensis.
- Taguieff, Pierre-André. 2005. La foire aux illuminés. Ésotérisme, théorie du complot, extrémisme. Paris: Éditions Fayard.
- Taylor, Charles. 2007. A secular Age. Boston: Harvard University Press.
- Tremblay, Stéphanie. 2022. « La laïcité dans l’imaginaire des Québécois de culture catholique », Dans La laïcité québécoise au miroir de sa religiosité. Sous la direction de J.-F. Laniel et J-P. Perreault. Ste-Foy : Presses de l’Université Laval. 17-46.
- Tuuli, Lipiäinen., Kuusisto, Arniika. & Kallioniemi, Arto. 2023. « The fluidity of Finnish youths’ Personal worldviews » International Journal of Children's Spirituality 28 (3-4) : 159-175. 10.1080/1364436X.2023.2224938
- Thiessen, Joël et Sarah Wilkins-Laflamme. 2020. None of the Above: Nonreligious Identity in the US and Canada. New York : New York University Press.
- UNESCO. 2022. Ce qu’il faut savoir concernant l’éducation au développement durable. En ligne. https://www.unesco.org/fr/education-sustainable-development/need-know (consulté le 23 août 2023).
- Vertovec, Steven. 2007. « Super-diversity and its implications ». Ethnic and Racial Studies 30:6, 1024-1054, DOI: 10.1080/01419870701599465
- Yates, Jeff. 2020. « Covid-19: les théories du complot gagnent du terrain, selon un sondage », Radio Canada, 22 avril, https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1696346/covid-conspirations-sondage-jeunes-stress-quebec-canada-complot


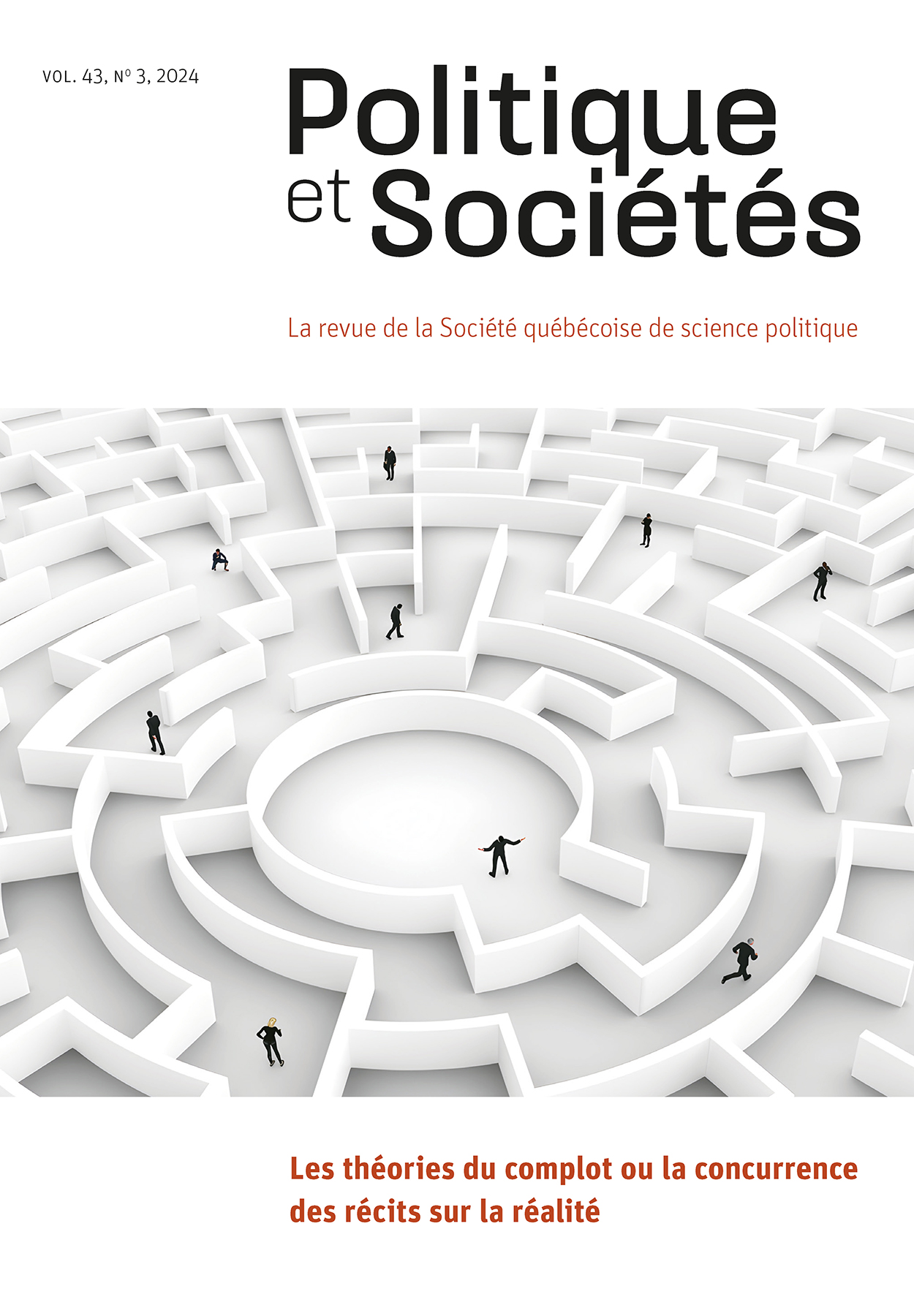
 10.7202/1097749ar
10.7202/1097749ar