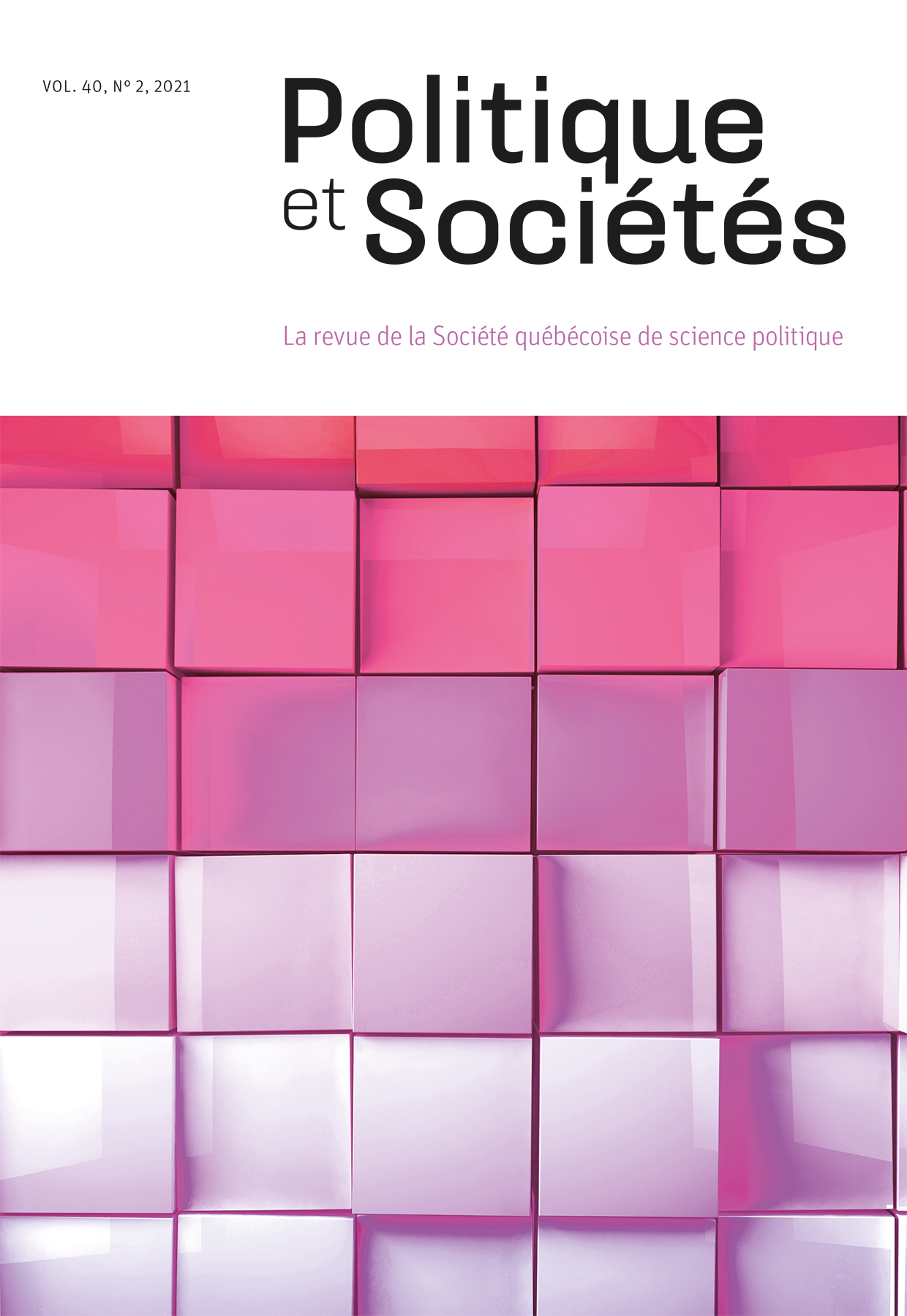À la suite du référendum de 1995 sur la souveraineté du Québec, le gouvernement fédéral a demandé à la Cour suprême du Canada (ci-après la Cour) si le Québec pouvait, en vertu du droit constitutionnel, déclarer son indépendance à la suite d’un référendum gagnant. En réponse, la Cour publie en 1998 le Renvoi sur la sécession du Québec (ci-après Renvoi) où elle identifie quatre principes indissociables sur lesquels repose l’ordre constitutionnel canadien, soit le fédéralisme, la démocratie, le constitutionnalisme et la primauté du droit, et la protection des minorités. Rédigé afin de souligner le vingtième anniversaire du Renvoi, cet ouvrage propose de « discuter et de débattre de la manière dont les quatre « prémisses inexprimées » de l’ordre constitutionnel peuvent contribuer – ou même nuire – à l’établissement de modalités équitables pour l’aménagement de la diversité au Canada » (p. 5). Pour y arriver, les directeurs ont structuré l’ouvrage en quatre parties où chaque principe identifié par la Cour est analysé. La première partie de l’ouvrage étudie le concept de fédéralisme tel que défini dans le Renvoi. En principe, le fédéralisme est un système d’organisation politique décentralisé conçu pour permettre à plusieurs minorités présentes sur un territoire donné de participer à la vie démocratique. À l’inverse, la définition du fédéralisme proposée par le Renvoi tend plutôt à favoriser une centralisation des décisions à Ottawa. Selon les auteurs, cette posture d’Ottawa explique le braquage politique du Québec et des Premières Nations, qui rejettent cette manière de fonctionner. Comme le souligne Alain G. Gagnon, une fédération devrait être construite sur des bases inverses, c’est-à-dire être décentralisée et diverse avec des trajectoires culturelles variées (p. 29). Dans son analyse sur les langues autochtones, Catherine Viens ajoute que ce braquage politique est encore plus important chez les Premières Nations. Alors que le gouvernement fédéral s’inscrit dans une logique de réconciliation, les Premières Nations sont plutôt dans une dynamique de résurgence nationale, c’est-à-dire qu’elles adoptent et réaffirment leurs cultures traditionnelles et se réapproprient leurs langues dans une perspective de lutte contre le gouvernement fédéral (p. 93). Lorsque des différends surgissent ainsi au sein de la fédération, il est de la responsabilité des juges de la Cour de mener les arbitrages nécessaires. Selon Eugénie Brouillet, les décisions de la Cour sont souvent fondées sur un préjugé favorable à la vision centralisatrice d’Ottawa (p. 56-58). La reproduction de cette vision d’un fédéralisme centralisateur se trouve en quelque sorte assurée par la Cour, rendant ainsi très difficile d’incorporer et de « constitutionnaliser » une place adéquate pour les minorités dans le fédéralisme canadien. Les trois chapitres qui abordent le principe de démocratie sont unanimes : la définition de la démocratie présentée dans le Renvoi est réductrice. La Cour réduit le principe à l’action de voter lors des élections, rejetant ainsi toutes les autres manifestations de la démocratie. Cette définition occulte les difficultés systémiques vécues par les groupes minoritaires au sein de la fédération, qui les empêchent d’exprimer leurs préoccupations. Par exemple, les Premières Nations ne sont pas autorisées à s’exprimer sur d’éventuels amendements constitutionnels puisque uniquement les membres des assemblées législatives dûment élus peuvent approuver la ratification d’une nouvelle constitution. Enfin, les auteurs rappellent que la Constitution canadienne de 1867 n’a pas été adoptée de manière démocratique. Il y a donc une contradiction importante entre, d’une part, la promotion d’une démocratie restrictive de la part de la Cour et, d’autre part, la promotion qu’elle fait du respect de l’ordre constitutionnel, alors que les principes de cette Constitution n’ont pas été adoptés de manière démocratique. La troisième partie étudie un aspect précis de l’ordre constitutionnel …
Ré-imaginer le Canada : vers un État multinational ?, de Félix Mathieu et Dave Guénette (dir.), Québec, Presses de l’Université Laval, 2019, 417 p.[Record]
…more information
Christian Jaouich
Ministère du Conseil exécutif
christian.jaouich.1@gmail.com