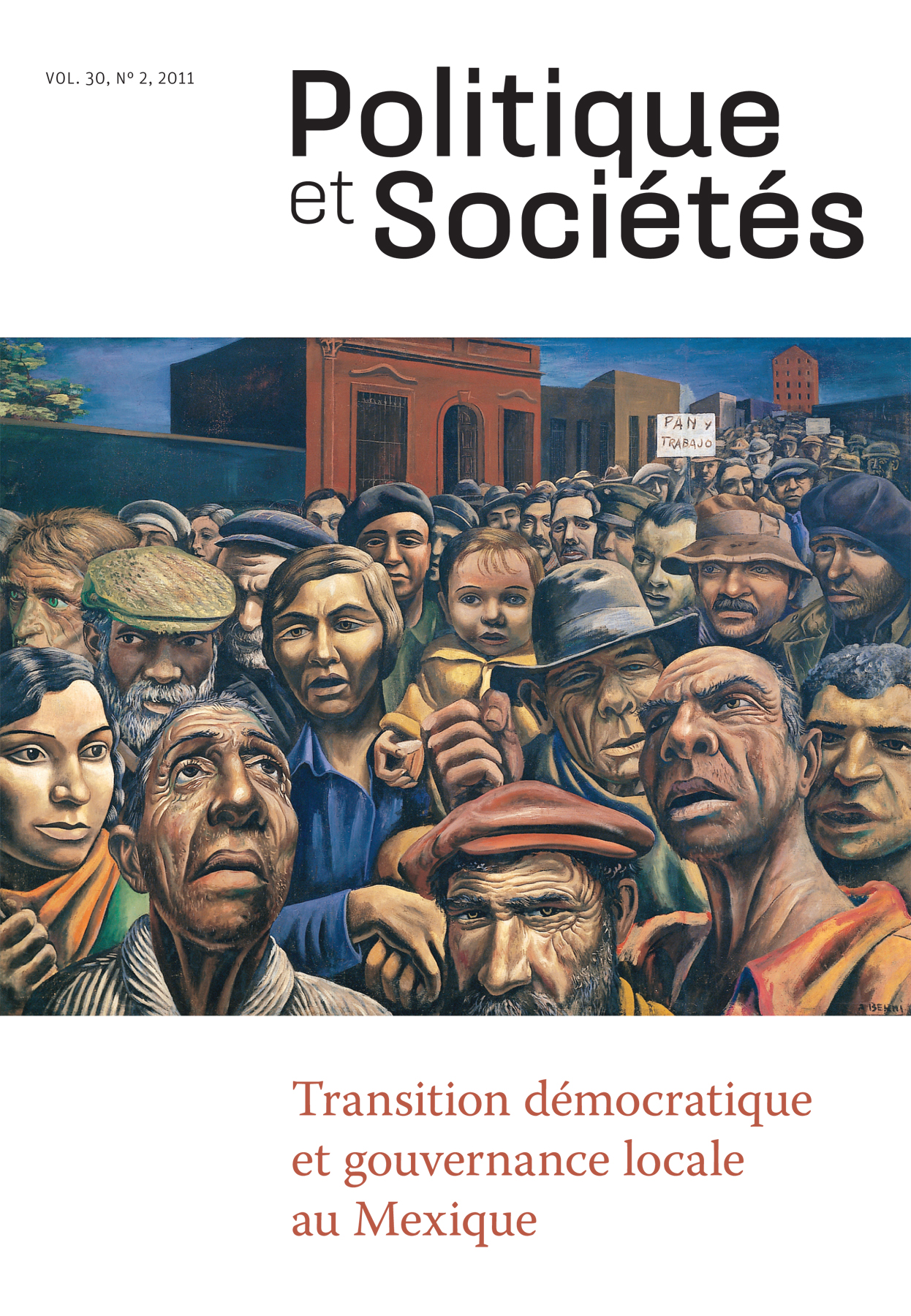Article body
La thèse centrale de cet ouvrage pose le libéralisme comme objet philosophique. Il s’agit d’un projet qui ne va pas de soi selon Blaise Bachofen qui, dans l’introduction, note que c’est d’abord dans un contexte politique et polémique que le terme voit le jour au sein des parlements européens. L’ouvrage s’articule autour d’une construction conceptuelle établissant un parallèle entre libéralisme et normativité juridique. Le libéralisme est ainsi décliné en trois dimensions (p. 16) : celle de l’État, comme producteur « de normes collectives et contraignantes », celle de la personne, comme « objet d’investigation », et celle de la propriété, qui représente une jonction entre les deux autres dimensions quant à ce qui est propre à la personne et quant à la jouissance de la « liberté dans l’État ». Les trois dimensions constituent la toile de fond qui relie les textes de l’ouvrage de façon transversale, constituant un cadre d’analyse dynamique ponctué par les questions pratiques auxquelles les penseurs libéraux ont tenté de répondre au cours de l’histoire ainsi que des débats entourant leurs propositions de réponses. Le libéralisme se serait donc « construit sur un mode stratégique et dialectique plutôt que sur un mode académique et didactique » (p. 14).
Les réflexions sur l’oeuvre de John Locke, figure paradigmatique du libéralisme, donnent le ton aux premiers textes de l’ouvrage. Michaël Biziou présente le libéralisme de Locke comme une « politique du jugement » qui met en perspective la confrontation de la personne à « l’exercice individuel et l’exercice en commun du jugement », notamment en ce qui concerne le droit de résistance (p. 31). S’y affiche le pragmatisme de Locke qui, tout en s’inscrivant dans l’optique de la raison et de la science, de portée universaliste, reconnaît que, face aux situations concrètes, le recours au jugement est nécessaire, ce dernier n’offrant toutefois que des probabilités et non des certitudes.
Le pragmatisme de Locke semble toutefois bien modéré face à l’utilitarisme de David Hume. Dans son texte, Claude Gautier reprend la question du droit de résistance chez Locke en la mettant en perspective avec la position de Hume. Tous les deux partagent l’idée de la constitution de l’État comme étant une construction artificielle, mais le processus y conduisant ne serait pas le même. Locke en fait l’objet d’une décision rationnelle, celle par laquelle les individus mandatent leurs représentants, se réservant la possibilité de résister à leur autorité dans le cas où son exercice ne serait pas justifié. Le droit de résistance au pouvoir est conçu comme exercice de la volonté individuelle. Quant à Hume, il voit plutôt le lien qui unit individu et gouvernement comme relevant de l’habitude. L’exercice de l’autorité serait utile au vivre ensemble, permettant une sorte de régulation des passions et des affects. Le principe directeur étant celui de l’utilité, la résistance au pouvoir se produirait lorsque les individus estiment que « l’intérêt immédiat à entrer en rébellion est plus fort […] que l’intérêt général à obéir » (p. 72-73).
La relation entre Locke et Hume est aussi abordée dans le texte d’Éléonore Le Jallé à propos de la propriété. La lecture qu’elle propose de la critique de Hume à l’égard de Locke indique un tournant par rapport à l’objet initial de l’ouvrage. D’autres textes viennent renforcer cette perception. Le libéralisme philosophique apparaît comme un axe autour duquel s’articule une réflexion plus large qui intègre d’autres courants constituant la pensée philosophico-politique moderne. La conception lockéenne de la propriété fait référence à une « prescription de la loi de nature selon laquelle chacun est tenu (et donc a le droit) de se préserver » (p. 79). Il en découle que ce qui sert à la préservation de l’individu, entre autres les fruits de son travail, peut être approprié de façon privative. Cette position, typiquement libérale, est remise en question par Hume qui voit dans la propriété une forme de relation morale, non pas d’origine naturelle. Pour ce dernier, la propriété est basée sur des conventions ou des règles artificielles : la stabilité de la possession, le transfert de propriété et l’obligation des promesses (p. 85-86). Comme le note Le Jallé, « la distance avec Locke est sur ce point patente » (p. 86).
La contribution de Céline Spector présente un baron de Montesquieu dont le propos sur la propriété ne correspond pas non plus aux canons du libéralisme. En proposant une théorie politique de la propriété qu’il ancre dans les rapports économiques et sociaux, cette dernière affirme que l’oeuvre de Montesquieu « échappe à la critique qui peut être adressée à la conception universaliste et anhistorique de l’individu ‘libéral’ » (p. 116). Montesquieu et Hume ne seraient d’ailleurs pas les seuls en marge de l’individualisme libéral quant à la question de la propriété. Emmanuelle de Champs situe Jeremy Bentham dans le sillage de Hume puisqu’il partage son refus de reconnaître le fondement naturel de la propriété. Chez Bentham, la défense de la propriété privée est justifiée par son utilité et sa contribution au bonheur des individus, ces éléments étant à caractère variable. Pour l’auteure, Bentham serait ainsi « à la marge de la tradition libérale » (p. 143).
Au dix-neuvième siècle, un certain nombre d’auteurs contribuent à l’ouverture d’un nouveau chapitre dans la pensée politique moderne, celui de la critique du libéralisme. Selon Frédéric Brahami, « en critiquant l’individualisme révolutionnaire, la pensée contre-révolutionnaire atteint aussi le libéralisme » (p. 146). Il note une distinction importante entre les libéraux et les contre-révolutionnaires par rapport au pouvoir de l’État. Si les libéraux le considèrent davantage comme un mal nécessaire qu’il faut limiter, les contre-révolutionnaires le voient plutôt comme étant immanent à la société (p. 155). C’est cependant au prix d’un certain détour que l’auteur du texte peut soutenir ce point de vue établissant une adéquation entre libéralisme, individualisme, raison et révolution, ce qui peut représenter une extension quelque peu abusive du libéralisme.
Les écrits de Benjamin Constant sur la religion se situent dans le contexte postrévolutionnaire en Europe, en offrant un modèle spirituel face à une certaine élite philosophique qui prône une religion d’État ou encore l’athéisme. Pour Blaise Bachofen, sa théorie de la religion viserait à naturaliser la liberté des modernes par « une tentative d’enraciner dans une empiricité anhistorique, dans une ‘nature humaine’, une décision axiologique » (p. 173). L’entreprise de Constant serait en lien avec le libéralisme parce que sa proposition, visant l’exercice du droit de religion dans la vie privée, équivaudrait à une conquête du droit de l’individu face à l’État marquant la distinction entre le privé et le public.
Au dix-neuvième siècle, la notion d’individualisme s’inscrit dans une mouvance réflexive, voire critique du libéralisme. Selon Florent Guénard, Alexis de Tocqueville serait « le premier à en faire une théorie explicite » (p. 189). On retient surtout de Tocqueville ses mises en garde contre la montée de l’individualisme dans les sociétés de son époque, signe avant-coureur d’un repli de l’individu sur sa vie privée, laissant l’État tutélaire animer la vie démocratique. Pour Guénard, cette lecture serait réductrice de l’oeuvre qui montre « une conception originale de la sociabilité » (p. 191) caractérisée par les « liens d’entraide et de solidarité » (p. 206). C’est son étude de la démocratie en Amérique qui aurait conduit de Tocqueville à développer cet aspect de l’individualisme et à en montrer deux potentialités : le repli sur soi ou l’ouverture aux autres.
Avec le développement de la social-démocratie et du marxisme, le libéralisme se verra mis en retrait. Ce n’est qu’à la fin du vingtième siècle qu’on découvre des auteurs qui, comme Friedrich Hayek, en ont perpétué dans l’ombre la tradition philosophique, sans toutefois la bouleverser. À ce sujet, Vincent Valentin affirme que c’est plutôt l’anarcho-capitalisme qui se présente comme « la vérité du libéralisme » (p. 210) parce qu’en radicalisant son expression, il en exprime « la spécificité face aux interprétations alternatives » (p. 211), c’est-à-dire « la liberté individuelle […] et l’autorégulation par la société civile » (p. 228). Cela revient à dire que les libéraux présents dans le champ politique le seraient au prix du sacrifice de leurs véritables idéaux. Le texte de Valentin, qui sert de conclusion à l’ouvrage, est intéressant car il nous permet de revenir à l’origine du questionnement concernant le libéralisme comme objet philosophique et comme idéalité centrés sur l’individu. En effet, un certain nombre de textes semblent souvent s’éloigner du libéralisme. Peut-on encore parler de libéralisme au sens strict chez les contre-révolutionnaires par exemple ? Valentin nous met justement en garde de ne pas confondre les termes au sujet du libéralisme et de la démocratie. Nous pourrions ajouter qu’il ne faut pas confondre le terme avec celui de modernité non plus. C’est parfois l’impression que laisse l’ouvrage, par ailleurs très captivant. En tentant de cibler le libéralisme comme objet philosophique, on en fait un axe central des débats marquant la philosophie politique moderne, comme si les autres courants n’arrivaient pas à se définir sans lui.