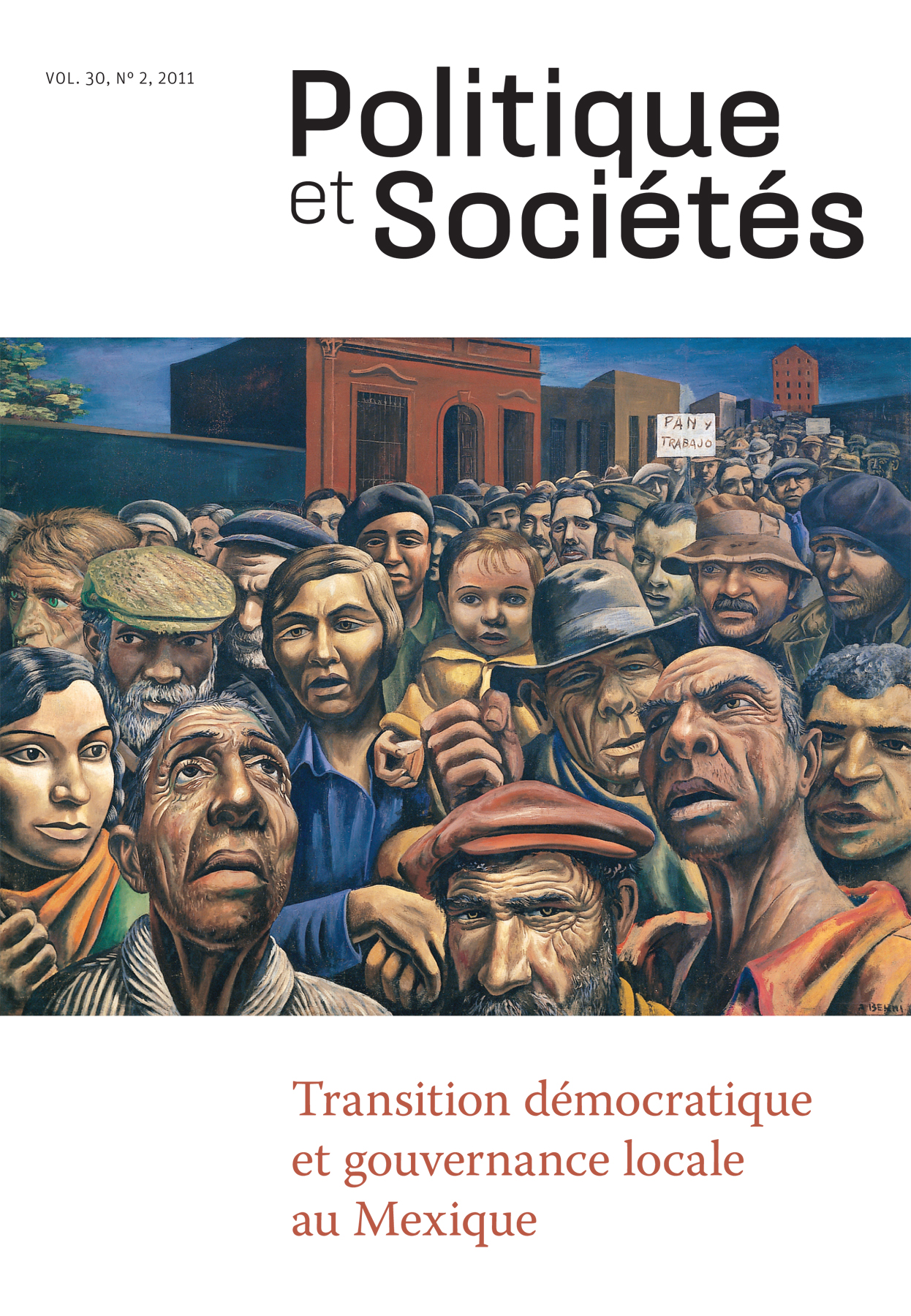Abstracts
Résumé
Loin de constituer une entité monolithique, l’Église catholique a engendré au Mexique, comme ailleurs, une diversité de courants de pensée, contradictoires entre eux, voire en conflit avec l’institution. Parmi eux, la théologie de la libération et la théologie indigène ont participé à la formation de mouvements sociaux et de secteurs nationaux de la société civile. L’impact de la théologie indigène dans le diocèse de San Cristóbal de las Casas, au Chiapas, n’en est qu’une illustration. Ces activismes, auxquels a contribué la religion, sont actuellement considérés à l’avant-garde du combat pour la démocratie et les droits de l’homme. Or, ils sont le produit du croisement de deux cultures politiques a priori distantes des principes de la démocratie représentative : l’antilibéralisme catholique, foncièrement antimoderne, et la gauche révolutionnaire, d’inspiration marxiste. Ce texte se propose d’abord de reconstruire la généalogie paradoxale de ces « activistes » de la démocratie. Il analysera ensuite leur passage progressif vers l’idéal démocratique et ses effets sociopolitiques. Il montrera, en ce sens, les ambivalences de leur adhésion aux principes démocratiques, ainsi que leur implication dans le contexte actuel de démocratisation au Mexique.
Abstract
Far from being a monolithic entity, the Catholic Church, in Mexico, as elsewhere, has given rise to numerous schools of thought, often mutually contradictory, sometimes even in conflict with the institution. Among these, liberation theology and indigenous theology have participated in the formation of social movements and national tracts of civil society. The impact of indigenous theology in the diocese of San Cristóbal de las Casas, Chiapas, is but an example of this. These activisms, to which religion has contributed, are currently considered to be at the forefront of the struggle for democracy and human rights. Yet, they result from combining two political cultures a priori quite distant from the principles of representative democracy: Catholic anti-liberalism, anti-modern by nature, and Marxist-inspired revolutionary leftism. This article seeks first to reconstruct these democratic activists’ paradoxical genealogy. It then analyzes their progressive turn towards democratic ideals and the ensuing socio-political consequences. The argument will thus show these movements’ ambivalent commitment to democratic principles, as well as their implications for Mexico’s current democratization process.
Article body
L’incompatibilité entre la religion et la modernité est une idée largement remise en cause par la sociologie des religions. Max Weber (2003) avait déjà démontré la filiation entre la Réforme protestante et le capitalisme. Dans ses travaux sur le « retour du religieux », Danièle Hervieu-Léger (1999, 2001) a analysé les recompositions religieuses de l’actualité comme un effet de la sécularisation, plus que comme une rupture avec elle. Ce « retour » remet en cause les visions normatives de la religion et de la modernité, en même temps que la fatalité de leur contradiction. En effet, l’incompatibilité est d’autant plus questionnable que les modèles linéaires de progrès, qui l’avaient justifiée, ont été fortement critiqués : en Europe déjà, mais à plus forte raison dans les pays dits « périphériques », notamment latino-américains, comme le Mexique. Les travaux de Michael Löwy (1998)[1] à propos de la théologie de la libération (TL) en Amérique latine, bien que questionnables, et ceux de Gilles Kepel (2004), dans un contexte musulman et donc non chrétien, accentuent le problème en ce sens.
En revanche, l’Église catholique a été souvent perçue comme fatalement enfermée dans le camp de la tradition contre celui du progrès. Or, les exemples d’adhésion catholique à des aspects de la modernité se sont multipliés. Il faut d’abord tenir compte du fait que l’Église catholique n’est pas une religion monolithique. Ses tendances internes sont multiples. Par ailleurs, dès le dix-neuvième siècle, il y a eu une évolution significative depuis le Syllabus de 1864, sous Pie IX, et son rejet symétrique de la modernité et l’encyclique Rerum Novarum de 1891, sous Léon XIII, qui proclamait l’adhésion du catholicisme aux valeurs de progrès et de liberté. Au vingtième siècle, le concile Vatican II ne fit qu’accentuer ce mouvement. Même si l’on considère les deux derniers pontificats plus « réactifs » à la modernité que ceux qui ont précédé, ils ont conservé des éléments de cette rénovation, dont les véritables motivations étaient elles-mêmes ambiguës.
Il ne faut en effet pas se laisser piéger par les apparences du glissement de la pensée catholique vers la modernité. L’adaptation aux valeurs de progrès et de liberté n’a jamais éliminé la défiance face à cette modernité. Les travaux d’Émile Poulat (1977) sur le catholicisme contemporain ont montré comment celui-ci s’est rapproché de la modernité pour mieux la combattre[2]. Dans cette optique, le sociologue français a refusé la division entendue entre deux types de catholicisme – de progrès et de tradition – et en a objectivé une autre : entre un catholicisme de conciliation et un catholicisme d’opposition à la modernité. Or, cet auteur s’est lui-même divisé entre la posture défensive de l’« intégrisme », qui s’opposait symétriquement à la modernité, et celle, offensive, de l’« intégralisme », qui faisait le choix de l’adaptation critique. L’« intégralisme » s’est, à son tour, fragmenté en courants et contre-courants successifs qui ont établi des rapports concurrents à la modernité. Malgré leurs différences d’appréciation et la violence des conflits qu’ils ont provoqués dans l’institution, ils sont, pour la plupart, restés dans les limites idéologiques du modèle social du catholicisme d’opposition qui a refusé un monde autonome de la religion, même quand il a pris les apparences de la conversion aux idéaux démocratiques et révolutionnaires de la modernité. En synthèse, si le catholicisme n’est pas resté ancré dans le camp de la tradition, cela ne signifie pas pour autant que ses courants de rénovation aient dépassé la contradiction entre ses origines antimodernes et la modernité, dont certains de ses courants se sont rapprochés, tout en projetant leurs propres motivations idéologiques sur sa critique.
De ce point de vue, on peut aussi se poser la question du rapport entre la religion et la démocratie[3]. A priori, dans un contexte démocratique et laïc, la religion est maintenue à distance de la sphère publique, comme cela a été notamment le cas au Mexique, durant le régime issu de la révolution mexicaine, après 1920, certes peu démocratique mais bien laïc. Pourtant, la religion, comme phénomène social, a forcément des effets politiques, directs ou indirects, ceux-ci étant de fait souvent directs en Amérique latine. Or, ils peuvent favoriser ou défavoriser la consolidation démocratique, notamment par le biais des pactes établis entre acteurs religieux, sociaux et politiques. Au Mexique, le principal acteur religieux est l’Église catholique[4]. Sa prédominance dans le champ religieux national constitue un fait historique qu’il n’est même pas nécessaire d’argumenter ; même si, aujourd’hui, le catholicisme se trouve, au Mexique comme ailleurs, aux prises avec des concurrences religieuses nouvelles. Le catholicisme mexicain a aussi été traversé, comme dans le reste de l’Amérique latine, par des divisions internes virulentes. En ce sens, nous nous intéresserons plus particulièrement au rapport entre un courant de l’Église catholique, lié aux idées de la théologie de la libération (TL), et la démocratisation du système politique mexicain progressivement opérée lors des trois dernières décennies.
A priori, l’Église catholique ne s’inscrit pas dans une tradition démocratique. Historiquement, son projet de Contre-Réforme puis son opposition au libéralisme l’ont mise en porte-à-faux avec les idéaux démocratiques. Pourtant, des courants de l’Église catholique ont adhéré aux principes de la démocratie représentative. De fait, aujourd’hui, les documents officiels du Vatican s’affirment régulièrement en accord avec eux. L’une des principales expressions de la « conversion » du catholicisme contemporain à la démocratie a été la démocratie chrétienne (DC). Au Mexique, le Parti action nationale (PAN) s’est notamment situé dans cette mouvance. Sa création, en 1939, a été le produit de la confluence de différents courants idéologiques. Parmi eux on trouve une filiation synarquiste, originellement située à l’antipode des idéaux démocratiques. Or, le PAN est devenu l’un des principaux acteurs de la démocratisation mexicaine[5]. Néanmoins, il faut de nouveau faire attention : les partis démocrates chrétiens défendent une démocratie, oui, mais chrétienne. Comme l’a montré Émile Poulat (1977 : 139), ou encore Olivier Compagnon (2003) pour l’Amérique du Sud, ils ne rendent pas complètement les armes d’une voie proprement chrétienne de société, en concurrence avec le libéralisme.
À partir de la fin des années 1960, la TL a constitué l’une des tendances de la rénovation du catholicisme contemporain dans la trajectoire du Concile Vatican II[6]. Au contraire de la DC, elle ne s’est pas convertie aux idéaux modernes de la démocratie, sinon à ceux de la voie révolutionnaire vers le socialisme. Elle a aussi maintenu une position critique face à la modernité, à cause des contradictions des projets de modernisation en Amérique latine, mais aussi de sa genèse dans le catholicisme d’opposition à la modernité. Même si elle a incarné une mutation de ce catholicisme, elle en a projeté les éléments sur la notion d’une modernité proprement latino-américaine de rupture avec les modèles exogènes, construite dans le discours révolutionnaire. Bref, elle a combiné une double généalogie antidémocratique : l’antilibéralisme catholique et la gauche révolutionnaire d’inspiration marxiste. La TL s’est inscrite dans la trajectoire de réseaux intellectuels, religieux et militants spécifiques, liés à l’univers social du catholicisme, tout en participant de dynamiques sociopolitiques plus amples dans le contexte de l’Amérique latine des années 1960, 1970 et 1980. Elle y a eu ses propres effets de mobilisation sociale, certes soumis aux intérêts idéologiques et sociaux de son univers religieux et intellectuel, dont elle ne s’est jamais autonomisée, ou seulement partiellement. Même les expressions plus autonomes, inspirées par elle, en ont gardé des héritages.
Or, face au reflux des espoirs révolutionnaires qui avaient motivé l’émergence de ce courant de pensée, la TL a aussi contribué à la formation de mouvements sociaux et de secteurs de la société civile qui ont participé aux luttes pour les droits de l’homme et les démocratisations dans la région, en particulier au Mexique. Ceux-ci ont défendu une conception amplifiée de la démocratie face aux modèles de la démocratie représentative. Cette conception a relevé, à la fois, de la conservation d’une défiance face aux idéaux démocratiques et de la tentative d’associer les objectifs de la liberté politique à ceux du changement social. Ses effets sont encore aujourd’hui indéniables dans le contexte national, tant sur le plan de la continuité de la lutte pour les droits de l’homme que par son impact dans des mouvements sociaux spécifiques, parmi lesquels le zapatisme est le plus médiatisé. Afin d’en explorer les ambivalences, ce texte propose de reconstruire la généalogie antidémocratique de la TL, puis d’analyser son glissement vers la lutte pour la démocratie ainsi que ses contradictions internes, sur le plan tant des idées que de ses dynamiques sociales, dans le contexte mexicain.
Une généalogie antidémocratique
On a beaucoup plus parlé de la TL en Amérique du Sud, surtout au Brésil et en Amérique centrale, qu’au Mexique. Cela ne veut pas dire que la TL n’a pas eu de relais et d’impact dans le pays. Dès la fin des années 1960, des secteurs minoritaires de l’Église catholique mexicaine se sont identifiés avec le discours de la TL et ont prétendu mettre en pratique les enseignements de la Conférence épiscopale latino-américaine de Medellín de 1968 dans le pays (CELAM, 1971).
En 1969, deux réunions marquèrent l’irruption de la TL au sein des discussions du catholicisme mexicain. La première, programmée en août afin de célébrer le premier anniversaire de la Conférence, fut une assemblée épiscopale qui avait pour mission d’étudier ses conclusions et leur application dans le contexte mexicain. L’organisation en revint à la Commission de pastorale sociale de la Conférence épiscopale mexicaine (CEM), qui la délégua à un secrétariat exécutif. Ce dernier intégrait notamment des représentants du Secrétariat social mexicain (SSM), chargé des oeuvres sociales de la CEM depuis 1929. Les évêques mexicains, présents à Medellín, en étaient déjà revenus profondément divisés. Durant les débats de l’assemblée, une majorité d’évêques se considéra prise en otage par les conseillers qui avaient préparé ces débats et se retira (Reflexión Episcopal Pastoral, 1969). En 1973, le SSM devint une association civile indépendante de l’Église catholique. Du 24 au 28 novembre, une rencontre théologique accentua ces divisions. Elle fut organisée par la Sociedad Teológica Mexicana (Société de théologie mexicaine – STM, 1970) et convoquée sous le titre « Théologie, foi et développement ». Or, durant la rencontre, les débats basculèrent vers le thème de la libération. Parmi ses organisateurs, se trouvaient l’évêque Francisco Aguilera et le théologien jésuite Luís del Valle, qui coordonnaient ensemble le Conseil de pastorale de l’archevêché de Mexico. Ses participants étaient principalement des catholiques mexicains, mais certains intervenants étaient venus d’Amérique latine, d’Europe et des États-Unis.
Déjà avant, le Centro Intercultural de Documentación (CIDOC) avait joué un rôle de pionnier au sein des réseaux du tiers-mondisme catholique, depuis le Mexique. L’organisme fut créé en 1961, dans le diocèse de Cuernavaca, sous l’impulsion du prêtre autrichien Ivan Illich et avec le soutien conjoint de l’évêque du diocèse, Sergio Méndez Arceo, et du pourtant considéré « conservateur » Cardinal Spellman de New York (dont Illich avait été secrétaire). Le CIDOC était chargé de la préparation des missionnaires qui arrivaient d’ailleurs en Amérique latine. Il était, en même temps, un espace de formation d’agents pastoraux et un important centre intellectuel, qui tentait l’intégration de la pensée théologique et des sciences sociales (avec les implications respectives). Cela le situait à la fois sur le terrain local de l’action collective, pour lequel ces agents étaient préparés, et au coeur de réseaux théologiques et intellectuels dans l’espace international. Dans l’optique de la TL, il faut relever que c’est Illich qui prit l’initiative de la réunion théologique de mars 1964, à Petrópolis, au Brésil. Elle constitua le premier pas vers la construction d’une pensée théologique proprement latino-américaine. Dès 1967, c’est-à-dire à l’aube de l’apparition de l’expression « théologie de la libération », le Vatican organisa une commission d’enquête sur les activités du CIDOC. Les conclusions de la commission sur les orientations « marxistes » du Centre aboutirent à l’interdiction, pour Illich, de prendre la parole publiquement, ce qui l’amena à abandonner la prêtrise.
On observe donc la position des réunions mentionnées et du CIDOC au carrefour de la théorie et de la pratique (ou de la théologie et de la pastorale), du « centre » de l’institution catholique et de sa périphérie, et de dynamiques transcontinentales, latino-américaines, nationales et locales. Le passage du combat du tiers-mondisme catholique pour le développement à l’engagement révolutionnaire pour la libération répondait d’abord au contexte latino-américain, lui-même surdéterminé par les effets de bipolarisation du contexte mondial de la guerre froide. Les exemples de chrétiens engagés dans les gauches marxistes de la région s’y multipliaient. Au début des années 1970, le cas chilien des chrétiens pour le socialisme, sous l’Unité populaire de Salvador Allende, eut notamment un retentissement régional, voire mondial[7]. Les réseaux du tiers-mondisme catholique s’étaient d’abord solidarisés avec le discours intégrateur du développement et ses troisièmes voies : national-populistes, surtout, et démocrates-chrétiennes, notamment au Chili. Leurs centres de réflexion théologique et d’action pastorale se situaient dans cette optique, dont l’expression achevée fut l’encyclique Populorum Progressio sur le développement des peuples[8]. Publiée par Paul VI, en 1967, elle fut inspirée par l’un des animateurs de ces réseaux : le fondateur du mouvement Économie et Humanisme et dominicain français, Louis Lebret[9]. On y défendait un nouvel ordre mondial, qui engageait la complémentarité de la paix et de la justice. En même temps, cette orientation réformiste était associée à un humanisme « communautaire » et « intégral », lié à la notion de « personne », qui s’opposait à l’individualisme et au matérialisme de l’humanisme « exclusif » des sociétés modernes. Le document se mettait à l’écoute des « signes du temps », comme y avait invité le concile Vatican II, et se rapprochait du monde, mais ce rapprochement était aussi teinté d’un esprit de reconquête religieuse, projetée sur les combats du tiers-monde contre les modèles imposés des sociétés développées.
Dans le contexte latino-américain de radicalisation révolutionnaire, notamment inspirée par la révolution cubaine, et sous l’influence de la théorie de la dépendance, des agents de ces réseaux proclamèrent, ensuite, la nécessité d’une « rupture structurelle » avec la domination interne et externe de l’Amérique latine, dont l’aboutissement était le socialisme (même s’il faut tenir compte des variations internes). Cela divisa le tiers-mondisme catholique et conduisit à des ruptures internes, qui coïncidèrent avec l’apparition des premiers ouvrages de la TL, dont l’expression s’imposa au tournant de l’année 1968, avant d’être systématisée dans ses textes fondateurs. Hugo Assmann (1971 : 40) écrivait, en référence à la théorie de la dépendance : « Nous avons pris conscience de ce que nous sommes historiquement : peuples pas seulement sous-développés, dans le sens de ‘pas encore suffisamment développés’, mais ‘peuples maintenus dans le sous-développement’, peuples dominés, ce qui est très différent[10]. » Il en déduisait, comme Gustavo Gutiérrez (1971 : 118), que l’option révolutionnaire la plus féconde pour la libération latino-américaine était le socialisme. Le virage n’impliquait pas seulement une nouvelle option politique, mais, plus fondamentalement encore, une nouvelle compréhension du rapport entre la foi et la politique. Les chrétiens s’engageaient pleinement dans les mouvements séculiers de la radicalisation révolutionnaire, contre l’idéologie antilibérale et anticommuniste de la troisième voie, c’est-à-dire d’une voie proprement chrétienne de société. En même temps, les premiers textes de la TL exigeaient l’implication directe de l’institution catholique dans l’action politique, contre le principe démocrate-chrétien de la séparation des deux plans (inspiré de Jacques Maritain), avec lequel – parmi les fondateurs de la nouvelle pensée théologique – Gutiérrez prit clairement ses distances (id. : 118). Sans non plus déboucher sur une fusion, ce rapport d’identité entre l’utopie politique du socialisme et l’utopie chrétienne du salut maintenait la perspective d’un idéal « intégral » de société, dont la foi ne serait pas exclue. Bref, sous le poids des dynamiques sociopolitiques de la région et des solidarités militantes développées, ces réseaux avaient glissé vers le socialisme révolutionnaire, sans y perdre de vue les enjeux et les intérêts liés à leur réflexion religieuse. On envisageait un changement social dans l’optique marxiste-léniniste de l’intégration des luttes anti-impérialiste et anticapitaliste, où la religion s’affirmait comme un facteur de conscientisation révolutionnaire des « pauvres » plutôt que comme l’opium du peuple[11].
Or, le Mexique se situait à la périphérie de ces dynamiques sud-américaines. D’une part, le pays n’était pas en proie aux convulsions sociopolitiques de l’Amérique du Sud qui, après l’échec des expériences national-populistes, connut une vague de guérillas et de dictatures militaires. Il y eut des mouvements de contestation dans le pays, voire des groupuscules armés. Le régime eut aussi recours à la répression. Toutefois, en comparaison avec le sud du continent, celle-ci demeura relativement mesurée et le régime ne fut jamais véritablement menacé. Il avait monopolisé l’héritage révolutionnaire et, à l’ombre de la révolution mexicaine, il désarticula efficacement son opposition, se permettant même le luxe d’être une base de repli des exilés et des guérillas de la région. D’autre part, la laïcité mexicaine, qui repose sur une stricte séparation de l’État et de l’Église catholique, assez atypique dans la région, empêchait une implication directe des agents de l’institution dans l’action politique.
Néanmoins, des avant-gardes du catholicisme mexicain adoptèrent le discours de la TL, notamment lors des deux réunions mentionnées. Cela se devait d’abord à leurs liens avec les réseaux transnationaux de la TL, ce qui permettait d’établir une influence exogène. Il y eut aussi des circonstances nationales et donc endogènes qui le justifièrent. Le mouvement de 1968, qui coïncida avec l’organisation de la Conférence épiscopale latino-américaine de Medellín, y contribua beaucoup. Au Mexique, la radicalisation révolutionnaire de secteurs du catholicisme national doit donc être recherchée dans les relais religieux et intellectuels des réseaux transnationaux de la TL et au sein de leurs convergences avec des mouvements sociaux. Elle n’était ni le simple reflet du changement social, puisqu’elle impliquait les visions et les intérêts spécifiques de ces réseaux, ni une pure réflexion intellectuelle, puisqu’elle déboucha sur une action collective qui eut des effets à long terme. Dans le cas spécifique de la TL, les déplacements opérés contre l’orthodoxie catholique vers le terrain pastoral et sociopolitique de l’action collective ne se concrétisèrent pas par une rupture avec le pouvoir religieux constitué[12]. Cela se refléta dans les propres ambivalences de ses effets sociaux qui contribuèrent à la formation de sujets populaires et de mouvements sociaux, notamment au sein des communautés ecclésiales de base, sans pour autant impliquer un rapport transparent d’identité entre le discours théologique de la libération et ses « sujets » supposés. L’évocation paradoxale de ces « sujets sociaux », inhérente à l’action collective, était renforcée par la distance sociologique entre la réalité des acteurs prédominants – cléricaux, de classe moyenne et transnationalisés – et les « bases locales » qui les légitimaient. Les intérêts politiques, religieux et intellectuels, qui s’y projetaient, ne servaient donc pas forcément les intérêts populaires. Il existait, en ce sens, des contradictions évidentes entre le discours très idéologisé de l’émancipation collective et les pratiques réelles, notamment sur le plan de l’« horizontalité démocratique » qu’on leur attribuait.
Au niveau des acteurs mexicains, il faut notamment prendre en compte les ordres religieux, comme les Jésuites, qui constituèrent des pôles de la radicalisation. En 1975, certains jésuites du Colegio Mayor de Cristo Rey de Mexico, dont Luís del Valle, fondèrent le Centro de Reflexión Teológica (CRT). Ils s’emparèrent de la prestigieuse revue de théologie, Christus, qui devint l’une des principales tribunes de la TL dans la région. Des organisations devenues indépendantes, comme le SSM, le CIDOC et le Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), défendaient les thèses de la TL. Le laïc fondateur du CENCOS, José Álvarez Icaza, avait été, avec son épouse, invité aux sessions du concile Vatican II, en 1964. Il fut l’un de ceux qui convainquirent l’évêque Sergio Méndez Arceo de participer à la rencontre latino-américaine de 1972 des chrétiens pour le socialisme. Méndez Arceo fut le seul évêque présent lors de cette rencontre.
Ces activistes avaient été exclus des organismes officiels de la CEM. Ils avaient par contre des soutiens minoritaires, mais de poids, au sein de l’Église catholique : dans les diocèses où un évêque leur était favorable, comme à Cuernavaca et à San Cristóbal de las Casas, et au sein du groupe d’évêques de la zone Pacifique-Sud, qui mettait l’accent sur la pastorale indigène. Dès 1960, quand Samuel Ruiz prit la tête du diocèse de San Cristóbal de las Casas, ce groupe d’évêques avait exigé la création du Centro Nacional de Ayuda para Misiones Indígenas (CENAMI – Centre national d’aide pour les missions indigènes), lequel demeura sous l’égide de la CEM jusqu’en 1989. Il est certes important de ne pas appréhender ces différentes expériences pastorales et le discours théologique qui les impliquait de façon homogène. La pastorale urbaine, en particulier à Cuernavaca et à Mexico, mettait l’accent sur les luttes ouvrières et la promotion sociale des quartiers populaires autour de la figure des « pauvres ». Au Chiapas, le discours et la pastorale se déplacèrent vers la problématique culturelle et territoriale des droits indigènes. Néanmoins, tout cela s’inscrivait dans un même ordre idéologique de discours et engageait les mêmes réseaux militants, intellectuels et religieux.
Parmi les évêques liés à ces réseaux, Samuel Ruiz, qui avait dirigé le Département des missions de la CELAM de 1969 à 1974, avait précisément pour politique de faire venir des missionnaires dans le diocèse de San Cristóbal de las Casas, avant de déplacer l’accent vers la formation des diacres indigènes. Diacres et missionnaires débordaient la structure traditionnelle du pouvoir ecclésial, à l’échelle locale et dans l’espace transnational, tout en la reproduisant et en lui demeurant subordonnés. Face à une minorité qui soutenait encore la doctrine sociale de l’Église, les missionnaires s’inscrivaient plutôt dans la perspective marxisante de la TL et des luttes sociales qu’ils déplacèrent progressivement vers la problématique indigène, tout en conservant les postulats essentiels de la TL[13]. Ceux-ci, notamment liés aux missions jésuite et dominicaine de Bachajón et d’Ocosingo qui se répartissaient véritablement le territoire diocésain, contribuèrent à la conscientisation des communautés indigènes, dont le soulèvement zapatiste fut un effet tardif. La relation entre le diocèse et l’Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN – Armée zapatiste de libération nationale) fut certes traversée de tensions pour l’appropriation du « sujet indigène » et sur le choix des stratégies politiques. Les axes religieux et politique d’engagement de la TL définissaient autant une solidarité qu’une tension entre ces deux dimensions. Samuel Ruiz s’imposa, de fait, comme un médiateur entre le mouvement et le gouvernement mexicain, ce qui montre qu’il se démarquait, dans une certaine mesure, de l’EZLN. Néanmoins, les liens et les sympathies entre les agents pastoraux du diocèse et l’EZLN sont largement établis. Sur le plan idéologique, l’impact du discours théologique de la libération dans l’imaginaire communautaire et « basiste » des zapatistes et l’écho des expériences zapatistes dans les propres recompositions de la pensée théologique de la libération sont évidents.
Les dynamiques du diocèse participèrent aussi du développement d’organisations de la société civile, orientées vers la lutte pour les droits de l’homme et la démocratie, aux niveaux international, national et local ; nous y reviendrons. Pourtant, au moment de l’émergence de la TL, la démocratie n’était pas un objectif de ces réseaux. On était aussi moins préoccupé par la construction de mouvements sociaux que par l’efficacité de l’action politique à mener. Le tiers-mondisme catholique avait certes soutenu la voie démocratique, notamment sous l’influence de l’Alliance pour le progrès lancée par l’administration Kennedy, bien qu’en concurrence avec l’orthodoxie libérale. Le basculement révolutionnaire de la TL s’opposait doublement à l’idéal démocratique. Pour les révolutionnaires, la démocratie représentative était une illusion, qui éloignait les milieux populaires de la lutte nécessaire pour leurs droits. L’adhésion de la TL au marxisme, dont les concrétisations politiques et le degré d’identification variaient toutefois (en Argentine, on demeurait péroniste[14]), signifiait aussi et plus unanimement une radicalisation de l’antilibéralisme catholique.
Au Mexique, cet antilibéralisme engageait l’opposition historique de secteurs du catholicisme national à l’institutionnalisation du régime postrévolutionnaire, qui culmina dans la guerre de la Christiade (1926-1929). Tandis que, dans le reste de l’Amérique latine, les régimes national-populistes entretinrent des connivences certaines avec l’Église catholique, le projet laïc du gouvernement postrévolutionnaire engendra un conflit ouvert avec l’institution religieuse. Il était la conséquence des propres vues conservatrices et cléricales de l’institution qui défendait ses intérêts dans l’optique de son opposition au projet modernisant de l’État. Néanmoins, il ne se réduisait pas à cela. Jean Meyer (1974) montra également la dimension populaire d’un soulèvement qui répondait aux propres contradictions de ce projet modernisant, dont – de fait – l’aspect corporatiste apparaît aujourd’hui évident[15]. En ce sens, les catégories de la tradition et de la modernité sont insuffisantes pour rendre compte d’un conflit, dont l’analyse interdit l’idéalisation des ambitions de modernisation de l’État autant que celle de l’opposition intransigeante envers lui. Si cette dernière témoigne, dans une certaine mesure, des limites du projet de la modernité, notamment libéral, son rapport à lui n’est pas moins envahi des motivations idéologiques également suspectes de l’« intégralisme » catholique. Modernisme et « intégralisme » s’opposent et s’impliquent mutuellement au détriment d’une lecture moins idéologisée de la réalité sociale et des aspirations émancipatrices et éthiques qui s’y font jour. Bref, la Christiade constitua un moment clé du rapport entre politique et religion dans le pays, puisqu’elle se conclut avec la marginalisation de l’Église catholique de la sphère politique et, plus largement, de l’espace public.
Or, la TL prétendit précisément réactiver l’engagement politique, au nom du catholicisme, contre sa réduction à la sphère privée. Elle n’emprunta pas directement la voie des partis politiques, mais plutôt celle des mouvements sociaux et de la société civile, à cause de la fermeture du système de partis, mais aussi des limites imposées par l’État laïc. Certes le PAN, dont l’existence était déjà ancienne, constituait un espace partisan marqué par ses liens avec l’Église catholique, mais il assumait une posture prudente sur les conditions d’engagement politique des catholiques, lesquelles ne devaient pas engager directement l’institution. La TL cherchait, au contraire, à mobiliser le clergé catholique. De fait, la hiérarchie catholique, toute à sa stratégie d’opposition et de rapprochement stratégique à l’État, vit d’un mauvais oeil cette politisation. Avec la TL, l’opposition bascula certes du conservatisme, accusé par elle de complicité avec le régime, vers la gauche. On s’opposait autant à l’orthodoxie catholique, défiée à l’intérieur de l’institution, qu’à l’hégémonie du régime. De la Christiade à la TL, il existait, malgré tout, des éléments de continuité dans le sens de cette opposition. Il est étonnant de voir le nombre important d’acteurs, en commençant par Samuel Ruiz, qui entretenaient une filiation idéologique, familiale et géographique avec ce passé. On prétendait de nouveau mobiliser le pays réel, c’est-à-dire le « peuple religieux » ou les « pauvres », contre le pays officiel et ses élites. À ce moment-là, l’objectif déclaré était le même que dans les autres pays latino-américains, où se développait le discours théologique de la libération et son activisme pastoral et sociopolitique : révolution et non pas démocratie. Le mouvement de 1968 qu’on a expliqué a posteriori comme un refus du régime autoritaire répondait surtout au contexte générationnel du rêve d’un autre monde possible. Dans le contexte international de la guerre froide, ce rêve était indissociable de l’utopie socialiste. Face au reflux de cette utopie, les engagements pris se réorientèrent vers l’objectif de la démocratie, mais d’une « autre démocratie ».
Le glissement idéologique vers la démocratie
À partir de 1989, on a beaucoup parlé de l’impact de la crise historique du socialisme sur le déclin de la TL. C’est un fait. La fin de la guerre froide changea profondément la donne. Malgré tout, il faut y mettre deux bémols. D’une part, dès le milieu des années 1970, l’option du socialisme perdit de sa clarté. Les coups d’État militaires et la répression refroidirent les espérances initiales. On continuait à lutter pour une révolution sociale, mais la forme qu’elle devait prendre était assez vague. En Amérique du Sud, on combattait aussi les dictatures militaires, au nom de la démocratie et des droits de l’homme. Ce fut, à la fois, une évolution de l’environnement militant, dont participait la TL, et du discours de ses agents, dont l’impact croissait, puisque l’Église catholique devint un centre de relative protection pour les oppositions politiques et sociales. Néanmoins, ce combat continuait à intégrer les éléments idéologiques du socialisme révolutionnaire. Si l’on combattait pour la démocratie, on faisait la distinction entre la démocratie « formelle » et une conception « amplifiée » de la démocratie. Cette dernière engageait les objectifs du changement social et de la participation populaire. Par ailleurs, en Amérique centrale, l’heure était encore à la révolution. De fait, le centre de focalisation de la TL se déplaça de l’Amérique du Sud (à l’exception du Brésil) vers l’Amérique centrale, où la révolution sandiniste triompha en 1979. C’était la première révolution à laquelle les chrétiens avaient participé directement, en assumant leur identité confessionnelle, ce qui déboucha sur l’intégration de trois prêtres au gouvernement sandiniste : Ernesto Cardenal à la Culture, son frère Fernando à l’Éducation et Miguel d’Escoto aux Affaires étrangères.
D’autre part, même après 1989 cet imaginaire sociopolitique a continué à avoir un impact, auquel les héritages de la TL ne sont pas étrangers. Il a eu l’avantage d’interroger les limites des processus latino-américains de démocratisation dans des conditions d’inégalité sociale et de citoyenneté précaire. Au Brésil, il a pris l’expression de ce qu’on a appelé le « basisme », étroitement lié au Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST – Mouvement des travailleurs ruraux sans terre) et au Partido dos Trabalhadores (PT – Parti des travailleurs)[16]. Or, la Commission pour la pastorale de la Terre de la Conférence épiscopale brésilienne et les activistes de la TL, notamment par le biais des communautés ecclésiales de base, ont contribué à leur forme d’organisation et d’action. Cet imaginaire, ancré dans le monde catholique, a défendu une conception radicale de la démocratie, pas forcément complètement réconciliée avec les principes de la démocratie représentative. Il a aussi propagé ses propres mythes néorévolutionnaires. Entre nouveaux socialismes et néopopulismes, on en voit les expressions actuelles, dont il ne faut toutefois pas surestimer la valeur de rupture.
Au milieu des années 1970, on observe donc un net infléchissement du discours de la TL et des pratiques qu’il véhiculait. On mettait moins l’accent sur l’action politique et davantage sur la construction de mouvements sociaux, même si ceux-ci définissaient des buts politiques. La TL était toujours définie comme une théologie politique, mais son rapport concret au politique variait selon les contextes. Au Nicaragua, il était direct. Au Brésil, on articulait les deux plans. Ailleurs, il prenait des formes plus indirectes, comme cela demeurait le cas au Mexique. Dans tous les cas, on envisageait des mouvements sociaux plus autonomes des organisations politiques. Ce virage, les guerres centre-américaines et l’arrivée massive d’exilés mirent le Mexique sur le devant de la scène. En 1975, une rencontre théologique latino-américaine se tint dans la ville de Mexico, à l’initiative des dominicains qui désiraient célébrer l’anniversaire du cinquième centenaire de la naissance de Bartholomé de las Casas. Dans son comité organisateur, on trouvait notamment des représentants du SSM, de la STM et du CENAMI. Parmi les nombreux participants, principalement des Mexicains, il y avait une proportion de Latino-Américains et d’Européens bien plus significative que lors de la réunion de 1969. Aux côtés de l’Argentin Enrique Dussel, exilé au Mexique, on trouvait d’autres importants théologiens de la libération comme les Brésiliens Hugo Assmann et Leonardo Boff, le Belge Joseph Comblin, l’Uruguayen Juan Luís Segundo et le missionnaire espagnol, au Salvador, Jon Sobrino. Des intervenants étaient aussi venus d’Europe, comme l’Espagnol Floristan Casiano, ex-professeur de l’Institut de pastorale latino-américain (IPLA), avant le basculement de la CELAM contre la TL (en novembre 1972), et le Français Vincent Cosmao, du Centre Lebret de Paris. Sergio Méndez Arceo et Samuel Ruiz y étaient bien entendu, accompagnés de neuf autres évêques.
Cette rencontre officialisa le virage de la TL. Les conférences insistaient sur le maintien de la méthode, c’est-à-dire d’une pensée théologique située du point de vue de l’action collective ou, selon le terme consacré, de la « praxis » (Encuentro latinoamericano de teología, 1975). La solidarité fondamentale avec les milieux populaires et la nécessité d’un changement structurel y étaient réaffirmées. Cependant, même si ce dernier engageait forcément une action politique, on reconnaissait aussi que les espoirs initiaux d’un changement rapide avaient été ruinés par la répression politique. La situation latino-américaine était définie comme une situation d’exil et de captivité qu’on renvoyait à l’Ancien Testament et à la captivité égyptienne du « peuple de Dieu ». Leonardo Boff écrivait à ce propos :
Avec l’établissement de régimes militaires dans de nombreux pays d’Amérique latine et face au totalitarisme de la doctrine de sécurité nationale, les tâches de la théologie de la libération ont profondément changé. Il faut vivre et penser depuis la captivité ; il faut élaborer une véritable théologie de la captivité. Cela ne signifie pas une alternative à la théologie de la libération : c’est sa nouvelle tactique, imposée par les régimes répressifs ; la captivité constitue l’horizon majeur, à l’intérieur duquel il faut travailler et réfléchir de façon libératrice.
Encuentro latinoamericano de teología, 1975 : 141
Bref, il fallait « préparer le terrain », « semer » et « concevoir ». Le temps était celui de la « croissance dans le ventre maternel » et non celui de la « naissance ». L’infléchissement portait d’abord sur la stratégie à choisir. Elle brouillait le contenu sociopolitique des engagements pris et mettait en tension l’action politique et l’activisme social. Sous les effets conjoints de la répression politique et religieuse, au sein de l’Église catholique, on révisa aussi la compréhension du rapport entre la foi et la politique, ainsi qu’entre le christianisme et le marxisme. Sur le plan des dynamiques internes aux réseaux de la TL, il se produisit alors un double phénomène contradictoire.
D’un côté, il y eut un mouvement de repli religieux sur leur identité chrétienne. Sans renier l’identification politique au marxisme, on en relativisait la portée philosophique. Selon la thèse consacrée, il fallait distinguer l’option éthique, fondamentalement chrétienne, de la TL pour la libération de son emprunt de l’instrument marxiste d’analyse de la réalité, afin de comprendre les causes de l’injustice sociale. Cela fut notamment l’argument développé par Clodovis Boff (1978), à propos des fondements épistémologiques de la TL. Bref, on menait une bataille pour la légitimé religieuse de la TL. Cela correspondait à la mise en avant des communautés ecclésiales de base, c’est-à-dire du travail de conscientisation populaire. On y revendiquait fortement les contributions de la foi à la formation d’une conscience révolutionnaire. De l’autre côté, les activités des agents de la TL, dont les prêtres, se déplacèrent aux marges de l’Église catholique vers des organisations oecuméniques et civiles. Dans ces organisations, on assistait à une sécularisation croissante de leur pensée, même si elle demeurait liée aux réseaux catholiques et aux enjeux de leur axe théologique de réflexion. On y faisait, à l’image d’Enrique Dussel (1993), de l’exégèse théologique de Marx.
La Conférence épiscopale latino-américaine de Puebla, en 1979, constitua un espace de confluence de ces réseaux oecuméniques et religieux. Soutenus par un groupe d’évêques, ils parvinrent à infiltrer les débats de la Conférence, dont les « radicaux » avaient été exclus. Il y avait certes eu une réunion à New York, en janvier 1978, organisée par les Maryknolls et l’ex-leader des chrétiens pour le socialisme, Sergio Torres. Mais, pour l’essentiel, la coordination de la riposte fut déléguée aux Mexicains. Sergio Méndez Arceo en était la tête et, en 1978-1979, il convoqua régulièrement les prêtres, les religieux et les militants opposés aux orientations imposées par le secrétaire général de la CELAM, l’évêque colombien Alfonso López Trujillo. Cet effort justifia la naissance du Centro Antonio Montesinos (CAM) de Mexico. Ce type d’organisation oecuménique avait explosé dans la région, à partir du milieu des années 1970, quand les agents de la TL furent exclus des organismes officiels de l’Église catholique. Financées par les organisations non gouvernementales (ONG) européennes, elles se consacraient à des activités de formation, de recherche et de publication dans l’optique de la TL. Avant le CAM, le Centro de Estudios Ecuménicos (CEE) de Mexico s’était déjà situé dans cette mouvance. Le CAM coordonna le réseau de ces organisations afin de mener un travail d’information et de pression sur le déroulement des sessions de la Conférence. Après les débats de la journée, des équipes parallèles de conseillers se réunissaient clandestinement dans un couvent de Puebla autour d’« évêques-amis », répartis dans les différentes commissions de la Conférence. Cela aboutit à l’« option préférentielle pour les pauvres », qui était suffisamment ambiguë afin de satisfaire les positions concurrentes exprimées durant les débats de Puebla (CELAM, 1984).
Ces réseaux demeuraient dans une position intermédiaire entre l’institution catholique et sa périphérie, depuis laquelle ils contestaient les régularités de la première, sans pour autant rompre avec elles. Moins qu’une rupture avec le pouvoir religieux constitué, ils en étaient une expression alternative : opposée à l’orthodoxie par le poids de ses engagements, mais structurellement dépendante de l’institution, dont elle intériorisait les régularités. Ils renvoyaient, à la fois, à l’amplitude de dynamiques militantes, aux niveaux local et national, et aux logiques spécifiques d’une élite religieuse et intellectuelle projetée dans l’espace international. Ces deux dimensions s’impliquaient mutuellement, sans forcément coïncider. Cette élite contribua à la formation d’organisations et de mouvements sociaux, orientés vers les fins de l’action collective, tout en y trouvant un mode alternatif de légitimation religieuse et intellectuelle. Les dynamiques militantes, dont elle participait, débordaient ses intérêts, mais en intégraient les logiques. Il faut donc analyser les effets sociaux de la TL comme le produit conjoint de ces deux dimensions.
L’autre démocratie et ses ambivalences[17]
Au Mexique, on trouve notamment des organisations de défense de droits de l’homme nettement situées dans la trajectoire de la TL : le Centro Fray Francisco Vittoria (Centre du frère Francisco Vittoria) de Mexico, fondé par les dominicains en 1984 ; le Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centre des droits de l’Homme Miguel Agustín Pro) de Mexico, créé par les jésuites en 1988 ; le Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Centre des droits de l’Homme frère Bartolomé de las Casas) dans le diocèse de San Cristóbal de las Casas, dont l’initiative revint, en 1989, à Samuel Ruiz et au dominicain Gonzalo Ituarte ; et le Centro de Derechos Humanos Tepeyac (Centre des droits de l’Homme Tepeyac) apparu en 1992 dans l’Isthme de Tehuantepec, dans l’État d’Oaxaca, sous la direction diocésaine de l’évêque Arturo Lona Reyes. Certaines de ces organisations participèrent à un réseau national de vigilance civique et démocratique, à partir de la fin des années 1980. En plus des organisations oecuméniques mentionnées, du SSM et de CENCOS, s’y joignirent d’autres organisations civiles : certaines d’origine chrétienne et d’autres hors du champ du christianisme. L’une de ces organisations civiles était la fondation Vamos. Elle avait été créée par Javier Vargas Mendoza, un ex-mariste et proche collaborateur de Samuel Ruiz, au Chiapas. S’y joignit aussi le sociologue de l’Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Bernardo Barranco, ex-président du Secrétariat mondial des mouvements de la jeunesse de Pax Romana, à Paris, entre 1982 et 1987.
Bref, on observe une accentuation du décentrement vis-à-vis de l’Église catholique et, à la fois, la conservation de liens forts avec l’institution, par le biais des ordres religieux et d’acteurs centraux du catholicisme national. Ces liens étaient, de fait, constitutifs de solidarités internationales et servaient de caution pour les ONG européennes qui finançaient ces organisations. On y menait des activités intellectuelles, dont la « praxis » était le mode de légitimation (le capital symbolique), aux marges des espaces universitaires, mais relayées à l’intérieur. En même temps, certaines de ces organisations réalisaient un travail juridique, social et de communication, au bénéfice de la défense des droits des groupes les plus vulnérables.
Leur investissement dans les partis politiques était faible (ce qui n’était pas le cas partout en Amérique latine). Il existait certes des sympathies pour le Parti des travailleurs (PT) et le Parti de la révolution démocratique (PRD), mais pas forcément une implication directe. Ce réseau et les organisations chrétiennes qui le composaient furent bien davantage engagés en faveur de l’EZLN. Cette dernière ne prétendait plus prendre le pouvoir, comme les guérillas des années 1960, mais plutôt construire des résistances sociales à long terme (Marcos, 2000). Il définissait donc un mouvement social, aux marges du système politique, qui ne renonçait toutefois pas à donner un sens politique à son action. Par ailleurs, on y choisissait la clandestinité et les armes, tout en en faisant un usage plus symbolique que réel et en cherchant à se légitimer – comme mouvement social – dans l’espace national et international. L’EZLN ne s’explique pas en dehors du travail de conscientisation des communautés indigènes mené, trois décennies en amont du soulèvement de 1994, par les agents pastoraux du diocèse de San Cristóbal de las Casas[18]. Indépendante du diocèse et des réseaux catholiques, sa forme de pensée, d’agir et de s’organiser en a hérité des éléments incontestables. On ne peut qu’être attentif à son discours qui rappelle celui de la TL, au milieu des années 1970. On attend moins exclusivement la transformation exigée de l’action politique. En même temps, on s’inscrit dans la continuité idéologique de la culture révolutionnaire héritée, aux accents très politisés. Le choix d’une action, située au carrefour de l’illégalité et de l’entreprise légitime d’un mouvement social, est aussi typique des formes de lutte inspirées par la TL ailleurs, notamment au Brésil (les occupations de terre). Enfin, l’idée d’une action menée depuis la « base », c’est-à-dire au niveau local, pour remonter vers le haut, est un trait caractéristique de la culture organisationnelle des activistes situés dans la trajectoire de la TL.
À l’instar des réseaux civils inspirés par la TL, l’EZLN paria sur la société civile nationale et internationale. On y prenait du recul vis-à-vis des objectifs immédiats de l’action politique, au nom de la construction de mouvements sociaux plus autonomes, ce qui marquait une certaine différence avec les mouvements révolutionnaires des années 1960 et 1970 en Amérique latine. Cela allait dans le sens de la démocratisation, contre la soumission traditionnelle des acteurs sociaux à l’action politique. En même temps, on y refusait l’intégration au système politique dans le cadre de sa démocratisation procédurière. Ce refus se devait d’abord aux soupçons légitimes qui pesaient sur la profondeur du changement démocratique, tel qu’il était mis en oeuvre par des partis politiques à la vocation démocratique discutable. Même ceux qui s’étaient situés dans la lutte politique pour la démocratie, comme le PAN et le PRD, étaient largement investis par les logiques antidémocratiques du système politique. On pariait donc contre les « acteurs du système », accusés de désarticulation avec les demandes citoyennes réelles, en faveur de l’action de mouvements sociaux et d’une société civile plus authentiquement engagée en faveur des droits de la société. En même temps, ce concept de démocratisation « depuis le bas » entendait ne pas renoncer à la lutte politique pour la justice sociale, inspirée des idéaux révolutionnaires du passé, lesquels étaient définis comme la condition de possibilité d’une démocratie véritable. Au Chiapas, cette lutte prenait une composante ethnique, qui demeurait tributaire de l’imaginaire socialiste des gauches radicales des décennies antérieures dans la région. Les acteurs religieux, intellectuels et activistes catholiques, situés dans la trajectoire de la TL, avaient contribué à la formation de ce mouvement, comme de plus amples secteurs de la société civile, dont ils demeuraient une source prédominante, notamment liée aux réseaux internationaux d’ONG et à leur financement.
Malgré tout, cette défiance avait une autre explication. On refusait l’intégration au système en voie (certes précaire et contradictoire) de démocratisation par méfiance pour les institutions et les acteurs politiques « formels », notamment les partis, mais aussi par culture politique. Les ambivalences du glissement démocratique opéré étaient le symptôme des limites de l’implantation du modèle procédurier de la démocratie représentative au Mexique et en Amérique latine, ainsi que de la permanence des mythes révolutionnaires du passé, qui prenaient des airs démocratiques. Elles posaient le problème de la construction d’une citoyenneté réelle dans des conditions d’exclusion sociale et politique qui la rendaient abstraite, tout en la soumettant aux mirages de sa propre conception idéologique du changement social, héritière d’une culture intellectuelle inspirée d’une vulgate marxiste pas forcément en phase avec la réalité. Le scepticisme, face aux vertus de l’action politique (dans un cadre démocratique), s’y accompagnait paradoxalement d’un contrôle politique serré sur les acteurs mobilisés. De ce point de vue, on ne prétendait pas seulement déplacer le centre de gravité du système politique vers la société civile, on tendait toujours à identifier la démocratie représentative au capitalisme, auquel on opposait la possibilité d’une autre démocratie.
Cette démocratie était définie comme participative et directe contre le principe de délégation de la démocratie représentative. Elle reposait sur la notion d’une citoyenneté collective, indissociable des mouvements sociaux, en opposition à la conception libérale de la citoyenneté individuelle, dont l’abstraction était accusée de favoriser la reproduction des logiques corporatistes du système politique mexicain. Cette citoyenneté collective était orientée vers l’ampliation des formes de participation, la défense des droits sociaux et culturels et la contestation du pouvoir politique constitué. Cette « autre démocratie » était, enfin, destinée à respecter les droits et la parole des minorités contre la tyrannie de la majorité. En arrière-fond de cette « alternative démocratique » se faisait jour une vision distincte de la politique. On y privilégiait la transformation de la société sur la prise de pouvoir. De là devait surgir une façon différente d’exercer le pouvoir qui se cristallisait dans la formule zapatiste : « commander, en obéissant ». Tandis que le pouvoir politique traditionnel imposait la division entre élites et masses, cette vision engageait la notion de leaders politiques subordonnés au contrôle direct de la volonté collective. La politique y était remise dans la perspective du social contre sa dépendance aux intérêts économiques dominants et sa définition comme une fin en soi. Cette vision était censée se mettre en oeuvre dans les expériences sociales liées à cet environnement militant, notamment au sein des municipalités zapatistes. De ce point de vue, on défendait l’autonomie de ces expériences face au système politique, tout en les considérant comme les « germes » d’un monde nouveau. « Autre démocratie » et « autre politique » sont des thèmes récurrents dans la littérature liée à la TL et à son environnement militant[19]. Les observateurs en rendent également compte, au sein des sciences sociales[20].
Quoique la critique des restrictions électorales, partisanes et représentatives de la démocratisation mexicaine fasse sens, à cause de ses dérives oligarchiques et de la faible consolidation citoyenne, on trouvait dans ces propos un écho de l’imaginaire de la démocratie directe. Celui-ci reposait, à son tour, sur l’illusion d’une action collective transparente et sans médiation institutionnelle, au moins aussi questionnable que le « formalisme » démocratique et ses réductionnismes. Sur le plan des pratiques, il faut interroger cette « transparence » démocratique, qui est bien souvent l’apparence de la reproduction de logiques autoritaires. Les observateurs, même sympathisants du zapatisme, ont souligné les limites de son autonomie, ainsi que ses effets paradoxalement dépolitisants[21]. Ni la conception libérale de la citoyenneté individuelle, ni les mythes néorévolutionnaires de la citoyenneté collective n’échappent complètement à l’emprise du corporatisme. De la sorte, les réseaux civils et religieux historiquement situés dans la trajectoire de la TL, ainsi que les expériences sociopolitiques où ils se trouvaient impliqués, gardèrent des traits incontestables du préjugé antidémocratique (face à la démocratie représentative) lié à leur double généalogie antilibérale, catholique et révolutionnaire. Le « réel » et le « formel » continuaient à exister comme deux catégories antagoniques, où ils projetaient leurs propres intérêts idéologiques et sociaux, c’est-à-dire leur raison d’être. Ce préjugé antidémocratique eut pour effet paradoxal leur désarticulation du système politique, c’est-à-dire l’occasion manquée de leur reconversion au bénéfice de mutations sociales et politiques que ni la foi aveugle dans les promesses de la démocratie représentative, ni les mythes révolutionnaires du passé – opposés à elle, bien que teintés de démocratie – ne semblent pouvoir parvenir à concrétiser sur le plan de la réalité.
Conclusion
Le Mexique postrévolutionnaire, dont l’imaginaire national n’en était pas moins fortement marqué par l’héritage catholique, s’était caractérisé par la séparation rigoureuse entre les sphères du politique et du religieux. Sous l’influence exogène de la radicalisation politique de secteurs du catholicisme latino-américain vers la lutte révolutionnaire et dans les conditions sociopolitiques spécifiques du pays, la TL s’opposa à cette séparation. Cela déboucha sur un discours de rupture avec l’orthodoxie catholique, au sein de l’institution, et sur des expériences pastorales et sociopolitiques significatives dans le contexte mexicain. La TL y participa de la constitution de mouvements sociaux locaux et d’une société civile nationale, tout en inscrivant résolument son action sur un plan politique, même s’il se situait aux marges des partis politiques.
Dans un premier temps, ce combat se situait, comme ailleurs, dans la perspective du socialisme révolutionnaire. Face au reflux de cette perspective, il défendit ensuite la possibilité d’une « autre démocratie », directe et participative, qui opposait la citoyenneté collective des mouvements sociaux à celle, abstraite et individuelle, de la démocratie représentative. Ce discours et les pratiques qui lui étaient liées s’imposèrent partout en Amérique latine. Ils combinaient l’action partisane avec les mouvements sociaux ou les opposaient, en proposant d’ouvrir, voire de dépasser, la démocratie représentative. Au Mexique, la conservation du rejet du système de partis fut la donne. Ce rejet répondait à la clôture extrême du champ partisan, où les partis de gauche jouèrent plus le « jeu politique » que celui des mouvements sociaux. S’il existait certes des liens forts entre le PRD et le développement de mouvements sociaux provenant de la mouvance révolutionnaire, mais qui tentaient de tirer profit des opportunités offertes par l’ouverture du système politique en voie de démocratisation, la relation fut bien souvent asymétrique et instrumentale (Aguilar Sánchez, 2009). Elle n’impliqua pas forcément les plus radicaux de ces mouvements, ni leur alignement sur le système politique. En ce sens, la rupture entre le PRD et l’EZLN fut évidente, au tournant des années 2000-2001. Le rejet répondait aussi aux propres préjugés de cet environnement militant, face à la démocratie représentative, et aux déterminismes sociopolitiques de la distance initiale entre l’activisme catholique, le radicalisme social et les partis politiques. La mutation de cet environnement militant vers la démocratie, même s’il se produisit partiellement, ne fut favorisée ni par les logiques du système politique, ni par sa démarche idéologique et ses stratégies politiques.
Pour le Mexique et au-delà, le bilan de la TL est donc fortement contrasté. D’une part, l’engagement politique du religieux a révélé qu’il ne se situait pas obligatoirement en rupture avec les idéaux émancipateurs de la modernité. Du combat révolutionnaire pour le changement social aux objectifs démocratiques de la formation de mouvements sociaux, il a été à la source d’expériences collectives porteuses de revendications souvent légitimes. Néanmoins, ces expériences ont aussi été profondément ambiguës. Elles ont imposé un contrôle religieux et politique, dont les formes et les idées ne sont pas forcément compatibles avec les principes et les institutions démocratiques. Anticipant la critique de la politisation du religieux, la TL avait interrogé le modèle de la stricte séparation entre la foi et la politique, au nom de l’impact social de la religion. Les limites avérées du modèle n’en rendent pas moins suspecte une politisation qui a conduit à reproduire – même dans un sens révolutionnaire – un aspect traditionnel de l’ordre social en Amérique latine : la connivence du religieux et du politique autour du contrôle des acteurs sociaux. La dénonciation chrétienne de la « souffrance des pauvres », combinée avec les visions macrosociales de la philosophie marxiste de l’histoire, ont fait l’originalité de la TL. On ne peut en réduire les enjeux. Malgré tout, ceux-ci se sont aussi inscrits dans des usages idéologiques et sociaux particuliers qui ont servi, au moins partiellement, d’alibis aux réseaux religieux et intellectuels qui en avaient fait leur modus vivendi.
Malgré son « option pour les pauvres », la TL est restée le discours d’une élite théologique et religieuse – foncièrement cléricale et de classe moyenne – qui, face aux mutations de son environnement social et politique, s’est accrochée à ses privilèges sociaux et à ses certitudes idéologiques. Le rapprochement de la pensée théologique et révolutionnaire fait sens, en Amérique latine, par la convergence possible de la foi populaire et de la volonté de transformation sociale dans un contexte culturel marqué par le catholicisme au-delà de ses frontières visibles. Il s’explique aussi par l’intériorisation de ces hiérarchies sociales, précisément liées à l’imaginaire catholique, au sein même de l’égalitarisme apparent des intellectuels marxistes et, à plus forte raison, des catholiques qui se sont rangés dans leur camp. L’élite en question a fort justement dénoncé les limites des processus démocratiques en cours, dont l’optimisme libéral est contredit par la réalité, en posant l’impératif d’un changement social et politique plus ample, motivé par la critique des effets du capitalisme en Amérique latine. Elle a aussi tenté d’y maintenir ses positions, au point de se compromettre, au niveau latino-américain, avec tout projet politique qui déclare prendre le parti du « peuple » contre celui de l’« impérialisme capitaliste », au détriment de la démocratie parfois, mais aussi de la promesse faite du changement social.
Bref, pour le cas de la TL, le rapport entre religion et démocratie ne peut être pensé sur le mode simpliste d’une opposition binaire, mais il n’en demeure pas moins profondément problématique. Il mobilise les enjeux et les ambiguïtés des engagements politiques du religieux, ainsi que les limites des conquêtes de la démocratie en Amérique latine et, plus particulièrement, au Mexique. En ce sens, ce n’est pas le moindre des paradoxes que d’observer que le discours théologique sur les « pauvres » a été récupéré, certes à l’antipode des visions de la TL, par les organismes internationaux et, en particulier, la Banque mondiale, qui ont mis la lutte contre la pauvreté à l’agenda politique de la « bonne gouvernance », dont le lexique nous sort du champ d’influence de la TL tout en montrant l’étendue de son pouvoir d’attraction idéologique, au carrefour du religieux et du politique.
Appendices
Note biographique
Malik Tahar Chaouch est détenteur d’un doctorat en sociologie, spécialité étude des sociétés latino-américaines, de l’Institut des hautes études de l’Amérique latine (IHEAL) de la Sorbonne Nouvelle-Paris III ; sa thèse, soutenue en 2005, portait sur la théologie de la libération en Amérique latine. Actuellement, il est chercheur à l’Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales (IIHS) de l’Universidad Veracruzana, à Xalapa (État de Veracruz, Mexique). Il a été chercheur invité au El Colegio de México, à Mexico (2001), professeur à l’Universidad Javeriana de Bogota en Colombie (2002-2004) et professeur invité à l’Université Le Mirail à Toulouse (2009). Il est chercheur associé de l’IHEAL et du Centre de sociologie des religions et d’éthique sociale (CSRES) de l’Université de Strasbourg. Ses publications portent sur les axes de recherche de « religion et politique en Amérique latine » « représentation, élites politiques, partis et démocratisation au Mexique » et « théorie des champs et réseaux sociaux ».
Notes
-
[1]
Michael Löwy (1998 : 79-98) rejette, à juste titre, les interprétations linéaires sur le rapport entre religion et modernité en Amérique latine, en soulignant le rapport critique de la TL à la modernité, mais aussi sa propre modernité en ce sens. Néanmoins, son idéalisation de la TL le conduit à définir un mouvement qui aurait dépassé l’opposition classique entre tradition et modernité, sans tenir compte des propres ambivalences et contradictions du phénomène de ce point de vue.
-
[2]
Poulat s’inscrit dans une tradition sociohistorique où il faut également mentionner Jean-Marie Mayeur (1980, 1986).
-
[3]
Sur ce thème, les travaux de Marcel Gauchet retiennent l’attention (1985 et, plus récemment, 1998).
-
[4]
Sur l’historiographie récente du catholicisme mexicain, le livre Historia de la Iglesia católica en México de Roberto Blancarte (1992) est le plus complet. Il a donné lieu à des travaux plus récents, notamment sur la sécularisation et la laïcité mexicaine (Blancarte, 2001, 2004). Outre son travail sur le PAN que nous citons ensuite, Soledad Loaeza (1985, 1990) s’est intéressée pour sa part aux relations entre l’État mexicain et l’Église catholique. Il faut aussi renvoyer aux ouvrages de Jean Meyer (1974, 2000) que nous citons également dans la suite du texte. Bernardo Barranco (1996), en plus d’être un acteur des réseaux de la TL, est aussi considéré comme l’un des sociologues mexicains de la religion les plus significatifs. Voir aussi, plus récemment, María Aspe Armella (2008). Nous renverrons ultérieurement à Victor Gabriel Muro González, qui a étudié le rapport entre TL, société civile et mouvements sociaux au Mexique. Au-delà du catholicisme, Jean-Pierre Bastian (1989) est l’autorité en matière de minorités protestantes pour les dix-neuvième et vingtième siècles. Il a ensuite amplifié son champ de recherche vers le changement religieux au Mexique et en Amérique latine (Bastian, 1997). L’Instituto Nacional de Estádistica y Geografía (Institut national de statistique et de géographie) (INEGI, 2003) en offre un panorama national. Sur la pluralité des identités religieuses actuelles, au Mexique, on peut aussi consulter : Gilberto Giménez (1996), Carlos Garma Navarro (2004), Renée de la Torre et Cristina Gutiérrez Zúñiga (2007), Carolina Rivera Farfán et Elizabeth Juárez Cerdi (2007). Nous renvoyons aussi au texte collectif dirigé par Carolina Rivera Farfán sur le Chiapas (2005). L’historiographie sur le christianisme latino-américain est ample, mais nous n’y renvoyons pas ici, puisque nous concentrons notre analyse au cas mexicain.
-
[5]
Le PAN est l’objet d’une ample littérature dans le domaine de la science politique. Le travail le plus complet à ce sujet est celui de Soledad Loaeza (1999). Au-delà du PAN et pour l’État de Jalisco, Elisa Cardenás Ayala (2001) montre comment, dès la révolution mexicaine, le militantisme catholique mexicain ne se réduisit pas au conservatisme et à la défense des intérêts cléricaux et put aussi stimuler des vocations démocratiques.
-
[6]
À propos de l’historiographie sur la TL, trois catégories de travaux prédominent. D’abord, il existe une littérature militante : Roberto Oliveiros (1977), Samuel Silva Gotay (1981), Philipp Berryman (1987), Luís del Valle (1996), Miguel Concha (1997). Viennent ensuite des travaux plus analytiques, quoique inscrits dans une perspective apologétique autour des notions d’Église « progressiste » et « populaire » : Daniel Levine et Scott Mainwaring (1986), Scott Mainwaring et Alexander Wilde (1988), Daniel Levine (1992), W.E. Hewitt et John Burdick (2000). Des travaux, non moins apologétiques, déplacent la perspective vers la notion de mouvement social : Victor Gabriel Muro González (1991), Christian Smith (1991), Michael Löwy (1998). Face à cette littérature apologétique, il existe des travaux plus distanciés, comme ceux sur le basisme, auxquels nous renvoyons plus loin dans le texte.
-
[7]
À ce propos, voir les témoignages de Teresa Donoso Loero (1975), Pablo Richard (1976) et Enrique Dussel (1979).
-
[8]
Consulté et actuellement disponible sur Internet en janvier 2011 (http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum_fr.html), encyclique publiée en 1967.
-
[9]
Ce mouvement a été étudié avec précision par Denis Pelletier (1996).
-
[10]
Toutes les traductions de l’espagnol sont des traductions libres, faites par l’auteur de l’article.
-
[11]
En ce sens, le titre de la thèse doctorale de Rubem Alves (1970), traduite en espagnol, est évocateur : Religion : ¿opium ou instrument de libération ?
-
[12]
L’espace de cet article ne permet pas d’en faire la démonstration complète, à partir de notre travail de recherche. Nous renvoyons donc à notre thèse doctorale et à un article, qui en résument la démarche et les résultats (Tahar Chaouch, 2005, 2007).
-
[13]
À ce propos, voir le témoignage de Jesús Morales Bermúdez (1992). Un texte collectif, parmi d’autres, Vida, clamor y esperanza. Aportes desde América Latina (Beozzo, 1992), fait la synthèse des « théologies latino-américaines émergentes », où convergeaient la théologie de la libération « historique » et la pluralisation de ses « sujets » autour des thématiques de genre, culturelles et écologiques. Il est facile de montrer les liens entre les acteurs et les théologiens liés à ces différents courants qui, malgré les débats internes, s’inscrivaient dans une même mouvance.
-
[14]
Voir le principal texte historique de la théologie de la libération « argentine » : Juan Carlos Scannone (1976).
-
[15]
À propos de la Christiade, le travail de Jean Meyer fait autorité. Quant à Samuel Ruiz, il exliqua lui-même le sens de son projet diocésain (1999).
-
[16]
Voir à ce propos les travaux distanciés sur le « basisme » entendu comme une culture militante plus ample, où l’imaginaire de la TL eut un impact indéniable : André Corten (1995) et David Lehmann (1996). Au-delà du cas brésilien, on peut aussi consulter le travail de Maristella Svampa et Sebastián Pereyra (2003) en Argentine.
-
[17]
L’ambivalence s’exprime sur le plan idéologique et dans les pratiques qui s’en dégagent, dans les effets réels des postures assumées par les acteurs liés au courant théologique de la libération. Notre travail s’est intéressé à l’aspect toujours délaissé par les lectures « mythologisantes » de la TL, c’est-à-dire aux acteurs réellement impliqués dans ses réseaux transnationaux d’activistes, d’intellectuels et de religieux au-delà de l’évocation généralisante du « peuple ». De la sorte, nous avons pu reconstruire ses véritables « bases sociales et institutionnelles », notamment au sein des organisations oecuméniques où ces acteurs avaient poursuivi leurs activités, comme conséquence de la répression ecclésiale au sein de l’Église catholique. Nous n’en sommes resté ni aux textes, ni aux mythes sur l’impact social de la TL. Nous avons rejeté les lectures unilatérales en termes d’action collective, en développant celle de champ social, sans non plus réduire l’aspect central de l’action collective dans les dynamiques sociales liées à la TL, mais sans valider ses approches « mythologisantes ». Les ambivalences que nous avons analysées dans le rapport des acteurs à l’action collective et dans le contenu idéologique et les formes politiques et sociales de cette action se reflètent également dans les effets sociaux de la TL, dont nous n’avons aucunement réduit les effets de mobilisation populaire. Néanmoins, une des limites certaines de notre travail a été de ne pas pouvoir approfondir l’observation de ces effets sur le terrain. Pour cela, notre appréciation des pratiques demeure générale et s’appuie également sur les références à la littérature spécialisée sur les mouvements sociaux, au Mexique.
-
[18]
Avant de partir du diocèse, l’évêque de San Cristóbal de las Casas exposa clairement les axes de son projet (Ruiz, 1999). Jean Meyer (2000) en fit une analyse distanciée. À propos du Chiapas, du zapatisme et de la problématique religieuse locale, les travaux les plus significatifs sont : Yvon Le Bot (1997), Maria Del Carmen Legorreta Díaz (1998), Julio Ríos Figueroa (2002), Juan Pedro Viqueira (2002), Jesús Morales Bermúdez (2005), Carolina Rivera Farfan (2005), Marco Estrada Saavedra (2007).
-
[19]
On en trouve une synthèse fidèle dans le texte de Carlos Antonio Aguirre Rojas (2010).
-
[20]
Un travail collectif récent, Los movimientos sociales : de lo local a lo global (Mestries et al., 2009), explore avec précision cette conception alternative de la citoyenneté et de la démocratie au sein des mouvements sociaux actuels, en particulier au Mexique et notamment dans le contexte du Chiapas.
-
[21]
Voir entre autres les travaux de Geffrey Pleyers : « Autonomías locales y subjetividades en contra del neoliberalismo : hacia un nuevo paradigma para entender los movimientos sociales » [Autonomies locales et subjectivités contre le néolibéralisme : vers un nouveau paradigme pour comprendre les mouvements sociaux] (Mestries et al. : 129-155) ; et de Sabrina Melenotte : « Una experiencia zapatista : San Pedro Polhó, doce años después » [Une expérience zapatiste : San Pedro Polhó, douze ans après] (id. : 231-248).
Bibliographie
- Aguilar Sánchez, Martin, 2009, Movimientos sociales y democracia en México (1982-1998). Una perspectiva regional [Mouvements sociaux et démocratie au Mexique (1982-1998). Une perspective régionale], Mexico, Porrua-UV.
- Aguirre Rojas, Carlos Antonio, 2010, Les leçons politiques du néozapatisme mexicain, commander en obéissant, Paris, L’Harmattan.
- Alves, Rubem, 1970, Religión : ¿opio o instrumento de liberación ? [Religion : opium ou instrument de libération ?], Montevideo, Tierra Nueva.
- Aspe Armella, María, 2008, La formación social y política de los católicos mexicanos. La Acción Católica Mexicana y la Unión Nacional de Estudiantes Católicos, 1929–1958 [La formation sociale et politique des catholiques mexicains. L’Action catholique mexicaine et l’Union nationale des étudiants catholiques, 1929-1958], Mexico, Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana–Universidad Iberoamericana.
- Assmann, Hugo, 1971, Liberación-opresión : desafío a los cristianos [Libération-oppression : défi aux chrétiens], Montevideo, Tierra Nueva.
- Barranco, Bernardo, 1996, « Posiciones políticas en la historia de la Acción Católica Mexicana » [Positions politiques dans l’histoire de l’Action catholique mexicaine], dans Roberto Blancarte (sous la dir. de), El pensamiento social de los católicos mexicanos [La pensée sociale des catholiques mexicains], Mexico, Fondo de Cultura Económica, p. 39-67.
- Bastian, Jean-Pierre, 1989, Los disidentes. Sociedades protestantes y revolución en México, 1872-1911 [Les dissidents. Sociétés protestantes et révolution au Mexique, 1872-1911], Mexico, Fondo de Cultura Económica.
- Bastian, Jean-Pierre, 1997, La mutación religiosa de América latina [La mutation religieuse de l’Amérique latine], Mexico, Fondo de Cultura Económica.
- Beozzo, José Oscar (sous la dir. de), 1992, Vida, clamor y esperanza. Aportes desde América Latina [Vie, clameur et espérance. Apports depuis l’Amérique latine], Buenos Aires, Paulinas.
- Berryman, Philipp, 1987, Liberation Theology. The Essential Facts about the Revolutionary Movement in Latin America and Beyond, New York, Pantheon Books.
- Blancarte, Roberto, 1992, Historia de la Iglesia católica en México [Histoire de l’Église catholique au Mexique], Mexico, Fondo de Cultura Económica.
- Blancarte, Roberto, 2001, « Laicidad y secularización en México » [Laïcité et sécularisation au Mexique], Estudios Sociológicos, Mexico, Colegio de México, vol. XIX, no 57, p. 843-855.
- Blancarte, Roberto, 2004, Entre la fe y el poder : política y religión en México [Entre la foi et le pouvoir : politique et religion au Mexique], Mexico, Grijalbo.
- Boff, Clodovis, 1978, Teología do político e suas mediações [Théologie de la politique et ses médiations], Petrópolis, Vozes.
- Cárdenas Ayala, Elisa, 2001, Le laboratoire démocratique : le Mexique en révolution (1908-1913), Paris, Publications de la Sorbonne.
- CELAM (Conférence épiscopale latino-américaine de Medellín), 1971, Medellín. Conclusión. Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano [Medellín. Conclusion. Seconde Conférence générale de l’épiscopat latino-américain], Bogota, Secrétariat général de la CELAM.
- CELAM (Conférence épiscopale latino-américaine de Medellín), 1984, La Evangelización en el presente y en el futuro de América latina. III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano [L’évangélisation dans le présent et le futur de l’Amérique latine. Troisième Conférence générale de l’épiscopat latino-américain], Mexico, Librería Parroquial de Claveria.
- Compagnon, Olivier, 2003, Jacques Maritain et l’Amérique du Sud. Le modèle malgré lui, Paris, Septentrion.
- Concha, Miguel, 1997, « Teología de la liberación » [Théologie de la libération], dans Norberto Bobbio (sous la dir. de), Diccionario de política [Dictionnaire de politique], Mexico, Siglo XXI, p. 1557-1563.
- Corten, André, 1995, Le pentecôtisme au Brésil. Émotion du pauvre et romantisme théologique, Paris, Karthala.
- de la Torre, Renée et Cristina Gutiérrez Zúñiga (sous la dir. de), 2007, Atlas de la diversidad religiosa en México [Atlas de la diversité religieuse au Mexique], Mexico, El Colegio de Jalisco–El Colegio de la Frontera Norte–El Colegio de Michoacán–Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social–Secretaría de Gobernación-Universidad de Quintana Roo.
- del Valle, Luís, 1996, « Teología de la liberación en América Latina » [Théologie de la libération en Amérique latine], Roberto Blancarte (textes compilés par), El pensamiento social de los católicos mexicanos [La pensée sociale des catholiques mexicains], Mexico, Fondo de Cultura Económica, p. 230-265.
- Donoso Loero, Teresa, 1975, Historia de los cristianos por el socialismo en Chile [Histoire des Chrétiens pour le socialisme au Chili], Santiago, Vaitea.
- Dussel, Enrique, 1979, De Medellín a Puebla : una década de sangre y esperanza 1968-1979 [De Medellín à Puebla : une décennie de sang et d’espérance, 1968-1979], Mexico, Centro de Estudios Ecuménicos (CEE).
- Dussel, Enrique, 1993, Las metáforas teológicas de Marx [Les métaphores théologiques de Marx], Estella, Verbo divino.
- Encuentro latinoamericano de teología [Rencontre latino-américaine de théologie], 1975, Liberación y Cautiverio : debates en torno al método de la teología en América latina [Libération et captivité : débats autour de la méthode de la théologie en Amérique latine], México, [s.e].
- Estrada Saavedra, Marco, 2007, La comunidad armada rebelde y el EZLN : un estudio histórico y sociológico sobre las bases de apoyo zapatistas en las cañadas tojolabales de la Selva Lacandona [La communauté armée rebelle et l’EZLN : une étude historique et sociologique sur les bases de soutien zapatistes dans les vallons tojobales de la jungle Lacandona], Mexico, El Colegio de México.
- Garma Navarro, Carlos, 2004, Buscando el espíritu. Pentecostalismo en Iztapalapa y la Ciudad de México [À la recherche de l’esprit. Pentecôtisme à Iztapalapa et Mexico], Mexico, Universidad Autónoma Metropolitana–Iztapalapa–Plaza Valdés.
- Gauchet, Marcel, 1985, Le Désenchantement du monde. Une histoire politique de la religion, Paris, Gallimard.
- Gauchet, Marcel, 1998, La religion dans la démocratie : Parcours de la laïcité, Paris, Gallimard.
- Giménez, Gilberto (sous la dir. de), 1996, Identidades religiosas y sociales en México [Identités religieuses et sociales au Mexique], Mexico, Instituto de Investigación Social–Universidad Nacional Autónoma de México.
- Gutiérrez, Gustavo, 1971 Teología de la liberación. Perspectivas [Théologie de la libération. Perspectives], Lima, Centro de Estudios y Publicaciones.
- Hervieu-Léger, Danièle, 1999, Le pèlerin et le converti. La religion en mouvement, Paris, Flammarion.
- Hervieu-Léger, Danièle, 2001 La religion en miettes ou la question des sectes, Paris, Calmann-Lévy.
- Hewitt, W.E. et John Burdick (sous la dir. de), 2000, The Church at the Grassroots in Latin America : Perspectives on Thirty Years of Activism, Londres, Praeger.
- INEGI (Instituto Nacional de Estádistica y Geografía), 2003, Diversidad religiosa en México [Diversité religieuse au Mexique], Mexico, INEGI.
- Kepel, Gilles, 2004, Fitna. Guerre au coeur de l’Islam, Paris, Gallimard.
- Le Bot, Yvon, 1997, Le rêve zapatiste, Paris, Seuil.
- Legorreta Díaz, Maria del Carmen, 1998, Religión, Política y Guerrilla en Las Cañadas de la Selva Lacandona [Religion, politique et guérilla dans les vallons de la jungle Lacandona], Mexico, Cal y Arena.
- Lehmann, David, 1996, Struggle for the Spirit : Religious Transformation and Popular Culture in Brazil and Latin America, Cambridge, Polity Press.
- Levine, Daniel et Scott Mainwaring (sous la dir. de), 1986, Religion and Popular Protest in Latin America, [sl], University of Notre Dame Press.
- Levine, Daniel, 1992, Popular Voices in Latin American Catholicism, Princeton, Princeton University.
- Loaeza, Soledad, 1985, « Notas para el estudio de la Iglesia en el México contemporáneo » [Notes pour l’étude de l’Église dans le Mexique contemporain], dans Charles Reilly et Martin De la Rosa (sous la dir. de), Religión y política en México [Religion et politique au Mexique], Mexico, Siglo XXI, p. 42-58.
- Loaeza, Soledad, 1990, El fin de la ambigüedad : las relaciones entre la Iglesia y el Estado en México, 1982-1989 [La fin de l’ambiguïté : les relations entre l’Église et l’État au Mexique, 1982-1989], Mexico, Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana.
- Loaeza, Soledad, 1999, El PAN : la larga marcha, 1939-1994. Oposición leal y partido de protesta [Le PAN : la longue marche, 1939-1994. Opposition loyale et parti de protestation], Mexico, Fondo de Cultura Económica.
- Löwy, Michael, 1998, La guerre des Dieux. Religion et politique en Amérique latine, Paris, Félin.
- Mainwaring, Scott et Alexander Wilde (sous la dir. de), 1988, The Progressive Church in Latin America, Indiana, University of Notre Dame Press.
- Marcos, Subcomandante [sous-commandant], 2000, Desde las montañas del sureste mexicano [Depuis les montagnes du Sud-Est mexicain], Mexico, Plaza & Janés.
- Mayeur, Jean-Marie, 1980, Des partis catholiques à la démocratie chrétienne (XIXe-XXe siècles), Paris, Armand Colin.
- Mayeur, Jean-Marie, 1986, Catholicisme social et démocratie chrétienne. Principes romains, expériences françaises, Paris, Cerf.
- Mestries, Francis, Geoffrey Pleyers et Sergio Zermeño (sous la dir. de), 2009, Los movimientos sociales : de lo local a lo global [Les mouvements sociaux : du local à l’international], Mexico, Universidad Autónoma Metropolitana–Anthropos.
- Meyer, Jean, 1974, Apocalypse et révolution au Mexique. La guerre des Cristeros (1926-1929), Paris, Gallimard.
- Meyer, Jean, 2000, Samuel Ruiz en San Cristóbal [Samuel Ruiz à San Cristóbal], Mexico, Tusquets.
- Morales Bermúdez, Jesús, 1992, « El Congreso Indígena de Chiapas : Un testimonio » [Le Congrès indigène du Chiapas : un témoignage], Anuario 1991, Chiapas, Instituto Chiapaneco de Cultura, p. 242-370.
- Morales Bermúdez, Jesús, 2005, Entre ásperos caminos llanos. La diócesis de San Cristóbal de las Casas 1950-1995 [Sur d’âpres chemins de plaine. Le diocèse de San Cristóbal de las Casas 1950-1995], Mexique, Casa Juan Pablos–Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas–Universidad Intercultural de Chiapas–Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas.
- Muro González, Victor Gabriel, 1991, « La Iglesia ante la movilización social en el México contemporáneo : una perspectiva teórica » [L’Église face à la mobilisation sociale dans le Mexique contemporain : une perspective théorique], dans Victor Gabriel Muro González et Manuel Canto (sous la dir. de), El Estudio de los movimientos sociales : teoría y método [L’étude des mouvements sociaux : théorie et méthode], Mexico, El Colegio de Michoacán, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, p. 155-174.
- Oliveiros, Roberto, 1977, Liberación y teología : génesis y crecimiento de una reflexión 1966-1976 [Libération et théologie : genèse et croissance d’une réflexion 1966-1976], Lima, CEP.
- Pelletier, Denis, 1996, Économie et humanisme : de l’utopie communautaire au combat pour le Tiers-monde (1941-1966), Paris, Cerf.
- Poulat, Émile 1977, Église contre bourgeoisie. Introduction au devenir du catholicisme actuel, Tournai, Casterman.
- Reflexión Episcopal Pastoral [Réflexion épiscopale pastorale], 1969, La Iglesia en la transformación de México [L’Église dans la transformation du Mexique], Mexico, Comisión Episcopal de Pastoral Social, 3 vol.
- Richard, Pablo, 1976, Cristianos por el Socialismo, historia y documentación [Chrétiens pour le socialisme, histoire et documentation], Salamanque, Sígueme.
- Ríos Figueroa, Julio, 2002, Siglo XX : Muerte y Resurrección de la Iglesia Católica en Chiapas [Vingtième siècle : mort et résurrection de l’Église catholique au Chiapas], Mexico, Universidad Nacional Autónoma de México.
- Rivera Farfan, Carolina (sous la dir. de), 2005, Diversidad religiosa y conflicto en Chiapas : Intereses, utopías y realidades [Diversité religieuse et conflit au Chiapas : intérêts, utopies et réalités], Mexico, Universidad Nacional Autónoma de México–Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social–Secretaria de Gobierno del Estado de Chiapas.
- Rivera Farfán, Carolina et Elizabeth Juárez Cerdi (sous la dir. de), 2007, Más allá del espíritu. Actores, acciones y prácticas en iglesias pentecostales [Par delà l’esprit. Acteurs, actions et pratiques dans les églises pentecôtistes], Mexico, Casa Chata.
- Ruiz, Samuel, 1999, Mitrabajo pastoral en la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Principios teológicos [Mon travail pastoral dans le diocèse de San Cristóbal de las casas. Principes théologiques], Mexico, Paulinas.
- Scannone, Juan Carlos, 1976, Teología de la liberación y praxis popular. Aportes críticos para una teología de la liberación [Théologie de la libération et praxis populaire. Apports critiques pour une théologie de la libération], Salamanque, Sígueme.
- Silva Gotay, Samuel, 1981, El pensamiento cristiano revolucionario en América Latina y el Caribe : implicaciones de la teología de la liberación para la sociología de las religiones [La pensée chrétienne révolutionnaire en Amérique latine et dans la Caraïbe : implications de la théologie de la libération pour la sociologie des religions], Salamanque, Sígueme.
- Smith, Christian, 1991, The Emergence of Liberation Theology. Radical Religion and Social Movement Theory, Chicago, University of Chicago Press.
- Sociedad Teológica Mexicana [Société théologique mexicaine], 1970, Congreso Nacional de Teología, Fe y Desarrollo [Congrès national de théologie, foi et développement], Mexico, Alianza.
- Svampa, Maristella et Sebastián Pereyra, 2003, Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras [Entre la route et le quartier. L’expérience des organisations de piqueros], Buenos Aires, Biblos.
- Tahar Chaouch, Malik, 2005, La théologie de la libération en Amérique latine : champ et paradigme d’une expression historique, Lille, Fichier central des thèses.
- Tahar Chaouch, Malik, avril-juin 2007, « Théologie de la libération en Amérique latine : approche sociologique », Archives des sciences sociales des religions, no 138, Paris, École des hautes études en sciences sociales (EHESS), p. 9-28.
- Viqueira, Juan Pedro, 2002, Encrucijadas chiapanecas. Economia, religion e identidades [Carrefours du Chiapas. Économie, religion et identités], Mexico, Tusquets–El Colegio de México.
- Weber, Max, 2003, La ética protestante y el espíritu del capitalismo [L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme], Mexico, Fondo de Cultura Económica.