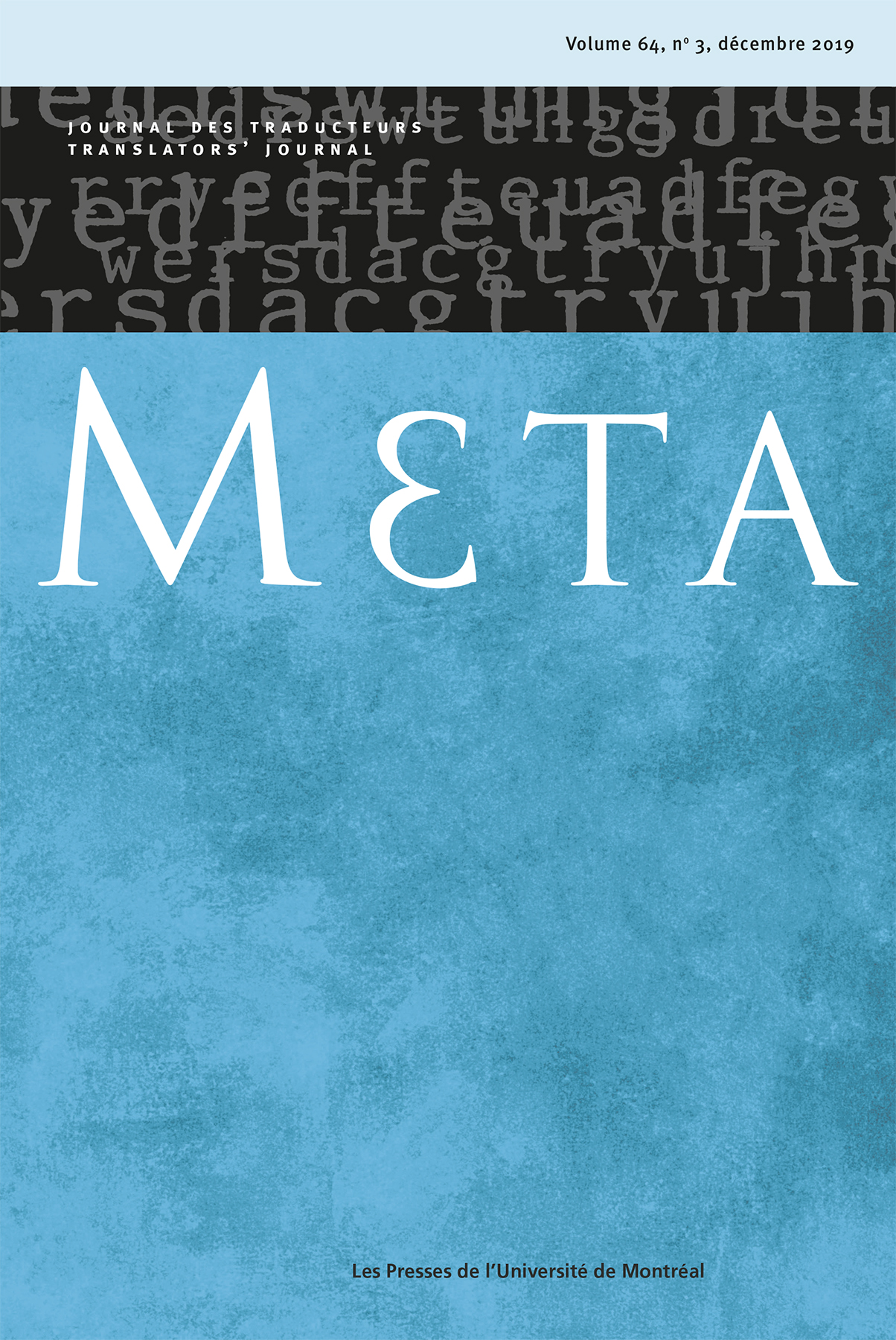Résultat du projet de recherche intitulé « Violencia simbólica y traducción : retos en la representación de identidades fragmentadas en la sociedad global », La traducción y la(s) historia(s). Nuevas vías para la investigación réunit les plus récentes réflexions d’África Vidal. Comme l’affirme Edwin Gentzler dans la présentation du livre, il s’agit d’une étude novatrice faite par l’une des responsables du « power turn » en traductologie qui, cette fois, amplifie considérablement ce paradigme. L’étude a sa place parmi celles qui depuis les années 1980 portent sur les rapports entre traduction et pouvoir, comme les travaux de Gayatri Spivak (1988), Paul Bandia (2009) et Georges Bastin (2010, 2011). L’auteure fait entendre les voix des femmes, des immigrants et des autochtones par le biais d’un ensemble de nouvelles méthodologies développées au long de l’ouvrage. Pour ce faire, África Vidal s’appuie sur des historiens tels que Hayden White (1987), Dominick LaCapra (1985) et Alum Munslow (2013). Le livre comporte, à part la préface de Gentzler, six chapitres et une conclusion. Dans le premier chapitre, « La traducción y el mar de historias », l’auteure part de l’oeuvre de Salman Rushdie, Haroun and the Sea of Stories, où il compare le monde des récits à l’océan. Comme celui-ci, les narrations sont fluides et se transforment toujours. On se rapproche ainsi d’un contexte épistémologique post-positiviste et d’une conception ouverte de l’histoire. L’idée de simulacre de Baudrillard, pour qui « la réalité est un reflet du réel », c’est-à-dire la réalité est une construction, permet à África Vidal de penser la traduction comme un médium pour le changement politique, social ou culturel. D’où son importance pour d’autres disciplines, comme l’histoire, qui, grâce à la traduction, développent d’autres outils d’analyse, menant, selon Backmann-Medick (2009), à une sorte de « translation turn » dans les sciences humaines. Ce rapprochement à l’histoire nous dirige vers une historiographie critique pour laquelle l’histoire est narration. Des auteurs comme Hayden White, Michel Certeau et Dominick LaCapra permettent d’envisager une histoire anti-téléologique, faite de fragments et qui n’accepte pas de hiérarchisation. Ainsi, écrire l’histoire, c’est réécrire des réalités, ce qui ferait de l’historien un traducteur. Cette conception élargie de la traduction offre la possibilité de voir l’Histoire comme un concept problématique. Dans « La Historia, un concepto problemático », deuxième chapitre du livre, África Vidal nous rappelle que ce n’est qu’au 18e siècle que l’histoire devient une discipline autonome. En quelques pages, on va de Quintilien et Cicéron, pour qui traduction et narration se confondent, en passant par Durkheim et Benjamin qui mettent en cause l’objectivité scientifique de l’observation du passé, pour arriver à l’histoire critique de Lawrence Stone, Michel de Certeau et Hayden White qui rapprochent à nouveau et de façon décisive histoire et narration. Le rôle central du langage comme espace de construction de l’histoire amène l’auteure au post-structuralisme de Derrida, Barthes et Foucault qui corroborent les principes énoncés par les historiens critiques. On touche ainsi à l’une des questions clés du livre : qui sommes-nous quand nous nous racontons l’histoire ? La réponse varie en fonction des contextes, une fois que les représentations qu’on se fait sont le résultat des interprétations que chaque groupe élabore selon ses intérêts. Le troisième chapitre, « El peligro de una sola historia », est un complément nécessaire au chapitre précédent. On ne peut accepter une conception ouverte de l’histoire sans dénoncer les dangers de l’imposition d’une seule version de l’histoire. Contre l’hégémonie d’une seule interprétation, souvent eurocentrique, África Vidal évoque « la radicalisation des politiques culturelles de la différence », partagée par des courants théoriques aussi diversifiés que l’École de Francfort …
Appendices
Bibliographie
- Adamo, Sergia (2006) : Microhistory of Translation. In : Georges L. Bastin et Paul Bandia, dir. Charting the Future of Translation History. Ottawa : University of Ottawa Press, 81-100.
- Anzaldua, Gloria, dir. (1990) : Making Face, Making Soul. Creative and Critical Perspectives by Women of Color. San Francisco : Aunt Lute Foundation Books.
- Backmann-Medick, Doris (2009) : Introduction : The Translation Turn. Translation Studies. 2(1) :2-16.
- Bandia, Paul (2009) : Cheik Anta Diop : Translation at the Service of History. In : Paul F. Bandia et John Milton, dir. Agents of Translation. Amsterdam/Philadelphie : John Benjamins, 209-227.
- Bastin, Georges L. (2006) : Subjectivity and Rigour in Translation History : The Latin American Case. In : Georges L. Bastin et Paul Bandia, dir. Charting the Future of Translation History. Ottawa : University of Ottawa Press, 11-129.
- Bastin, Georges L. (2010) : La Pertinencia de los estudios históricos sobre traducción en Hispanoamérica. Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe. 21(1) :17-28.
- Bielsa, Esperança (2016) : Cosmopolitanism and Translation. Investigations into the Experience of the Foreign. Londres/New York : Routledge.
- Genzler, Edwin (2017) : Translation and Rewriting in the Age of Post-Translation Studies. Londres/New York : Routledge.
- LaCapra, Dominick (1985) : History and Criticism. Ithaca : Cornell University Press.
- Munslow, Alun (2013) : Authoring the Past. Writing and Rethinking History. Londres/New York : Routledge.
- Rafael, Vicente (2016) : Motherless Tongues : The Insurgency of Language amid Wars of Translation. Durham/Londres : Duke University Press.
- Spivak, Gayatri (1988) : Can the Subaltern Speak ? In : Patrick Williams et Laura Chrisman, dir. Colonial Discourse and Post-Colonial Theory. A Reader. Hertfordshire : Prentice Hall/Harvester Wheatsheaf, 66-111.
- White, Hayden (1987) : The Content of Form. Narrative Discourse and Historical Representation. Baltimore/Londres : John Hopkins University Press.