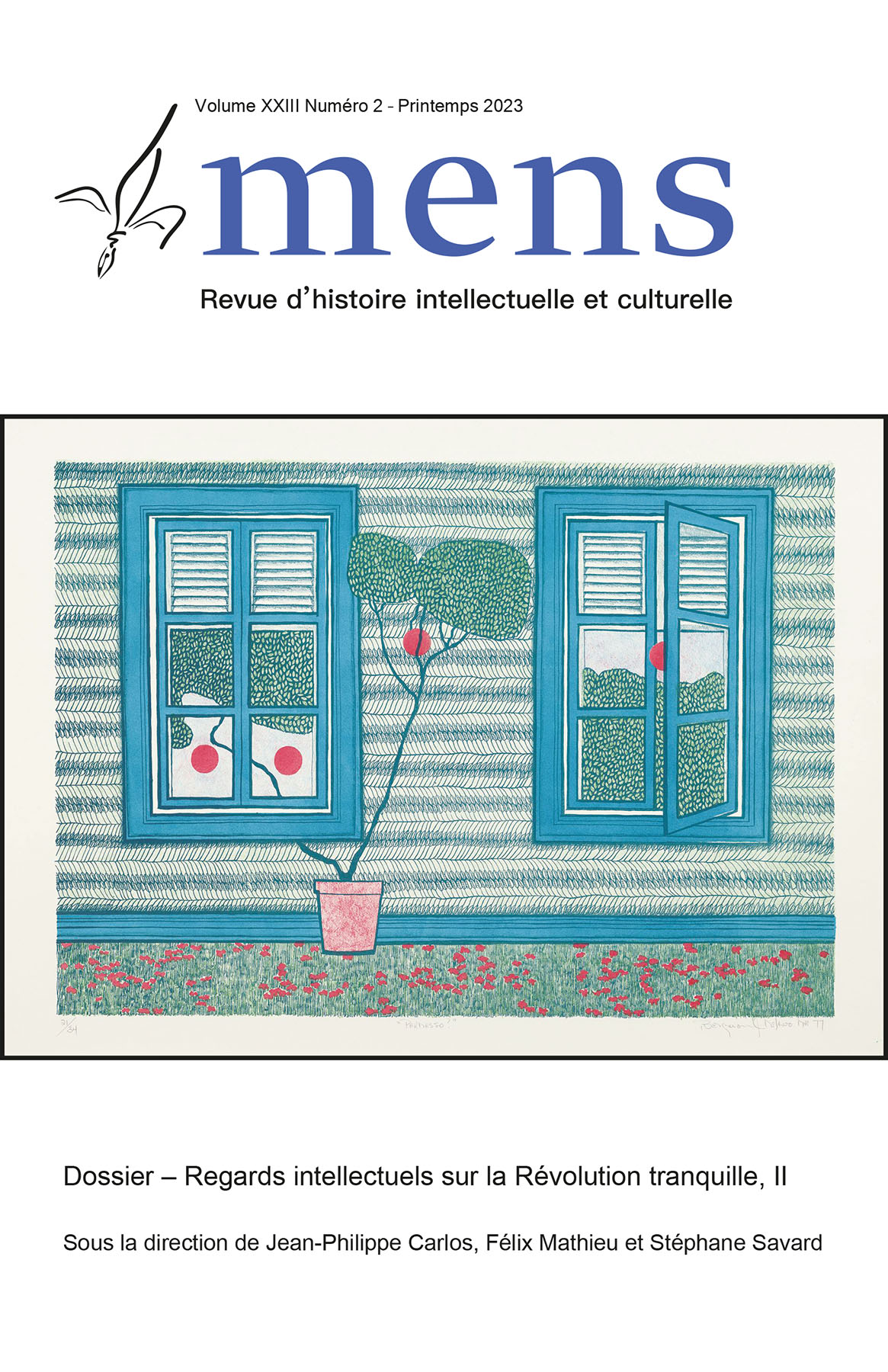Dans leur dernier ouvrage, les historiens Robert Gagnon et Denis Goulet s’intéressent aux bourses d’études à l’étranger du gouvernement québécois. Deux programmes de bourses retiennent leur attention, le premier fondé en 1920 et le second, en 1947. Tous deux poursuivaient le même objectif : permettre à des étudiants des cycles supérieurs de parfaire leur formation à l’extérieur du pays, particulièrement en Europe et aux États-Unis. La date d’octroi des premières bourses (1920) et la date d’abolition des deux programmes (1959) sont significatives à plusieurs égards. L’abolition des programmes en 1959 rappelle que les grandes réformes des années 1960 emportent avec elles les politiques publiques des gouvernements précédents au profit d’une nouvelle vision de l’État et d’une diversification du soutien accordé aux étudiants. La création du premier programme en 1920 rappelle, quant à elle, que le Québec n’a pas attendu la Révolution tranquille pour se transformer de l’intérieur. En cela, entretenir l’idée de « grande noirceur » masque souvent le fait que la société québécoise n’a jamais été statique ou figée, elle qui, au contraire, se transformait bel et bien grâce aux multiples institutions mises en place depuis le xixe siècle. Nous n’avons qu’à penser à la création de l’École Polytechnique de Montréal en 1873, à l’autonomisation de l’Université de Montréal en 1920, à la création de l’ACFAS quelques années plus tard, à l’ouverture de l’École des mines de l’Université Laval dans les années 1930 et à tous les autres établissements qui ont contribué à former et à soutenir des générations de jeunes francophones qui ont profondément influencé le devenir de leur société. C’est en partie à cette élite francophone que le livre de Gagnon et de Goulet s’intéresse. De fait, bien que le titre fasse référence aux « bourses d’études », c’est davantage le parcours des boursiers qui est au coeur de l’ouvrage. À travers l’histoire des deux programmes de bourses, c’est l’histoire d’une élite en formation dont il est question. Une élite certes, mais une élite relativement nombreuse, puisque les deux programmes ont soutenu plus de 1000 boursiers pendant leurs années d’existence. Si certains d’entre eux ont par la suite pris leur place dans le champ universitaire à titre de professeurs ou d’administrateurs, ramenant avec eux un habitus de chercheurs dans des universités québécoises largement dédiées à l’enseignement, plusieurs autres se sont retrouvés dans la haute fonction publique, à la tête de sociétés d’État comme Hydro-Québec, dans l’arène politique en tant qu’élus, dans le champ économique comme fondateurs de grandes entreprises et même, fréquemment, dans le champ artistique dans des domaines aussi variés que la musique ou la sculpture. Puisque les boursiers n’ont jamais véritablement constitué un groupe social cohérent, malgré les tentatives de l’éphémère Association des anciens étudiants d’Europe fondée en 1928, c’est à titre individuel qu’ils ont contribué à ce que Gagnon et Goulet nomment le « processus de modernisation du Québec ». Sans surprise, on constate que cette élite n’était pas sans capital hérité. Les auteurs signalent que les programmes de bourses ont aussi contribué à la reproduction sociale, plusieurs des boursiers ayant reçu de leur environnement familial un bagage important de capitaux, qu’ils soient culturels, sociaux ou économiques. Le mot d’ordre n’était donc pas celui de la démocratisation de l’enseignement supérieur, comme ce fut davantage le cas à partir des années 1960, notamment avec l’entrée rapide des femmes dans les universités. Toutefois, réduire les programmes à un simple mécanisme de reproduction serait trompeur. Certains candidats, perçus comme trop nantis pour recevoir le soutien de l’État, se sont même vu refuser une bourse en raison de leur appartenance à la haute bourgeoisie. C’est même vraisemblablement …
Robert Gagnon et Denis Goulet. La formation d’une élite : les bourses d’études à l’étranger du gouvernement québécois (1920-1959), Montréal, Éditions du Boréal, 2020, 544 p.[Record]
…more information
Maxime Colleret
Université du Québec à Montréal