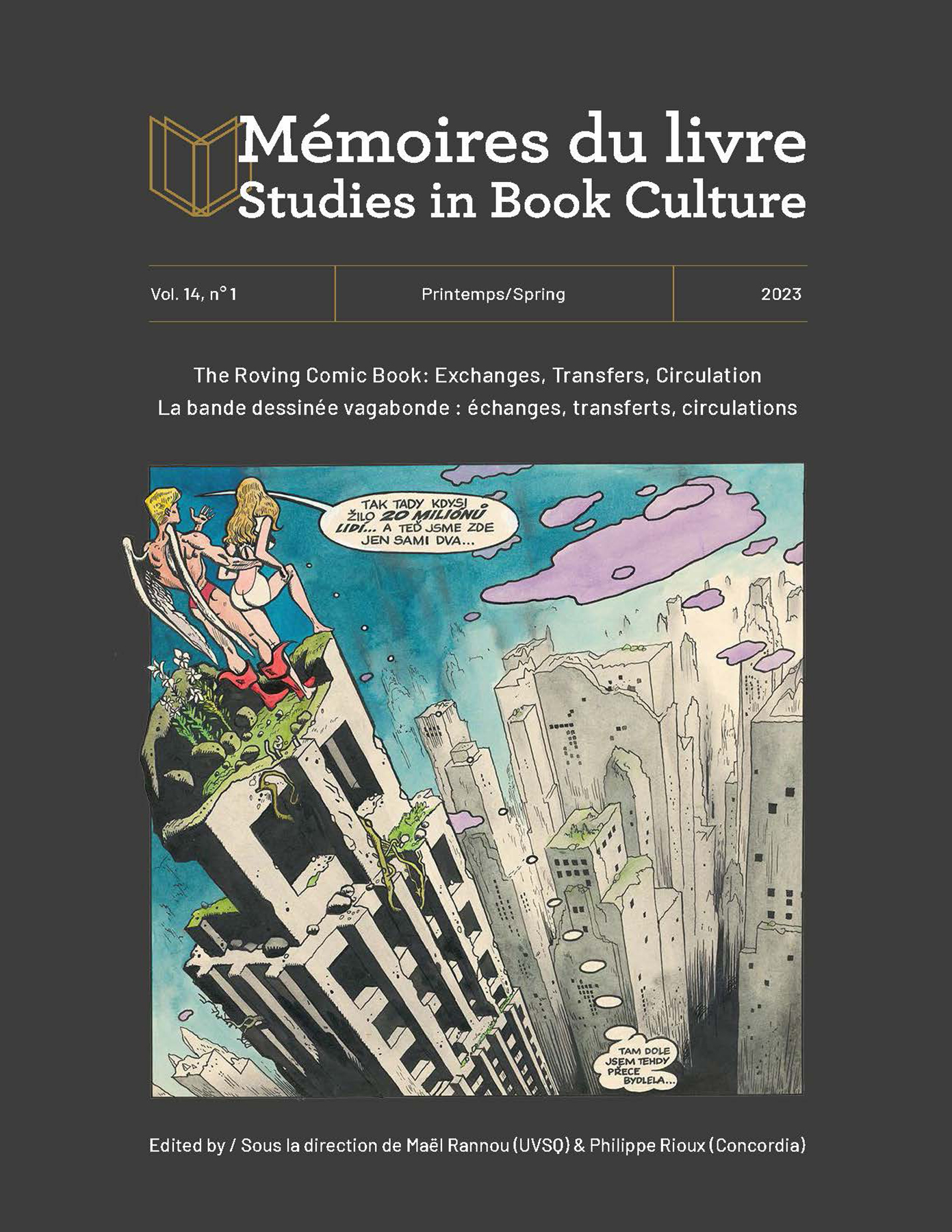Abstracts
Résumé
Les pratiques professionnelles liées à la sphère d’influence de la télévision et les adaptations transmédiatiques jouent historiquement un rôle majeur dans les transferts culturels du manga en France, en Italie et en Espagne à la fin des années 1970. Déviées de leur circuit de communication initial pour être reterritorialisées dans un contexte non prévu, les oeuvres japonaises subissent de multiples transformations afin de correspondre aux conventions locales. Les entreprises locales créent des adaptations de dessins animés dérivés de mangas avant d’importer des oeuvres japonaises en les modifiant selon les besoins de leurs réseaux de diffusion. Si la fiction peut circuler de manière globale en s’incarnant dans différents médias, le format reste un élément fortement contextualisé plus difficile à déterritorialiser : il matérialise en effet une histoire des pratiques de création et de réception distincte selon les pays.
Mots-clés :
- manga,
- télévision,
- adaptation,
- bande dessinée,
- globalisation
Abstract
Professional practices related to the sphere of influence of television and transmedia adaptations played a significant historical role in the cultural transfer of manga in France, Italy and Spain in the late 1970s. Diverted from their initial communication circuit in order to be reterritorialized in an unintended context, Japanese comic books underwent multiple transformations in order to correspond to local conventions. Local companies created cartoon adaptations of manga before importing Japanese works by modifying them according to the needs of their distribution networks. If fiction can circulate globally by being embodied in different media, the format remains a strongly contextualized element that is more difficult to deterritorialize: it materializes a history of creation and reception practices, distinct for each country.
Keywords:
- manga,
- television,
- adaptation,
- bande dessinée,
- globalization
Article body
Lorsque les historiens Michael Werner et Michel Espagne introduisent la notion de transfert culturel, ils s’attachent surtout au travail des médiateurs en matière de pratiques discursives et institutionnelles. De leur côté, les chercheurs s’intéressant aux médias tendent à s’appuyer sur l’analyse des échanges commerciaux légaux et la circulation transnationale de produits culturels pour déterminer les rapports de forces entre différents pays et le rayonnement culturel d’une nation[1]. Face au flux dominant américain, il y a des « contre‑flux[2] » constitués par les productions développées dans des pays non occidentaux (films de Bollywood, dramas coréens, télénovelas d’Amérique du Sud) qui forment des réseaux d’influence régionaux[3].
Dans les deux cas, les analyses peinent à prendre en compte les transformations des pratiques de consommation des fictions contemporaines et les relations d’interdépendance entre les médias à l’échelle locale. En effet, la circulation de la bande dessinée japonaise en Europe du Sud (France, Italie, Espagne) est avant tout liée à un changement du paysage audiovisuel européen. C’est par le biais des adaptations de séries télévisées en bandes dessinées que les premiers mangas à succès ont été traduits.
En s’appuyant sur une perspective historique, cette étude vise à montrer l’importance des adaptations transmédiatiques dans les transferts culturels. Après avoir rappelé l’appartenance d’un pan de la bande dessinée à la sphère d’influence de la télévision, puis les changements du paysage audiovisuel en Europe du Sud, nous examinerons plusieurs cas de « bédéisations[4] » montrant les transformations liées à la déterritorialisation, mais aussi les différences de pratiques de production à l’échelle régionale lors de la reterritorialisation : la France, l’Espagne et l’Italie adoptent des pratiques distinctes sur le plan des formats et des contenus.
La bande dessinée dans l’économie télévisuelle
Le découpage en disciplines universitaires contribue à rendre difficiles les études sur des objets non identifiés par l’institution, ce qui entraîne un certain biais dans les analyses : les chercheurs tendent à rapprocher ces arts mineurs des pratiques plus prestigieuses afin d’étendre une partie de la reconnaissance sociale de ces dernières. Les études sur les liens entre la bande dessinée et la littérature[5] ou le cinéma[6] ne manquent pas. En revanche, peu d’articles prennent pour sujet la bande dessinée en tant qu’adaptation d’un média moins prestigieux, ou en tant que produit dérivé. Or, ce média est le « bâtard de l’art et du commerce » selon Art Spiegelman[7].
Ian Gordon consacre un ouvrage aux comics en tant que produits de consommation, mais il ne traite que d’une période ancienne (1890‑1945)[8]. Plus récemment, à la suite des études sur le transmedia storytelling de Henry Jenkins[9], plusieurs ouvrages montrent l’importance économique des adaptations, mais ils restent focalisés sur les liens avec des médias plus reconnus comme le cinéma[10]. Il n’y pas vraiment d’études sur la bande dessinée comme produit dérivé de la télévision, bien que cette production ait un poids économique considérable. Michael G. Rhode rappelle que certaines sociétés se spécialisent dans la bande dessinée comme exploitation de licences préexistantes[11]. Paul Lopes et Jean‑Paul Gabilliet consacrent également un court paragraphe aux adaptations de séries télévisées en comic books par Dell et Gold Key dans les années 1960[12].
Ce secteur américain de l’adaptation de feuilletons télévisés en bandes dessinées s’exporte ensuite en dehors des États‑Unis, en suivant les trajectoires des séries télévisées originales. Publiée en 1962 chez Dell, la transposition du feuilleton The Untouchables (1959‑1963) en comic book est traduite par ARTFI en 1966, à la suite du succès de la série diffusée à la télévision espagnole à partir de 1964[13]. De même, l’arrivée de Bonanza[14] (1959‑1973) à la télévision espagnole entraîne la publication des adaptations de Dell produites entre 1962 et 1970 aux éditions Laida, dans la collection « Telexito ». Celle‑ci rassemble des adaptations de dessins animés et de séries télévisées généralement traduites de l’anglais.
Ces éditeurs reprennent en réalité les pratiques instaurées par Novaro, une société mexicaine qui traduit en espagnol les adaptations de Dell depuis les années 1950. Ces versions mexicaines ont été diffusées en Espagne à la fin des années 1950 par Queromón Editores. À une époque où le marché espagnol est dominé par la bande dessinée en noir et blanc, ces histoires originales en couleur ont eu un succès immédiat, car elles mettent en scène des héros déjà popularisés à la télévision.
En France, l’Office de radiodiffusion‑télévision française (ORTF) diffuse la série Bonanza en 1965 et, la même année, l’éditeur Sage lance son magazine Bonanza, comprenant des planches américaines traduites en français et des traductions d’autres comics. Après la fin du magazine en 1974, les planches de Bonanza paraissent dans la collection « Vedettes TV » (1976 et 1979) et dans le magazine Rintintin et Rusty (1976‑1984). Comme en Espagne, le format standard de la bande dessinée en presse comprend plus de pages que celui qui est pratiqué aux États‑Unis. Les versions américaines étant insuffisantes pour le volume de lecteurs français, Sage publie ensuite des planches créées par Ferdinando Fusco, dessinateur italien vivant en France. Celui‑ci a aussi réalisé pour Sage d’autres adaptations en bandes dessinées de feuilletons américains dont Rin Tin Tin (1954‑1959) et Le cheval de fer (1966‑1968).
Le succès de ces bédéisations américaines entraîne l’adaptation de feuilletons français en bandes dessinées. Par exemple, Thierry la Fronde (1963‑1966) devient une bande dessinée publiée aux éditions Oz sous la forme d’un volume en petit format et dans la collection « Télé série verte » entre 1964 et 1966. D’autres séries sont également déclinées en bandes dessinées, dont Les Brigades du Tigre[15] et Fantômas[16].
Les adaptations transmédiatiques voyagent ainsi des États‑Unis à l’Europe en passant par le Mexique avant que la pratique ne s’installe définitivement chez les professionnels, au point que les marchés locaux créent leurs propres versions. Autrement dit, ce qui circule n’est pas seulement l’objet lui‑même (adaptation traduite), mais également les conventions de production de l’objet (création d’adaptation par les entreprises locales).
Cette pratique de bédéisation s’intensifie à mesure que la télévision prend une part grandissante dans les pratiques de loisir[17]. La concurrence entre l’audiovisuel et les supports imprimés se perçoit en fait de temps de loisir. En 1973, 41 % des Français de 15‑24 ans déclaraient avoir lu 20 livres ou plus par an; ils ne sont plus que 20 % en 1997[18]. Cette diminution du temps de lecture est renforcée par la multiplication des chaînes télévisées[19] et l’augmentation du temps de diffusion[20]. En 1953, la télévision française ne diffusait que 30 heures d’émissions hebdomadaires, alors qu’en 1988 TF1 diffuse à elle seule 27 heures hebdomadaires d’émissions pour la jeunesse. Celles‑ci constituent une véritable culture enfantine, car même si les illustrés et albums restent importants, le petit écran « offre le “fond commun” des conversations des cours de récréation[21] » : 74 % des enfants interrogés citent la télévision comme sujet de conversation avec leurs camarades.
Cette nouvelle configuration des loisirs enfantins est identique à celle de l’Italie et de l’Espagne, où la création de chaînes privées et locales a favorisé l’explosion des émissions destinées à la jeunesse et l’importation de dessins animés japonais. Daniel Ferrera revient sur l’importance de ces séries dans la programmation des chaînes nationales en Espagne[22]. Mais le succès des animes est initialement lié à la création de chaînes locales durant la phase de transition démocratique[23]. Les régions ayant la plus forte demande d’autonomie sont celles qui ont constitué le plus tôt leur canal de diffusion télévisé et elles alimentent leur programmation de dessins animés doublés dans les langues locales[24]. Le paysage audiovisuel italien est également marqué par la multiplication des stations de radiodiffusion dès les années 1970[25]. Dans les trois pays, la libéralisation du marché audiovisuel et la concurrence entre le secteur public et les chaînes privées favorisent l’importation des séries japonaises perçues comme produits d’appel peu coûteux.
C’est dans ce contexte audiovisuel spécifique que les entrepreneurs de la presse ont transposé les pratiques éditoriales de bédéisation des séries importées des États‑Unis à l’adaptation des dessins animés. Ces bandes dessinées réalisées en Europe reprennent les graphismes japonais et permettent au jeune public de retrouver les héros du petit écran. Elles ont d’autant plus de succès que cette audience a une pratique de consommation intensive que les moyens techniques de l’époque ne leur permettent pas d’assouvir. En effet, s’il est aujourd’hui possible de regarder la même vidéo en boucle, dans les années 1970, le magnétoscope restait un produit de luxe encore peu installé dans les foyers. Pour retrouver le plaisir de la fiction, les enfants n’avaient pas d’autres choix que de lire les adaptations en bandes dessinées et consommer les produits dérivés à leur disposition sur le marché local : affiches, autocollants, etc.
Ces bédéisations témoignent de la sphère d’influence de la télévision comme premier lieu de divertissement. D’ailleurs, la référence à la télévision apparaît soit dans le nom de la collection[26], soit dans une mention « vu à la TV », soit dans l’apposition d’un logo de chaîne en couverture[27]. S’il y a bien un « effet livre[28] » qui tend à déplacer la bande dessinée de la presse à la librairie afin d’apporter une forme de consécration symbolique, il y a aussi le mouvement inverse d’une marginalisation du support magazine qui devient à partir des années 1960 un objet dérivé de la télévision.
« Manga » made in Europe
La majorité des bédéisations sont conçues comme des produits dérivés à durée de vie limitée, visant à prolonger et soutenir l’enthousiasme du public pour les émissions télévisées. Destinées à accroître la visibilité d’une série sur différents supports, elles entraînent la création d’un cercle vertueux : la diffusion télévisée incite le public à acheter les publications sur papier et celles‑ci poussent en retour les lecteurs à suivre la série au petit écran. Par ailleurs, ces magazines offrent un contexte idéal pour faire la promotion des autres produits dérivés (jeux, jouets, objets divers, produits alimentaires…). Ainsi, les bédéisations s’inscrivent plus dans une économie de la télévision que dans celle du livre.
La première adaptation de séries japonaises en BD est espagnole : Las bellas historias de Heidi, hebdomadaire réalisé par des artistes espagnols pour l’éditeur barcelonais Bruguera. Dès 1975, la série télévisée était diffusée en Espagne sur RTVE et la version barcelonaise reprend le design des personnages en ajoutant de nouveaux récits inédits. Les droits d’exploitation en bande dessinée ont été achetés aux Allemands de München Merchandising qui détenaient la licence pour l’Europe. Les Japonais n’ont pas été inclus dans la boucle de production ni même au courant de la création de cette bande dessinée. Cela est d’autant plus étonnant que, parallèlement au Japon, Heidi a fait l’objet d’une adaptation en bande dessinée sous forme d’anime comics, forme de bande dessinée réalisée à partir des photogrammes de la série télévisée.
La situation française est comparable à celle de l’Espagne et de l’Italie. À la suite de la diffusion du Prince Saphir (Ribbon no kishi, 1967‑1968) en 1974 sur l’ORTF, Whitman‑France publie l’album Les Aventures de Prince Saphire en 1976 et une bédéisation paraît dans Télé Junior en 1977[29]. Personne ne semble savoir que la série réalisée par Osamu Tezuka est l’adaptation de son propre manga. Les intermédiaires de l’édition française procèdent avec la série japonaise comme ils travaillent avec les autres matériaux audiovisuels. D’ailleurs, le dessinateur, Norbert Fersen, qui a travaillé pour Pilote et Tintin, est connu pour ses adaptations d’émissions télévisées comme Le Manège enchanté et L’Île aux enfants.
La plupart des bédéisations espagnoles ont été ensuite commercialisées en Italie, où d’autres entrepreneurs opportunistes profitent de la popularité des dessins animés. Ainsi, la traduction de Las bellas historias de Heidi est publiée par la société Ediboy sous la forme d’un hebdomadaire en kiosque : le fascicule comporte 16 pages en couleurs au format 18,8 x 24,6 cm et coûte 250 lires[30]. Le premier numéro est lancé le 24 février 1978, 10 jours après la diffusion télévisée italienne. Le succès de Heidi en kiosque en Italie a poussé d’autres éditeurs à exploiter la popularité des personnages de séries animées sous forme d’adaptations en bandes dessinées vendues sur le circuit du livre et celui de la presse. Ces récits sont avant tout conçus comme des produits dérivés des séries télévisées. D’ailleurs, les éditeurs achetaient les droits d’exploitation à la SACIS, régie publicitaire et société de gestion des droits dérivés de la RAI (Radiotelevisione italiana), et non aux ayants droit japonais.
De son côté, ERI, la maison d’édition de Turin appartenant à la RAI, a également fait appel à différents studios italiens pour produire des bédéisations destinées au Radiocorriere TV, magazine officiel de la chaîne. Mais la plupart ont fait l’objet d’exploitations à part dans l’hebdomadaire Il Trenino della TV (octobre 1978), qui est ensuite renommé TV Junior à partir d’avril 1979. La plupart des planches sont réalisées par des artistes et studios italiens : Immagini e Parole, Bierrecì, Studio Smack, Staff di If, Studio Farina, Edistudio et Cartoon Studio[31].
En raison du succès commercial des bédéisations, les groupes d’édition plus traditionnels se lancent également sur ce marché opportuniste et très concurrentiel qui comprenait initialement la filiale presse de la RAI et de petits entrepreneurs. L’éditeur Rizzoli[32] a calqué les pratiques d’ERI et son magazine pour enfants Corriere dei Piccoli[33] (« Courrier des petits ») a suivi la même évolution que TV Junior en incluant progressivement des personnages de dessins animés japonais. Une même stratégie est mise en oeuvre dans l’hebdomadaire La banda TV produit par Andrea Mantelli et le Studio Smack[34].
Dans ce contexte de production régionale entre Espagne et Italie, une série a engendré un engouement sans précédent : Goldorak ou, dans sa version italienne, Atlas UFO Robot Goldrake. Les droits d’exploitation pour la fabrication d’autocollants ont été cédés à Rossi, tandis que ceux de la bande dessinée ont été vendus à Edizioni Flash de Giovanni Carozzo. Entre juillet 1978 et février 1982, ce dernier commercialise de nombreuses publications dont les planches sont produites par un studio milanais[35] : le mensuel Telestory (Atlas Ufo Robot), Atlas Ufo Robot presenta Goldrake (mensuel), Actarus (mensuel), Super raccolta Atlas Ufo Robot (mensuel), TV Special Star Blazers (one shot), La battaglia dei pianeti (Gatchaman, hebdomadaire; Gatchaman la Battaglia dei pianeti, mensuel).
Outre les adaptations officielles créées en Italie pour le marché local, des bédéisations non autorisées ont également été produites par un studio milanais pour la revue Telefumetto de l’éditeur Epierre[36]. Une autre méthode pour contourner l’achat des droits d’exploitation à la SACIS est d’acquérir une licence auprès de l’ayant droit original, certains animes étant des adaptations de romans européens. Publiées sans les droits italiens d’exploitation officielle ou avec des détours juridiques, ces bandes dessinées à la durée de vie limitée visent à profiter de l’exposition médiatique à la télévision. Cette technique est semblable à celles de certaines productions actuelles de jeux ou films qui ont des noms très proches des blockbusters, ce qui induit souvent en erreur les consommateurs.
Une grande partie des fascicules italiens et espagnols se retrouvent rapidement sur le marché français sous forme de traductions. La transition est facilitée par la proximité linguistique, la similarité des habitudes de consommation (revues à bas coût en kiosque), la ressemblance des formats (récits courts en couleurs) et de la programmation télévisée[37].
Parmi les éditeurs, on compte Junior Productions de Franklin Loufrani qui produit Télé Junior[38], Télé Parade et Télé BD. Une adaptation de Goldorak en bande dessinée réalisée par les Français Sacha et Jorge Domenech paraît dans Télé Junior à partir du numéro 13 (31 août 1978). De son côté, la société Éditions Télé Guide publie également des bandes dessinées dérivées des séries télévisées[39]. Ainsi, le premier numéro du magazine Goldorak est tiré à 150 000 exemplaires et obtient un score de 90 % de vente[40]. En plus du Télé Guide Goldorak, mensuel puis bimensuel avec bandes dessinées, coloriages et affiches, il y a le Télé Guide Goldorak Pocket mensuel avec uniquement des bédéisations, puis le Télé Guide Goldorak Super Pocket[41], et enfin un album publié en coédition avec Jean Chapelle Éditeur : Goldorak, Racines d’acier avec un scénario de Michel Rebichon et des dessins de Frank Chesqui (1979).
L’adaptation en bande dessinée semble n’être qu’un prétexte pour faire acheter un catalogue publicitaire déguisé sous la forme d’un magazine. La présence de nombreuses publicités manifeste également le fait que les acheteurs sont considérés comme de potentiels consommateurs prêts à collectionner tous les items en lien avec leurs héros favoris. Par exemple, le « Club des amis de Goldorak » compte 25 000 membres en 1979[42], ce qui correspond à un public captif à qui l’on peut envoyer des informations concernant de nouveaux produits. Dans le cas de Goldorak, le succès commercial est donc immense. Le chiffre d’affaires engendré par les adaptations et produits dérivés est ensuite réparti entre la chaîne, les ayants droit originaux et l’intermédiaire. La directrice des programmes jeunesse d’Antenne 2 déclarait en 1980 : « À ce jour le chiffre d’affaires de Goldorak, en France, atteint un milliard de centimes[43]. »
La plupart de ces bandes dessinées sont avant tout considérées comme des produits dérivés de peu de valeur symbolique. Cette déconsidération se perçoit à travers l’usage de pseudonymes et l’effacement de la plupart des noms[44]. Sur le plan graphique, les dessinateurs européens imitent le style des Japonais en redessinant parfois des images de la série. Les couleurs sont semblables à celles qui sont utilisées dans les comics de l’époque. L’exotisme du graphisme est en quelque sorte désamorcé par la narration et le format de publication. Ces adaptations sont avant tout des produits conçus pour un public européen n’ayant aucune idée des standards de publication des originaux japonais qui sont généralement en noir et blanc.
Ces bédéisations européennes et les nombreux produits dérivés élaborés pour être vendus en même temps que la diffusion télévisée sont des produits supplétifs servant à combler l’attente du prochain épisode, à se remémorer les événements visionnés précédemment, à jouer et interagir avec des éléments du monde fictif. Tous ces produits sont à mettre en lien avec d’autres activités du jeune public, que pratiquent souvent les fans : redessiner des personnages, créer des récits dérivés, et incarner les personnages dans des jeux de rôle informels dans les cours de récréation. En tant qu’objets matériels, ils s’échangent et sont exposés à la vue des autres. Ils participent à une fonction socialisante autour de la fiction.
Destins contrastés de Candy et Dragon Ball
Ces bédéisations d’animes par les sociétés locales témoignent du flou juridique lié à une mauvaise communication entre l’Europe et le Japon. En effet, même si, théoriquement, les possibilités de dialogue et d’information existent, en pratique les ayants droit japonais ne sont pas vraiment au courant de ce qui se fait en Europe et inversement. C’est dans ce contexte particulier de la fin des années 1970 que des premiers mangas sont traduits. Contrairement aux autres éditeurs faisant appel à une main‑d’oeuvre régionale pour redessiner des séries télévisées, l’éditeur italien Fabbri[45] est allé à la source pour acheter les droits de l’oeuvre originale dont l’anime est une adaptation. Il est le premier éditeur européen à commercialiser avec succès un manga pour enfant en adaptant le format japonais aux habitudes de consommation italiennes[46].
Les récits sont publiés dans le sens de lecture occidental et colorisés pour être commercialisés sous forme de magazines hebdomadaires. Au lieu de regrouper toutes les séries en un volume, Fabbri procède à une segmentation par genre avec, d’un côté, la revue pour garçons et son manga de robot Il Grande Mazinga[47] et, de l’autre, la revue pour jeunes filles et son manga sentimental Candy Candy. Plus encore, après la traduction du manga original dans les 77 premiers volumes de l’hebdomadaire, les dessinateurs italiens ont élaboré une continuation allographe. Le magazine compte 326 parutions entre 1980 et 1986 sous le titre Candy Candy, puis CandyCandy TV‑Junior à partir du n° 175 et Candy‑issima à partir du n° 241. Alors que d’autres tentatives d’introduction du manga en Europe ne donnent pas vraiment de suite, ces magazines pour enfants constituent une première réussite commerciale.
Les succès de Fabbri entraînent la traduction d’autres titres en italien, mais elle s’effectue toujours dans le cadre de magazines liés à la télévision[48]. Toutefois, à la suite des polémiques suscitées par la supposée mauvaise influence de ces séries sur les enfants, les chaînes diminuent progressivement leur diffusion. La multiplication des rediffusions et la démocratisation du magnétoscope favorisent la fin du marché des bédéisations après 1985. Les téléspectateurs peuvent facilement revoir un épisode au lieu de lire une version adaptée en BD.
Notons également que la continuation de Candy Candy par les Italiens n’a pas été publiée au Japon, alors que dans le cas des magazines produits par Disney, les planches italiennes sont ensuite traduites et diffusées à l’international. Précisons qu’à cette époque les ayants droit japonais ne voyaient pas l’intérêt d’une diversification des centres de production ou des centres de profit puisque le marché intérieur était largement suffisant.
Autrement dit, la diffusion du manga en Europe du Sud n’est pas liée à une volonté de glocalisation des éditeurs japonais, qui laisseraient les intermédiaires locaux adapter leurs produits culturels aux formats locaux[49]. Il s’agit avant tout d’une initiative locale des intermédiaires qui dévient l’oeuvre originale de sa trajectoire normale (créée par un artiste japonais pour un public japonais) pour un nouveau public n’ayant pas le même horizon d’attente. La démarche de Fabbri (acquérir les droits de traduction du manga original) est si différente de celle des autres sociétés de l’époque que peu l’imitent.
En revanche, la traduction italienne colorisée de Fabbri a ensuite été diffusée en France à partir de 1982 sous la forme du mensuel Candy Candy Poche[50]. La version française ne comporte que 12 numéros s’étalant sur une année[51]. Pour le public comme pour les éditeurs, Candy Candy Poche n’est qu’un produit presse comme un autre. En effet, le dessin animé était parallèlement décliné en bandes dessinées par des Européens aux Éditions Télé Guide, en magazine mensuel (Candy Candy)[52] et en recueil de BD mensuel (Spécial Candy)[53]. Ainsi, le succès commercial du premier manga pour enfants passe totalement inaperçu dans l’Hexagone. D’ailleurs, lorsque l’éditeur Kodansha propose une version française de Candy Candy en 1993, celle‑ci passe pour être la première traduction française de l’oeuvre[54].
Non seulement les intermédiaires de l’Hexagone ne cherchent pas à traduire les oeuvres originales, mais ils font évoluer les processus de bédéisation pour qu’ils soient plus rentables. Au lieu de commander des planches à des dessinateurs, la société AB Productions, qui développe l’émission Club Dorothée et le magazine officiel, réinvente ce que les Japonais désignent comme étant un anime comics, c’est‑à‑dire des photogrammes agrémentés de bulles et disposés de manière à imiter des planches de bande dessinée. Publiées au sein du Dorothée Mag en kiosque, puis sous forme de livres, ces adaptations jouent le même rôle que les précédentes formes de bédéisation[55]. Elles tirent profit de la visibilité médiatique d’une série afin de l’exploiter sous forme de produits dérivés peu coûteux et dont la durée de vie est liée au temps de diffusion télévisée.
Les dessins animés étant diffusés avant que les originaux ne soient publiés, certains ont sans doute pu croire que les mangas étaient des produits dérivés des animes. D’ailleurs, il y a eu un problème de publications officielles mais non légales : un livret à part de 64 pages d’un manga traduit du japonais était donné en supplément du magazine Dorothée Spécial histoires complètes en 1992. Le premier fascicule comprenait des planches inédites de City Hunter et le second de Dragon Ball. Dans les deux cas, le manga traduit est présenté comme une « histoire complète », publié au format 14 x 20 cm, en noir et blanc, mais dans un sens de lecture français et avec des éléments redessinés afin de faire disparaître les onomatopées japonaises. Or, si AB Productions détenait bien les droits d’exploitation des séries télévisées, la société n’avait pas celui de publier les mangas originaux. Cet incident montre qu’en ce qui concerne les intermédiaires français, la chronologie des médias et la distinction entre l’oeuvre originale et l’adaptation (et la cascade des ayants droits japonais selon les supports) ne semblaient pas évidentes, ce qui explique qu’elles le soient encore moins auprès du grand public à cette époque.
La première publication de Dragon Ball se fait en France sur un malentendu juridique, mais en Espagne elle permet d’établir les fondations durables du marché du manga en Europe. Initialement, le directeur de Planeta DeAgostini Comics souhaitait produire une bédéisation de l’anime. Son succès était tel que les jeunes téléspectateurs ont fait émerger un marché non légal où les enfants s’échangeaient et vendaient des objets qu’ils produisaient eux‑mêmes. Dans les images extraites d’un reportage télévisé de 1993 sur TV3 et reprises dans le documentaire vidéo Songokumanía: El Big Bang del Manga[56], des enfants espagnols s’échangent des photocopies du Dorothée Magazine français comportant des BD réalisées à partir de photogrammes.
La vente des droits d’exploitation de Dragon Ball aux Espagnols est l’une des anecdotes les plus connues dans le milieu de l’édition du manga et elle témoigne du désintérêt initial des Japonais pour l’exportation de leurs bandes dessinées. La société Planeta DeAgostini Comics aurait tenté de joindre la maison d’édition Shūeisha pendant plus de six mois avant que l’agence Tuttle‑Mori, spécialisée dans la gestion et la vente de droits, ne la contacte et lui serve d’intermédiaire. Casey Brienza a recueilli le témoignage d’un agent littéraire travaillant chez Tuttle‑Mori qui souligne le désarroi des éditeurs japonais face aux fax de Barcelone[57]. Dans les années 1990, Shūeisha ne possédait pas de département pour gérer les droits internationaux. Dragon Ball a été la première série de Shūeisha vendue en Occident et la publication du manga en catalan et castillan est la première version de cette série en dehors du Japon.
Nommée « Serie blanca », cette première édition hebdomadaire en kiosque est un succès commercial[58]. Elle est suivie de la « Serie roja » dont les chapitres correspondent aux épisodes alors diffusés à la télévision, alors que la série blanche reprenait les chapitres japonais depuis le début. Cette double publication en kiosque s’accompagne d’une parution sous forme de volume relié en librairie.
Les responsables de Planeta DeAgostini Comics ont adopté un format comics, puisque c’était celui qu’ils utilisaient pour le reste de leur catalogue constitué de traductions de comics américains en catalan et en castillan. Les pages étaient inversées, car ils estimaient que les jeunes lecteurs pouvaient être perturbés par une lecture dans le sens japonais alors qu’ils étaient en plein apprentissage de la langue espagnole. Les pratiques conventionnelles au sein de cette maison d’édition et les craintes quant aux compétences de lecture du public influencent ainsi la traduction et la forme matérielle de la bande dessinée japonaise.
L’importation de mangas en Europe du Sud est ainsi une conséquence indirecte des changements dans le paysage audiovisuel local : la démocratisation de la télévision au sein des foyers et la progressive autonomisation de ce secteur par rapport à l’État. Alors que les professionnels de la bande dessinée tendent à se tourner vers le format livre et un public plus adulte afin d’acquérir une forme de prestige social, des entrepreneurs occupent le marché de la presse pour la jeunesse en produisant à bas coût des bédéisations de séries télévisées à succès afin de promouvoir des produits dérivés auprès d’un public déjà conquis.
La méconnaissance du contexte de production japonais, où la majorité des animes sont des adaptations, et les conventions du monde de la presse pour la jeunesse expliquent le fait que les sociétés européennes n’ont initialement pas traduit les oeuvres originales. Lorsqu’elles en acquièrent les droits, elles le font avec un objectif d’exploitation à court terme pour profiter de la couverture médiatique. C’est pourquoi le manga est transformé pour correspondre aux habitudes de lecture de la bande dessinée locale. Cette forme de « domestication[59] » assure aux séries un succès considérable.
***
À travers l’historique des adaptations en bandes dessinées entreprises par les éditeurs américains, traduites au Mexique, exportées en Europe, puis créées par des sociétés locales, il est remarquable de voir à quel point la circulation et la transformation d’un objet ont un impact sur les territoires qui l’accueillent. D’autre part, cette analyse permet de constater que les circulations internationales n’aboutissent pas à une uniformisation des pratiques. Si la fiction peut circuler de manière globale en s’incarnant dans différents médias, le format est un élément fortement contextualisé plus difficile à déterritorialiser. Il constitue la matérialisation d’une histoire des pratiques de création et de réception.
Les oeuvres ayant ainsi été déviées de leur cercle de communication initial pour être reterritorialisées dans un contexte non prévu, elles ont fait l’objet de multiples transformations afin de correspondre aux conventions de production et aux pratiques de réception locales. Contrairement à la glocalisation qui prend en compte dès l’origine du projet créatif une diffusion mondiale (avec des adaptations locales gérées par des filiales transnationales), le manga a subi ce que nous désignons par le terme « déviation » : une trajectoire non prévue par les créateurs, difficile à gérer pour des ayants droit, soumise aux aléas des intermédiaires locaux. Les frictions engendrées par la glocalisation sont minimes, alors que celles que déclenche la déviation sont imprévisibles, ce qui les rend d’autant plus intéressantes pour comprendre l’évolution des horizons d’attente des publics et des pratiques professionnelles.
Appendices
Note biographique
Agrégée de lettres modernes, Bounthavy Suvilay est titulaire d’un doctorat en littérature. Sa thèse est publiée aux Presses universitaires de Liège : Dragon Ball, une histoire française. Elle a aussi publié La culture manga aux Presses universitaires Blaise Pascal. Ses recherches portent sur les transformations liées aux adaptations des récits de fiction dans différents médias et leurs impacts sur les réceptions divergentes des oeuvres selon les pays. Spécialiste du jeu vidéo, elle a également publié chez Bragelonne Indie Games, série d’ouvrages consacrés aux studios indépendants.
Notes
-
[1]
Cette méthode est notamment utilisée dans les rapports de l’UNESCO sur la diversité culturelle.
-
[2]
Voir Dayan Kishan Thussu, Media on the Move: Global Flow and Contra‑Flow, Londres, Routledge, 2007.
-
[3]
Koichi Iwabuchi a montré l’influence grandissante du Japon sur l’Asie du Sud‑Est. Voir Koichi Iwabuchi, Recentering Globalization: Popular Culture and Japanese Transnationalism, Durham, Duke University Press, 2002.
-
[4]
Nous utiliserons ce terme pour désigner les adaptations d’un autre média en bande dessinée (qu’elle se rapproche du comic book, du manga ou d’autres formats).
-
[5]
Jan Baetens, Adaptation et bande dessinée. Éloge de la fidélité, Bruxelles, Les Impressions Nouvelles, coll. « Traverses », 2020, 228 p.
-
[6]
André Gaudreault et Thierry Groensteen (dir.), La Transécriture. Pour une théorie de l’adaptation. Littérature, cinéma, bande dessinée, théâtre, clip, Québec/Angoulême, Éditions Nota bene/Centre national de la bande dessinée et de l’image, 1998; Blair Davis, Movie Comics: Page to Screen/Screen to Page, New Brunswick, Rutgers University Press, 2017; Barry Keith Grant et Scott Henderson (dir.), Comics and Pop Culture, Austin, University of Texas Press, 2019.
-
[7]
Art Spiegelman, « Birth of the Comics », The New Yorker, 24 décembre 1993‑2 janvier 1994, p. 106‑107.
-
[8]
Ian Gordon, Comic Strips and Consumer Culture (1890‑1945), Washington, Smithsonian, 2002.
-
[9]
Henry Jenkins, Convergence Culture: Where Old and New Media Collide, New York, New York University Press, 2006.
-
[10]
Dans son ouvrage, Derek Johnson s’intéresse surtout aux adaptations de BD au cinéma et à la télévision. Voir Derek Johnson, Media Franchising, Creative License and Collaboration in the Culture Industries, New York, New York University Press, 2013.
-
[11]
Michael G. Rhode, « The Commercialization of Comics: A Broad Historical Overview », International Journal of Comic Art, vol. 1, no 2, automne 1999.
-
[12]
Paul Lopes, Demanding Respect: The Evolution of the American Comic Book, Philadelphie, Temple University Press, 2009 p. 65‑66; Jean‑Paul Gabilliet, Des comics et des hommes. Histoire culturelle des comic books aux États‑Unis, Nantes, Éditions du Temps, 2005, 478 p.
-
[13]
José Miguel Contreras, « El retorno de “Los Intocables” », El Pais, 19 septembre 1987, https://elpais.com/diario/1987/09/20/cultura/559087210_850215.html.
-
[14]
La série est diffusée en Espagne au début des années 1960. Voir Sonia Morales Pérez, « 1962‑1964 : la expansión y el consumo social de la televisión », RTVE.es, https://www.rtve.es/rtve/20170801/expansion-consumo-social-television/1591040.shtml.
-
[15]
Adaptation de Pierre Le Goff pour Télé Junior en 1979.
-
[16]
Adaptation de Sacha et Pierre Frisano pour Télé Junior en 1980.
-
[17]
Philippe Coulangeon, « Le poids de la télévision dans les loisirs : évolution de 1986 à 1998 », dans Olivier Donnat (dir.), Regards croisés sur les pratiques culturelles, Paris, La Documentation française, 2003, p. 283‑301.
-
[18]
Site consulté le 10 octobre 2022, http ://www.pratiquesculturelles.culture.gouv.fr/doc/evolution73-08/T5-LECTURE-REGULIERE-LIVRES.pdf.
-
[19]
Rappelons que la deuxième chaîne est lancée en 1964 et la troisième en 1973. Canal + commence à émettre en 1984. La Cinq, TV6 et La Sept sont créées en 1986. TF1 est privatisée en 1987.
-
[20]
À partir de 1984, motivée par la diffusion d’un journal d’information, l’ouverture de l’antenne le matin a contribué à l’élaboration de nouveaux types de programmes, dont des émissions destinées à la jeunesse proposant des dessins animés avant le départ pour l’école.
-
[21]
Géraldine Poels, Les Trente Glorieuses du téléspectateur. Une histoire de la réception télévisuelle des années 1950 aux années 1980, Bry‑sur‑Marne, INA Éditions, 2015, p. 213.
-
[22]
Daniel Ferrera, « Analysis of anime programming in general television in Spain (1990‑1999) », L’Atalante. Revista de estudios cinematográficos, no 29, 2020, p. 25‑38.
-
[23]
Pablo Pérez López, « Les médias de la démocratie », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, vol. 2, no 74, 2002, p. 113‑130.
-
[24]
Ainsi, Euskal Telebista a été fondée en 1982 pour le Pays basque espagnol, suivie par TV3 en Catalogne (première diffusion en 1983) et Televisión de Galicia à partir de 1985, diffusant leurs émissions en langues locales (respectivement basque, catalan et galicien). Voir Annie Cordelle, « TV3‑Catalunya, audiovisuel et culture catalane, de 1983 à 2006 », thèse de doctorat en histoire des mondes contemporains, sous la direction de Sylvie Dallet, Université de Versailles Saint‑Quentin‑en‑Yvelines, 2015.
-
[25]
Giulia Guazzaloca, « Un amalgame bizarre entre politique et télévision en Italie : du “fief démocrate‑chrétien” au “phénomène Berlusconi” », Le Temps des médias, vol. 13, no 2, 2009, p. 42‑55.
-
[26]
En Espagne, Tele Color (1963‑1968) et Tele Infancia (1966‑1967) de Bruguera, puis Heroes De La Tele (1977‑1983) et Tele‑Historieta (1969‑1983) des Ediciones Recreativas proposent les adaptations en bandes dessinées des dessins animés produits par Hanna et Barbera. Dans Telecomic (1986‑1989) de Planeta DeAgostini, on trouve l’adaptation de la série animée Les Bisounours (1985‑1988).
-
[27]
Entre 1963 et 1967, les éditions OZ publient Télé Série Bleue, Télé Série Jaune, Télé Série Verte, Télé Série Rouge. À la fin des années 1970, Franklin Loufrani fonde une maison d’édition qui publie plusieurs magazines, dont Télé Parade (1978‑1980), Télé Junior (1977‑1983), Télé BD (1978‑1979).
-
[28]
Sylvain Lesage, L’effet livre. Métamorphoses de la bande dessinée, Tours, Presses universitaires François‑Rabelais, 2019.
-
[29]
La trace de cet album n’est visible que sur les sites de vente de particuliers, car le catalogue de la BnF ne le répertorie pas. C’est le cas de la majorité des publications de ce type qui semblent absentes de la base de données malgré l’obligation de dépôt légal. Voir https://web.archive.org/web/20221010134317/https://fr.shopping.rakuten.com/offer/buy/64385983/Les-Aventures-De-Prince-Saphire-Livre.html.
-
[30]
Une centaine de numéros ont été diffusés jusqu’en 1980. L’hebdomadaire a été suivi par un mensuel au contenu similaire paru entre juin et novembre 1978. L’éditeur a également publié des magazines avec jeux et autres activités exploitant le nom Heidi. Il s’agit de Gioca Leggi Colora Heidi : 23 numéros sont parus entre avril 1978 et juin 1980.
-
[31]
Pour plus de détails concernant la production italienne de BD adaptant des animes, voir Claudia Baglini et Cristiano Zacchino, « Manga made in Italy », Immagini & fumetti, no 8, 1999, p. 62‑73; Gianni Bono, Guide de la bande dessinée italienne, Milan, Epierre, 2002.
-
[32]
Fondé en 1927 par Angelo Rizzoli, ce groupe de média comprend la production et la diffusion de quotidiens, de magazines et de livres. En 1974, Rizzoli Editore devient le premier groupe de presse italien après le rachat d’Editoriale Corriere della Sera qui possédait le premier quotidien italien. Après une série de scandales financiers et de rachats, le groupe est rebaptisé RCS MediaGroup (Rizzoli‑Corriere della Sera) en 2003.
-
[33]
Créé en 1908, cet hebdomadaire est le premier magazine italien à publier régulièrement des bandes dessinées pour le public enfant. Il s’agissait initialement d’un supplément illustré du quotidien Corriere della Sera. Le dernier numéro a été publié en 1995.
-
[34]
30 numéros hebdomadaires ont été publiés entre le 13 mars 1980 et le 17 octobre 1980.
-
[35]
La plupart des planches sont réalisées par l’Italien Massimo Pedretti (scénario) et l’Espagnol Joaquin Chacopino (dessins).
-
[36]
10 numéros ont été publiés entre 1979 et 1980.
-
[37]
La création de La Cinq et l’arrivée de Berlusconi n’ont fait qu’accentuer les reprises de programmes entre les deux pays puisque de nombreuses séries ayant connu une diffusion transalpine se retrouvent ensuite dans les émissions françaises.
-
[38]
42 volumes du 1er janvier 1978 au 30 septembre 1980, au format 20,5 x 28,5 cm.
-
[39]
Le responsable du projet est Patrick Manoukian, frère du présentateur de la Nouvelle Star. Il crée en 1987 les Éditions de Tournon, spécialisées dans la presse pour enfants avec des produits dérivés du jeu vidéo ou de la télévision.
-
[40]
Chiffres disponibles dans l’article suivant : Francis Lambert, « Les héros de télé revus et dessinés », Télérama, 9 décembre 1978, p. 33.
-
[41]
Il s’agit de refaçonnage des invendus en couplant deux numéros massicotés pour former un nouveau volume. Ainsi, le n° 11 de la version Super Pocket correspond aux volumes 21 et 22 de la version Pocket.
-
[42]
Agnès Chaveau et Yannick Dehée (dir.), Dictionnaire de la télévision française, Paris, Nouveau Monde Éditions, 2007, p. 281.
-
[43]
Nicole Du Roy, « Les petites Poucet à l’assaut de Goldorak », Télérama, 26 novembre 1980, p. 23.
-
[44]
Dans le cas des Télé Guide Goldorak Pocket, seul apparaît le nom du lettreur, un certain A. Lequéré. Dans certains cas, le « Fine » figurant en récitatif à la fin du chapitre italien n’a même pas été traduit dans la publication en français.
-
[45]
Fondée en 1947 par les frères Fabbri, cette maison d’édition a fait fortune dans le secteur des manuels scolaires, puis dans la publication de classiques de la littérature italienne. Elle est connue pour Conoscere, une encyclopédie illustrée destinée aux enfants, produite durant les années 1960.
-
[46]
Il y a eu d’autres tentatives d’introduction du manga en France mais il s’agissait avant tout de séries destinées à un public adulte. Voir Bounthavy Suvilay, « Le manga, du produit dérivé à un secteur de la bande dessinée à part entière », Colloque international organisé par la Bibliothèque nationale de France / Centre national de la littérature pour la jeunesse en partenariat avec la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image et l’Université Paris 13, 24 nov. 2016, https://www.bnf.fr/fr/mediatheque/le-manga-du-produit-derive-un-secteur-de-la-bande-dessinee-part-entiere.
-
[47]
25 numéros de cette version colorisée par Carla Fiorini ont été publiés entre décembre 1979 et juillet 1980. Ils étaient vendus sous la forme d’un hebdomadaire de 32 pages au format 17 x 24,3 cm. Le fascicule était vendu au prix de 500 lires.
-
[48]
Voir Marco Pellitteri, « Manga In Italy: History of a Powerful Cultural Hybridization », International Journal of Comic Art, vol. 8, no 2, automne 2006, p. 56‑76.
-
[49]
Comme exemple de glocalisation, on peut citer l’insertion de scènes inédites dans la version chinoise du film Iron Man 3 (2013) pour sa distribution sur ce territoire précis. Sur la différence entre déviation et glocalisation, voir Bounthavy Suvilay, Dragon Ball, une histoire française, Liège, Presses universitaires de Liège, 2021, p. 139.
-
[50]
Vendue au tarif de 7 Fr, la publication est au format 150 x 210 mm. Brochée, elle comporte environ 64 pages, mais la pagination est fluctuante (n°1, juin 1982; n°12, mai 1983).
-
[51]
Par ailleurs, la série était déclinée aux Éditions Télé Guide en magazine mensuel, Candy Candy (57 numéros, 5 Fr), en recueil de BD mensuel Spécial Candy (34 numéros, 48 pages, 10 puis 12 Fr).
-
[52]
57 numéros à 5 Fr.
-
[53]
34 numéros d’environ 48 pages vendus 10 puis 12 Fr.
-
[54]
Yumiko Igarashi et Kyoko Mizuki, Candy Candy, Paris, Presses de la Cité, 1993. Il est à noter que la notice est incomplète à la BnF : elle ne comporte pas la mention de TBC. De plus, elle ne référence que le tome 4 sur les neuf volumes publiés. Ces volumes sont disponibles à prix d’or sur les sites comme eBay, car un procès entre les créatrices empêche toute nouvelle republication de la série.
-
[55]
Parmi ces bédéisations réalisées à partir de photogrammes et publiées dans le Dorothée Mag, on compte des adaptations des Chevaliers du Zodiaque et de Juliette, je t’aime.
-
[56]
Oriol Estrada, Songokumanía: El Big Bang del Manga, Sant Cugat del Vallès, Edicions Xandri, 2016.
-
[57]
Casey Brienza, Manga in America: Transnational Book Publishing and the Domestication of Japanese Comics, Londres, Bloomsbury Publishing, 2016.
-
[58]
Le premier numéro est sorti le 3 mai 1992 lors du Salon international de la bande dessinée de Barcelone. La version catalane (Bola de Drac) vendait autour de 100 000 exemplaires par semaine et la version castillane (Dragon Ball) s’écoulait à 50 000 exemplaires hebdomadaires.
-
[59]
Sur les différentes politiques de traduction et d’adaptation du manga, voir Bounthavy Suvilay, « Traduire les best‑sellers du manga : entre “domestication” et “exotisation” », Fixxion, no 15, décembre 2017, p. 189‑201.
Bibliographie
- Jan Baetens, Adaptation et bande dessinée. Éloge de la fidélité, Bruxelles, Les Impressions Nouvelles, coll. « Traverses », 2020.
- Claudia Baglini et Cristiano Zacchino, « Manga made in Italy », Immagini & fumetti, no 8, 1999, p. 62‑73.
- Gianni Bono, Guide de la bande dessinée italienne, Milan, Epierre, 2002.
- Casey Brienza, Manga in America: Transnational Book Publishing and the Domestication of Japanese Comics, Londres, Bloomsbury Publishing, 2016.
- Agnès Chaveau et Yannick Dehée (dir.), Dictionnaire de la télévision française, Paris, Nouveau Monde Éditions, 2007.
- Annie Cordelle, « TV3‑Catalunya, audiovisuel et culture catalane, de 1983 à 2006 », thèse de doctorat en histoire des mondes contemporains, sous la direction de Sylvie Dallet, Université de Versailles Saint‑Quentin‑en‑Yvelines, 2015.
- Philippe Coulangeon, « Le poids de la télévision dans les loisirs : évolution de 1986 à 1998 », dans Olivier Donnat (dir.), Regards croisés sur les pratiques culturelles, Paris, La Documentation française, 2003, p. 283‑301.
- José Miguel Contreras, « El retorno de “Los Intocables” », El Pais, 19 septembre 1987, https://elpais.com/diario/1987/09/20/cultura/559087210_850215.html.
- Blair Davis, Movie Comics: Page to Screen/Screen to Page, New Brunswick, Rutgers University Press, 2017.
- Nicole Du Roy, « Les petites Poucet à l’assaut de Goldorak », Télérama, 26 novembre 1980, p. 23.
- Oriol Estrada, Songokumanía: El Big Bang del Manga, Sant Cugat del Vallès, Edicions Xandri, 2016.
- Daniel Ferrera, « Analysis of anime programming in general television in Spain (1990‑1999) », L’Atalante. Revista de estudios cinematográficos, no 29, 2020, p. 25-38.
- Jean‑Paul Gabilliet, Des comics et des hommes. Histoire culturelle des comic books aux États‑Unis, Nantes, Éditions du Temps, 2005.
- André Gaudreault et Thierry Groensteen (dir.), La Transécriture. Pour une théorie de l’adaptation. Littérature, cinéma, bande dessinée, théâtre, clip, Québec/Angoulême, Éditions Nota bene/Centre national de la bande dessinée et de l’image, 1998.
- Ian Gordon, Comic Strips and Consumer Culture (1890-1945), Washington, Smithsonian, 2002.
- Barry Keith Grant et Scott Henderson (dir.), Comics and Pop Culture, Austin, University of Texas Press, 2019.
- Giulia Guazzaloca, « Un amalgame bizarre entre politique et télévision en Italie : du “fief démocrate‑chrétien” au “phénomène Berlusconi” », Le Temps des médias, vol. 13, no 2, 2009, p. 42‑55.
- Koichi Iwabuchi, Recentering Globalization: Popular Culture and Japanese Transnationalism, Durham, Duke University Press, 2002.
- Henry Jenkins, Convergence Culture: Where Old and New Media Collide, New York, New York University Press, 2006.
- Derek Johnson, Media Franchising, Creative License and Collaboration in the Culture Industries, New York, New York University Press, 2013.
- Francis Lambert, « Les héros de télé revus et dessinés », Télérama, 9 décembre 1978, p. 33.
- Sylvain Lesage, L’effet livre. Métamorphoses de la bande dessinée, Tours, Presses universitaires François‑Rabelais, 2019.
- Paul Lopes, Demanding Respect: The Evolution of the American Comic Book, Philadelphie, Temple University Press, 2009.
- Pablo Pérez López, « Les médias de la démocratie », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, vol. 2, no 74, 2002, p. 113‑130.
- Sonia Morales Pérez, « 1962-1964 : la expansión y el consumo social de la televisión », RTVE.es, https://www.rtve.es/rtve/20170801/expansion-consumo-social-television/1591040.shtml.
- Marco Pellitteri, « Manga In Italy: History of a Powerful Cultural Hybridization », International Journal of Comic Art, vol. 8, no 2, automne 2006, p. 56-76.
- Géraldine Poels, Les Trente Glorieuses du téléspectateur. Une histoire de la réception télévisuelle des années 1950 aux années 1980, Bry‑sur‑Marne, INA Éditions, 2015.
- Michael G. Rhode, « The Commercialization of Comics: A Broad Historical Overview », International Journal of Comic Art, vol. 1, no 2, automne 1999.
- Art Spiegelman, « Birth of the Comics », The New Yorker, 24 décembre 1993‑2 janvier 1994, p. 106‑107.
- Bounthavy Suvilay, « Traduire les best‑sellers du manga : entre “domestication” et “exotisation” », Fixxion, no 15, décembre 2017, p. 189-201.
- Bounthavy Suvilay, Dragon Ball, une histoire française, Liège, Presses universitaires de Liège, 2021.
- Dayan Kishan Thussu, Media on the Move: Global Flow and Contra-Flow, Londres, Routledge, 2007.