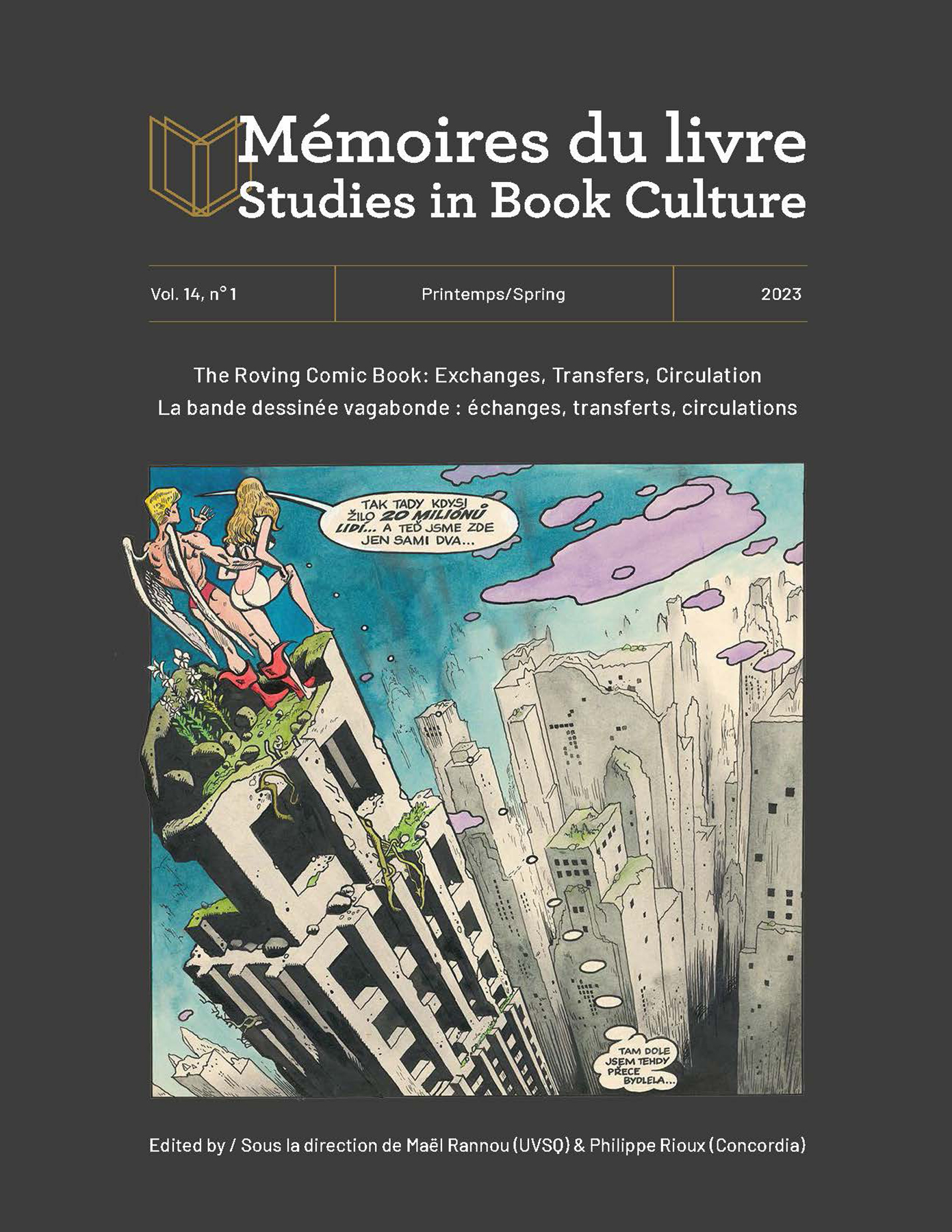Abstracts
Résumé
En France, l’engouement pour les mangas et la japanimation a véritablement commencé à la fin des années 1980 avec la diffusion à la télévision de dessins animés japonais. Les premiers fans vont, à partir de 1994, publier des fanzines dans lesquels on trouve des bandes dessinées inspirées des mangas dont l’accès était compliqué (contrairement aux dessins animés japonais diffusés à la télévision). De jeunes autrices et auteurs d’à peine 20 ans vont chercher à imiter leur modèle asiatique, mais avec un bagage culturel européen qui intervient forcément dans leurs productions, que ce soit sur le plan de la langue ou de la gestion des codes de la bande dessinée.
Mots-clés :
- Fanzine,
- manga,
- global manga,
- amateur
Abstract
In France, towards the end of the 1980s, the appetite for mangas and Japanese animation began in earnest with the broadcasting of Japanese cartoons on French television. By 1994, early fans published fanzines containing comics inspired by mangas that were difficult to access (contrary to the Japanese cartoons on television). Young authors, most of them barely twenty years of age at the time, tried to emulate their Asian role models, but inevitably their own European cultural background intervened, may it be in the language or in the way they dealt with comic-book genre codes.
Keywords:
- Fanzine,
- manga,
- global manga,
- amateur
Article body
En France, on parle souvent du phénomène « manga ». Pour les médias de masse, ce mot regroupe à la fois la bande dessinée et les dessins animés japonais. Pour les fans, le manga et la japanimation sont deux choses distinctes. En effet, il est possible d’être un fan lecteur ou un fan non‑lecteur. La forme par laquelle il reçoit le récit va évidemment influer sur les pratiques culturelles du fan. Si les premières planches de bandes dessinées japonaises sont publiées en France en 1969 dans le magazine Budo[1] (consacré aux arts martiaux) et de 1978 à 1981 dans Le Cri qui tue (la première revue francophone dédiée à la BD japonaise), ce sont surtout les animés diffusés sur TF1 et La Cinq à la fin des années 1980 qui vont rendre populaires les productions japonaises auprès de la jeunesse. C’est ce public qui va publier, à partir de 1994, les premiers fanzines de bandes dessinées inspirées du manga. Quand on regarde l’offre éditoriale française à cette époque, on ne peut que s’étonner de l’apparition de ces productions amateurs dessinées par des jeunes d’à peine 20 ans. Dépassant les difficultés d’accès aux mangas, ces apprentis auteurs et autrices vont chercher à imiter les bandes dessinées japonaises.
Thierry Groensteen, dans son ouvrage L’univers desmangas[2], a donné un aperçu de la richesse de la bande dessinée japonaise. Celle‑ci se définit, comme le comics et la BD franco‑belge, par des traditions nationales et un ensemble de caractéristiques formelles (thématiques, économiques, graphiques, narratives). Comment ces publications de BD amateurs se positionnent‑elles par rapport aux oeuvres qui les inspirent et à la tradition franco‑belge à laquelle la production francophone demeure (r)attachée?
Un retour sur l’arrivée du manga en France est nécessaire pour comprendre l’apparition d’une scène amateur liée aux productions japonaises. L’analyse de planches, issues d’un corpus de 20 fanzines français[3] de 1994 à 1997, permet de relever l’adoption de codes graphiques venant du manga, mais également une influence émanant de la bande dessinée franco‑belge. Le choix de la première date est assez évident, puisque c’est l’année des débuts des publications de BD amateur dans les fanzines manga en France. Le choix de la date de fin est, lui, motivé par la multiplication des mangas proposés par les éditeurs français – le manga cesse d’être un produit rare –, mais également par le nombre de fanzines publiés. L’essor est soudain et conséquent : les fanzines d’après 1998 ne constituent plus une avant‑garde.
La publication de mangas en France
Pour parler de cette BD hybride, il convient d’évoquer ses origines et, donc, l’arrivée en Europe francophone de productions japonaises (bandes dessinées et dessins animés) dès les années 1970. En 1978, Goldorak commence à être diffusé à la télévision française et connaît un vrai succès qui va entraîner une explosion de la vente des jouets à l’effigie du robot géant. Le phénomène attire l’attention de l’hebdomadaire Paris Match qui fait sa une du 19 janvier 1979 (n° 1547) avec ce personnage de dessin animé. La série remporte un grand succès auprès des enfants et suscite des réactions dans les médias. Des dessins animés japonais comme Albator 78, Candy, Demetan, Gigi, Edgar détective cambrioleur et bien d’autres vont continuer à être diffusés de façon dispersée à la télévision française (avant que le Club Dorothée concentre ce type de programme dans une longue émission). Les cotes d’écoutes sont au rendez‑vous mais, à l’exception de Goldorak, les productions japonaises, malgré leur popularité, ne génèrent pas à ce moment‑là de communautés de fans. Leur audimat et leur bas coût encouragent les chaînes de télévision à investir dans ces programmes. L’adhésion du public ciblé (les enfants) est complète, mais le bas âge de ces téléspectateurs ne leur permet pas encore de s’organiser en communauté.
Le magazine Le Cri qui tue d’Atoss Takemoto, bien que précurseur, doit s’arrêter après quatre ans et six numéros[4]. Quelques lecteurs (dont de futurs critiques de bandes dessinées ou libraires), marqués par la découverte du manga à cette période, vont chercher à lui donner plus d’audience en France. Le succès que rencontrent, à partir de 1987, les dessins animés japonais dans les émissions le Club Dorothée (sur TF1 de 1987 à 1997) et Youpi l’école est finie (sur La Cinq de 1987 à 1992) va leur permettre de gagner un nouveau public parmi les téléspectateurs principalement âgés de 4 à 14 ans[5]. Ce passage d’un support à un autre ne se fera pas instantanément. En 1989, Ségolène Royal publie chez Robert Laffont Le Ras‑le‑bol des bébés zappeurs et s’engage aux côtés des détracteurs des dessins animés japonais, qui ont la faveur des médias à cette époque. Ce débat déclenche la période « d’austérité » : c’est‑à‑dire une période où il n’y aura quasiment aucun dessin animé japonais sur les chaînes nationales. Pour Clotilde Sabre[6], ce sont ces scandales qui font découvrir aux enfants le pays d’origine de leurs dessins animés préférés. Auparavant, aucun ne s’interrogeait à ce sujet, d’autant plus que les noms étaient francisés.
Face à cette situation d’austérité, les fans les plus âgés vont organiser un réseau d’information via les fanzines, le Minitel, puis Internet. Certains ont des liens avec le Japon (des correspondants ou des proches), comme le fanzine L’Effet Ripobe créé en 1992 par une association d’anciens élèves du lycée français de Tokyo. Les libraires qui partageaient la passion des fans étaient identifiés par ceux‑ci et leurs boutiques servaient de lieux d’approvisionnement et de rendez‑vous. Yvan West Laurence raconte cette époque et les nombreuses rencontres qu’il a pu faire à la librairie Déesse à Paris[7].
Les produits achetés en importation pouvaient être revendus grâce à des petites annonces[8] ou dans les kiosques de dépôt‑vente mis en place lors de conventions – surtout vers la fin des années 1990. Les mangas en langue originale circulent par ce réseau. Le public de ces programmes télévisés, très hétéroclite, va créer un lectorat qui l’est tout autant. La diversité la plus facile à évaluer est celle de genre, sur laquelle nous reviendrons plus loin.
Dès la fin des années 1990, des productions japonaises réapparaissent timidement à la télévision, mais avec des programmes dénués de violence et de sexualité – mignons, en somme – et destinés à un jeune public, comme Hamtaro[9], diffusé en France depuis 2003, ou Pokémon[10], depuis 1999. Elles prennent surtout d’assaut le cinéma, avec notamment les films du studio Ghibli, qui s’étaient fait remarquer dans des festivals d’animation comme celui d’Annecy. L’abondance de programmes offerte par Internet va progressivement rendre ce « puritanisme » télévisuel inefficace.
Les jeunes téléspectateurs des années 1980‑1990 vont garder en mémoire des éléments qui les guideront vers la lecture de mangas, mais aussi vers la création de bandes dessinées. En choisissant l’ambiance plutôt que la qualité graphique, les dessins animés japonais ont donné à ces jeunes le sentiment qu’eux aussi pouvaient réaliser des oeuvres captivantes. Les fans retiennent aussi la présence de personnages féminins ou androgynes, le développement psychologique et l’ambiguïté des caractères, ainsi que les univers merveilleux (de science‑fiction comme la série Robotech ou d’heroic fantasy comme Fly/Dragon Quest).
À cette époque, les fans peuvent trouver des albums tirés de séries animées : soit les images sont redessinées par des anonymes (souvent sans autorisation des ayants droit japonais), soit il s’agit de captures d’écran issues des dessins animés (ce qui sera appelé anime comics). Aucune de ces publications n’a pu servir de modèle aux fans français, car si le design des personnages rappelle le manga, le découpage de l’action est très différent de ce que font les mangakas. Club Dorothée Magazine, qui a commencé à paraître en 1989, proposait par exemple des « bandes dessinées » qui étaient en réalité des mosaïques de captures d’écran particulièrement maladroites.
Les années 1990 voient également arriver les premiers fanzines d’articles consacrés aux mangas. Il est possible d’établir une liste des titres apparus entre 1990 et 1994 et de la considérer comme exhaustive, les publications étant encore limitées et se citant beaucoup entre elles : Mangazone (1990‑1994), AnimeLand (période fanzine : 1991‑1995), Sumi Joohoo (1991‑1992?), Tsunami (1992‑1997), L’Effet Ripobe (1992‑1994), Manken Z (1992‑1994?), Kimagure Mangamag (1992‑1995), Animapa (1992‑2000), le fanzine d’une APA[11] à distribution restreinte à ses contributeurs, Vision Parallèle (1993‑1995), Chibi Setsumei (1993‑1996), Animéfan (1993‑1999), Macross News qui deviendra E‑News (1993‑2001), Namida (1993‑1997), SeiGanMag (1993‑1995), Amazing World (1993‑1995), CDZ magazine (1993), Comic Strips (1993), Dirty mag (1993), Manga quest (1993), Otaku (1993), Made in Japan (1993), Amphétamine (1994), Animé Comics (1994), Kawaï (1994), Shogakun (1994), Toki Doki (1994), Piyo (fanzine cité à plusieurs reprises par ses confrères mais sans indication de date). Ces fanzines permettaient aux fans de voir à quoi ressemblaient des planches de bandes dessinées japonaises. Ils étaient diffusés lors de conventions liés aux univers fantastiques (par exemple « Les arpenteurs du rêve », en 1996 à l’Université de Saint‑Denis) et dans des librairies spécialisées en importation. Certains liens avec la scène de la bande dessinée franco‑belge ont existé (comme le prouve le fanzine Fun en bulles ou le récit d’Yvan West Laurence sur les débuts d’AnimeLand), mais, pour beaucoup de jeunes autrices et auteurs, ce n’est pas la lecture d’albums de BD qui leur a donné envie de dessiner des planches. Les pages de Mangazone et de ses confrères fanzines reproduisaient des extraits de mangas. Une représentation commune a émergé de ces illustrations et de ces articles plus ou moins poussés. Les fans de dessins animés ont aussi pu entendre parler des mangas dans les magazines de jeux vidéo comme Player One, Consoles + ou Joystick : les rubriques consacrées au cinéma asiatique et aux autres produits culturels japonais font une large place aux mangas. Durant cette période, de nombreux fans trouvent des oeuvres en importation dans des boutiques de jeux vidéo ou des vidéoclubs. D’après les témoignages recueillis dans cet article (voir la section « Sources » de la bibliographie), le phénomène dépasse Paris et se retrouve dans plusieurs villes du pays. Le proto‑lecteur de manga ne fréquente donc pas les librairies pour assouvir sa passion, et trouve des chemins de traverse.
Nous avons établi que l’intérêt pour la bande dessinée japonaise a été éveillé par les adaptations animées et par quelques publications avant‑gardistes. De son côté, l’offre éditoriale est d’abord très restreinte. Quelques titres, comme Gen d’Hiroshima de Keiji Nakazawa (Les Humanoïdes Associés, 1983), ont déjà eu une édition française, mais cela reste marginal avant les années 1990. Clotilde Sabre synthétise les informations de 2007 de l’Association des critiques et des journalistes de bande dessinée (ACBD) : « Les tirages sont passés de six séries traduites en 1991 à plus de mille depuis 2005, avec une part de marché de plus de 40 % dans le domaine de la bande dessinée. »[12]
À côté de cela, il est possible de trouver dès 1987 dans les boutiques d’importation les quelques titres disponibles sur le marché américain. Le réseau des fans de comics, déjà bien en place, est un soutien certain à l’arrivée du manga en territoire français. Le fanzine dédié au comicsScarce est d’ailleurs la première publication à consacrer un dossier à la BD japonaise en France, avec un dossier spécial dans le n° 21 d’automne 1989.
En 1990, Glénat publie la traduction française du manga Akira de Katsuhiro Otomo. Certains fans ont déjà eu accès à la version américaine (1988), mais cette publication française, qui reprend d’ailleurs la version américaine colorisée[13], devient plus facile à se procurer. L’année suivante, en 1991, paraît du même auteur, mais chez Les Humanoïdes Associés, Dômu – Rêves d’enfants qui avait été publié au Japon en 1980.
Peu après, Glénat édite ses premiers gros titres : Dragon Ball d’Akira Toriyama en 1993, c’est‑à‑dire juste avant que la série ne connaisse son incroyable succès – attesté par les couvertures de la revue de jeux vidéo Player One et par la rubrique courrier du Club Dorothée Magazine; le magazine de prépublication Kaméha, en kiosque à partir de 1994. À partir du n° 22 (juin 1996), le supplément « Kaméha Kids » publie des BD envoyées par les lecteurs, dont des oeuvres d’amateurs déjà actifs dans les fanzines; Dr Slump d’Akira Toriyama, en 1995, dont nous reparlerons. On trouve également quelques albums français revendiquant une influence étrangère (manga et/ou comics). Le plus connu est Nomad de Morvan, Savoia et Buchet. Le nom de la collection choisi par les éditions Glénat pour ce type d’hybridation est « Akira », ce qui démontre qu’il s’agit surtout de projets dans la lignée d’un manga en particulier. Le format A4 retenu, avec couverture cartonnée et en couleur, est assez proche des albums franco‑belges. Il s’agit alors de publications avant‑gardistes, qui posent un jalon, mais seront peu citées par les artistes à venir.
Tenue par Dominique Véret et Sylvie Chang, la librairie et boutique d’importation Tonkam, qui s’était spécialisée en manga, se lance dans l’édition en 1994 avec Vidéo Girl Aï (sorti au Japon en 1990), tiré à 4 000 exemplaires. Ce titre est le premier en France à paraître dans le sens de lecture original. Le goût de Dominique Véret pour la culture asiatique plonge ses racines dans les toutes premières occurrences du manga en France. Il explique en effet dans une interview au fanzine Vision Parallèle : « Personnellement, mes relations avec le manga débutent dans les années 70 avec Le Cri qui tue et la pratique des arts martiaux (la génération Bruce Lee)[14]. »
Pour résumer l’offre éditoriale manga en France à ses débuts, on peut noter que : avant 1995, il n’y avait que 13 titres officiellement disponibles dont deux à caractère pornographique, deux définis comme « manga », mais dont les auteurs étaient originaires de France et des États‑Unis (Bubblegum Crisis Genom d’Adam Warren est un comics de 1994 inspiré de la série d’animation japonaise Bubblegum Crisis et Nomad est une BD de Jean‑David Morvan, Sylvain Savoia et Philippe Buchet éditée chez Glénat), et deux difficilement trouvables (Candy Candy est retiré du marché pour des problèmes de droits et Vidéo Girl Aï est tiré à moins de 5 000 exemplaires); en 1995, parmi les 24 nouveaux titres, est publiée la première édition française d’une oeuvre de Jirō Taniguchi, L’Homme qui marche, chez Casterman; en 1996, les shôjo mangas[15] restent très rares (à peine cinq sont disponibles en version française), alors que l’offre hentaï (pornographique), publiée et diffusée par les librairies Tonkam et Samouraï, se porte plutôt bien. On note également trois titres dont les adaptations en dessins animés sont déjà passées à la télévision; en 1997, le fan de manga peut officiellement se procurer des titres de 115 séries différentes en version française.
On remarque rapidement que, parmi les premiers titres parus, il y a très peu de shôjo mangas, peut‑être parce que c’est ce genre qui bouscule le plus la structure de la planche, n’hésitant pas à effacer les décors au bénéfice de fonds à motifs‑émotions, à oublier la case et à placer les pensées des personnages au centre de la page – sans bulle d’aucune sorte. Cependant, à cette période, la segmentation japonaise n’était pas encore totalement intégrée par le marché et les fans français. Le cas le plus révélateur est celui de Vidéo Girl Aï de Masakazu Katsura qui, parce qu’il met en scène une romance, n’a pas été perçu comme un manga à destination des jeunes garçons.
Les fanzines de la scène manga en France
Au vu de ce panorama, il est évident que les dessins animés ont eu une influence importante sur ces premières BD inspirées des mangas. On peut même émettre l’hypothèse que certaines et certains de ces jeunes artistes ont pioché davantage dans les oeuvres audiovisuelles que dans les bandes dessinées japonaises qui étaient, dans les années 1990 en France, majoritairement difficiles à trouver, que ce soit en langue originale ou en version anglaise ou française. Aurore Demilly, créatrice de MyCity, explique qu’au moment de la publication du premier numéro de ce fanzine, elle et la majeure partie de ses correspondantes et correspondants avaient déjà lu un nombre relativement conséquent de mangas. Dépassant l’insuffisance éditoriale française, ils se rendaient régulièrement dans des boutiques où l’on pouvait trouver des oeuvres en version originale (notamment à la boutique Tonkam). Cet approvisionnement demandait à ces jeunes d’à peine 20 ans un effort physique (Aurore habitait à l’époque à Angers) et économique. La majorité des lecteurs et lectrices ne lisaient pas le japonais et ne comprenaient l’histoire qu’à travers les dessins des mangas, ce qui en dit long sur l’engagement passionné de ces fans envers la japanimation et le manga.
Les chroniques d’AnimeLand permettent de recenser la majeure partie des fanzines de la scène manga de cette époque : le passage dans cette rubrique semble incontournable. Les fanzines envoyés à la rédaction avaient droit à un paragraphe contenant parfois un avis du chroniqueur (surtout dans les premières années), mais en général il s’agissait seulement du sommaire et des coordonnées de la publication. Cette rubrique a eu sa place dès les premiers numéros d’AnimeLand. Au début, elle comprenait indifféremment les magazines (notamment les publications étrangères) et les fanzines, avant de consacrer un espace spécifique aux fanzines qui devenaient de plus en plus nombreux. Les publications se faisaient également connaître dans les pages de leurs camarades : on trouve par exemple des réclames pour MyCity, MinW ou SD Comics dans le fanzine Prototype. Ne pas passer par ces canaux signifiait se situer en dehors de la scène et de son fonctionnement. L’ensemble du corpus (précisé en annexe) est aujourd’hui consultable au Fanzinarium, une fanzinothèque associative à Paris, dont le catalogue est accessible en ligne[16].
L’imitation du modèle japonais
Aurore Demilly[17] explique que, lorsqu’elle a publié le premier numéro du fanzine MyCity en 1995, c’était dans le but de faire du manga. La publication, au format A5, est alors entièrement en noir et blanc. Le sommaire indique les titres des BD contenues dans la revue, lesquelles se poursuivent dans les numéros suivants. Les différentes manières de représenter les yeux, le nez et les cheveux des personnages rappellent incontestablement les oeuvres japonaises. Les décors semblent également être des copies de ceux qu’on trouve dans les pages des mangas. Enfin, la rupture graphique aussi est intégrée à ces BD amateurs : il est courant de voir un personnage à l’air très sérieux qui, à la case suivante, prend des traits caricaturaux, voire devient un chibi (aussi appelé « SD » pour « super deformed »), c’est‑à‑dire que le corps correspond à environ deux fois la taille de la tête, alors que la proportion réelle est de sept ou huit fois la tête pour un corps. Citons deux utilisations notables du procédé : dans le fanzine SD Comics, une BD met en scène les participants de fanzines qui se transforment en SD à cause d’une encre magique leur permettant d’entrer dans leurs mangas favoris; dans le fanzine Sakura, un personnage explique qu’il ne peut conserver son expression sérieuse que peu de temps, laquelle alterne donc avec des mimiques comiques. D’autres éléments du langage graphique du manga vont être plus ou moins adoptés par les fans français : la goutte de la gêne, la veine de l’énervement, le corbeau de la perplexité, etc.
L’utilisation de trames[18] pour marquer les gris du dessin est notable : l’usage des trames est effectivement la norme pour les mangas, tandis qu’elles sont généralement absentes des bandes dessinées franco‑belges et nord‑américaines. La trame permet donc de coller au modèle que ces jeunes artistes se sont choisi. Cette technique posait tout de même un problème puisqu’il fallait soit se procurer de la trame à découper et à coller sur les dessins (article difficile à trouver, onéreux et qu’on ne peut utiliser indéfiniment), soit être équipé d’un ordinateur, d’un scanneur et d’une imprimante pour poser les gris à l’aide d’un logiciel de retouche d’image. Ces difficultés expliquent que la trame ne soit pas la règle dans les fanzines du corpus (40 BD sur 88 contiennent de la trame, une bonne partie ayant certainement été posée par ordinateur). Certaines et certains artistes optent pour une absence de gris, pour des hachures, voire pour des trames à la main (le mouchetage de certaines BD de Lullaby n° 2). La présence d’impressions couleur dans ces fanzines reste limitée en raison de leur coût. Ce privilège est réservé aux couvertures– dès 1996– ainsi que, parfois, à quelques encarts ou pages glissés dans la publication. Cela permet de comprendre que, pour Aurore Demilly, l’impression en noir et blanc n’est pas un choix, mais une contrainte indépassable. Pourtant, cette contrainte participe à l’imitation du modèle japonais.
Dans le corpus cohabitent différents formats : deux A4, deux A6, 15 A5 et un livret A5 consacré au manga dans un fanzine A4 sur la BD franco‑belge. Le choix du format A5 par la majorité des fanzines peut également s’expliquer par une raison économique, puisque quatre pages A5 équivalent au prix d’une page A4 recto verso. Cette contrainte permet aussi un rapprochement, pas forcément volontaire, avec le format de poche des mangas.
L’une des caractéristiques graphiques du manga est l’utilisation (voire la surutilisation dans un but expressif) des lignes de vitesse et de tension. Ces lignes existent dans d’autres bandes dessinées, mais pas aussi fréquemment. Dans les dessins animés, le téléspectateur est habitué à voir des lignes à l’écran. Certaines servent à exprimer le mouvement de l’objet dessiné : par exemple, dans Olive et Tom, ces lignes entourent systématiquement le ballon. D’autres marquent un état d’âme et ajoutent une tension épique à la scène : toujours dans Olive et Tom, elles apparaissent lorsqu’un des footballeurs est en position de tir et que l’enjeu est de taille. On comprend donc que le téléspectateur, même sans être lecteur de manga, a déjà eu affaire à ces façons d’exprimer le mouvement. Les dessinatrices et dessinateurs de fanzines vont reprendre ce code (et parfois même l’utiliser comme élément comique en ajoutant des lignes à des scènes anodines).
Un autre phénomène intéressant, chez ces jeunes fans imitant le manga, est la présence d’un nombre conséquent d’autrices. La bande dessinée franco‑belge est un milieu très masculin, que ce soit du côté des auteurs ou du lectorat ciblé. À partir d’un relevé des prénoms donnés dans les fanzines et des (re)présentations des autrices et auteurs – une méthode qui a ses limites mais permet un premier aperçu –, nous pouvons estimer qu’il s’y trouve 26 auteurs, 17 autrices et 15 de genre inconnu. Cette répartition des genres pourrait s’expliquer par la meilleure visibilité des autrices de mangas et dans l’existence au Japon d’une bande dessinée à destination des jeunes filles et des femmes. À cette époque, peu de shôjo mangas sont disponibles en France et c’est par les dessins animés adaptés de ces oeuvres que les fans vont découvrir l’existence d’une bande dessinée pour adolescentes. Le plus grand succès de l’époque est Sailor Moon, qui décline la figure de la « magical girl » et met en scène une petite fille se transformant en une femme adulte avec un talent ou un pouvoir particulier, comme le font d’autres séries telles que Creamy ou Emy magique. Est‑ce que ce sont ces productions qui vont permettre la présence de femmes dans les fanzines? Pas nécessairement, car le système japonais hyper‑segmenté n’est pas adopté par les Français : les filles ne cachent pas leur goût pour les shônen mangas. Les garçons sont plus discrets, mais quelques éléments montrent qu’une série à destination des filles comme Sailor Moon a eu un public masculin en France : le fanzine Sailor Otaku dédié à Sailor Moon a été créé par un garçon; lors de festivals, de nombreux cosplayers incarnent des personnages masculins de cette même série.
Il est difficile de savoir ce qui a amené des femmes à s’investir dans la production de manga plutôt qu’en bande dessinée franco‑belge. Elles n’y ont pas une position passive de consommatrices. On peut supposer que les thématiques abordées les ont davantage séduites ou bien que cette scène naissante n’avait pas mis en place des privilèges masculins. Ces jeunes autrices ont décidé de faire du manga, mais elles n’étaient pas dépourvues de contacts avec la culture occidentale.
L’héritage occidental
Si l’influence du manga est manifeste chez les autrices et auteurs des fanzines de notre corpus, la lecture de bandes dessinées européennes et parfois américaines se laisse aussi deviner. Le fait que ces jeunes aient accès à des éditions originales ainsi qu’à quelques titres traduits en français ne les a pas empêchés d’avoir recours à des éléments de langage graphique fréquemment utilisés dans la bande dessinée franco‑belge : des symboles signifiants, comme les têtes de mort, le couteau et autres objets menaçants, pour remplacer des propos injurieux (présents dans deux fanzines du corpus); des étoiles pour représenter la douleur (présentes dans huit fanzines du corpus); l’expression de la surprise par de gros points d’interrogation dessinés (présente dans 10 fanzines du corpus); l’utilisation de notes pour évoquer la musique (présente dans 10 fanzines du corpus); des éclairs au‑dessus de la tête d’un personnage en colère ou un tourbillon pour la contrariété (présents dans six fanzines du corpus); le nuage de poussière d’où sortent des poings pour représenter une bagarre potache (présent dans quatre fanzines du corpus); la fusion des deux yeux (parfois dissymétriques) pour créer un effet comique (présente dans deux fanzines du corpus).
La transcription graphique d’un bruit pose problème aux jeunes autrices et auteurs : dans cette situation, il est difficile d’imiter le modèle japonais. On sait que le cri du coq est retranscrit en français sous la forme « Cocorico! », alors qu’en japonais il s’agirait plutôt de « Kokekokko! ». Les mangas associent des bruits à des choses considérées en France comme silencieuses. L’exemple le plus fameux est l’évocation de l’érection d’un pénis : « Mokkori ». Ces retranscriptions d’action ou d’émotion par des sons constituent une pratique japonaise (appelée gitaigo) sans équivalent en France. Les jeunes autrices et auteurs des années 1990 vont souvent traiter les sons de leurs oeuvres à la manière franco‑belge. Les onomatopées présentes dans notre corpus reprennent largement les retranscriptions traditionnelles des sons : « Boum! », « Pff! », « Blam! », « Splash! », « Scratch! », « Tap Tap Tap Tap! », « Bang! ». On voit ici les limites de la compréhension des mangas en langue originale.
Les autrices et auteurs de notre corpus n’ont pas cherché à imiter la manière japonaise d’intégrer la retranscription écrite du son au dessin. Les mangas en donnaient un aperçu, mais la barrière de la langue a constitué un obstacle à la compréhension de ce code graphique. L’onomatopée écrite en idéogramme se confond parfaitement avec le dessin et participe à l’immersion du lecteur. Le fan français qui a eu accès à des planches originales a pu comprendre le sens global sans pour autant lire les caractères japonais. Parfois, les premières éditions françaises ont renoncé à traduire les onomatopées (les éditions J’ai lu, par exemple, étaient connues pour laisser les caractères japonais en l’état), d’autres fois elles ont choisi de recouvrir les idéogrammes par la traduction – et donc de profondément intervenir dans le graphisme de la case. Ces choix éditoriaux ont évidemment fait débat chez les fans, mais ils n’ont pas influencé nos jeunes artistes entre 1995 et 1997. Certains fans ont franchi le pas en intégrant du japonais dans leurs oeuvres. Dans Ultra Sushi, fanzine exploitant beaucoup le second degré, des termes japonais sont utilisés. Ils reprennent par exemple le personnage de Mokona, une petite mascotte des autrices du studio Clamp, et lui adjoignent une bulle en caractères japonais traduite par « PUU » (petit cri de la mascotte en question). L’auteur de cette BD affiche son érudition de fan avec cette bulle, rappelle le pays d’origine des mangas et souligne la distance culturelle qui existe entre le manga et la France. L’apparition de langue étrangère, à la manière d’une alternance codique, peut donc servir à se moquer des fans qui introduisent à outrance des mots japonais et essaient de nier (ou effacer) cette distance culturelle avec des mots comme chibi, kawaï, nani, ronin, yosh…, termes couramment utilisés.
Une autre BD de ce fanzine, un hommage à City Hunter, retient l’attention. Un personnage féminin, poursuivi par des brigands, est sauvé par le héros du manga, Ryô Saeba. Celui‑ci s’exprime en japonais. La bulle est en idéogrammes avec un renvoi à une retranscription en caractères latins et/ou une traduction en fonction du texte. « Arigatô Gozaïmassu » est ainsi transcrit, mais pas traduit, car il est évident pour l’autrice que le lectorat connaît ce terme japonais. Les dernières paroles de Ryô Saeba sont en français (ce qui surprend l’héroïne) : « Mais… cette fille… elle a vraiment une tronche bizarre!!… Mais ouais, elle est pas du tout dessinée comme moi! Qu’est‑ce que je fous ici? Où est passée la jolie brune que je devais sauver??! » La fin de l’histoire révèle que toute cette situation était un rêve éveillé. Cette passion dévorante lui est reprochée par un autre personnage féminin qui la tire de sa rêverie. La langue sert ici à séparer le monde de la fiction et celui de la réalité. La pratique du japonais devient un élément qui permet de prolonger le manga dans la vie quotidienne, comme pourraient le faire le cosplay (déguisement en personnage de fiction) ou l’écriture de fanfiction.
Dans SD Comics, les auteurs parlent de leur pratique du karaoké, où ils interprètent des chansons de leurs animés favoris en langue originale – les paroles sont transcrites phonétiquement en alphabet latin. C’est aussi dans l’une de leurs BD que l’on trouve un samouraï qui s’exclame : « Ksooo ». Il s’agit de la transcription de « kuso » (« merde » en japonais), mais une transcription suroralisée pour évoquer le son que l’on entend dans les animés en version originale. Pourtant, la bulle est verticale comme dans un manga. Impossible ici de savoir si l’auteur a délibérément joué avec la langue et la forme de sa bulle ou s’il a reproduit un modèle sans la volonté de jouer avec celui‑ci.
Dans Ikari no Ryu, Robin, l’unique dessinateur de ce fanzine, se présente dans une planche où il s’exprime en japonais. Les bulles contiennent des idéogrammes, une transcription en alphabet latin et un numéro qui renvoie à la traduction française en bas de page. Le dessinateur signale discrètement dans sa signature qu’il a été aidé pour ce travail multilingue. Plus qu’une preuve d’érudition, il s’agit surtout d’afficher une volonté de se rattacher au modèle : Robin se dessine en train de s’incliner pour faire une salutation à la japonaise et caricature son personnage avec des yeux réduits à de simples traits. L’imitation des codes graphiques est ici complétée par une imitation de la langue.
Les jeunes autrices et auteurs sont, dans leur volonté de faire du manga, confrontés à la question linguistique, notamment avec les onomatopées (dont la lecture est difficile à cause des idéogrammes et des particularités culturelles), ce qui pose la question de la définition même du manga. Peut‑on réellement faire du « manga français » ou bien le manga est‑il une forme de bande dessinée intrinsèquement liée à la culture japonaise et à sa langue? Beaucoup de fans, à l’époque comme aujourd’hui, engagent une démarche d’apprentissage du japonais. Cela témoigne d’un besoin d’un désir d’accéder à l’oeuvre originale. Entre 1995 et 1997, les artistes de notre corpus, très rarement japonophones, disposaient de mangas non traduits. Bien sûr, ils n’avaient pas accès à l’entièreté du sens. Cette difficulté ne leur permettait pas d’imiter fidèlement le modèle. Pour combler ce manque, les autrices et auteurs ont puisé de l’inspiration à la fois dans les dessins animés (où l’écrit était peu présent) et dans la bande dessinée franco‑belge.
L’expression de la surprise, qu’on soit dans le manga ou la BD franco‑belge, passe souvent par un signe de ponctuation. Les Japonais utilisent le caractère typographique, alors que les Européens jouent avec la forme et font de cette ponctuation un objet épais et graphique, avec parfois du relief[19]. Dans les fanzines que nous avons examinés, c’est bel et bien l’influence de la BD franco‑belge qui l’emporte, avec des points d’interrogation de grande taille et graphiquement travaillés.
Le recours aux codes de la bande dessinée franco‑belge est surtout présent dans le cas où l’autrice ou l’auteur souhaite donner à son oeuvre une portée humoristique, voire parodique. Cela reflète peut‑être les lectures d’albums de ces fans. Il n’est pas anodin qu’un des premiers mangas à paraître en France aux éditions Glénat – donc avec une diffusion large, contrairement à celle des éditions Tonkam – soit Dr Slump d’Akira Toriyama. Il s’agit d’un manga humoristique qui joue sur la forme et dont le traitement graphique est proche de la bande dessinée franco‑belge. Dr Slump utilise des procédés graphiques (comme la déformation des cases sous l’action des personnages, le dépassement de la case par un bout du personnage, etc.) rares dans la bande dessinée japonaise et au contraire très répandus dans la BD franco‑belge, notamment chez l’auteur Gotlib. Dans sa rubrique de chroniques, la revue AnimeLand a souligné l’influence de ce dessinateur français sur le fanzine Sakura, présent dans notre corpus et que l’on peut effectivement considérer comme l’une des publications les plus hybrides. Les mentions sur la couverture indiquent que ce croisement d’influences est intentionnel : « Le meilleur fanzine de manga amateur made in France. Venez découvrir la nouvelle dimension du manga! »
Sakura, dont le titre est un mot japonais désignant les fleurs de cerisier, contient notamment une BD de Mohamed Bouziani intitulée Sindbab le malicieux dans la vallée aux trois échos. Au‑delà des décors et des costumes, qui rappellent fortement l’univers de la BD Iznogoud (de Goscinny et Tabary), on relève une référence directe à Lucky Luke (le héros arrive sur le dos d’un âne en chantant « I’m a poor lonesome cowboy and I want to find my home… ») et, surtout, deux éléments très peu présents dans la bande dessinée japonaise : des récitatifs ainsi que plusieurs actions réalisées dans la même case.
Les récitatifs sont extrêmement rares (voire inexistants) dans les mangas grand public. Parfois, l’un des personnages y prend le rôle de narrateur, mais la présence d’un narrateur omniscient tel qu’il se rencontre dans la bande dessinée franco‑belge est un fait inhabituel. Pourtant, dans notre corpus de 20 fanzines, nous relevons 14 titres dans lesquels figurent des récitatifs. Ils servent principalement à donner des repères temporels et spatiaux (« Plus tard… », « Le lendemain », « Quelque part dans une station‑service… », « Dans une lointaine forêt… », etc.). Les fans français semblent avoir besoin de ces indications pour organiser leurs récits. Les récitatifs qui commentent l’action existent, mais sont plus rares. On en trouve dans le supplément dédié au manga du fanzine Fun en bulles, où trois BD n’ont pas de bulles, mais uniquement des récitatifs. Il s’agit de récits courts et non d’histoires à suivre et le procédé a sans doute été choisi à cause de cette contrainte. En effet, toujours dans l’idée d’imiter le modèle, les fans de mangas ont généralement eu tendance à faire des BD à suivre avec un découpage en chapitres. Les univers de ces oeuvres étant souvent de pures inventions, les autrices et auteurs ont également recours à des introductions écrites que l’on peut rattacher au récitatif. Elles se présentent, par exemple, sous forme de texte calligraphié, comme celui d’un livre ancien ou comme le récit d’une légende ancestrale, mais n’engagent pas dans l’histoire une voix de narrateur récurrent.
Le temps qui s’écoule à l’intérieur d’une case est un choix d’auteur, mais l’on observe des tendances propres à l’origine géographique. Le manga privilégie un rapport au temps assez court, et présente généralement une seule action par case. En BD franco‑belge, il n’est pas rare que des personnages aient plusieurs bulles au sein de la même case. Les scènes d’affrontement sont donc en général plus brèves dans les albums européens puisqu’il est possible de synthétiser un échange de coups dans une seule case. Dans notre corpus, on voit que l’action unique n’a pas toujours été le choix de l’artiste. Le découpage des cases reste souvent dans la tradition franco‑belge : un quadrillage. L’arrivée d’un personnage est souvent mise en avant au moyen de « l’effet podium », c’est‑à‑dire en présentant le corps entier à cheval sur plusieurs lignes de cases. L’éclatement de la planche y est assez rare, à l’exception du fanzine Lullaby, très influencé par le shôjo manga. On y trouve des bandes dessinées par Miss Chan avec des structures de planche très irrégulières. Sa maîtrise des codes est remarquable et plutôt inhabituelle dans notre corpus, où l’on sent dans la majorité des oeuvres une tension entre la volonté de faire du manga et le bagage culturel européen.
***
Aurore Demilly, du fanzine MyCity, disait dans un entretien :
Quand moi j’ai commencé, aucun éditeur français ne signait un auteur qui voulait faire un manga en noir et blanc, beaucoup de pages, format plus petit que A5… Aujourd’hui, c’est complètement différent. Le grand format franco‑belge imprimé en couleur avec un style graphique inspiré par le manga, c’est une espèce de parenthèse dans l’histoire de la BD parce que ceux qui veulent faire du manga, ils feront du manga (petit format noir et blanc) et ils ne feront jamais un 46 pages couleur. Quand nous, les anciennes du fanzinat devenues pros, on sera mortes, plus personne ne fera ça. À l’époque où j’ai signé, le format manga ne se faisait pas. Pour faire de la BD professionnellement, il fallait se plier au format franco‑belge[20].
Rien n’est moins sûr, car les jeunes autrices et auteurs qui occupent la scène fanzine manga aujourd’hui adoptent une grande variété de formats pour leurs publications. La technologie leur permet facilement de choisir la forme de leur objet et même d’avoir accès à la couleur. On constate d’ailleurs que celle‑ci est omniprésente et, surtout, que le format poche n’est pas forcément celui qui est retenu. Même le style graphique s’éloigne parfois du modèle manga. Ces nouveaux fans ont grandi avec des références bien différentes de celles de la « génération Club Dorothée », notamment avec des dessins animés américains comme Steven Universe auquel font allusion les pages de ces fanzines, et ont eu accès à une quantité et une diversité de titres incomparables. Les échanges permis par Internet font constamment dialoguer les BD du monde : les mangas parlent de super‑héros, les personnages de comics ont de grands yeux, etc. Si la volonté d’imiter le modèle est sans doute toujours la même, le modèle a évolué et ne présente plus le visage monolithique qu’il avait dans les années 1990. Cependant, pour reprendre la citation d’Aurore, on comprend que l’enjeu de l’utilisation des termes « manga », « franco‑belge » et « comics » reste intimement lié au support. C’est le format qui dicte les contraintes de la mise en récit et en image. Il est d’ailleurs remarquable que les albums 46 pages couleur d’Aurore soient qualifiés de BD d’inspiration manga et que des oeuvres comme Radiant de Tony Valente soient appelées « manfra » ou « franga », ou encore « global manga ». Les termes « manga », « comics » ou « bande dessinée franco‑belge » sont liés à des caractéristiques, mais ils désignent en réalité un type de marché (avec ses formats et ses modes de publication) bien plus qu’un style graphique ou narratif. Cela expliquerait que la BD Gipsy de Marini et Smolderen, parue dès 1993 en France, n’ait jamais été qualifiée de « manga français » malgré son découpage ouvertement influencé par Akira de Katsuhiro Otomo. On pourrait croire que ce cloisonnement par le modèle économique pose une barrière définitive entre le manga et la BD franco‑belge, mais c’est compter sans le développement des webtoons qui mondialise le marché, le rythme de parution, de même que le support de publication. L’hybridation ne concerne plus seulement l’apparence et les codes graphiques ou narratifs, mais également le modèle économique.
Appendices
Note biographique
Delphine Ya-Chee-Chan est née en 1980, ce qui lui a permis de découvrir la japanimation à la télévision et les fanzines manga dans les conventions manga des années 1990. Dans les années 2000, elle découvre que le fanzine existe en dehors de cette scène. Sa passion pour les formes d’expression marginales l’a poussée à participer à la création de l’association des Amis de l’Imprimé Populaire. Elle a également participé à Bande dessinée en bibliothèque (Cercle de la Librairie, 2018). Elle a fait des études littéraires à l’Université Paris-Sorbonne. Aujourd’hui, elle complète ses activités associatives par le métier de professeure-documentaliste au lycée Maurice Utrillo de Stains.
Notes
-
[1]
David Yukio, « Premier manga traduit en France? 1969 », sur le blogue Mon amour pour le Japon et Tôkyô, 16 décembre 2005, http://japon.canalblog.com/archives/2005/12/19/1128926.html.
-
[2]
Thierry Groensteen, L’univers des mangas, Tournai, Casterman, 1996 [1991].
-
[3]
Voir la liste complète en bibliographie.
-
[4]
Maël Rannou, « Le Cri qui tue, honorable revue trop en avance », Les Cahiers de la BD, n° 11, juin 2020, p. 144-150.
-
[5]
Marie Lherault et François Tron, La télévision pour les nuls, First Éditions, 2010.
-
[6]
Clothilde Sabre, « La mise en tourisme de la pop culture japonaise : la légitimité culturelle par le croisement des regards exotiques », Thèse de doctorat en ethnologie, Villeneuve d’Ascq, École doctorale Sciences économiques, sociales, de l’aménagement et du management, 2012, p. 198.
-
[7]
Yvan West Laurence et Gersende Bollut, Big bang Anim’ : confessions du fondateur d’AnimeLand, Montreuil, Omaké books, 2013.
-
[8]
Notamment dans Okaz (1992-1996). Ce magazine de petites annonces gratuites dédié aux jeux vidéo contient dès son premier numéro des annonces concernant le manga et la japanimation. Il sera aussi pour les fanzines un lieu de recrutement, où il est possible de chercher un correspondant. L’éditeur a également publié le magazine Yoko, qui proposait de la BD très inspirée du manga.
-
[9]
Hamtaro est une série qui met en scène des hamsters vivant de petites aventures dans un cadre domestique. Son univers mignon et enfantin lui a permis de ne pas être la cible des détracteurs de la japanimation.
-
[10]
Le dessin animé Pokémon est une adaptation du jeu vidéo du même nom. Son succès au Japon et aux États-Unis (où il a été diffusé à partir de 1998) explique son arrivée sur les marchés occidentaux, sans doute motivée par des intérêts économiques. La licence remporte aujourd’hui encore un grand succès. Malgré son contenu mignon et enfantin, elle a dû faire face, à son arrivée en Occident, à une controverse autour de crises d’épilepsie déclenchées par le visionnage du premier épisode de la série.
-
[11]
APA : Amateur Press Association. Groupe de fans s’échangeant des lettres selon une organisation définie.
-
[12]
Clothilde Sabre, « Être vendeur, être fan : une cohabitation difficile. L'exemple d'une boutique spécialisée dans le manga », dans Réseaux, vol. 153, no. 1, 2009, p. 129 156.
-
[13]
Florian Moine, « Akira en France : retour sur un mythe », aVoir-aLire.com, 11 août 2020, https://www.avoir-alire.com/akira-en-france-retour-sur-un-mythe (consulté le 24 octobre 2022).
-
[14]
Vision Parallèle, n° 3, 1995, p. 47.
-
[15]
Manga à destination d’un public féminin adolescent. Le système d’édition japonais est extrêmement segmenté et produit des oeuvres en fonction d’un public cible.
-
[16]
Le catalogue en ligne du Fanzinarium est consultable sur le site http://fanzinarium.fr.
-
[17]
Entretien avec l’autrice, 13 septembre 2022.
-
[18]
Lorsque qu’on veut imprimer un motif avec des nuances de couleurs sur une machine monochrome, il est possible de créer un rendu nuancé en utilisant des points (de manière plus ou moins dense) au lieu d’un aplat.
-
[19]
Laurent Gerbier, « Lettrage », dans Thierry Groensteen (dir.), Le bouquin de la bande dessinée. Dictionnaire esthétique et thématique, Paris/Angoulême, Robert Laffont/Cité internationale de la bande dessinée et de l’image, coll. « Bouquin », 2021.
-
[20]
Entretien avec Aurore Demilly, 13 septembre 2022.
Bibliographie
- AnimeLand, n° 1 15.
- Mohamed Bouziani, « Sindbab le malicieux dans la vallée aux trois échos », Sakura, n° 1.
- Cathy Delanssay alias Miss Chan, Lullaby, n° 2.
- Dorothée magazine.
- Entretien avec Patrick Marcel, 27 juillet 2018.
- Entretien avec Myriam Morand, 4 août 2018.
- Entretien avec Jean Paul Jennequin, 25 septembre 2018.
- Entretien avec Kalahan, 5 mars 2019.
- Entretien avec Maëva Pierre, 19 février 2020.
- Entretien avec Aurore Demilly, 13 septembre 2022.
- Entretien avec Mohamed Bouziani, 31 octobre 2022.
- AnimeLand, du n° 1 au 115.
- Fun en bulles, n° 29, spécial « Manga à la française », 1997.
- Ikari no Ryu, n° 0, 1997.
- Kaméha.
- Light & Darkness, n° 0, 1997.
- Lullaby, n° 2, 1997.
- MaVille, A, 1997.
- MaVille, B, 1997.
- MyCity, hors série no III, 1997.
- MyCity, hors série no IV, 1997.
- MyCity, n° 7, 1997.
- Neo Jump, n° 2, 1997.
- Noname shinbun, n° 3, 1996.
- Okaz.
- Sakura, n° 1, 1997.
- SD Comics, n° 1, 1996.
- SD Comic, n° 3, 4 et 5, 1997.
- Sho, n° 0 et 1, 1997.
- Noname shinbun n° 3.
- Yoko.
- ACBD. (2007). 2007 : Vitalité et diversité. https://www.acbd.fr/1038/rapports/2007-vitalite-et-diversite.
- Jean Marie Bouissou, Manga : Histoire et univers de la bande dessinée japonaise, Arles, Éditions Philippe Picquier, 2013.
- Sébastien Floc’h, Japan Expo : Le meilleur de la culture japonaise, Paris, Hachette Heroes, 2019.
- Laurent Gerbier, « Lettrage », dans Thierry Groensteen (dir.), Le Bouquin de la bande dessinée, Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 2021.
- Olivier Gilbert, Cartoonist, l’histoire du premier salon manga français, s.l., Anime Vintage, 2018.
- Thierry Groensteen, L’univers des mangas, Tournai, Casterman, 1991.
- Kara, Sayonara Tonkam : une page se tourne, un livre se referme… Karafactory Voices. http://karafactory.blogspot.com/2010/04/sayonara-tonkam-une-page-se-tourne-un.html, 23 avril 2010.
- Sharon Kinsella, « Dessins à risques : les otaku et le manga amateur », dans Alessandro Gomarasca (dir.), Poupées, robots. – La culture pop japonaise, Paris, Autrement, 2002, p. 80 97.
- Marie Lherault et François Tron, La télévision pour les nuls, Paris, First Éditions, 2010.
- Clothilde Sabre, « La mise en tourisme de la pop culture japonaise : la légitimité culturelle par le croisement des regards exotiques », thèse de doctorat en ethnologie, École doctorale Sciences économiques, sociales, de l’aménagement et du management de Villeneuve d’Ascq, 2012.
- Gabriel Segré, Fans de... : sociologie des nouveaux cultes contemporains, Paris, Armand Colin, 2014.
- Yvan West Laurence et Gersende Bollut, Big bang Anim’ : confessions du fondateur d’AnimeLand, Montreuil, Omaké books, coll. « Culture geek », 2013.
Sources
Les fanzines de ma collection sont aujourd’hui disponibles en consultation libre au Fanzinarium à Paris. Pour l’accès et les horaires d’ouverture, consultez le site : http://fanzinarium.fr.