Ce volume collectif propose une mise en perspective de deux pratiques d’écriture européennes qui, entre les xvie et xviiie siècles, se chevauchent, se complètent et se transforment : la correspondance et la presse périodique. Il ne s’agit pas ici d’entreprendre une histoire conjointe de ces deux productions complexes et polymorphes, mais d’en cerner, par leur rapprochement, des effets de résonnance, de continuité, de reprise ou de contraste. Une telle approche se justifie si l’on considère que la presse périodique naît dans le sillage de la correspondance avec laquelle elle entretient durablement un rapport d’imitation et/ou de concurrence. L’étude des figures de lecteur·trice, à laquelle est dédié ce numéro, témoigne de cette parenté et de ces jeux de démarcation réciproques. Centrales au sein de ces deux genres d’écrit essentiellement adressés, ces figures déterminent des choix formels, des stratégies éditoriales et économiques autant que des politiques médiatiques. Réel·le, imaginaire, construit·e ou fantasmé·e, le·la lecteur·trice mobilise la correspondance et la presse périodique, et invite à lire l’histoire de ces pratiques discursives non pas isolément, mais dans la dynamique complexe, parfois labyrinthique, de leur interaction durant tout l’Ancien Régime. La correspondance comme la presse périodique ont fait l’objet de nombreuses recherches ces dernières décennies. Nous ne reviendrons ici que sur quelques éléments qui signalent les ponts existant entre ces deux corpus, plus particulièrement autour du rôle que joue la figure de lecteur·trice dans leur constitution et leur évolution. La correspondance, d’abord, comme « ensemble de lettres réellement expédiées qui mettent en scène un je non métaphorique s’adressant à un destinataire également non métaphorique », constitue l’une des formes de l’épistolaire. Connaissant un essor remarquable à la Renaissance, notamment sous l’influence cicéronienne, la correspondance, qu’elle soit érudite ou familière, puise aux sources d’une rhétorique antique revisitée. Art de l’entretien en différé, elle repose alors sur un système de distinction et de reconnaissance entre pairs, emblématique de la production textuelle humaniste. À ce titre, elle participe à l’élaboration et à la visibilité d’une culture élitiste et érudite tournée vers l’Antiquité. Cette allégeance au passé n’empêche pas, cependant, un ancrage fort dans le temps présent et au sein de géographies précises : la correspondance dessine des réseaux socioculturels et des écosystèmes intellectuels dans lesquels priment la circulation des informations, le partage des idées, mais aussi les marques d’affection et les pauses autoréflexives. La familiarité et le caractère privé de la lettre engagent, en effet, une posture auctoriale plus informelle et ouvrent à l’actualité du sujet écrivant. Le registre familier laisse ainsi pressentir l’examen de soi sous la plume de certain·e·s humanistes, permettant de faire coïncider principe formel et processus d’individuation. Certes, la « correspondance “familière” n’implique pas correspondance intime », mais elle joue sur l’image publique que l’on souhaite transmettre de soi et le portrait de la personne privée. Dans tous les cas, le·la destinataire détermine un certain genre d’éloquence (il faut lui plaire, le·la convaincre, susciter son admiration), tout en étant une figure en partie construite par le·la locuteur·trice (qui est l’ami·e, le·la critique, le·la censeur·e, le·la juge, etc.). Cependant, lorsqu’elle est insérée dans un mélange ou une série manuscrite structurée, la lettre change de nature : la médiation du recueil transforme la relation épistolaire, fondée sur une circonstance et un·e lecteur·trice ciblé·e, en un modèle textuel capable de servir de référence. Si le·la destinataire est essentiel·le à la pratique épistolaire, ses visages et ses fonctions se modifient donc au gré des conditions matérielles de circulation de la correspondance. Réciproquement, ce·tte nouveau·elle lecteur·trice, devenu·e public au contour plus flou, affecte à son tour les traits que prend la correspondance. Au cours des xviie …
Appendices
Bibliographie
- Jean Richer, Le Mercure François, ou, la suitte de l’Histoire de la paix. Commençant l’an M.DC.V. pour suitte du Septenaire du D. Cayer, & finissant au Sacre du Tres‑Chrestien Roy de France & de Navarre, Paris, 1612.
- Paul Aron, Denis Saint‑Jacques et Alain Viala (dir.), Le dictionnaire du littéraire, Paris, Presses universitaires de France, 2002.
- Pierre‑Yves Beaurepaire, Jens Häseler et Anthony McKenna (dir.), Réseaux de correspondance à l’âge classique (xvie‑xviiie siècle), Saint‑Étienne, Publications de l’Université de Saint‑Étienne, 2006.
- Déborah Blocker et Anne Piéjus (dir.), « Auctorialité, voix et publics dans le Mercure galant », Dix‑septième siècle, vol. 1, n° 270, 2016.
- Mathilde Bombart, Guez de Balzac et la querelle des Lettres. Écriture, polémique et critique dans la France du premier xviie siècle, Paris, Honoré Champion, 2007.
- Mathilde Bombart et Éric Méchoulan (dir.), Politiques de l’épistolaire au xviie siècle. Autour du Recueil Faret, Paris, Classiques Garnier, 2011.
- Hans Bots et Françoise Waquet (dir.), Commercium litterarium. La communication dans la République des Lettres. Forms of Communication in the Republic of Letters, 1600‑1750, Amsterdam/Maarssen, APA‑Holland University Press, 1994.
- Bernard Bray, « Espaces épistolaires », Études littéraires, vol. 34, no 1‑2, hiver 2002, p. 133‑151. https://doi.org/10.7202/007558ar.
- Isabelle Brouard‑Arends (dir.), Lectrices d’Ancien Régime, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2016.
- Mélinda Caron, « L’imaginaire de la féminité en (Ancien) Régime médiatique », Littératures classiques, vol. 2, n° 90, 2016, p. 89‑103.
- Virginie Cerdeira, « Le Mercure François, un recueil périodique d’histoire politique du temps présent », dans Mathilde Bombart, Sylvain Cornic, Edwige Keller‑Rahbé et Michèle Rosellini (dir.), « À qui lira ». Littérature, livre et librairie en France au xviie siècle, Tübingen, Gunter Narr Verlag, coll. « Biblio 17 », 2020, p. 447‑457.
- Roger Chartier, Lectures et lecteurs dans la France d’Ancien Régime, Paris, Seuil, 1987.
- Franck Collard, « La renaissance des lettres. La correspondance d’un humaniste français de la fin du xve siècle, Robert Gaguin (1433‑1501) », Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, vol. 74, no 1, 2012.
- James Daybell et Andrew Gordon (dir.), Cultures of Correspondence in Early Modern Britain, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 2016.
- Sébastien Drouin et Camelia Sararu, « Introduction », La lettre érudite. Nouvelles recherches sur la communication savante à l’époque moderne (xvie‑xviiie siècles), Arborescences, no 9, 2019. https://www.erudit.org/fr/revues/arbo/2019‑n9‑arbo05195/1068271ar/.
- Myriam Dufour‑Maître, « “Ces Messieurs du Recueil des pièces choisies”. Publication collective et anonymat féminin », Littératures classiques, vol. 1, no 80, 2013, p. 309‑322.
- Suzanne Dumouchel, Le journal littéraire en France au dix‑huitième siècle. Émergence d’une culture virtuelle, Oxford, Voltaire Fondation, 2016.
- Gérard Ferreyrolles, « L’épistolaire, à la lettre », Littératures classiques, vol. 1, no 71, 2010, p. 5‑27.
- Gilles Feyel, La presse en France des origines à 1944. Histoire politique et matérielle, Paris, Ellipses, 2007.
- Susan Fitzmaurice, The Familiar Letter in Early Modern English: A Pragmatic Approach, Amsterdam, John Benjamins, 2002.
- Françoise Gevrey et Alexis Lévrier (dir.), Érudition et polémique dans les périodiques anciens, xviie‑xviiie siècles, Reims, Presses universitaires de Reims, 2009.
- Guy Gueudet, L’Art de la lettre humaniste, Paris, Classiques Garnier, 2007.
- Stéphane Haffemayer, L’information dans la France du xviie siècle. La Gazette de Renaudot, de 1647 à 1663, Paris, Honoré Champion, 2002.
- Stéphane Haffemayer, « Transferts culturels dans la presse européenne au xviie siècle », Le Temps des médias, vol. 2, no 11, 2008, p. 25‑43.
- Frédéric Lachèvre (éd.), Bibliographie des recueils collectifs de poésies publiés de 1597 à 1700, Genève, Slatkine Reprints, 1967.
- Cécile Lignereux, « L’art épistolaire de l’âge classique comme champ d’application du savoir rhétorique », Exercices de rhétorique, no 6, 2016. http://journals.openedition.org/rhetorique/441.
- Éric Méchoulan, Lire avec soin. Amitié, justice et médias, Lyon, ENS Éditions, 2017.
- Benoît Melançon, Diderot épistolier. Contribution à une poétique de la lettre familière au xviiie siècle, Montréal, Fides, 1996.
- Benoît Melançon (dir.), Penser par lettre, Montréal, Fides, 1998.
- François Moureau, De bonne main. La communication manuscrite au xviiie siècle, Paris/Oxford, Universitas/Voltaire Foundation, 1993.
- Guillaume Pinson (dir.), La lettre et la presse : poétique de l’intime et culture médiatique, Médias19, 2012. http://www.medias19.org/index.php?id=275.
- Pierre Rétat (dir.), Le journalisme d’Ancien Régime, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1982.
- Clémence Revest, « Naissance du cicéronianisme et émergence de l’humanisme comme culture dominante : réflexions pour une histoire de la rhétorique humaniste comme pratique sociale », Mélanges de l’École française de Rome, vol. 125, no 1, 2013.
- Caroline Rimbault, « La presse féminine de langue française au xviiie siècle : production et diffusion », dans Pierre Rétat (dir.), Le journalisme d’Ancien Régime, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1982, p. 199‑216.
- Jean Sgard (dir.), Dictionnaire des journaux,1600‑1789, Paris, Universitas, 1991.
- Luc Vaillancourt, La lettre familière au xvie siècle. Rhétorique humaniste de l’épistolaire, Paris, Honoré Champion, 2003.
- Toon Van Houdt et al. (dir.), Self‑Presentation and Social Identification: The Rhetoric and Pragmatics of Letter Writing in Early Modern Times, Louvain, Leuven University Press, 2002.
- Aude Volpilhac, « Le secret de bien lire ». Lecture et herméneutique de soi en France au xviie siècle, Paris, Honoré Champion, 2015.
- Françoise Waquet, « De la lettre érudite au périodique savant : les faux semblants d’une mutation intellectuelle », Dix‑septième siècle, vol. 35, no 140, 1983, p. 347‑359.

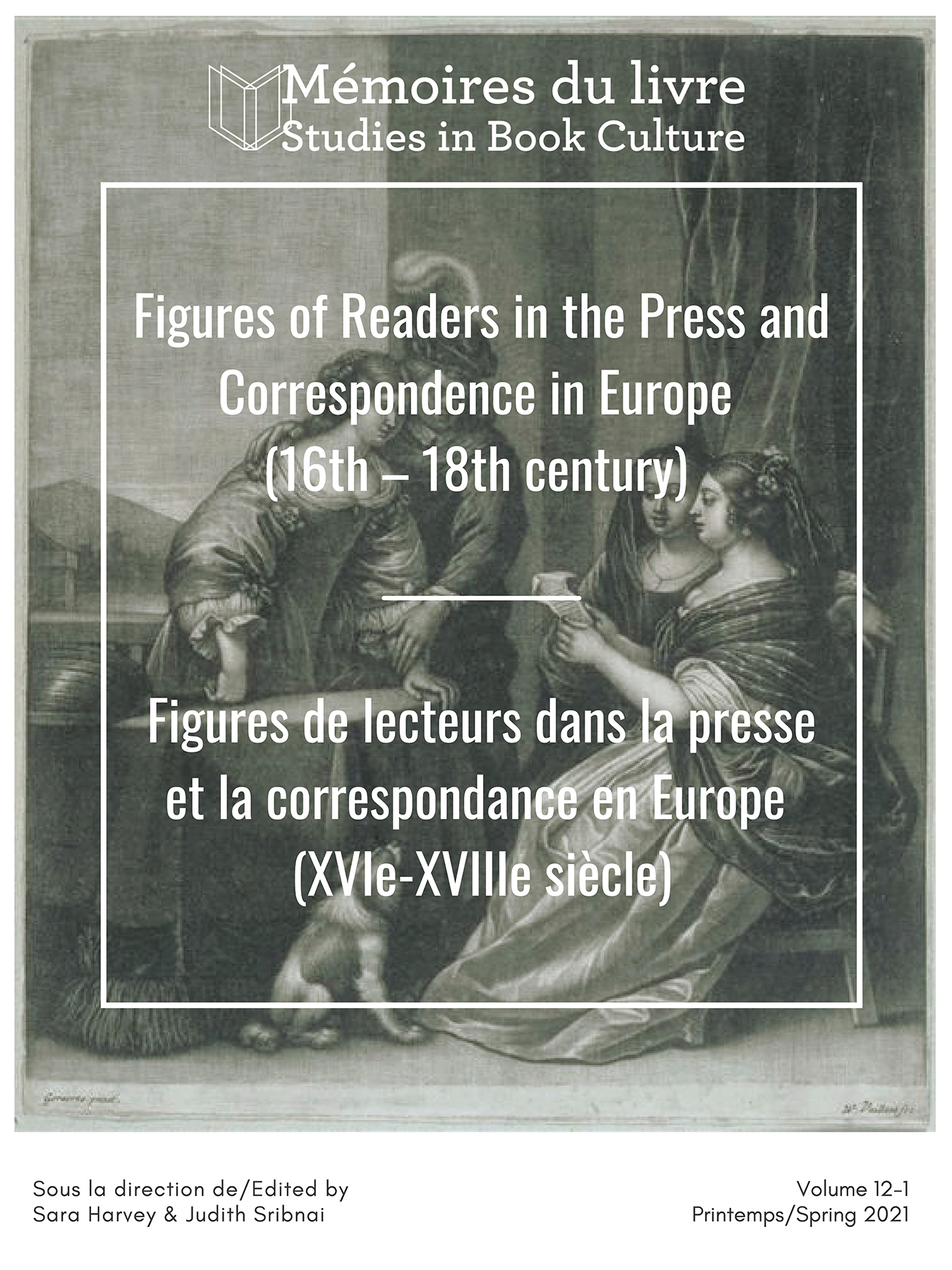

 10.7202/007558ar
10.7202/007558ar