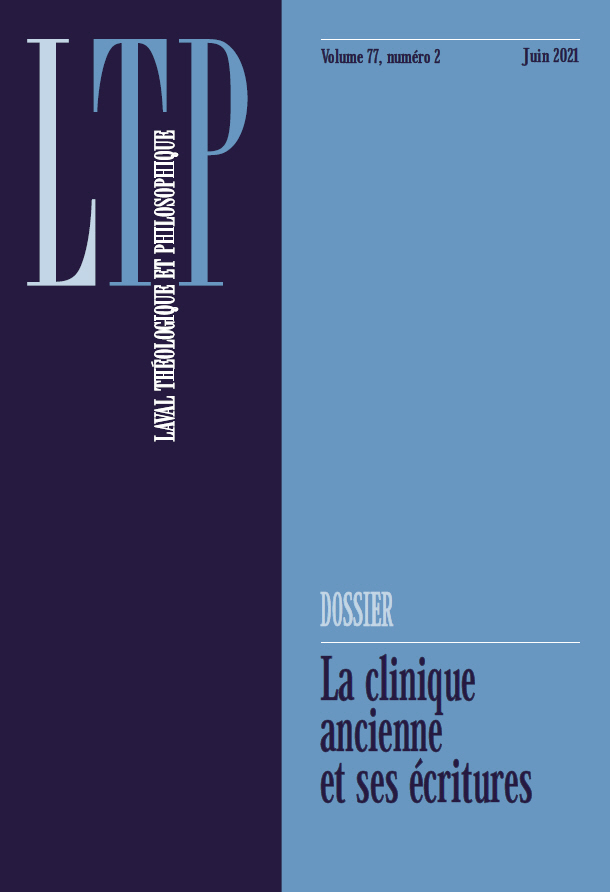Article body
Les deux ouvrages offrent plusieurs similitudes, tout en étant bien différents. Les auteurs sont deux grands et prolifiques théologiens français de tradition protestante : l’un, André Gounelle, réformé ; l’autre, Gérard Siegwalt, luthérien. Les deux sont à l’origine de l’Association Paul Tillich d’expression française (APTEF). Après une longue carrière d’enseignement universitaire de la théologie (Gounelle à Montpellier, Siegwalt à Strasbourg), les deux sont actuellement à la retraite, un temps propice à la réflexion sur le sens de la foi et de la théologie.
I. André Gounelle, Dieu encore et toujours [1]
Les premiers mots de Gounelle, dans son Avant-propos, indiquent bien le ton de l’ouvrage : « Pour moi, Dieu est avant tout une présence. Cette présence m’accompagne, m’habite et m’anime ; elle me bouscule et m’apaise ; elle m’apporte en même temps réconfort et exigence » (p. 7). Il poursuit, du point de vue théologique cette fois : « Comme toute expérience, cette présence sollicite la pensée, elle demande à être cernée, analysée, scrutée, évaluée et comprise aussi rigoureusement que possible » (ibid.).
Dieu est donc en même temps objet d’expérience et de réflexion. Gounelle a déjà fait paraître chez le même éditeur trois ouvrages sur Dieu : Après la mort de Dieu (1974 et 1999), Le dynamisme créateur de Dieu (1980 et 2000). Parler de Dieu (1998 et 2004). S’il récidive, c’est qu’il n’a jamais fini de le penser : « Il me faut penser et dire Dieu parce que j’éprouve sa présence ; mais précisément parce qu’il s’agit d’abord d’une présence et non seulement d’un objet d’étude, je n’arriverai et personne ne parviendra jamais à le penser jusqu’au bout » (p. 8).
Cela explique le « toujours et encore » du titre : « Les deux adverbes “toujours et encore” du titre de l’ouvrage ne traduisent pas la lassitude excédée d’une rumination sans fin ou d’un piétinement sans débouché ; ils expriment plutôt de l’émerveillement devant ce que Dieu, à la fois fidèle à lui-même et sans cesse nouveau, a d’inépuisable » (p. 9). Dieu toujours nouveau, c’est le Dieu toujours vivant. Mais la pensée toujours renouvelée de Dieu est aussi l’expression continue de la vitalité et de l’historicité humaines. À chaque étape, à chaque moment de sa vie, l’être humain fait de nouvelles expériences, où le visage de Dieu se reflète de façon différente.
1. La parabole du jardinier invisible
Le premier chapitre de l’ouvrage présente la question de Dieu telle qu’elle se pose aujourd’hui. Gounelle le fait de façon originale, à l’aide de trois paraboles. J’en retiens la première, proposée par Anthony Flew. Elle illustre bien la différence entre le croyant (théiste) et l’incroyant (athée).
« Un jour, deux explorateurs arrivent dans une clairière au beau milieu de la forêt vierge. Cette clairière est très belle : quantité de fleurs et de mauvaises herbes y poussent. L’un des explorateurs affirme : “Il doit nécessairement y avoir un jardinier qui entretient cette clairière.” L’autre explorateur n’est pas d’accord : “Il n’y a aucun jardinier” » (p. 11-12). Le sens est clair. La clairière, c’est le monde ; l’hypothétique jardinier, c’est Dieu, le créateur du monde ; mais ce créateur est invisible et indémontrable, ce qui est source de dissension.
Gounelle admet qu’un tel jardinier invisible est « quelqu’un qui correspond à l’image habituelle de Dieu dans notre culture » (p. 12). Mais voilà ce qui ne va pas. Et voilà par où doit commencer la discussion : non pas par la question de l’existence de Dieu, mais par celle de l’idée qu’on s’en fait. Gounelle renvoie donc ici à la distinction, qui se trouve déjà chez Calvin, entre « croire que Dieu existe » et « croire en Dieu ». Croire que Dieu existe signifie « estimer que les êtres et les choses impliquent une réalité objective qui est leur origine », leur cause. Croire en Dieu « signifie vivre en relation avec Dieu et en fonction de Dieu, avoir un lien existentiel avec lui » (ibid.). Voilà donc bien marquée la différence entre une approche purement objective de Dieu, considéré de façon extérieure, détachée, et une approche existentielle, où je suis moi-même concerné, engagé dans la relation.
Paul Tillich dira à ce propos que Dieu n’est pas un être particulier séparé des autres, au-dessus des autres ; il est l’être-même. Pourtant, il nous concerne personnellement ; il est notre ultimate concern, ce qu’il y a de plus important pour nous. En ce sens, il est pour nous en même temps personnel et transpersonnel. Ce que Gounelle exprime à sa façon : « Si Dieu a une dimension personnelle, il est autre chose et bien plus qu’une personne ; notre lien avec lui implique une relation de personne à personne sans jamais s’y réduire » (p. 21).
2. Dieu et l’idéal humaniste
Le deuxième chapitre de l’ouvrage aborde une question encore tout à fait actuelle et pertinente. Il s’agit du rapport entre la foi en Dieu et la croyance à l’idéal humaniste du vrai, du juste, du bien. Gounelle définit la question en ces termes : « Dieu apporte-t-il quelque chose de spécifique qu’on ne trouve pas dans un idéalisme humaniste ? » (p. 23). La question est traitée ici à partir des échanges ayant eu lieu en 1903 entre deux figures importantes du protestantisme libéral, Ferdinand Buisson et Charles Wagner.
Les deux adhèrent pleinement aux valeurs humanistes, mais Buisson représente les libres penseurs qui rejettent la foi en Dieu, identifiée à la pensée supranaturaliste, et qui lui substituent la foi humaniste : « Pour eux, croire en Dieu et le servir ne veut rien dire d’autre qu’“aimer le bien et aimer l’humanité” » (p. 25-26). Buisson peut donc écrire : « Foi religieuse et foi morale semblent se confondre, […] elles font pareillement croire au devoir, croire au bien, croire à un idéal vers lequel monte lentement le progrès de l’homme et de l’humanité » (p. 26).
Pour Wagner cependant, Dieu ne se réduit pas à un tel idéal rationnel qui donne sens à la vie et qui éclaire la conduite des humains. Il est le Dieu vivant, principe de vie non seulement de sens. Il est le dynamisme créateur qui permet non seulement de connaître, mais aussi de réaliser concrètement, dans sa vie et dans le monde, ces idéaux humanistes, en dépit de tous les obstacles qui se présentent. Gounelle peut donc écrire : « Quand on fait de Dieu un principe de la raison, principe explicatif ou principe éthique, on le mutile et on le rapetisse. On oublie qu’il est surtout une puissance vivante capable de faire du nouveau et d’opérer […] des transformations créatrices » (p. 26-27).
La question devient alors celle du rapport entre morale et religion. « Pour Buisson, écrit Gounelle, la religion […] a pu être utile pour susciter et favoriser la moralité à des époques incultes et barbares […]. Avec les progrès de la conscience morale, elle l’est moins » (p. 30). Ce qu’ajoute la religion à la morale, pourrait-on dire, c’est la réalisation concrète, historique, de l’idéal moral proposé. L’évangile ne propose pas seulement l’idéal moral du christianisme ; c’est la réalisation concrète de cet idéal dans la personne de Jésus. Et c’est l’inspiration (l’Esprit, la grâce) qui permet, aujourd’hui encore, la réalisation de ce même idéal.
3. Le monothéisme de l’alliance et celui de la création
Avec le troisième chapitre sur le monothéisme, on passe du registre existentiel de la foi à celui, objectif, de l’histoire des religions. Le chapitre commence, en effet, avec la distinction du cosmothéisme, du polythéisme, de l’hénothéisme et du monothéisme. Gounelle reconnaît que « pour commode qu’elle soit, cette classification n’en demeure pas moins superficielle et lacunaire » (p. 37). Le problème n’est pas seulement celui de l’exactitude historique, mais d’abord celui du caractère purement objectif, extérieur, de la classification : « […] les fidèles des divers cultes ne se disent pas polythéistes ou monothéistes ; ces termes sont utilisés par ceux qui les étudient et parlent d’eux de l’extérieur » (p. 35).
Cette distinction des deux approches, objectivante et existentielle, prend toute sa signification dans la partie du chapitre consacrée à la dualité du monothéisme biblique. Gounelle s’inspire alors d’une analyse de Thomas Römer qui distingue dans les écrits bibliques deux composantes, l’une ségrégationniste, l’autre universaliste : « La première se concentre sur l’alliance, la seconde sur la création » (p. 42). En effet, l’alliance signifie « le lien particulier que Dieu contracte avec des élus » (ibid.). Une telle relation risque toujours de verser dans l’exclusivisme. Par contraste, le Dieu créateur de l’Univers « ne réserve pas à quelques-uns sa parole, sa présence et son action ; il intervient et se manifeste partout » (p. 43-44).
Ces dernières remarques expriment le point de vue objectivant de l’observateur, de l’historien des religions. Il en va autrement si l’on adopte l’approche existentielle qui est celle de la foi religieuse. Je reconnais alors que je suis saisi par la présence de Dieu qui se présente, qui se révèle à moi. Mais ce saisissement grâce auquel je reconnais Dieu comme mon Père n’exclut d’aucune façon la réalité d’autres enfants de Dieu qui bénéficient d’une relation semblable avec lui. C’est bien ce que soutient Gounelle quand il écrit : « Pour être le Dieu de tous, il n’en est pas moins mon Dieu, celui avec qui j’ai une relation vivante et singulière. Toutefois, rien n’interdit qu’il ait des liens différents, mais tout aussi vivants et singuliers avec n’importe laquelle de ses créatures » (p. 45).
4. La Trinité
Après le chapitre sur le monothéisme biblique suit, comme il se doit, celui sur la trinité. Ce que je suis porté à appeler le dogme mal-aimé du christianisme, tant catholique que protestant. Bien des prêtres catholiques se sentent au supplice quand ils doivent prêcher le dimanche de la Sainte Trinité. Et Gounelle entame lui-même son chapitre sur la trinité par ces mots : « Ce chapitre m’embarrasse et je me le serais volontiers épargné » (p. 49).
Il précise d’abord de quoi il s’agit : « Par trinité j’entends la doctrine qu’ont formulée aux ive et ve siècles de notre ère les conciles de Nicée (325) et de Constantinople (381) dans des “symboles”, auxquels on ajoute, en général, le Quicumque, attribué (à tort) à Athanase d’Alexandrie, rédigé entre 430 et 500. Ces textes déclarent, en gros, que Dieu est une essence ou une substance unique en trois personnes ou instances différentes : le Père, le Fils, et l’Esprit » (p. 51).
Dans les débats théologiques qui s’ensuivent, on tentera de concilier monothéisme et trinitarisme. Cela se fera selon deux lignes de pensée différentes, celle de la « trinité immanente » (la trinité immanente à Dieu de toute éternité), et celle de la « trinité de l’histoire du salut » (le Père envoie son Fils, et le Fils envoie son Esprit).
Ces deux perspectives se retrouvent chez Gounelle. La trinité immanente se trouve dans le dynamisme même de la vie divine :
Pour le croyant, Dieu est puissance […], ce qui correspond à la première personne de la trinité […]. Dieu est également sens, ce qui correspond à la deuxième personne de la trinité, associée à la sagesse ou au Logos (logos, en grec, veut dire « parole raisonnable et raisonnée ») et symbolisée par la figure du Fils. Et Dieu est l’unité de la puissance et du sens […], ce qui correspond à l’Esprit, dont on dit classiquement qu’il est l’union du Père et du Fils.
p. 58
Cette interprétation est ingénieuse, mais pas tout à fait satisfaisante quant à son fondement biblique, pour ce qui concerne l’Esprit. Et c’est là une interprétation purement « immanente » de la trinité, ce qui laisse l’impression d’une spéculation sur le mystère.
L’autre perspective se trouve aussi chez Gounelle, celle de la trinité de l’histoire du salut. Elle se trouve partout où l’auteur signale que la trinité ne concerne pas seulement Dieu en lui-même, mais Dieu par rapport à nous : « Pour ma part, je crois que Dieu est fondamentalement “emmanuel” (ce qui veut dire “Dieu avec nous”). Il n’est Dieu que dans sa relation avec l’homme et le monde, ce qu’à mon sens exprime l’affirmation qu’il est amour et relation » (p. 55-56).
On renoue par là avec la tradition biblique. Pensons aux célèbres versets d’Is 55,10-11 : « De même que la pluie et la neige descendent des cieux et n’y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer pour fournir la semence au semeur et le pain à manger, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche, elle ne revient pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que j’ai voulu et réalisé l’objet de sa mission. » Une note de la Bible de Jérusalem commente ici : « La parole de Yahvé est semblable à un messager qui ne revient qu’après avoir accompli sa mission. »
Telle est précisément la notion vétérotestamentaire du Shaliah : l’émissaire, le messager, l’envoyé. Le Logos ne se distingue de Dieu que pour autant qu’il est envoyé par lui. Mais alors, il le représente, il le rend présent, il s’identifie à lui. Il doit être reçu au même titre que celui qui l’envoie. Ainsi en est-il du Verbe envoyé par Dieu, et de l’Esprit envoyé par le Christ. S’il y a un ancrage biblique pour la doctrine trinitaire, c’est bien là qu’il se trouve.
5. Le Père
Le cinquième chapitre commence par des considérations sur les noms divins. Gounelle rappelle l’importance du nom dans les cultures anciennes. Elles « accordent une très grande valeur et beaucoup de poids au nom. Elles l’identifient avec la personnalité de celui qui le porte » (p. 62).
Il en va de même, tout particulièrement, pour le tétragramme YHWH dans le judaïsme : « Il est “le nom par excellence”. Plus que tout autre, il détient en lui quelque chose de la puissance et de la présence divines ; on le considère comme aussi sacré que celui qu’il désigne. On ne doit pas “le prendre en vain”, l’utiliser à la légère » (ibid.). En somme, le nom divin représente le Dieu qu’il désigne, comme font les images, les représentations du divin. Aussi est-il soumis aux mêmes interdits.
À propos du tétragramme encore, Gounelle rappelle une évolution importante indiquée en Ex 6,3, où Dieu dit à Moïse : « Je suis apparu à Abraham, à Isaac et Jacob comme El Shaddai ; mais je n’ai pas été connu par eux sous mon nom de YHWH. » Dieu prend donc un nouveau nom qu’il révèle à Moïse en Ex 3,14. Gounelle commente alors bien justement que changer de nom n’a rien d’anodin : « Quand il s’agit de Dieu, on indique ainsi qu’il prend un visage différent ; le lien que ses fidèles ont avec lui se modifie. En recevant ou en proposant une nouvelle manière de nommer Dieu, Moïse témoigne d’une révélation et d’une alliance qui prolongent, transforment et remplacent celles dont avaient auparavant bénéficié Adam, Noé ou Abraham » (ibid.). En somme, le nouveau nom de Dieu témoigne d’une nouvelle alliance qu’il contracte avec son peuple.
On doit en dire autant de l’appellation de Dieu comme Père dans la bouche de Jésus. Gounelle dit bien : « Elle suggère que Jésus, à l’instar de Moïse, apporte ou dévoile un nouveau nom propre de Dieu inaugurant ainsi une nouvelle alliance » (p. 64).
Cela est d’autant plus vrai que la paternité divine est toujours considérée dans la Bible comme une paternité d’alliance, non comme paternité d’engendrement. Gounelle le reconnaît en reprenant la distinction qu’il a déjà faite entre le monothéisme de l’alliance et le monothéisme de la création : « Quand l’Ancien Testament parle de la paternité divine, il la lie à une élection (à un choix déclaré par une parole) plus qu’à la création (au fait de conférer l’être ou la vie) » (p. 65). Tel est bien le sens de Jr 31,9 : « Car je suis un père pour Israël et Éphraïm est mon premier-né. »
On peut alors répondre, partiellement du moins, à une double objection que rappelle ici Gounelle. D’abord, « qualifier Dieu de “père” choque souvent les musulmans » (ibid.), soit parce que cette appellation implique une sexualité qui ne convient pas à Dieu, soit parce qu’elle s’avère trop familière, rapprochant trop Dieu de l’homme. L’objection tombe quand on reconnaît qu’il s’agit d’une paternité d’alliance plutôt que d’engendrement. L’alliance implique alors la loi, les commandements en même temps que l’amour.
L’autre objection est plus difficile. C’est l’objection féministe : « Pourquoi nommer Dieu “père” et non “mère” ? » (p. 67). S’il s’agit des textes bibliques, la réponse est simple : c’est parce que ces textes relèvent d’une culture patriarcale. La transposition dans une culture non patriarcale peut se faire alors « en découplant paternité et masculinité » (ibid.). Cela est possible quand on distingue la paternité d’alliance (dont parle la Bible) de la paternité biologique (dont il est question dans l’objection). La paternité (ou parenté) d’alliance, d’élection, comprend alors la mère aussi bien que le père.
6. La Providence
Le chapitre sur la Providence suit celui sur le Père. N’est-ce pas le rôle du père, ce qu’on attend de lui, de protéger sa famille et chacun de ses membres ? Et c’est bien là aussi l’attitude de la foi : la conviction qu’on n’est pas seul pour affronter les négativités de la vie.
La notion de providence est, d’une façon ou d’un autre, commune à toutes les religions. Gounelle rappelle le sens qu’elle a chez les Grecs, chez les stoïciens tout spécialement, selon lesquels « une nécessité universelle et contraignante modèle, dirige, détermine le monde dans ses plus petits détails » (p. 75). La foi chrétienne en la Providence est bien différente : « Le croyant vit dans la sérénité et la confiance, car il se sent entouré par la sollicitude divine » (p. 76). Cette différence existentielle, Gounelle en parle comme « d’une différence analogue à celle entre l’idéal humaniste de Buisson et le Dieu vivant de Wagner » (ibid.).
Dans le même sens, Gounelle rappelle la distinction faite par Bultmann, qui « sépare l’objectivant (le fonctionnement des choses) de l’existentiel (le vécu croyant) » (p. 77). Mais cette distinction ne le satisfait pas : « Il serait absurde de faire existentiellement confiance à Dieu pour la vie de tous les jours si Dieu n’intervenait pas objectivement, d’une manière ou d’un autre, dans la marche du monde » (ibid.).
Cette dernière idée n’est pas pleinement satisfaisante non plus. Car on se retrouve là en plein supranaturalisme, Dieu intervenant dans le monde et dans la vie des humains. Dieu se trouve alors objectivé, personnifié comme quelqu’un qui, du haut du ciel, à chaque instant dirige l’ordre du monde. Par contre, de façon tout à fait opposée, pour sauvegarder l’autonomie du monde et la liberté des humains, d’autres affirment que Dieu n’intervient d’aucune façon (p. 82).
On explique parfois les choses en supposant que Dieu, dans sa grande sagesse, conduit le monde par des voies qui nous sont inconnues, pour le plus grand bien du monde et de chacun d’entre nous. On se réfère alors à ce verset de Rm 8,28 : « Nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. » Gounelle conteste la pertinence de cette référence dans ce contexte : « Elle vacille quand on s’aperçoit que, comme l’écrit Tillich, “beaucoup de choses se terminent mal” » (p. 84).
Une autre référence au même chapitre de Paul serait sans doute plus pertinente ici : « Qui nous séparera de l’amour du Christ ? La détresse, l’angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive ? […] Mais en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par Celui qui nous a aimés » (Rm 8,35-37). On retrouve là le paradoxe de l’évangile : la foi en dépit de tout. Le fondement de la foi alors, ce n’est pas telle ou telle raison qui explique la gouvernance divine du monde et de la vie ; c’est l’amour de Dieu qui nous saisit et nous soutient, au coeur de l’obscurité de la foi.
7. Dieu, une invention ?
Du septième et dernier chapitre, je retiens le dernier point, intitulé : « Dieu une invention ? » C’est la question de la réalité de Dieu. On en parle habituellement comme de la « projection » de Dieu : Dieu ne serait pas une réalité objective, mais une simple projection de l’imagination humaine. Dans le même sens, Gounelle demande si Dieu est autre chose qu’une simple invention humaine. La question est bien pertinente aujourd’hui, où Dieu semble de plus en plus absent de la culture et de la conscience humaine.
Gounelle reprend la question du point de vue sémantique, celui de la signification du mot. Il rappelle qu’« invention » vient du latin invenire, qui ne signifie pas « créer quelque chose qui n’existait pas auparavant », mais « rencontrer ce qu’on ne connaissait pas jusque-là ». En somme, « on invente quelque chose quand on le découvre » (p. 100). L’argumentation est subtile, mais elle me semble contourner la question au lieu d’y répondre. Selon cette interprétation, en effet, Dieu n’est d’aucune façon un objet construit par l’homme ; c’est une réalité qu’on découvre.
Je préfère, pour ma part, l’interprétation de Tillich, qui s’attaque directement à l’objection de la projection, selon laquelle « les dieux ne sont rien d’autre que des projections imaginaires d’éléments naturels et humains, appartenant à la finitude[2] ». Tillich insiste alors sur la distinction entre la projection et l’écran sur lequel se réalise cette projection :
Ce que ces théories [de la projection] méconnaissent, c’est qu’une projection se fait toujours sur quelque chose, un mur, un écran, un autre être, un autre domaine. On tombe dans une évidente absurdité quand on met sur le même plan la projection elle-même et ce sur quoi il y a projection. Un écran n’est pas projeté, il reçoit la projection. Le domaine contre lequel les images divines sont projetées n’est pas lui-même une projection. C’est l’expérience de la réalité ultime de l’être et du sens. C’est le domaine de la préoccupation ultime[3].
La projection est alors une expression de la réalité divine, du mystère divin de l’être. Ce mystère est bien réel et nous en sommes conscients d’une certaine façon. Telle est la conscience originelle de la révélation divine. Cette conscience du mystère divin est d’abord confuse : c’est la foi qui cherche l’intelligence (fides quaerens intellectum). Or la première étape de l’intelligence de la foi est précisément celle de la projection. On pourrait aussi bien dire : celle de l’objectivation, de la représentation du mystère divin.
Gounelle disait bien, à la première ligne de son volume, que Dieu est pour lui une présence. Cette présence qui nous englobe, qui nous comprend, nous désirons la comprendre à notre tour, et pour cela nous l’objectivons, nous la faisons passer devant nous, devant nos yeux. Par là, nous l’amenuisons, nous la diminuons, mais ce n’est pas pure invention. C’est encore et toujours un aspect du divin, comme l’étincelle qui surgit du brasier.
II. Gérard Siegwalt, La réinvention du nom de Dieu. Où donc Dieu s’en est-il allé ? [4]
La brève préface (p. 9-11) situe bien le propos du volume. Au point de départ, c’est le constat de l’absence de Dieu, qui n’appartient plus à la réalité du monde présent. Cette absence est d’ordre objectif, concernant la connaissance, tout aussi bien que d’ordre existentiel, quant à la vie quotidienne. On n’a plus besoin de Dieu pour expliquer l’ordre du monde, et on n’a plus besoin de lui pour obtenir ce dont on a besoin. Ce fait, ce constat, requiert un discernement pour reconnaître ce qui a été gagné et ce qui a été perdu dans cette avancée culturelle.
Car le sentiment du temps présent comporte aussi autre chose, soit une nouvelle conscience de Dieu, jaillissant à travers les restes du passé. Voilà surtout ce qu’entend montrer Siegwalt : cette conscience qui émerge des ruines de la civilisation passée. Nous ne ressentons pas seulement la fin d’une certaine conscience de Dieu, de la religion et de l’Église ; notre monde moderne lui-même, dans tous les éléments de sa culture, nous apparaît comme en fin de vie. Mais on peut reconnaître là même un nouveau commencement, comme l’appel à un nouvel avènement de Dieu.
1. L’absence de Dieu
L’absence de Dieu peut être considérée du côté de Dieu : c’est la mauvaise compréhension qu’on a de Dieu. Elle peut être vue aussi du côté humain : c’est le péché humain qui éloigne de Dieu.
La mécompréhension de Dieu. — La théologie a pour fonction la compréhension de Dieu, plus précisément la compréhension de la foi en Dieu, de l’expérience humaine de Dieu. La mécompréhension de Dieu sera donc attribuée aux failles de la théologie. Il n’y a pas de théologie éternelle, hors du temps. Une théologie peut avoir été excellente en son temps, et ne plus convenir aujourd’hui. — La principale déviation théologique que signale Siegwalt est aujourd’hui celle du supranaturalisme, qu’il définit comme suit : « Le supranaturalisme, stigmatisé ici à la suite de Paul Tillich, c’est le dualisme de l’immanence et de la transcendance, c’est la transcendance substantivée, objectivée et donc extérieure à l’immanence » (p. 33). Le dualisme de l’immanence et de la transcendance, c’est celui des deux mondes, naturel et surnaturel. Dieu se trouve alors identifié au monde surnaturel. C’est un être distinct de tous les êtres naturels, un être en plus des autres. Voilà bien une objectivation de Dieu, qui le réduit à un élément de l’univers. C’est l’être le plus parfait, le plus important, l’Être suprême.
L’éloignement de Dieu par le péché. — L’absence de Dieu, la perte de Dieu à notre époque, est aussi le fait de l’éloignement humain par le péché. Le péché prend alors toute sa signification. Ce n’est pas simplement une faute morale, la désobéissance à un quelconque commandement ; c’est la rupture de l’alliance avec Dieu. Et c’est en même temps une aliénation par rapport à soi-même, puisque Dieu est le fondement créateur de notre être (p. 41-42).
2. L’ébranlement de la civilisation moderne
La civilisation moderne est celle de l’ébranlement des religions et de la disparition de Dieu. Mais la modernité se trouve elle-même ébranlée actuellement, et de cet ébranlement semble resurgir un nouveau cri vers Dieu. Siegwalt mentionne trois aspects de cet ébranlement : la catastrophe écologique, la catastrophe sociale et la catastrophe humaine, personnelle.
La catastrophe écologique. — Elle « marque la fin d’un monde, celui de la modernité » (p. 78). Mais cette fin comporte un nouveau commencement : « Elle appelle et annonce une autre civilisation qui, dans la fin de la civilisation précédente, se prépare grâce à un discernement […] entre ce qui, dans la modernité, apparaît comme condamné et ce qui y est des éléments susceptibles de devenir partie prenante de la nouvelle civilisation en gestation » (ibid.). Car la modernité signifie une avancée importante pour le bien-être de l’humanité. Cette avancée s’effectue malheureusement au détriment de la nature, qui se trouve alors surexploitée.
La catastrophe sociale. — Mais il y a aussi un autre aspect du malaise de la civilisation moderne. Ce sont les disparités sociales qui en résultent entre les peuples et entre les individus. La catastrophe sociale consiste dans « l’injustice entre les peuples et dans les peuples entre catégories sociales, et elle porte en elle une menace majeure pour la paix » (p. 80). Cela « ouvre l’abîme de la barbarie dans lequel peut s’engouffrer à tout moment l’humanité » (ibid.).
La catastrophe humaine, personnelle. — On en arrive ainsi à l’aspect existentiel de la question : le mal. Il y a le mal subi, le malheur qui nous arrive et qui soulève la question de son sens : « […] la question métaphysique de la théodicée, de la justice de Dieu face au mal ainsi entendu » (p. 81). Il y a aussi la faute, la réalité « du mal agi qui rend coupable » (ibid.). Là encore se trouve posée implicitement la question de Dieu, sous la forme de la question de la transcendance, de l’obligation morale.
Le choc du réel. — On voit comment la question de Dieu revient dans ce que Siegwalt appelle ici « le choc du réel ». La modernité signifie l’accès de l’humanité à l’âge adulte, à l’âge de la pleine autonomie. Mais l’autonomie devient vite alors domination. Domination sur la nature, asservie à tous les besoins et désirs humains ; domination des humains, les uns sur les autres ; enfin domination sur sa propre destinée qu’on désire conduire à son gré. Mais cela ne va pas, et c’est ce que révèle le choc du réel, qui résiste aux prétentions humaines. Siegwalt en conclut : « […] à chaque fois le réel concerné doit être traversé, nommé, perlaboré afin de dégager en lui la question de Dieu en tant que s’y posant de manière neuve » (p. 81-82).
3. Le balbutiement du nom
Le cri issu du choc du réel. — Le choc du réel dont on vient de parler comporte lui-même deux aspects contrastants. D’abord, un aspect de déconstruction. Car l’effondrement de certaines valeurs centrales de la modernité laisse entrevoir l’abîme qui menace. C’est ce qu’en retiennent plusieurs de nos contemporains, qui ne voient rien de positif dans le temps présent, et encore moins dans celui qui vient. D’autres pourtant gardent espoir : c’est l’espérance d’un monde nouveau, d’une nouvelle civilisation. Cette espérance s’appuie sur le fondement divin de la création. Une telle espérance s’exprime d’abord dans le cri dont parle Siegwalt : « Cette nouvelle ère est le sens du cri issu du choc du réel, le sens du balbutiement du nom qui procède de ce cri et qui annonce ce qui n’est pas encore advenu mais est susceptible d’advenir » (p. 125).
Universalité du cri. — Le cri dont on parle signifie, inclut tout le réel, aussi bien historique que cosmique. Mais, par le fait même, il demeure indéterminé, il ne signifie rien de particulier, de précis. Voyons chacun de ces deux aspects contrastants. L’universalité du cri d’abord. Siegwalt écrit : « Il en va, avec, dans et à travers ce cri non seulement de quelque chose, mais de tout : du tout holistique prenant en compte, avec le particulier, l’universel, et du tout essentiel qui est au fondement et à la fin […] de ce tout holistique » (p. 126). — Ce cri, qui s’exprime à travers l’esprit humain, procède du tout de la nature et de l’histoire. Il vient de la profondeur du fondement divin de l’être, et il aspire à la finalité, à l’accomplissement de tout le réel : « Le cri total est un cri religieux, le cri religieux un cri total, c’est-à-dire : il vise Dieu à travers le tout holistique et à travers Dieu le tout holistique. […] Latence religieuse du cri : en lui sont cachées en puissance la totalité du réel et la prégnance de la transcendance qui le porte et l’oriente » (p. 127).
Indétermination du cri. — Autant le cri fondamental est riche en contenu, autant il est pauvre dans son expression. Il dit tout et rien. D’où l’insatisfaction du cri. On ne peut en rester là ; il conduit au-delà de lui-même, jusqu’au nom de Dieu. C’est ce qu’entend Siegwalt quand il parle du balbutiement du nom de Dieu dans le cri : « Le sens du cri, c’est le balbutiement du nom. […] Il faut écouter — et entendre — non le cri comme tel, mais le balbutiement qui se murmure en lui » (p. 128).
4. L’accouchement du nom
Le tabou de Dieu. — Siegwalt parle de ce passage du cri au nom (de Dieu) comme d’un accouchement, pour indiquer les peines qu’il comporte. C’est par ces mots que s’ouvre le chapitre : « Un accouchement est le brisement d’un interdit. En l’occurrence, et au fond, du tabou de Dieu » (p. 129). Ce tabou est caractéristique de la modernité : « Car c’est bien à cela que l’oubli de Dieu a conduit la civilisation moderne : à tabouiser Dieu, à en faire un interdit […]. Le nom de Dieu imprononçable dans la sphère publique ; sauf à choquer et à provoquer la discrimination de soi » (ibid.).
Le tabou de la religion. — Du tabou de Dieu, on passe à celui de la religion. Les deux vont de pair. La religion se définit par Dieu ; Dieu engendre la religion. Ce qui fait problème à la modernité, ce n’est pas Dieu comme tel, mais la religion qui se réclame de lui. La modernité signifie l’accès à l’autonomie. Si elle s’attaque frontalement à la religion, c’est qu’elle y voit la principale menace à l’autonomie politique et à la liberté personnelle. Siegwalt dénonce la tentation hégémonique de la religion, qui pourrait s’ensuivre du brisement du tabou de Dieu : « Tentation d’une revanche théocratique, que ce soit au nom de la collusion entre le religieux à prétention hégémonique et le politique assigné à la fonction servante ou que ce soit au nom de l’exclusivisme religieux, fanatisme pathologique déniant la réalité même du politique : il est l’image, sur le plan religieux, du totalitarisme sur le plan politique » (p. 136).
Un retour du religieux ? — Parallèlement au brisement du tabou de Dieu, Siegwalt note donc un nouvel intérêt pour les religions, provenant de la même source transcendante : « Après l’oubli de Dieu […], l’athéisme intellectuel antireligieux tout comme l’allergie émotionnelle antireligieuse […] cèdent la place — ici et là — à une nouvelle ouverture — un nouvel intérêt — pour elles [les religions], voire à une nouvelle quête religieuse » (p. 84-85). Siegwalt refuse cependant d’y voir le « retour du religieux », comme on dit souvent : « Le “retour du religieux” n’est pas déjà à la hauteur du défi qu’est le choc du réel : il est un retour du passé, lequel sans être supprimé est largement dépassé, l’histoire étant devenue autre » (p. 123-124). En somme, la réinvention du nom de Dieu appelle une réinvention de la religion.
5. Nom propre et nom commun
« Dieu » et « dieu ». — On sent le besoin de revenir ici sur une notion élémentaire, la distinction entre le nom commun et le nom propre. Le nom propre désigne une personne ; le nom commun s’applique aux réalités d’une même catégorie. « Dieu », avec majuscule, désigne donc le Dieu personnel, tandis que « dieu », avec minuscule, signifie un être de nature divine. Nommer Dieu, attribuer à Dieu un nom propre, quel qu’il soit, c’est exprimer par là son caractère personnel. En d’autres termes, c’est dire la relation personnelle qui l’unit à nous. Dans ce cas, nous ne parlons pas simplement de Dieu, nous parlons à Dieu.
Quelle réinvention du nom de Dieu ? — On perçoit mieux alors le sens de ce volume sur La réinvention du nom de Dieu. De quelle réinvention s’agit-il ? Il ne s’agit pas de l’invention d’un nouveau nom. La même question se poserait alors : est-ce vraiment un nom personnel, un nom qui permet d’entrer en relation personnelle avec Dieu aujourd’hui, qui permet de lui parler vraiment ? — C’est en ce sens que je comprends Siegwalt quand il écrit : « Il ne s’agit pas d’inventer la roue ; elle a été inventée. Mais il s’agit de la redécouvrir comme roue, comme ce qui permet de rouler, de faire tourner, de sortir de l’impasse » (p. 148). Il s’agit donc de redécouvrir le nom de Dieu comme celui qu’on peut appeler par son nom, comme celui qu’on peut prier.
La réinvention comme révélation. — Or cela n’est pas simplement le fruit d’une recherche humaine ; c’est la grâce d’une révélation divine. La recherche n’est pas exclue pour autant. Elle prépare l’esprit et le coeur à recevoir la révélation divine : « Rappelons-nous : pour les témoins mentionnés — Moïse et tous les autres — l’illumination vient à chaque fois au bout d’un long chemin » (p. 145). — Siegwalt parle ici de la révélation en termes d’illumination : « On peut dire : l’illumination est aussi une réinvention, la réinvention est en fait une illumination » (p. 145). En effet, le mot « Dieu » ne devient vraiment personnel pour nous que s’il est illuminé par la lumière de la grâce divine. L’illumination se produit alors tant du côté subjectif de l’esprit du croyant, que du côté objectif du nom divin.
6. Dieu personnel et transpersonnel
Dieu nommé, un Dieu personnel. — En bout de course, au terme de ce volume, on se rend compte qu’il a toujours été question là du Dieu personnel, du Dieu avec lequel nous sommes engagés dans une relation d’alliance, une relation personnelle. Plus encore, le mot « Dieu » lui-même, écrit avec majuscule, désigne le divin comme un être personnel. Nous prions « Dieu », non pas le divin ou la transcendance. Siegwalt en est bien conscient : « La question est toujours à nouveau posée : peut-on garder le mot Dieu alors qu’il est tellement lié à la compréhension supranaturaliste (traditionnellement on parle de théisme) ? Mais alors, par quoi le remplacer ? » (p. 51).
Dieu et le divin. — Siegwalt indique cet au-delà du théisme quand il parle du divin et de la transcendance. C’est la « réalité que la tradition religieuse monothéiste appelle Dieu et qu’une tradition plus mystique nomme le divin, alors que la philosophie parle de transcendance » (p. 41). On entrevoit ainsi quel est le vrai problème de la nomination de Dieu. Un esprit philosophique pourra récuser l’appellation personnelle de Dieu, parce qu’elle le réduit à l’état d’un être individuel : un individu, un être particulier parmi d’autres. Mais parler de transcendance plutôt que de Dieu n’est pas satisfaisant non plus. Car cela ne rend pas compte de la relation personnelle à Dieu, relation caractéristique de toute foi religieuse : « […] le mot transcendance peut certes convenir au Dieu transpersonnel mais non au Dieu personnel qu’il est aussi, car c’est à lui que le croyant ayant fait une expérience de grâce ou de changement de vie, qui le concernent dans sa personne, attribue ce bouleversement, et c’est à lui qu’il adresse sa prière » (p. 56).
7. Conscience du mystère et nomination de Dieu
Conscience mystique et conscience prophétique. — En langage religieux, on parle de la conscience du Dieu personnel comme d’une conscience prophétique, et de la conscience du Dieu transpersonnel comme d’une conscience mystique. Celle-ci est conscience du mystère divin, dont le philosophe parlera lui-même en termes de conscience de l’être. Cette conscience du mystère de l’être n’est pas une conscience objective, comme la vision d’une réalité mystérieuse devant soi. C’est la conscience d’une réalité englobante qui nous entoure, qui nous comprend. On pense alors à « l’englobant » de Karl Jaspers ou à « l’être-même » de Paul Tillich. Quant à la conscience prophétique, c’est la conscience du Dieu personnel comme fondement de l’histoire : le Dieu de l’histoire du salut dont il est question dans toute l’histoire biblique.
De la conscience mystique à la nomination du mystère. — Siegwalt reconnaît lui-même cette distinction entre, d’une part, le mystère divin et, d’autre part, le nom de Dieu : « […] si tous ces mots (Dieu, divin, transcendance) ne sont pas tout à fait effacés de la conscience générale, la qualité de nom de “Dieu” (alors que “divin” et “transcendance” ne sont pas des noms mais des signifiants susceptibles d’être en attente de ce nom) est largement perdue dans notre civilisation moderne caractérisée par l’oubli de Dieu » (p. 41). — Ce texte appelle quelques commentaires. 1) Il est vrai que « divin » et « transcendant » désignent Dieu comme l’englobant, comme le tout qui nous contient, alors que le « Dieu » qu’on peut nommer et prier est devant nous comme une réalité avec laquelle nous sommes en relation personnelle. 2) Est-ce à dire que la conscience du mystère transcendant de l’être est en attente du nom de Dieu, au sens où elle ne serait encore qu’une approximation de ce sommet religieux qu’est la nomination de Dieu ? 3) Devrait-on comprendre ainsi tout le sens de ce volume ? Il est vrai, comme l’écrit Siegwalt, que l’oubli de Dieu à notre époque est surtout caractérisé par la perte du sens du nom de Dieu, la perte du sens de nommer Dieu, de le prier. Ceux et celles qui ont la moindre conscience philosophique peuvent encore reconnaître une dimension transcendante de la réalité. Mais tous ceux-là et celles-là ne sont pas pour autant des priant-Dieu.
8. Religion et foi
Le problème : Dieu ou la religion ? — On a jusqu’ici parlé de l’oubli de Dieu. Mais je reviens sur la question : le problème religieux de notre époque est-il vraiment celui du nom de Dieu ? Ne serait-ce pas plutôt celui de cette relation humaine à Dieu qu’est la religion ? Voyons ce qu’en dit Siegwalt : « La religion est […] la maison communautaire de la foi et de son élucidation théologique. Elle consiste dans des rites communautaires qui sont autant de célébrations […] de la foi commune, et elle est l’institution temporelle […] pour assurer la possibilité de ces rites » (p. 37). Trois choses à noter là : 1) toute religion est une communauté de foi ; 2) cette communauté comporte une institution comme structure sociale ; 3) elle comporte également une théologie, qui est l’expression de la foi commune. Ces deux derniers points font problème aujourd’hui.
« Autonomisation de la communauté de foi par rapport à l’institution religieuse ministérielle » (p. 88). — C’est une tendance qui se propage partout aujourd’hui. Un cas illustre bien la chose. Un théologien catholique affirmait qu’une communauté chrétienne assemblée pour la célébration dominicale pouvait se désigner un célébrant si elle en était privée. Le théologien protestant à qui je rapportais la chose m’a répondu : « C’est évident ! » Je doute cependant que ce soit là l’avis de beaucoup d’évêques catholiques. Siegwalt reconnaît pour sa part que c’est la communauté de foi qui est à l’origine et au principe de l’institution ministérielle, et non pas l’inverse (p. 39).
« Autonomisation de la communauté de foi par rapport à la théologie » (ibid.). — La communauté de foi de notre temps est aussi de plus en plus autonome quant à sa théologie, c’est-à-dire quant à la formulation de son Credo. Bien sûr, cette communauté n’est pas née d’hier, elle a tout un passé, toute une histoire. Il en va de même pour son Credo, ce dont elle doit tenir compte. Mais elle accepte de plus en plus difficilement de se voir dicter ce qui est légitime de croire et ce qui ne l’est pas. Siegwalt écrit bien justement à ce propos : « La théologie supranaturaliste est sans prise sur cette autonomisation, et celle-ci appelle une autre théologie, à savoir une théologie de l’expérience de la foi » (ibid.).
Foi communautaire et foi personnelle. — Ces derniers mots nous rappellent cependant que l’expérience de foi est propre à chaque membre de la communauté de foi, selon le vécu de chacun et de chacune. Ne faudrait-il pas alors préciser plus strictement encore l’affirmation de Siegwalt, et dire que chaque membre de la communauté est porté à formuler son propre Credo ? Le problème se déplace alors. Ce n’est plus celui d’une communauté plus ou moins autonome, mais celui d’une tension entre la foi communautaire et la foi personnelle de chacun et chacune. L’autonomie réclamée par la communauté doit donc s’appliquer aussi à chacun de ses membres. Cela ne devrait pas affaiblir la communauté, mais l’enrichir d’un dialogue, d’un échange spirituel entre ses membres.
9. Théologie d’en haut et théologie d’en bas
Une révolution théologique. — La réinvention du nom de Dieu implique une réinvention de la théologie. Cette nouvelle théologie se caractérise comme une théologie d’en bas, ce qui la distingue de la théologie d’en haut qui a, jusqu’à maintenant, dominé le paysage. — La théologie a toujours été pensée de Dieu. Mais Dieu peut être pensé comme transcendant (en haut, au ciel) ; et il peut être pensé comme immanent (ici-bas, au coeur de ce monde). Ces deux dimensions doivent être réunies. Le Dieu purement transcendant est un Dieu supranaturaliste, qu’on a déjà écarté comme irréel. Quant au Dieu purement immanent, il est purement fictif, une pure idole qui ne comporte rien de divin. La question n’est donc pas de savoir lequel choisir : le Dieu d’en bas ou le Dieu d’en haut. Les deux doivent être retenus. La question consiste plutôt à choisir par où commencer : par le haut ou par le bas. Tel est le sens de la théologie d’en bas : « Les noms bibliques de Dieu (puissant, créateur, libérateur, sauveur, juste, législateur, bon, miséricordieux…) rendent compte d’une expérience “en bas” de Dieu et d’une découverte de Dieu à partir de ce “bas” » (p. 141-142). Aussi bien dire : à partir de l’expérience de foi, de l’expérience de Dieu.
Le mystère et sa révélation. — La révolution théologique consiste alors à reconnaître Dieu dans l’ici-bas du monde, à reconnaître dans la profondeur du monde le mystère du Dieu créateur, et à commencer ainsi la réflexion théologique. — Toute connaissance du mystère implique cependant une révélation. Siegwalt en parle ici comme d’une illumination qui implique la jonction du bas et du haut : « Même si l’illumination est une révélation et est perçue comme telle, et donc quelque chose qui est donné et non conquis, une irruption/éruption et non une projection, elle s’effectue dans, avec et à travers le matériau du vécu et ressortit par conséquent du haut et du bas » (p. 145). Plus précisément : « […] l’illumination est l’irruption dans la conscience humaine travaillée par le pressentiment du mystère du réel, de quelqu’un qui fait briller le signifiant du réel du feu de lumière de son sens » (p. 143).
Du cri à la parole. — L’illumination arrive chaque fois « au bout d’un long chemin » (p. 145), tant pour l’histoire des religions que pour les individus. Cela est tout particulièrement vrai pour nous actuellement. Car le mystère du réel n’est pas seulement aujourd’hui l’indicible divin, c’est aussi le mystère caché dans l’oubli de Dieu : « Nous sommes alors placés devant la question : y a-t-il une prophétie pour nous aujourd’hui ? La question est posée compte tenu du réel actuel, du cri qui s’y fait entendre en raison de l’effondrement de l’oubli de Dieu » (p. 107-108). — L’idée du cri indique bien la prégnance tout autant que l’indicibilité du mystère divin aujourd’hui. C’est l’expression première du mystère, qui appelle cependant l’expression seconde qu’est la parole : « Passer du cri à la parole, aider le cri à accoucher de la parole ! Le cri a besoin d’une voix pour en dire le sens, pour accoucher de la parole » (p. 111).
De l’illumination spirituelle à la religion. — Que devient alors la religion dans ce tableau de l’expérience spirituelle ? La question est importante, puisque c’est cela, la religion, qui fait problème aujourd’hui, qui risque de faire disparaître avec elle la substance spirituelle qu’elle portait. On retrouve le sens de la religion en la reportant à l’illumination initiale dont on a parlé. Celle-ci n’est pas seulement personnelle, mais communautaire. Elle suscite un esprit commun, une communauté : « Portée communautaire de cette illumination, puisqu’elle crée un récit narratif qui, dans la succession de ses irruptions, se poursuit, s’enrichit, s’approfondit, se corrige et qui rassemble autour de lui une communauté qui y trouve exprimée son identité typique — et donc rassembleuse — profonde » (p. 144). — De la portée communautaire de l’illumination spirituelle des origines, on passe à sa portée créatrice de rites religieux : « Portée créatrice aussi de rites communautaires dans lesquels sont célébrées les différentes faces ou implications de l’expérience fondatrice » (ibid.).
Une religion d’en bas. — L’idée de religion qui arrive au terme de cette réflexion est celle d’une religion d’en bas. S’il y a une réinvention de la religion possible aujourd’hui, c’est bien ainsi qu’elle pourrait s’effectuer. Rien ne discrédite davantage la religion que l’idée d’une religion d’en haut, venant directement du ciel avec tout son appareil clérical. L’autorité religieuse n’est pas exclue pour autant, mais elle vient d’en bas, des besoins de la communauté.
Corrélation du bas et du haut. — Terminons en relisant ces quelques lignes qui résument bien le contenu du volume : « C’est de la conjonction entre le “bas” du cri […] avec la nomination temporelle du sens de ce dernier tel qu’il se dit dans les valeurs temporelles évoquées, et le “haut” signifié par la mémoire du passé des religions avec leur témoignage concernant Dieu (ou le divin ou la transcendance) que peut advenir l’illumination d’où pourra accoucher le nom de Dieu aujourd’hui » (ibid.). — On voit bien qu’il s’agit là de la corrélation du « bas », de l’immanence des valeurs humaines, et du « haut » des valeurs religieuses. Celles-ci ne sont pas dictées d’en haut cependant, elles sont portées par les religions humaines. Il y a là corrélation, interdépendance et équivalence, puisque les valeurs humaines sont reconnues dans leur transcendance par le langage religieux, et que celui-ci retrouve sa réalité en étant référé au vécu, à l’expérience humaine des valeurs transcendantes.