Abstracts
Résumé
Le philosophe américain John Dewey a élaboré une théorie des émotions spécifique qui permet d’aborder de façon renouvelée la question de la transformation sociale. La théorie de Dewey est précieuse, car elle constitue un outil appréciable d’unification des théories modernes des émotions : foncièrement non dualiste, elle pose que l’émotion est ce qui nous relie à autrui ou à notre environnement. Loin d’être un phénomène purement intérieur, l’émergence d’une émotion dépend de notre humeur, de notre histoire personnelle, du contexte social et culturel dans lequel nous vivons. La théorie propose ainsi une analyse dynamique qui prend en compte l’histoire de la relation. L’émotion a en particulier un pouvoir de transformation sociale qui s’exerce à l’échelle de l’individu, mais aussi sur le plan collectif. Les institutions, les habitudes, les règles de vie ne sont donc pas figées et évoluent elles-mêmes avec les émotions qu’elles génèrent.
Dans cette analyse, l’émotion est ce qui signale et guide le changement d’habitude. Or, il peut arriver aussi qu’une routine ou une habitude émotionnelle nous fige dans une posture qui empêche toute transformation. L’approche de Dewey nous interroge en conséquence sur la façon dont l’articulation entre les habitudes et les émotions individuelles conduit à une transformation sociale durable et pérenne. Cela dépend-il de la « qualité » de l’émotion ? Le pouvoir des émotions est-il celui d’une émotion « ordinaire » ? Ce pouvoir est-il limité ?
Mots-clés :
- émotion,
- transaction,
- transformation,
- habitudes,
- John Dewey
Abstract
The American philosopher John Dewey has developed a specific theory of emotions that provides a renewed approach to the question of social transformation. Dewey’s theory is valuable because it is a useful tool for unifying modern theories of emotions: fundamentally non-dualistic, it asserts that emotion is what connects us to others or to our environment. Far from being a purely internal phenomenon, the emergence of an emotion depends on our mood, our personal history, and the social and cultural context in which we live. The theory thus proposes a dynamic analysis that takes into account the history of the relationship. In particular, the emotion has a power of social transformation which is exercised at the level of the individual but also at the collective level. Institutions, habits, rules of life, are therefore not fixed and evolve themselves with the emotions they generate.
In this analysis, emotion is what signals and guides the change of habit. But it can also happen that a routine or an emotional habit freezes us in a posture that prevents any transformation. Dewey’s approach therefore asks us to consider how the articulation between habits and individual emotions leads to lasting and sustainable social transformation. Does this depend on the « quality » of the emotion? Is the power of emotions the power of an « ordinary » emotion? Is this power limited?
Keywords:
- emotion,
- transaction,
- transformation,
- habits,
- John Dewey
Article body
Introduction
Lorsque l’émotion est convoquée, que ce soit dans les médias (Robert, 2019) ou dans la littérature scientifique parfois (Le Coz, 2014), c’est le plus souvent pour évoquer son caractère éruptif et non contrôlé, sa grande part d’irrationalité (la peur), ses capacités de destruction (l’envie, la colère), ou encore pour mettre en avant la manipulation dont elle est l’objet à travers l’usage stratégique qu’en font certains hommes politiques. En contrepoint de cette conception largement répandue, la thèse développée dans cet article est que l’émotion, considérée sous une forme dynamique et insérée dans un récit, est au coeur de la transformation sociale et institutionnelle, et que cette transformation peut être bénéfique. Notre argumentation repose sur une théorie des émotions « relationnelle » (Laflamme, 1995) qui évite à la fois d’adopter (exclusivement) le point de vue de l’individu (comme le font généralement les psychologues) et de reposer principalement (comme le font le plus souvent les sociologues) sur le conditionnement social ou culturel de l’émotion[1]. Dans cette approche relationnelle, l’émotion peut être considérée tout autant comme un indicateur de la qualité de la relation qui existe entre les individus et leur environnement que comme un moteur susceptible de faire évoluer cet environnement autant que les individus qui le composent. Nous pensons ainsi que l’émotion peut agir en tant que puissance de transformation des règles et des institutions, mais que cette dynamique agit à son tour en changeant les individus eux-mêmes.
Dans cet article, nous nous appuyons sur la théorie des émotions du philosophe américain pragmatiste John Dewey (1859-1952). Nous montrons tout d’abord comment la portée non duale, non réduite, de sa théorie des émotions s’inscrit dans une approche dite de la « transaction ». Nous mettons en évidence le pouvoir de transformation de l’émotion en montrant son rôle déterminant dans la modification de nos habitudes individuelles et collectives. Nous envisageons enfin les limites de ce pouvoir en questionnant la nature et la « qualité » de l’émotion dans le cadre de la philosophie de l’« expérience » de Dewey.
1. La notion de « transaction » chez Dewey : une forme non duale de l’émotion
Comme les deux auteurs pragmatistes qui l’ont précédé — Charles Sanders Peirce et William James —, John Dewey est connu pour avoir mené une réflexion approfondie sur le rôle des règles et des habitudes dans les prises de décision individuelles et dans la construction des institutions[2]. Le philosophe américain a également élaboré — ce qui est beaucoup moins connu — une théorie des émotions spécifique (Dewey, 1894, 1895 et 1896). Les premiers écrits de Dewey sur l’émotion s’inscrivent dans la lignée des théories de Charles Darwin (1809-1882) et de William James (théories qui sont à la fois mises en valeur et critiquées par Dewey), mais s’en détachent assez nettement dans ses écrits ultérieurs, en particulier dans Human Nature and Conduct: Introduction to Social Psychology, publié en 1922, et surtout dans L’art comme expérience[3], publié en 1934. C’est notamment dans ce dernier ouvrage que l’on trouve la version la plus aboutie de sa théorie et que l’on peut saisir la portée non duale et non réductrice de son approche. De ce point de vue, la théorie de Dewey, initiée dans les années 1890 à partir de la théorie de James (1884), élaborée ensuite dans les années 1930, se distingue de la façon dont les théories contemporaines ont appréhendé et surtout « segmenté » le processus émotionnel.
1.1 Des théories contemporaines de l’émotion « segmentées »
Si l’on considère en effet les différentes disciplines d’études de l’émotion (en sciences naturelles comme en sciences humaines et sociales), il apparaît, en schématisant et en simplifiant, que les théories contemporaines s’inscrivent, contrairement à celle de Dewey, dans une forme de dualité corps/esprit, individu/société, sujet/objet. On peut notamment faire le constat que ces théories reproduisent (en partie) une fracture opposant les sciences naturelles aux sciences humaines et sociales, et qu’elles ont en ce sens une tendance à la réduction de leur objet d’étude : l’émotion. Il est ainsi possible de « classer » ou de « catégoriser » les théories de l’émotion selon qu’elles mettent l’accent sur (1) sa dimension physiologique et biologique, (2) sa dimension cognitive ou (3) sa dimension sociale et culturelle.
On peut « résumer » la première approche (biologique) en disant que l’émotion est incarnée, située dans le corps, et qu’en conséquence, les émotions (ou du moins certaines d’entre elles) peuvent être produites, exprimées et reconnues par tout humain, quelle que soit sa culture. Une émotion comme la peur, par exemple, aurait cette dimension universelle, innée, naturelle, qui se manifeste notamment par des expressions du visage (crispation) ou du corps (tremblements, sueurs froides, palpitations, etc.) qui lui sont associées et que chacun est susceptible de reconnaître.
En « opposition » à cette approche biologique, les auteurs cognitivistes et les philosophes de l’esprit insistent sur la dimension cognitive et intentionnelle caractéristique à l’émotion. Schématiquement, cela sous-tend l’idée que, pour qu’une émotion soit provoquée, l’objet sur lequel elle porte doit affecter ou impliquer l’individu en fonction de son vécu, de son expérience, de ses attentes, de ses intérêts ou de ses objectifs. Héritière de la pensée d’Aristote, initiée par Arnold (1960) et par la théorie « cognitivo-physiologique » de Schachter (1964), l’approche cognitive foisonne à partir du début des années 1980, regroupant des travaux de psychologie (Frijda, 1986) et de philosophie (Solomon, 1976). Ces différents auteurs partagent l’idée que les émotions ne sont pas des « passions » que nous subirions passivement — Solomon (1976) a notamment dénoncé la version « hydraulique » du courant physiologique de l’émotion — et affirment au contraire que nous sommes activement impliqués dans leur fabrication. Frijda (1986), en particulier, concilie de façon habile l’idée phénoménologique selon laquelle les émotions ont une visée intentionnelle avec la conception évolutionniste (darwinienne) soutenant qu’elles auraient des fonctions adaptatives. Dans ce cadre, l’émotion est associée à une « tendance à l’action » (Frijda, 1986) qui est davantage une préparation à l’action (une potentialité) qu’un comportement automatique. La culpabilité, par exemple, nous incite à la réparation (d’un tort), alors que la peur nous pousse à agresser (l’agresseur), à fuir ou même à nous évanouir. Une tendance à l’action peut ainsi donner lieu (mais pas nécessairement) à toute une gamme de comportements différenciés en fonction de la situation.
Enfin, et nous insistons sur cette troisième approche, de nombreux auteurs voient davantage dans l’émotion l’expression d’une société socialement et culturellement construite. L’émotion est ici considérée comme un « produit » du social au sens où la société fabriquerait le ressenti et le comportement émotionnel des individus. Les émotions sont (certes) des dispositions connectées au corps, mais le corps lui-même est façonné par la culture et l’époque. Dans la première moitié du xxe siècle, cette conception de l’émotion a été portée par des travaux en sociologie (Mauss, 1921; Halbwachs, 2014 [1939]), en anthropologie (Benedict, 1995 [1946]) ou encore en histoire (Febvre, 1941). Dans cette optique, c’est le groupe, la collectivité, qui est à considérer en priorité lorsque l’on s’interroge sur la formation des émotions individuelles. De façon schématique, on peut résumer l’idée en posant que le social façonne, contraint, oriente, prescrit, de façon déterministe, les émotions des individus et leur façon de se comporter affectivement. Ce sont, autrement dit, les pratiques rituelles, les codes, les normes, les « règles de sentiments » (Mauss, 1921) qui dictent les conduites émotionnelles typiques d’une culture ou d’un collectif. Les institutions d’une société (la famille, la religion, l’État, le marché) orientent et contraignent le répertoire émotionnel des individus dans une culture ou une société donnée à une époque déterminée. Les institutions valorisent certaines attitudes, en stigmatisent d’autres ou encore créent une ambivalence à leur propos. Toute société, toute nation, dispose de ses propres codes émotionnels qui exercent une forte influence sur ce que les gens ressentent et sur la façon dont ils le ressentent. Benedict (1995 [1946]), par exemple, a été la première anthropologue à caractériser la culture japonaise comme une « culture de la honte », une culture qui valorise le respect, l’amour du prochain, l’honneur, la loyauté, la maîtrise de soi. Le sang-froid qui est requis d’un Japonais soucieux de sa dignité ou de sa réputation fait notamment partie de ses obligations.
Au total, dans les théories de la « production sociale des affects », on considère que, dans une large mesure, c’est la société qui définit les conditions d’acceptabilité, de perception et d’expression des émotions. Ce sont en résumé les normes sociétales qui imposent une forme à l’émotion ressentie et exprimée. Dans les années soixante-dix, ces différents travaux ont été prolongés en sociologie des émotions par des auteurs qui considèrent que les fondements sociaux des émotions ne constituent qu’une dimension parmi d’autres du comportement affectif individuel[4]. À la suite notamment du travail de Goffman (1974), il apparaît clairement que le jeu de figuration de l’émotion dépend étroitement de la position sociale et contraint ceux qui, au plus bas de l’échelle hiérarchique, sont soucieux du regard que les dominants portent sur eux. La pensée « interactionniste » de Goffman (1974) a ainsi ouvert la voie à une conception « relationnelle » de l’émotion (proche de celle de John Dewey) dans laquelle celle-ci est elle-même l’objet d’une réélaboration de la part des individus. Hochschild (2017) en particulier a décrit très tôt les contours du « travail émotionnel » — le sourire (forcé) de l’hôtesse de l’air ou de la caissière, la jovialité (feinte) du commerçant ou de la secrétaire — caractéristique du secteur marchand.
1.2 L’approche « transactionnelle » de Dewey
L’approche de Dewey se distingue de ces trois formes « dualistes » (biologique, cognitive et sociale), car elle n’oppose pas le corps à l’esprit, la raison à l’émotion, l’individu à la société. John Dewey se réfère à la notion d’« interaction », dans une logique darwinienne, entre un organisme (un humain, un animal, une plante) et son environnement. Ce dernier est formé des choses extérieures susceptibles d’entrer en relation avec les activités d’un organisme, mais il est constitué également des effets concrets des activités de cet organisme. L’environnement et l’organisme sont ainsi plongés dans un processus d’ajustements et d’échanges réciproques. Plus l’influence de l’organisme est élevée, plus son environnement se confond avec les conséquences ou les effets de ses activités. En se centrant en particulier sur l’interaction qui existe entre le sujet et l’objet, entre l’organisme et l’environnement, Dewey insiste donc sur l’importance du caractère mutuel des relations de dépendance entre ces entités (Steiner, 2010).
Selon Dewey, un sujet se transforme de façon radicale au contact des autres et de son environnement. Or, sur le plan étymologique, l’interaction (mot composé du préfixe latin inter-, « entre », et de « action », du latin actio, « faculté d’agir ») désigne l’action réciproque de deux ou plusieurs personnes et n’implique pas la modification des entités qui y participent. C’est la raison pour laquelle Dewey substitue le terme de « transaction » (qui vient du mot latin transactio et qui signifie « transiger ») à celui d’« interaction » dans un article coécrit avec Arthur Bentley : « le terme d’"interaction" [entre l’organisme et l’environnement] est dangereux, étant donné qu’il est facile de comprendre qu’il met en jeu deux ou plusieurs existences préalables » (Dewey et Bentley, 1949). A contrario, la transaction suppose que l’on prenne en compte la manière dont la relation entre le sujet et son environnement s’est construite de façon dynamique au cours du temps. Comme le suggère par exemple Scott (2015), illustrant la conception transactionnelle de Dewey, au fur et à mesure que les institutions universitaires se transforment selon une logique entrepreneuriale (liée à la rentabilité), les membres de ces institutions évoluent eux-mêmes (et changent) au rythme de cette transformation dans leur façon de se comporter, d’enseigner ou même d’être ou de vivre dans leur quotidien.
La pensée de Dewey apparaît ainsi comme anti dualiste. Il s’agit fondamentalement d’une pensée de la non-séparation. Sa méthode, rappelle-t-il, « est la méthode transactionnelle, dans laquelle [est défendu] le droit de voir ensemble, du point de vue de l’extension et du point de vue de la durée, ce qui est conventionnellement considéré comme étant composé de parties séparées irréconciliables » (Dewey et Bentley, 1949 : 69). Au lieu d’expliquer un phénomène donné en partant de plusieurs causes distinctes, l’approche requiert davantage de partir du phénomène à expliquer, et de le considérer comme un moment d’une situation d’intégration première et en devenir continu. Appliquée à la théorie des émotions, la méthode transactionnelle confère à l’approche de Dewey une capacité d’unification des théories modernes (Mendonça, 2012). Elle se rapproche de la théorie « relationnelle » qui, de la sociologie (Laflamme, 1995) à l’anthropologie (Bateson, 1991), met en avant le caractère primordial de la relation dans la constitution même de ce qu’est l’« individu » : l’émotion est ce qui nous relie à autrui ou à notre environnement. John Dewey s’inscrit, comme nous le voyons maintenant, dans une logique de l’« expérience », où l’émotion joue un rôle moteur de transformation et de modification des habitudes.
2. L’émotion, un facteur de changement de nos habitudes
Comme nous l’avons mentionné au début de l’article, John Dewey est souvent associé à la question de la formation des habitudes (Pratten, 2015). S’il est effectivement d’avis que « Man is a creature of habit, not reason, nor yet of instinct » (Dewey, 1922), John Dewey ne croit cependant pas que les individus sont des automates qui se conforment aux règles et suivent des habitudes intangibles. Ils sont aussi des « faiseurs de règles ».
La culture, en tant que système constitué de règles et d’habitudes, a pour objet de fournir des solutions à des problèmes pratiques. Quand le système ne satisfait plus aux problèmes pratiques, des changements interviennent. Ces changements sont le fruit d’une « transaction » entre les individus et le système — les organismes et leur environnement —, de sorte que les deux en sont modifiés, le système par des changements dans les pratiques culturelles, et les individus par l’apparition de nouvelles règles à suivre. Dewey ne peut donc être lu simplement comme un auteur qui attribue un rôle majeur aux règles ou aux habitudes ; il est avant tout un penseur du changement dans les règles et les habitudes (Pedwell, 2017).
2.1 La notion d’expérience et l’épisode de la « chambre »
Au coeur de ce processus de changement se trouve la notion d’« expérience », au cours de laquelle l’émotion joue un rôle fondamental (Quéré, 2018). Selon Dewey, « il y a constamment expérience, car l’interaction [au sens de la transaction] de l’être vivant et de son environnement fait partie du processus même de l’existence » (A : 80). L’expérience « inclut tout ce qui est fait, tout ce qui se fait, et tout ce qui est concrètement impliqué au sein d’une relation d’ajustement continu entre l’organisme et l’environnement » (Steiner, 2010 : 206) ; elle n’est donc pas un état d’esprit ou un phénomène pour l’organisme, mais un processus unifié, continu, étendu, et cependant rarement stabilisé.
Dans L’art comme expérience, le propos de Dewey s’articule essentiellement autour de l’artiste et de l’expérience esthétique qui lui est propre. La conception de l’expérience que l’auteur pragmatiste révèle dans l’ouvrage est cependant beaucoup plus générale et porte en définitive sur nos expériences « ordinaires » : s’atteler à une tâche et la mener à son terme ; résoudre un problème conceptuel ou pratique ; plus simplement encore, mener à bien une conversation. L’exemple de la « chambre » illustre de façon claire à la fois ce que signifie « faire une expérience » — c’est-à-dire réaliser une « activité » de transformation d’une relation entre un sujet et son environnement — et le rôle crucial qu’y joue l’émotion :
Une personne énervée ressent le besoin de faire quelque chose. Elle ne peut éliminer son énervement par un acte de volonté ; si elle tente de le faire, elle peut au plus amener ce sentiment jusque dans une voie souterraine où son effet sera encore plus insidieux et destructif. Cette personne doit agir pour se libérer de son énervement […]. [Elle] peut assujettir les manifestations de son énervement à l’accomplissement de nouveaux objectifs qui neutraliseront la puissance destructrice de l’agent naturel. […] Elle peut se mettre à ranger sa chambre, redresser des tableaux qui ne sont pas droits, classer des papiers, trier le contenu de ses tiroirs, c’est-à-dire mettre de l’ordre de façon générale. Elle utilise ainsi ses émotions, les déplaçant vers des voies indirectes tracées par des occupations et des intérêts antérieurs. Mais comme il y a quelque chose dans l’utilisation de ces voies qui est émotionnellement proche des moyens qui fourniraient à son énervement un exutoire direct, cette émotion est ordonnée alors même que la personne met en ordre des objets.
A : 145-146 ; l’auteur souligne
Dans cette situation, il y a bien une transaction qui s’opère entre un sujet (la personne en proie à une forte irritation) et un objet (la chambre). La transaction intervient lorsque la personne se met à ranger sa chambre et transforme ainsi, par son activité, son émotion originelle d’irritation. Si « l’émotion originelle d’énervement et d’impatience a été ordonnée et apaisée par ce que [la personne] fait, la chambre rangée lui renvoie l’image du changement qui a eu lieu en elle. Elle a le sentiment non pas de s’être acquittée d’une corvée nécessaire, mais d’avoir fait quelque chose d’épanouissant émotionnellement » (A : 146).
On voit ici toute la différence entre le registre de l’habitude (la personne range sa chambre par pure routine) et celui de l’expérience (qui implique une transformation). Dans l’épisode de la chambre, l’émotion (primaire) modifie la forme de l’objet (la chambre rangée), qui lui-même façonne l’émotion en retour (l’apaisement). Dans nos vies quotidiennes, nous modulons en permanence nos émotions de cette façon, car celles-ci nous poussent à agir en lien avec notre environnement. Ressentir, ce serait essentiellement être en relation, être affecté par quelqu’un ou par quelque chose. Ainsi, même dans la colère, par exemple, il demeure souvent un lien, une relation à autrui, qui exprime l’attente d’une réponse. Dans le mépris ou même le dégoût, émotions proches de la colère à laquelle elles sont de possibles répliques, c’est a contrario une mise à distance (intentionnelle ou non) de la relation qui s’opère.
2.2. L’émotion, élément moteur et unificateur de l’expérience
Deuxième idée centrale chez Dewey, l’émotion (sous une forme brute) se trouve au départ de toute expérience. « [S]igne d’une rupture actuelle et imminente » (A : 48), l’émotion est le moteur du changement qui s’opère chez le sujet ; elle participe donc de la construction de la relation et de sa transformation. Cependant, l’émotion originelle, rudimentaire et imprécise, née du « suspense », de l’intrigue et de l’incertitude, a elle-même la vocation de se transformer dans le cours de l’expérience. L’émotion est « à la fois élément moteur et élément de cohésion. Elle sélectionne ce qui accorde et colore ce qu’elle a sélectionné de sa teinte propre, donnant ainsi une unité qualitative à des matériaux extérieurement disparates et dissemblables » (A : 92). À travers l’émotion, l’individu perçoit que les règles, les habitudes qu’il suit ne sont pas ou plus adaptées au contexte qui est le sien.
En somme, dans l’analyse de John Dewey, les émotions ne sont pas considérées comme des phénomènes autonomes, isolés ou purement intérieurs, ainsi que le présupposent souvent les théories psychologiques de l’émotion. Elles ne sont pas universelles, mais bien davantage associées à une situation spécifique et à une relation particulière ; elles ne sont pas non plus la simple « extériorisation » (A : 123), la « décharge immédiate » (A : 263) d’un affect. La conception de l’émotion chez John Dewey se rapproche plutôt d’une mémoire affective (les « marqueurs somatiques » de Damasio [1994]) qui se co-construit continûment et de façon dynamique en relation avec notre environnement, la situation présente et en proportion de ce qu’est notre histoire personnelle. Les émotions sont « des attributs d’une expérience complexe qui progresse et évolue » (A : 90). Elles sont à l’origine de l’expérience en même temps qu’elles constituent des modes opératoires efficaces de son déroulement et de son aboutissement. C’est en ce sens que nous pouvons affirmer le pouvoir des émotions dans la modification des habitudes individuelles qui sont elles-mêmes à l’origine des normes sociales ou, dans une acception large, des institutions. Loin cependant d’être infaillible, le pouvoir unificateur de l’émotion dépend également de sa nature ou de sa « qualité ».
3. Les limites du pouvoir émotionnel de transformation
La particularité de l’épisode de la « chambre » évoqué précédemment est qu’il a une fin. L’expérience est « close » puisque la transformation semble avoir eu lieu complètement. Elle est aboutie. Dans la réalité, ce n’est pas le cas le plus fréquent. En règle générale, nous vivons plutôt un flux continu d’expériences, enchâssées elles-mêmes dans des expériences passées. Au sein même d’une relation, nos émotions sont liées par la série d’événements qui les ont suscitées et que nous conservons plus ou moins consciemment en mémoire. Nous avons ainsi souvent l’impression diffuse d’expérimenter à répétition une certaine gamme d’émotions semblables en apparence alors que nous les ressentons dans des contextes très différents et autour d’objets ou de relations qui le sont aussi.
3.1 Nature de l’émotion et incomplétude de l’expérience
Une expérience n’est donc pas en général finie, ce qui signifie qu’au contraire, elle est le plus souvent incomplète, toujours en cours et, forcément, imparfaite. L’incomplétude et l’imperfection nous renseignent sur la qualité de l’expérience à laquelle est associée celle de l’émotion. Le contraire de l’expérience, c’est l’impossibilité de réélaboration d’une émotion primaire. Celle-ci peut provenir d’une stimulation insuffisante ou inadaptée qui nuit à l’engagement de l’individu dans l’expérience. C’est le cas par exemple dans l’ennui ou dans la passivité. C’est le cas aussi lorsque des habitudes émotionnelles sont un frein à l’expérience du fait de résistances psychiques individuelles ou de normes sociales et culturelles contraignantes. L’émotion est ce qui signale le changement d’une habitude. Toutefois, il peut arriver aussi qu’une routine émotionnelle nous fige dans une posture qui empêche toute transformation. C’est ce qui se produit lorsque les habitudes individuelles convergent, suivant la sécrétion de dopamine, vers une forme addictive (au jeu, au travail, etc.).
L’inaccomplissement de l’expérience provient aussi, très souvent, de la dispersion, de la précipitation et du manque d’attention, qui provoquent le désajustement du sujet vis-à-vis de l’objet ou de son environnement. C’est souvent à ce titre que l’émotion est disqualifiée ou condamnée dans les médias et dans l’espace éducatif. On réduit l’émotion à une forme impulsive, à une « décharge », à un réflexe, à un automatisme. Notre interprétation, à la lecture de Dewey, est qu’il s’agit d’une forme inaboutie de l’expérience dans laquelle l’émotion primaire n’a pas été transformée. Pour que l’expérience soit complète, il faut que l’énergie émotionnelle soit conservée et investie dans la conduite de l’expérience comme force organisatrice. L’émotion est à la fois un moteur et un élément de coordination de l’expérience. L’énergie émotionnelle, nous dit John Dewey, « évoque, assemble, reçoit ou rejette souvenirs, images, observations, et les façonne dans un ensemble dont toutes les parties sont harmonisées par un même sentiment émotionnel immédiat. En résulte un objet doté d’une unité et complètement indépendant » (A : 264). Ce n’est qu’à cette condition que « la manifestation de l’émotion devient une véritable expression, pourvue d’une qualité esthétique » (A : 263-264).
En somme, l’insuffisance de l’émotion, son inadaptation ou son excès provoquent l’inaccomplissement de l’expérience. Dès lors, sa réalisation est au contraire le fruit, comme le suggère John Dewey, d’une juste « proportion » (aristotélicienne) d’affects. L’émotion est nécessaire pour que se réalise une parfaite unité, une intégration, entre le sujet et l’objet (Quéré, 2018). Cela suggère qu’une expérience « réussie » implique une aptitude particulière dans la conduite de l’émotion et un certain degré d’intensité de l’énergie émotionnelle.
3.2 Un critère de qualité de l’expérience : la coïncidence des fins et des moyens
Selon le philosophe américain, c’est sans doute dans le domaine artistique et esthétique que se réalise la forme la plus complète, la plus profonde et la plus intense de l’expérience humaine. La raison essentielle en est que l’artiste apprend en permanence, du fait de sa pratique, à « cultiver » les tensions provoquées par ses émotions primaires. On a cette image du peintre, du sculpteur ou du musicien qui, inlassablement, retravaille le matériau interne à partir duquel l’acte créateur s’effectue. L’émotion (esthétique) qui accompagne l’artiste dans sa pratique a cependant une nature profondément « ordinaire » (Formis, 2015). On la retrouve chez l’artisan, le sportif, le scientifique, le producteur, le spectateur tout autant que le simple voyageur.
Très tôt, dans L’art comme expérience, John Dewey a lui-même rapproché l’activité de l’artiste de celle, par exemple, du mécanicien : « Le mécanicien intelligent impliqué dans son travail, cherchant à bien le faire, et trouvant de la satisfaction dans son ouvrage, prenant soin de ses matériaux et de ses outils avec une véritable affection, est impliqué dans sa tâche à la manière d’un artiste […]. » (A : 33) On peut y voir un parallèle intéressant avec ce que Crawford (2010) décrit dans l’Éloge du carburateur. Brillant philosophe qui était payé rubis sur l’ongle dans les fameux « laboratoires d’idées » américains, Crawford, à contre-courant de sa trajectoire universitaire, revient à ses premières amours — les motos de collection, auxquelles il voue une véritable passion — et se fait embaucher comme mécanicien. Il montre dans son essai que le « savoir-faire », la « pensée en action », est une qualité qui s’acquiert avec l’expérience, et non par l’addition des connaissances techniques et rationnelles : « Il m’est arrivé un nombre incalculable de fois », nous livre-t-il, « qu’un mécanicien plus expérimenté me montre du doigt quelque chose que j’avais littéralement sous le nez, mais que j’étais incapable de voir […]. » (Crawford, 2010 : 238-239) C’est ainsi que « les distinctions les plus fines formulées par les praticiens d’un art expriment aussi certaines subtilités esthétiques qui peuvent rester invisibles à l’observateur extérieur » (Crawford, 2010 : 239 ; nous soulignons). Cela n’est vrai que lorsque le compagnon de métier expérimenté ne fait pas la distinction, comme le suggère John Dewey à propos de l’expérience artistique[5], entre la finalité de l’acte (ici, résoudre un problème mécanique) et le moyen par lequel il y parvient. Lors d’un acte de routine, l’activité de réparation, si elle est aisée, est guidée par le seul objectif de rendre la moto de collection à son usage premier. Dans ce cas de figure, le mécanicien sera satisfait s’il y consacre un minimum de temps. Peu importe le moyen, ce qui compte, c’est l’objectif fonctionnel assigné à la tâche. Si la réparation est plus complexe, cependant, elle implique de faire une expérience qui mobilise un savoir-faire et qui est une source de transformation. Le moyen par lequel le mécanicien parvient à son objectif n’est plus dissocié de la finalité. De même, il nous arrive de voyager pour nous rendre quelque part parce que cela est nécessaire. À d’autres moments, nous voyageons pour le plaisir de nous déplacer et de voir certains paysages. Dans ce dernier cas, moyens et fins coïncident. John Dewey généralise cette idée en posant que « tous les cas pour lesquels les moyens sont extérieurs aux fins ne sont pas de nature esthétique » (A : 328). A contrario, un objet possède une forme esthétique à partir du moment où le matériau est organisé de façon à contribuer à l’enrichissement de l’expérience immédiate de celui qui dirige vers lui son attention.
Dans l’activité décrite par Crawford, ce n’est que lorsque la forme de l’objet (la moto) s’affranchit des limites qui la subordonnent à une fin spécifique (la réparation) qu’elle devient « esthétique et cesse d’être utile » (A : 204). Une expérience et l’émotion qui la sous-tend sont de qualité lorsqu’il y a adéquation entre la finalité de l’expérience et la forme que l’objet doit prendre pour y parvenir. La question de l’adéquation de la forme de l’objet au dessein se pose donc également dans le cas d’une expérience « ordinaire », qu’il s’agisse d’une activité sportive ou ludique, ou même d’activités de consommation ou de production directement liées au marché.
La réalisation d’une expérience implique, on le voit, une alchimie complexe qui suggère que nous vivons régulièrement des expériences très imparfaites ou inaccomplies. Ou, de façon plus littérale, que nos vies ordinaires se caractérisent (trop) souvent par l’absence d’expériences esthétiques. Ou que, finalement, nos émotions n’ont pas aussi souvent qu’elles le pourraient une qualité permettant la transformation de la relation que l’émotion primaire suggère.
Conclusion
Dans cet article, nous avons suggéré, à partir de l’approche pragmatiste de John Dewey, que l’émotion possède un pouvoirdetransformation sociale qui s’exerce à l’échelle de l’individu et qui peut avoir une incidence sur le plan collectif. En pensant la « transaction », et non seulement l’« interaction », Dewey ouvre une perspective sur l’articulation entre institution et émotion par l’intermédiaire de l’individu. Dans ce cadre, l’émotion est ce qui signale et guide le changement des habitudes ou des règles établies. Toutefois, il peut arriver aussi qu’une routine ou une habitude émotionnelle nous fige dans une posture qui empêche toute transformation, ou que l’expérience vécue par l’individu soit incomplète ou imparfaite lorsque l’émotion qui la sous-tend est elle-même insuffisante, excessive ou inadaptée. L’approche de Dewey nous interroge donc sur la façon dont l’articulation entre les habitudes, les règles institutionnelles et les émotions individuelles conduit à une transformation sociale durable et pérenne. Comme le suggèrent par exemple Palpacuer et Seignour (2019) lorsqu’ils pointent l’évolution des pratiques managériales contestées au sein de l’entreprise France Télécom, c’est probablement la transformation d’une ou de plusieurs émotions primaires (anxiété, honte, indignation) qui est à l’origine récente d’un changement dans les règles de droit[6]. Il s’agit, selon notre interprétation de Dewey, d’une « expérience » aboutie dans laquelle l’émotion des différents acteurs a joué un rôle moteur et unificateur.
L’approche du changement institutionnel par les émotions que nous proposons, inspirée de L’art comme expérience de John Dewey, ouvre sur de nombreuses questions qui dépassent le cadre de cet article, et que nous avons simplement suggérées ici. Si l’émotion est au coeur de la transformation sociale, s’agit-il cependant d’une émotion « ordinaire », c’est-à-dire d’un affect que l’on ressent dans le cadre de nos expériences quotidiennes, ou d’une émotion plus spécifique de nature « esthétique » ? Certaines émotions, comme la colère, la joie ou l’empathie, sont-elles plus propices que d’autres au changement ? S’il faut changer les habitudes de comportement, quelle place doit-on accorder à une politique éducative des émotions ?
Appendices
Notes
-
[1]
Voir Petit (2018) pour une revue de la littérature.
-
[2]
En suivant la lecture des économistes institutionnalistes, nous définissons de façon élargie les institutions comme « des systèmes durables de règles sociales et de conventions établies, encastrées, qui structurent les interactions sociales » (Chavance, 2018 : 99). Ainsi, le langage, la monnaie, le droit, les systèmes de poids et de mesures, les manières de table, les firmes et les autres organisations sont tous considérés comme des institutions.
-
[3]
John Dewey, L’art comme expérience, présentation de Richard Shusterman, postface de Stewart Buettner, traduction coordonnée par Jean-Pierre Cometti, Paris, Gallimard, coll. « Folio essais », 2005 [1934], 596 p. Désormais, les références à cet ouvrage seront indiquées par le sigle A suivi du folio, et placées entre parenthèses dans le texte.
-
[4]
Voir Bernard (2017) pour une revue de la littérature.
-
[5]
John Dewey remarque en particulier que le mot « design » possède une double signification : il dénote l’agencement ou l’arrangement autant que l’intention, le « dessein ».
-
[6]
Le 20 décembre 2020, le tribunal correctionnel de Paris a rendu un jugement historique, condamnant l’entreprise française (devenue Orange en 2013) pour « harcèlement moral institutionnel » (Le Monde, 23 décembre 2019). Le caractère exceptionnel du jugement vient ici notamment du fait que c’est un « système de règles » qui est mis en cause (et non pas seulement des personnes comme c’est le cas lors de procédures classiques de harcèlement). Le tribunal a notamment souligné l’utilisation de « méthodes qui ont abouti à déstabiliser les salariés et à créer un climat professionnel anxiogène » (Le Monde, 21 décembre 2019).
Bibliographie
- Arnold, Magda. 1960. Emotion and Personality. New York, Columbia University Press.
- Bateson, Gregory. 1991. Une unité sacrée. Quelques pas de plus vers une écologie de l’esprit. Paris, Seuil.
- Benedict, Ruth. 1995 [1946]. Le chrysanthème et le sabre. Paris, Picquier.
- Bernard, Julien. 2017. La concurrence des sentiments : une sociologie des émotions, Paris, Métaillé.
- Chavance, Bernard. 2018. L’économie institutionnelle. Paris, La Découverte.
- Crawford, Matthew B. 2010. Éloge du carburateur. Essai sur le sens et la valeur du travail. Paris, La Découverte.
- Damasio, Antonio R. 1994. L’erreur de Descartes : la raison des émotions, Paris, Odile Jacob.
- Dewey, John. 1894. « The Theory of Emotion I: Emotional Attitudes », Psychological Review, 1, 6 : 553-569.
- Dewey, John. 1895. « The Theory of Emotion II: The Significance of Emotions », Psychological Review, 2, 1 : 13-32.
- Dewey, John. 1896. « The Reflex Arc Concept in Psychology », Psychological Review, 3, 4 : 357-370.
- Dewey, John. 1922. Human Nature and Conduct: Introduction to Social Psychology. New York, Henry Holt and Company.
- Dewey, John. 2005 [1934]. L’art comme expérience. Paris, Gallimard.
- Dewey, John et Arthur. F. Bentley. 1949. Knowing and the Known. Boston, Beacon Press.
- Febvre, Lucien. 1941. « La sensibilité et l’histoire : comment reconstituer la vie affective d’autrefois ? », Annales d’histoire sociale, 3, 1-2 : 5-20.
- Formis, Barbara. 2015. Esthétique de la vie ordinaire. Paris, Presses universitaires de France.
- Frijda, Nico. H. 1986. The Emotions. Cambridge, Cambridge University Press.
- Goffman Erving. 1974. Les rites d’interaction. Paris, Minuit.
- Halbwachs, Maurice. 2014 [1939]. « L’expression des émotions et la société », texte présenté et annoté par Christophe Granger, Vingtième siècle. Revue d’histoire, 3, 123 : 39-48.
- Hochschild, Arlie Russel. 2017. Le prix des sentiments : au coeur du travail émotionnel. Paris, La Découverte.
- Laflamme, Simon. 1995. Communication et émotion. Essai de microsociologie relationnelle. Paris, L’Harmattan.
- Le Coz, Pierre. 2014. Le gouvernement des émotions. Paris, Albin Michel.
- James, William. 1884. « What is an Emotion? », Mind, 9, 34 : 188-205.
- Mauss, Marcel. 1921. « L’expression obligatoire des sentiments », Journal de psychologie, 18 : 425-434.
- Mendonça, Dina. 2012. « Pattern of Sentiment: Following a Deweyan Suggestion », Transactions of the Charles S. Peirce Society: A Quarterly Journal in American Philosophy, 48, 2 : 209-227.
- Palpacuer, Florence et Amélie Seignour. 2019. « Resisting Via Hybrid Spaces: The Cascade Effect of a Workplace Struggle Against Neoliberal Hegemony », Journal of Management Inquiry, 29, 4 :1-15.
- Pedwell, Carolyn. 2017. « Transforming Habit: Revolution, Routine and Social Change », Cultural Studies, 31, 1 : 93-120.
- Petit, Emmanuel. 2018. « La mise en oeuvre d’une conception relationnelle de l’émotion en économie comportementale », Nouvelles perspectives en sciences sociales, 14, 1 : 43-83.
- Pratten, Stephen. 2015. « Dewey on Habit, Character, Order and Reform », Cambridge Journal of Economics, 39, 4 : 1031-1052.
- Quéré, Louis. 2018. « L’émotion comme facteur de complétude et d’unité dans l’expérience. La théorie de l’émotion de John Dewey », Pragmata, 1 : 10-59.
- Robert, Anne-Cécile. 2019. La stratégie de l’émotion. Montréal, Lux.
- Schachter, Stanley. 1964. « The Interaction of Cognitive and Physiological Determinants of Emotional State », Advances in Experimental Social Psychology, 1 : 49-81.
- Scott, Charles E. 2015. « Differences, Borders, Fusions », The Journal of Speculative Philosophy, 9, 1 : 16-24.
- Solomon, Robert C. 1976. The Passions: Emotions and the Meaning of Life. Indianapolis, Hackett Publishing.
- Steiner, Pierre. 2010. « Interaction et transaction : quelques enjeux pragmatistes pour une conception relationnelle de l’organisme », Chromatikon. Annales de la philosophie en procès/Yearbook of Philosophy in Process, 6 : 203-213.

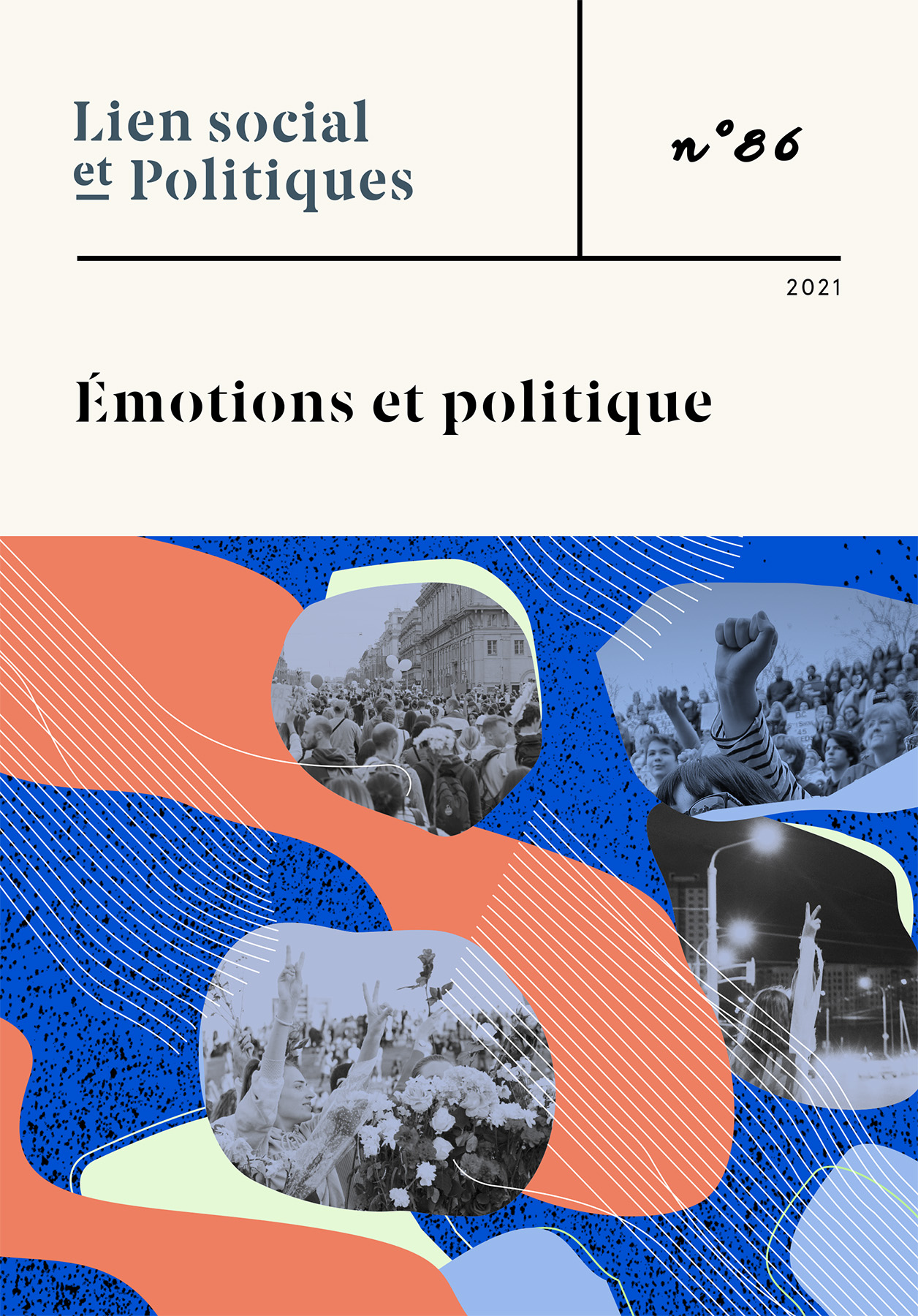
 10.7202/1056432ar
10.7202/1056432ar