Abstracts
Résumé
À partir d’une enquête ethnographique par observations et entretiens auprès de plusieurs collectifs antiracistes franciliens formés à partir de 2005, cet article examine les processus de production du « Nous » dans l’action collective. Il s’agit notamment de prendre au sérieux les processus émotionnels, dans une double perspective de sociologie de l’action collective et des rapports sociaux. On montre d’abord le lien entre engagement, sentiment d’injustice et colère face au racisme dans les trajectoires individuelles, lorsque la rencontre avec un cadre collectif permet de transformer cette colère en capacité d’agir. On analyse ensuite la dimension émotionnelle et relationnelle du travail militant, c’est-à-dire l’ensemble des pratiques qui produisent de l’appartenance « pour soi » pour les participant·e·s, dans une logique de communalisation et de subjectivation politique qui dépasse les assignations raciales.
Mots-clés :
- antiracisme,
- travail militant,
- travail émotionnel,
- rapports sociaux
Abstract
This article is based on an ethnographic study of several antiracist activist groups from the Paris region, oriented towards political autonomy and a systemic approach of racism since their creation around 2005. It aims at examining the process of production of a collective subject, « Us ». It focuses on emotional processes and combines the perspectives of the sociology of collective action and that of social relations of power. First, we show how individually felt anger and sense of injustice become empowering when they encounter a collective frame of action. Then we analyse the emotional and relational aspects of militant work as a series of acts producing a sense of belonging for oneself, in a dynamic of communalisation and political subjectivation rather than racial domination.
Keywords:
- antiracism,
- militant work,
- emotion work,
- social relations of power
Article body
Parmi les approches des émotions en sciences sociales, un certain nombre de travaux s’est penché sur la dimension émotionnelle de la vie politique et, notamment, de l’action collective, après l’avoir délaissée pendant plusieurs décennies pour se défaire de l’héritage d’une psychologie des foules qui postulait l’irrationalité des participant·e·s aux mobilisations (Jasper, 2011). Dans le sillage des travaux sur l’action collective qui prennent au sérieux les émotions, on analysera ici les mobilisations antiracistes sous deux angles complémentaires : celui des motivations affectives de l’engagement et celui du travail émotionnel observé durant les temps d’action collective. Cet article repose sur mon enquête doctorale, menée auprès de plusieurs collectifs antiracistes en région parisienne entre 2013 et 2018 : Conseil représentatif des associations noires (CRAN), Parti des indigènes de la république (PIR), Brigade anti-négrophobie (BAN), tous trois fondés en 2005 ; réseau Reprenons l’initiative contre les politiques de racialisation (RI) actif de 2014 à 2017, comité d’organisation des Journées contre l’islamophobie (de 2013 à 2017) et plusieurs collectifs ad hoc. Bien qu’ils présentent des modes d’action et des revendications hétérogènes, ces collectifs ont en commun d’être animés par des militant·e·s français·es — enfants d’immigré·e·s des anciennes colonies ayant connu une mobilité sociale ascendante — et constituent un réseau d’interconnaissances et d’alliances. Ils s’inscrivent dans un espace français de l’antiracisme dominé par quelques grandes associations dont ils contestent l’institutionnalisation. Ils critiquent aussi la définition du racisme proposée par ces dernières, qualifiée d’« antiracisme moral », car elle associe le racisme à une opinion déviante. Les collectifs formés à partir de 2005 se distinguent de cette vision en se réclamant d’un « antiracisme politique », caractérisé par la centralité de la revendication de l’autonomie politique des personnes visées par le racisme et par un important travail militant d’élaboration théorique. Celui-ci débouche sur des analyses du racisme qui convergent vers une définition axée sur les rapports de domination hérités des rapports coloniaux, combinée à l’usage de catégories de racisme qui correspondent aux groupes racisés que chaque collectif aspire à représenter : négrophobie, islamophobie, antitziganisme (Picot, 2016 et 2019). Ces mobilisations constituent ainsi un lieu privilégié de la revendication d’une existence politique autonome des minoritaires racisés[1] dans le contexte de la France hexagonale dont l’un des enjeux centraux est la production d’un « Nous », d’une identification collective en tant que Français·es et racisé·e·s.
Il pourrait paraître superflu de s’attarder sur une analyse de la dimension émotionnelle de mobilisations dont les modes d’action valorisent principalement le travail militant intellectuel (écriture, prise de parole publique). La saisie des émotions apparaît d’ailleurs peu objectivable en comparaison avec d’autres données comme les propos, les écrits ou la description des tâches ordinaires. Pourtant, aussi bien l’observation ethnographique au long cours, en particulier lors des événements publics (meetings, manifestations) et des temps informels qui les entourent, que l’exploitation d’une quinzaine d’entretiens biographiques menés auprès de membres des collectifs étudiés révèlent la dimension centrale de cette analyse pour comprendre les dynamiques d’engagement et de maintien dans la mobilisation. On peut distinguer pour l’analyse trois « sites » d’expression des émotions dans les mouvements sociaux (Ransan-Cooper et al., 2018) : le soi (self), le groupe mobilisé (in group and between-groups), les arènes publiques. Les données issues des entretiens relèvent plutôt des niveaux du soi et de l’in group, tandis que celles issues de l’observation participante concernent les groupes mobilisés au sens large — les événements observés rassemblant souvent plusieurs des collectifs et étant fréquentés par leurs sympathisant·e·s. La combinaison des deux méthodes « permet de s’attacher au contexte de manifestation des émotions en les associant à des expériences sociales antérieures ou parallèles » (Salaris, 2018).
Dans une double perspective de sociologie de l’action collective et des rapports sociaux, le terrain antiraciste devient alors celui d’une exploration de la dimension émotionnelle de la production d’un « Nous » mobilisé, dont les ressorts sont à la fois politiques et communautaires (au sens de la communalisation entre minoritaires racisé·e·s). En effet, le partage de la situation minoritaire n’implique pas nécessairement un sentiment d’appartenance commune (Haapajärvi et al., 2018), qui constitue plutôt un des enjeux de la mobilisation. On s’intéressera donc, dans un premier temps, aux ressorts émotionnels de l’engagement, notamment au rôle de la colère et du sentiment d’injustice lorsqu’ils sont ressentis individuellement, mais aussi aux façons dont les appartenances collectives (famille, groupe mobilisé) façonnent ou donnent un terrain d’expression à l’« expérience vécue génératrice d’émotions individuellement ressenties, mais collectivement partagées par [leurs] membres » (Johsua, 2013). On pourra ainsi tenter d’appréhender « les effets théoriques de la colère des opprimées » et des « minoritaires » — ceux et celles qui sont « en situation de moindre pouvoir » (Guillaumin, 1981) —, à savoir que les « appréhensions conceptuelles » des logiques d’oppression sont indissociables de la connaissance intime et des sentiments que cette oppression inspire à celles et ceux qui la subissent.
Dans un second temps, on combinera cette entrée par les trajectoires et carrières militantes avec une entrée par le travail militant, qui regroupe l’ensemble des tâches effectuées dans la mobilisation, et qui « consiste à légitimer ou délégitimer et à conserver ou transformer les modalités de la production du vivre en société » (Dunezat et Galerand, 2014). Analyser les dimensions émotionnelles de l’action collective en termes de travail militant — en s’appuyant notamment sur les concepts de travail émotionnel (Hochschild, 2003) et relationnel (Demailly, 2008) — permet de saisir la pratique militante en tant que moment de production d’appartenances minoritaires « pour soi », au-delà des catégorisations imposées par les majoritaires dans le cadre des rapports sociaux racistes. On cherchera à appréhender le passage d’un sentiment individuel à un sentiment d’appartenance collectif, notamment par l’intermédiaire de la parole publique et des réactions qu’elle suscite sur deux registres principaux : celui du partage de la souffrance et de l’empathie, et celui de l’humour comme outil de cohésion du groupe. On portera également attention à la dimension physique des processus émotionnels collectifs, lorsque faire ensemble les gestes militants conduit à « faire corps ». Ce sont ainsi autant de pratiques qui constituent un « procès de travail bien réel, qui contient sa part d’idéel et de réel, qui produit du matériel et de l’idéel, des activités, des actions, des comportements, des représentations et des identités » (Juteau, 1999 : 92-94).
1. Les trajectoires des militant·e·s : de la colère individuelle à l’action collective
1.1 Face au racisme, la colère et le sentiment d’injustice
Les entretiens constituent un moment privilégié pour observer et recueillir les formes d’expression des émotions, en particulier en ce qui concerne le ressenti individuel et la façon dont celui-ci découvre des affinités avec le discours et/ou les modes d’action d’un collectif. Ainsi, lorsqu’elles répondent à la question « Comment es-tu devenu·e militant·e (du PIR, du CRAN, de la BAN, de RI) ? », les personnes interrogées inscrivent toutes leur trajectoire d’engagement dans leur histoire personnelle et familiale. Elles font état d’expériences marquantes de confrontation au racisme, et relatent les sentiments de colère et d’injustice que celles-ci ont suscités. Ces expériences ne sont pas seulement celles que l’individu a subies : au-delà des récits de stigmatisation, de mises à l’écart, à l’école, de la part d’enseignant·e·s ou de camarades de classe ou, plus tard, lors de l’entrée sur le marché du travail, la colère face aux discriminations racistes résulte aussi d’un processus de transmission intrafamiliale des récits de « l’émigration-immigration » (Sayad, 2006) :
Mon père, par exemple, il est venu en France à l’époque de la colonisation, c’était le premier arrivé de ma famille, c’est la première génération. Lui, ça lui parle, parce qu’il sait, il sait ce qu’a commis de Gaulle, il sait comment il a mis en place les indépendances de façade, Mitterrand lorsqu’ils ont tué Sankara, il me racontait tout ça. Mon père, il m’a aidé à avoir une conscience politique aussi.
I., homme, trentenaire, BAN
Ici, le fils inscrit spontanément le parcours migratoire de son père dans l’histoire des rapports coloniaux. Comme dans d’autres enquêtes sur le devenir des minoritaires racisé·e·s dans les sociétés occidentales, la famille s’avère un lieu décisif d’apprentissage « informel » de « connaissances générales » sur le racisme (Essed, 1991 : 88-100). Elle est aussi un lieu d’acquisition de dispositions critiques qui favorisent ensuite le passage à l’action collective, au sens où les récits de l’émigration-immigration fournissent des repères et des points de comparaison aux personnes interrogées pour reconnaître leur propre situation comme injuste et discriminatoire. En effet, les émotions — et notamment la colère — constituent des « pratiques sociales et culturelles », « relationnelles », dépendantes d’« histoires » personnelles et collectives (Ahmed, 2014 : 8-9). Les entretiens permettent ainsi de comprendre comment la colère exprimée individuellement est en fait déjà façonnée par son contexte d’énonciation, la socialisation dans la famille s’avérant décisive pour être en mesure de formuler des émotions qui constituent une dimension fondamentale de l’expérience de la racisation.
Par ailleurs, les militant·e·s expliquent souvent leur décision de s’engager dans un collectif antiraciste comme une réaction à des événements qu’ils et elles considèrent être les déclencheurs, car ils sont ressentis comme la « violence de trop ». Citons notamment la participation de deux militants quarantenaires de la BAN et de RI à des émeutes, après la mort de jeunes hommes racisés entre les mains de la police au milieu des années 1990 ; ou celle de deux initiateurs de la BAN à des rassemblements en mémoire des victimes des incendies de logements insalubres occupés par des familles majoritairement sans-papiers en 2005. Leur décision de « faire quelque chose » pour lutter contre une injustice désormais vécue comme intolérable intervient alors que leur colère se teinte d’empathie pour des victimes dont ils se sentent proches (jeunes hommes de quartiers populaires, familles immigrées d’Afrique de l’Ouest précarisées). Ces récits éclairent le rôle des états émotionnels les plus intenses dans « l’émergence des mobilisations, quand la colère est transformée en puissance d’agir » (Johsua, 2013). La cohérence entre la colère individuellement ressentie et les cadres d’expression acquis dans la famille apparaît par ailleurs centrale dans l’élaboration d’une analyse du racisme contemporain comme héritage des rapports coloniaux. Ainsi, ce militant contre les violences policières explique :
Il se trouve qu’en 2009 il y a l’affaire Ali Ziri, c’est un vieux monsieur chibani de 69 ans qui meurt dans ma ville, Argenteuil, tué par la police [...]. Et c’est un vieux monsieur qui par ailleurs est un ami de mon père, et c’est pas rien, parce que quand mon père m’en parle... [sa voix s’éraille] j’ai rarement vu mon papa pleurer, pour des milliards de raisons, une sorte de pudeur, bien ou mal placée, mais c’est comme ça, mais il a beaucoup d’émotion quand je lui apprends le truc, et il détourne le regard pour pas que je voie ses larmes, et puis il dit : « Ça recommence. » Il dit ces mots-là, et pour lui, évidemment ça évoque la guerre d’Algérie, ça évoque tout ça. Et c’est un truc qui tient aux tripes, parce que je me dis, l’affaire Ali Ziri, c’est pas une affaire de violences policières au-dessus des autres, pas du tout, ni en dessous d’ailleurs, mais en tous les cas, perso, elle va marquer profond dans la chair quoi, parce qu’il y a un peu de mon papa dedans, il y a un peu ses potes du foyer.
O., homme, quarantenaire, militant contre les violences policières
Le rapport affectif entre le père et la victime et entre le père et le fils, ainsi que le lien que fait le père entre la mort d’Ali Ziri et la période de la guerre d’Algérie que le fils a déjà appris à considérer comme synonyme d’injustices constituent une chaîne de relations et de réactions affectives qui conduisent O. à réorienter son engagement vers les mobilisations contre les violences policières à ce moment précis, alors même qu’il était déjà, de longue date, militant dans une organisation trotskyste.
Par ailleurs, la plupart des personnes interrogées relatent leur frustration et leur colère croissantes face à des contextes politiques ressentis comme hostiles. Pour les initiateurs et initiatrices du PIR, de la BAN, de RI et pour certain·e·s militant·e·s du CRAN, le moment de cristallisation de la colère se situe au milieu des années 2000. Cette période, qui fait suite au choc politique causé par l’accession du parti d’extrême droite au second tour de la présidentielle de 2002, est caractérisée par l’omniprésence dans le débat public (autant dans le discours politique que dans celui produit par un ensemble d’intellectuel·le·s s’exprimant dans les médias nationaux) des thèmes du « communautarisme » et de la « concurrence des mémoires ». À la faveur des débats autour de la loi du 15 mars 2004 qui interdit, au nom de la laïcité, le port de « signes ou tenues manifestant une appartenance religieuse » dans les établissements scolaires[2], ainsi que de la loi du 23 février 2005 « portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés[3] » qui visait notamment la reconnaissance de « l’oeuvre accomplie par la France » dans ses colonies, les espaces médiatiques et militants sont saturés par un discours « national-républicain » qui stigmatise l’expression d’une appartenance minoritaire et toute vision critique de l’histoire coloniale comme incompatibles avec l’appartenance au corps national (Picot, 2019 : 96-116). Pour les enquêté·e·s, le contexte des années 2000 est celui d’un renforcement des assignations racistes, avec l’hégémonie d’un discours sur « l’identité nationale » qui accroît le décalage avec la promesse d’égalité républicaine faite aux enfants d’immigré·e·s (qui sont français·es) :
Ce qui m’a remis les idées un peu au clair, c’est la présidence Sarkozy. Sarkozy arrive au pouvoir et, en fait, il te renvoie à la figure ce que tu es. C’est-à-dire qu’en fait, toi, tu penses être une Française qui t’intègres et qui es comme tout le monde et puis on te renvoie à une identité stricte, et dénuée de toute autre possibilité, de toute autre culture, que l’idée que tu es une Noire, quoi !
E., femme, quarantenaire, CRAN
Pour les militant·e·s plus jeunes, c’est le contexte du milieu des années 2010, notamment les suites des attentats de 2015 et l’assignation qui s’en suit des personnes perçues comme musulmanes à une figure d’« ennemi intérieur », qui provoque le même type de colère. Ils et elles expriment aussi leur peur de l’aggravation des discriminations et violences racistes :
Et on va dire que... suite à ce qui se passait médiatiquement en France après les attentats de Charlie, puis ceux de novembre, j’ai vu émerger une parole politique en France, laïque, très... très nationaliste et islamophobe, et ça m’a plutôt inquiété. Et puis j’ai interprété ça quand même comme un ravivement du racisme en France, au niveau politique et même culturel, donc ça m’a inquiété. Du coup, la voix la plus évidente que j’ai trouvée c’était celle du PIR.
I., homme, trentenaire, PIR
Dans cet extrait, on retrouve non seulement l’inquiétude, mais aussi le soulagement que provoque la rencontre avec un discours militant qui vient donner une expression publique et collective aux émotions jusque-là vécues de manière relativement isolée, à contre-courant des discours médiatiques mainstream. L’engagement dans la cause antiraciste s’explique ainsi, en partie, par la coïncidence entre « un contexte politique spécifique et un cadre militant original [qui] créent une opportunité de conversion de la colère en puissance d’agir » (Johsua, 2013).
1.2 Mettre des mots sur ce qu’on vit : le travail militant intellectuel
Pour comprendre le processus de mobilisation, il paraît difficile (et illusoire) de se contenter de la division classique entre raison et émotion. En effet, à l’échelle de l’individu, l’engagement antiraciste est en partie issu de la colère provoquée par le sentiment d’être atteint dans sa dignité, mais la formulation de cette colère et sa transformation « en paroles et en actes » (Lorde, 1977) s’effectuent grâce à des cadres d’analyse élaborés collectivement, dont la production est un des enjeux de la mobilisation. Le constat du manque d’outils théoriques pour analyser le racisme dans la France contemporaine est ainsi largement partagé parmi les enquêté·e·s, en particulier par ceux et celles qui forment les collectifs au milieu des années 2000. L’espace de l’antiracisme est alors organisé, d’un côté, autour d’analyses de la xénophobie, tournées vers le soutien aux sans-papiers et la problématique de la situation faite aux étrangers·ères, et, de l’autre, autour des dispositifs de lutte contre les discriminations menés conjointement avec les pouvoirs publics, teintés de « moralisme » (Eberhard, 2011). L’adoption d’un registre intellectuel et critique par les collectifs étudiés traduit ainsi la correspondance entre les dynamiques émotionnelles de l’engagement et le choix de modes d’action distincts de ceux des mobilisations préexistantes.
Pour les militant·e·s qui rejoignent ces collectifs, la lecture des textes fait souvent office de déclic. Elle provoque des réactions indissociablement affectives et intellectuelles. Dans le cas de l’Appel inaugural des « Indigènes de la République » en janvier 2005, F. dit : « Quand je l’ai lu la première fois, j’en ai eu des frissons » (homme, quarantenaire, PIR puis RI). De la même façon, L. raconte avoir réagi avec enthousiasme à la lecture des comptes rendus des manifestations parisiennes de soutien à Gaza en 2014 : « Eurêka, quoi : j’ai eu l’impression de tout comprendre d’un coup » (femme, trentenaire, PIR). Cet effet de révélation traduit le passage du sentiment diffus à l’expression politique, en liant indissociablement compréhension rationnelle et affects positifs. Cela s’accompagne du sentiment intime de (re)prendre une forme de contrôle sur son destin : se mobiliser en tant que membre d’un groupe social subissant le racisme implique de ne plus seulement être défini·e par les assignations racistes, mais de s’arroger le pouvoir de se nommer et de nommer la domination subie (Delphy, 2008 : 39). Cela implique aussi de ne plus limiter l’expression de sa colère et de son sentiment d’injustice à un cadre privé, mais d’accéder à une expression collective et publique. L’entrée dans le militantisme transforme alors en retour toute l’économie émotionnelle de la personne et, notamment, sa perception d’elle-même :
Je pense que, quand j’ai commencé à militer aux Indigènes, pendant trois mois, tous les matins... je me sentais digne ! Je me sentais digne, le fait de pouvoir répondre, de pouvoir agir, de pouvoir faire des choses, mais c’était vraiment libératoire. J’ai passé trois mois à me sentir digne 24H/24 ! Pourtant, je vivais dans un vieux cloaque !
A., homme, trentenaire, PIR
Elle transforme aussi en partie le rapport au monde, que ce soit en rendant visibles les « résistances des actes, de la vie de tous les jours » (A., PIR) ou en redéfinissant le rapport de l’individu à son héritage familial :
Et ma mère, elle savait très bien que, plus j’allais avancer dans les études, plus j’allais avancer dans ma carrière, et plus j’allais m’éloigner d’elle en fait. Mais d’elle au sens de... de ce qu’elle m’a inculqué, de la tradition. C’était un déchirement parce qu’à la fois, elle veut pas l’empêcher, elle veut que je réussisse, mais elle savait très vite que c’était au prix de la trahir. Que j’étais obligée de la trahir. Et ça, c’était un drame. C’est pour ça, je parlais de réconciliation. Parce que moi, la politisation au PIR, elle m’a permis de dire : « Mais attends, regarde, je réussis et en plus je te trahis pas, je reviens à toi. » Et ça, elle a senti, je pense que dans ma famille tout le monde a senti un changement, mes frères et soeurs, un changement qu’ils ont pu charrier même [rire] !
L., femme, trentenaire, PIR
Cette dynamique intime de remise en cohérence de soi, lorsque l’engagement antiraciste permet de résoudre la contradiction entre l’attachement affectif au milieu d’origine et les changements de mode de vie provoqués par la mobilité ascendante, revient régulièrement dans les entretiens, de manière plus ou moins explicite. L’économie affective est aussi transformée au sens où certains des collectifs antiracistes étudiés deviennent des réseaux de sociabilité pour leurs membres (Picot, 2019 : 371-378). Un membre du bureau du CRAN souligne à quel point lui et deux membres entrés en même temps que lui sont « soudés » (T., homme, quarantenaire). Ils quittent d’ailleurs ensemble l’association en 2018 et continuent de militer pour la « diaspora » en animant une émission sur une radio associative francilienne. Le PIR est le collectif où la sociabilité apparaît la plus forte, par exemple pour cette militante alors membre de l’organisation depuis environ trois ans : « C’est pas des rapports amicaux, des rapports cordiaux, c’est évidemment beaucoup plus que ça. Moi, c’est ma famille, quoi. Le seul truc qui nous manque, dans ce qui nous lie, c’est le sang ! » (L., femme, trentenaire)
J’ai ainsi constaté tout au long de l’enquête l’importance du « souci [care] pour les autres militants et pour la création d’espaces où construire et renforcer les relations » (Ransan-Cooper et al., 2018), en parallèle des tâches militantes les plus visibles. L’attention à la dimension émotionnelle des trajectoires permet alors d’appréhender les processus d’allers-retours entre le niveau intime de l’économie affective et celui de l’action collective : au-delà de l’expression collective de la colère, l’entrée dans la cause antiraciste alimente aussi des émotions positives et un sentiment de cohérence identitaire.
Du sentiment d’injustice transmis dans les familles, à la joie et au soulagement de trouver une expression collective à une colère ressentie d’abord seul·e, tout un ensemble de processus émotionnels apparaissent ainsi sous-jacents dans les productions théoriques elles-mêmes. Ils affirment la « dignité » des minoritaires racisés en mettant en avant l’héritage des luttes passées et la nécessité de l’autonomie politique.
Cette première dimension de la production du « Nous » antiraciste qui se joue dans la rencontre entre des dispositions critiques, des colères individuelles et l’investissement dans des modes d’action qui privilégient le travail militant intellectuel n’est cependant pas la seule façon d’appréhender les processus émotionnels. L’enquête fait aussi apparaître toute une dimension incarnée, perceptible à travers la « charge émotionnelle » des temps collectifs.
2. Émotions collectives et émotions publiques au prisme du travail militant
2.1 Partager sa peine : l’empathie à la base du sentiment d’appartenance
Les événements publics organisés par les collectifs étudiés[4] — réunions, meetings, manifestations de rue — sont caractérisés par le souci des militant·e·s d’ancrer leur théorisation et leur analyse politique dans l’expérience personnelle du racisme et de ses effets, en cohérence avec le paradigme de l’autonomie politique qui guide leurs actions et que résume la formule souvent reprise « par nous, pour nous ». Les événements publics sont ainsi le lieu d’un travail militant à la fois intellectuel et émotionnel, de la part des militant·e·s à destination des personnes auxquelles ils et elles s’adressent prioritairement : les membres des catégories minoritaires racisées, dont il s’agit d’accroître ou d’entretenir le niveau de participation. L’observation participante permet d’appréhender la démarche de production du « Nous » mobilisé à travers le travail émotionnel déployé par les membres des collectifs, mais aussi de saisir au plus près les réactions affectives des personnes qui participent. Cette démarche peut être qualifiée de « travail de communalisation » (Haapajärvi et al., 2018) au sens où elle vise à passer d’une condition de minorité, caractérisée par le fait de partager une position objectivement défavorable dans les rapports sociaux et l’assignation à des catégories hétéro-définies (une appartenance « par défaut »), à celle de communauté partageant un sentiment d’appartenance et une autodéfinition commune (une appartenance « pour soi »). Les deux dimensions du travail militant — intellectuelle et émotionnelle — fonctionnent ainsi ensemble dans les « dispositifs de sensibilisation », entendus comme « l’ensemble des supports matériels, des agencements d’objets, des mises en scène, que les militants déploient afin de susciter des réactions affectives qui prédisposent ceux qui les éprouvent à s’engager ou à soutenir la cause défendue » (Traïni, 2011).
Un des registres émotionnels très présents dans les événements, qui joue un rôle central dans la production d’un sentiment d’appartenance commune, est celui du deuil et de la peine, associé à la colère. Il est notamment mobilisé lorsqu’il s’agit d’exposer la violence du racisme, en particulier des crimes sécuritaires et policiers, et vient alors alimenter un cadre d’analyse qui conceptualise le « racisme d’État ». Il correspond à un dispositif de sensibilisation récurrent : le récit de leur propre expérience de la violence ou du deuil par des militant·e·s, qui sollicite l’empathie des participant·e·s. Le meeting qui précède la Marche de la Dignité, manifestation qui s’est tenue à Paris en octobre 2015 à l’initiative d’un collectif de « femmes subissant le racisme d’État », constitue un bon cas d’étude. Plusieurs militantes y témoignent notamment de la façon dont des hommes de leur famille ont été maltraités par les institutions qui incarnent le « racisme d’État » qu’elles dénoncent (travail, prison, police). Elles exposent la façon dont cela les affecte, tout en soulignant le caractère ordinaire de ces expériences pour les femmes « comme elles », c’est-à-dire des héritières de l’immigration maghrébine qui vivent en banlieue parisienne. Une des organisatrices, A., est devenue militante à la suite de la mort de son frère, tué d’une balle dans le dos par un policier. Lorsque vient son tour de parole, elle apparaît très émue, elle pleure au micro, puis se reprend, encouragée par les autres militantes présentes sur l’estrade, et dit : « Ce ne sont pas seulement les familles qui sont touchées, mais tous ceux qui savent que ça aurait pu être eux ! » Elle réalise ainsi un travail émotionnel pour canaliser ses propres émotions et susciter l’empathie du public, tout en donnant une portée plus large au récit de son expérience personnelle en présupposant une conscience latente de l’appartenance à un même monde, celui des victimes potentielles de l’arbitraire policier. Le recours à l’exposition de l’histoire intime ou familiale d’une personne suppose également du travail émotionnel de la part des autres militant·e·s pour contenir leurs propres affects et prendre soin de celles qui s’exposent : lorsqu’une intervenante, debout au micro, se met à pleurer, une autre se lève et la réconforte, debout à côté d’elle et bras sur son épaule ; et il n’est pas rare que les militant·e·s manifestent leurs émotions en s’écoutant les un·e·s les autres au même titre que les personnes du public. Lors du meeting de la Marche de la Dignité, les réactions sont nombreuses dans le public : certains propos suscitent une approbation vigoureuse tandis que d’autres provoquent larmes, commentaires à voix basse et applaudissements. Ces réactions témoignent de la circulation d’émotions comme la colère et la peine, depuis l’estrade sur laquelle les militantes s’expriment jusqu’aux personnes présentes dans la salle qui réagissent avec empathie. On repère ainsi que « ces dispositifs de sensibilisation et l’expression d’émotions produites sur soi et sur les pairs ont pour effet de conforter la cohésion du collectif et le sens de l’adhésion à la cause » (Salaris, 2018), à la fois au sein des collectifs mobilisés (in-group et between groups) et, plus largement, auprès des sympathisant·e·s.
Ces exemples issus d’un événement particulier sont représentatifs des observations récurrentes faites dans les meetings et les rassemblements. Ils illustrent la place du travail émotionnel dans la production du « Nous » indispensable au développement d’un sentiment d’appartenance, non seulement à une cause commune, mais aussi à une communauté d’affects : comme le souligne S. Ahmed, c’est aussi ce qui nous émeut qui nous ancre aux autres (2014 : 10), ici, avec la mise en commun des peines et des souffrances.
2.2 L’humour, facteur de cohésion du groupe mobilisé
Si le racisme est un sujet grave et l’antiracisme une cause sérieuse au service de laquelle les militant·e·s produisent analyses et théorie, l’enquête a permis de constater à quel point l’humour est également un registre très présent dans la sociabilité entre mobilisé·e·s comme dans les discours publics. Sous la forme de parodies, d’ironie, de jeux de mots ou de « vannes », l’humour joue un rôle important dans la production du sentiment d’appartenance au « Nous » mobilisé — et, plus largement, au « Nous » des minoritaires racisé·e·s —, à la fois car il suscite des émotions positives qui contrebalancent la colère et la tristesse, et car il rend explicite la désignation d’une frontière « nous/eux » par l’accord sur ce qui est considéré comme drôle. En effet, « chaque communauté a un "style" d’humour qui lui est propre, et ces énoncés humoristiques sont performatifs dans le sens où ils révèlent et construisent l’implicite commun au groupe » (Zambiras, 2011).
Certains événements reposent entièrement sur le registre de la parodie, à l’instar du faux procès « l’antiracisme politique face aux inquisiteurs » qui s’est tenu à Saint-Denis en mai 2016. Coorganisé par des membres de tous les collectifs étudiés (à l’exception du CRAN) et d’autres collectifs, notamment contre les violences policières, il avait pour but de réagir au discrédit médiatique subi de manière décuplée depuis les attentats de 2015 par les militant·e·s de « l’antiracisme politique ». Ce « procès » a pris la forme d’une succession de prises de parole de militant·e·s, organisées thématiquement, entrecoupées d’interventions de sympathisant·e·s prestigieux·ses dans le rôle des « juges ».
Plusieurs intervenant·e·s ont notamment recours à un registre d’humour proche du stand-up, qui repose sur la mise en scène de leur personne et sur l’usage des catégories et stéréotypes du registre racial. En faisant appel, pour provoquer le rire, au répertoire déjà disponible des assignations de classe, de sexe et, surtout, de race auxquelles les personnes présentes ont immédiatement accès, les militant·e·s construisent des formes de connivence : « le caractère comique de la dérision est reconnu et légitimé par le rire du public des pairs et suppose que l’audience accepte et partage cette réinterprétation humoristique de la situation » (Le Lay et Pentimalli, 2013). On remarque par exemple des jeux sur le décalage entre les discours — ici, l’enchaînement de jeux de mots basés sur le lexique du noir et du blanc — et les caractéristiques visibles de l’orateur — le porte-parole de la BAN, qui est noir — qui mettent en lumière l’arbitraire des processus de catégorisation ordinaire par le majoritaire :
C’est au tour de F. de la BAN de passer devant la « juge », qui l’accuse d’introduire le vocabulaire de la négrophobie « par effraction dans la langue française ». Il commence par dire : « Je pourrais plaider coupable, mais ce serait nier la réalité ségréguée ! […] Qu’ai-je à dire pour que votre justice puisse me blanchir ? [Le public rit, applaudit]. J’ai compris depuis longtemps qu’il était impossible de montrer patte blanche pour un Noir qui vit dans un monde de Blancs ! » En parlant, il prend un ton grandiloquent, agite la main : le public rit.
Carnet de terrain, mai 2016
Il existe également tout un registre du « rire contre » qui repose sur la parodie du style et des catégories politiques employées pour discréditer les militant·e·s, et qui permet de tourner un ou plusieurs adversaires en ridicule :
N. dans le rôle de la juge surjoue la mauvaise foi et le discours national-républicain : « Qui a eu la mauvaise idée de remplir cette salle avec des gens qui respectent si peu la République ? » [...] Elle présente trois militant·e·s majoritaires de gauche, anti-impérialistes, en disant : « Voilà trois exemplaires de ce qu’il faut bien appeler des idiots utiles ! » Les trois « idiots » se prêtent au jeu et prennent place en riant. Chaque plaisanterie de la « juge » fait réagir les personnes présentes, aussi bien les militant·e·s qui participent à la parodie de procès sur l’estrade que les personnes présentes dans la salle : rires, applaudissements, commentaires, etc.
Carnet de terrain, mai 2016
La parodie permet notamment de retourner le stigmate attaché à la cause de l’antiracisme « politique », ici en reprenant les qualifications d’« idiots utiles de l’islamisme » ou « du communautarisme » souvent employées par les adversaires des collectifs antiracistes et, plus largement, de la critique post- et décoloniale. En effet, dans un contexte français où le fait même, pour des minoritaires racisés, de dénoncer le racisme subi et de s’autodésigner comme « Noir » ou « Arabe » dans une perspective politique peut exposer à une accusation de « communautarisme » et à un discrédit public (Dhume, 2013), plaisanter avec ces catégories et rire des tenants de l’aveuglement à la race constitue une prise de position en soi. Lors du procès parodique et, de manière plus générale, dans les temps collectifs observés, « l’accord autour des formes d’humour est une façon de rendre explicite l’implicite partagé qui unit la communauté » (Zambiras, 2011) et, notamment, de dédramatiser le fait de parler des rapports sociaux de race.
Par ailleurs, l’analyse de la division du travail militant, en ce qui concerne les modes et les registres de prise de parole, montre que l’humour est principalement l’attribut des militant·e·s les plus légitimes, du fait de leur ancienneté dans la cause, de leur compétence en tant qu’orateur·trice, ou de leur statut de fondateur·trice ou de porte-parole de leur collectif (Picot, 2019 : 398-403). Ces personnes sont donc en position de prescrire implicitement une sorte de « règle de sentiments » (Hochschild, 2003) particulière à cet espace de mobilisation. L’apprentissage de ce qui peut être tourné en dérision, de ce qui est ridicule — de même que ce qui met en colère — fait ainsi partie du travail émotionnel réalisé par les militant·e·s et les participant·e·s aux événements. En cela, il contribue à produire à la fois adhésion à la cause et sentiment d’appartenance au « Nous » mobilisé, par opposition à un « eux » et par l’alignement des manifestations d’affects entre personnes mobilisées.
2.3 « Faire corps » : quand l’émotion passe par le geste
Enfin, l’attention aux processus émotionnels dans l’observation conduit à rappeler cette évidence : l’engagement militant est aussi un engagement qui passe par le corps, en particulier dans le cas des mobilisations de minoritaires. On analysera donc ici la dimension physique du travail militant, c’est-à-dire notamment les techniques du corps relativement codifiées et l’usage de symboles ou d’objets culturels qui permettent aux militant·e·s d’affirmer en pratique un sentiment d’appartenance collective.
Les techniques du corps les plus repérables pour l’observatrice sont celles qui relèvent des modes de présentation de soi des militant·e·s. La plupart arborent en effet des « signes visibles (comportementaux, vestimentaires, etc.) qui peuvent être mobilisés et sélectionnés pour typifier un groupe social ou pour présenter un Moi ethnique spécifique » (Poutignat et Streiff-Fenart, 2008 : 183), au premier rang desquels les vêtements : t-shirts aux couleurs de leur collectif (BAN) ou keffieh noir et blanc symbolisant la solidarité avec la Palestine (PIR, RI). Même s’ils sont plus contraints par les normes de genre et de race, les choix de coiffure traduisent aussi dans certains cas l’affirmation (publique, manifeste) de son appartenance à un groupe racisé, comme E., membre du CRAN qui me confie que son afro peut être « mal vu » par ses collègues et son employeur, mais qu’elle en est « fière ».
Les manifestations de rue sont aussi des moments privilégiés pour l’observation de la dimension physique des processus émotionnels, d’abord car elles permettent l’usage de techniques du corps le plus souvent mises en place par les militant·e·s des collectifs, mais qui impliquent aussi les participant·e·s ; ensuite, parce qu’elles sont souvent synonymes de forte intensité affective : « la présence manifestante est une présence inséparablement collective et solidaire » (Soutrenon, 1998). C’est le cas, par exemple, lors d’un rassemblement contre une exposition tenue dans un équipement culturel public et accusée de véhiculer une représentation raciste des Noir·e·s, rassemblement qui fait l’objet d’une intervention policière :
Vers 17 heures, alors que la nuit tombe, le rassemblement se transforme en manifestation improvisée en direction de la deuxième entrée : la centaine de personnes s’engage en marchant dans la rue perpendiculaire, barrée par les gendarmes mobiles en tenue de maintien de l’ordre. On chante les mêmes slogans que pendant les autres rassemblements : « on sera là tous les jours » ; « respectez nos ancêtres » ; « État raciste, État impérialiste » ; « Annulez l’exposition ». Quand on arrive devant le barrage de gendarmes mobiles (camions et hommes avec boucliers), les manifestant·e·s crient plus fort, ne tentent pas de franchir le barrage ni de s’en prendre physiquement aux gendarmes, mais ceux-là utilisent quand même les gaz lacrymogènes. En face d’eux : plutôt des hommes, dont les militants de la BAN. Aux premiers rangs du cortège, les gens ont tous les mains en l’air, le geste fait référence aux manifestations contre les violences policières en cours aux États-Unis et à leur mot d’ordre « hands up ».
Carnet de terrain, décembre 2014
Ici, la gestuelle employée est aisément compréhensible pour n’importe quelle personne présente : les mains en l’air symbolisent la non-agressivité des manifestant·e·s, face aux gendarmes équipés de gaz lacrymogène et de lanceurs de balles de défense qui incarnent alors une des institutions du « racisme d’État ». La position des mains croisées en l’air fait aussi référence aux mouvements noirs états-uniens, ce qui revient à se placer dans la filiation de mobilisations prestigieuses et largement médiatisées à cette période. La gestuelle contribue ainsi à la collectivisation des émotions, en permettant à chaque participant·e·de « faire corps » avec les autres en effectuant le même geste au même moment et en partageant le sens du symbole (Soutrenon, 1998 ; Laplanche-Servigne, 2011 : 255-263).
Le recours à la musique est un autre moyen de susciter des émotions collectives, en faisant appel à un soubassement culturel partagé et/ou élaboré dans la mobilisation, qui renforce le sentiment d’appartenance. Ainsi, « l’expression collective d’affects et de sentiments (mis en scène par l’organisation comme des émotions), loin de traduire un "état d’esprit" commun aux membres du groupe, contribue à les construire, par le jeu à la fois de dynamiques de situation et de codages culturels » (Sommier, 2010 : 200). La chanson We shall overcome, popularisée dans les années 1960 par le mouvement des droits civiques aux États-Unis, a ainsi été chantée à deux reprises lors de la soirée des dix ans du CRAN : « Dans le public, beaucoup de gens chantent, certains la main sur le coeur. On sent que les gens sont émus, certain·e·s ont la larme à l’oeil et la chanteuse est très applaudie. » (Carnet de terrain, novembre 2015)
Une des militantes précise également : « c’est une chanson très belle, très importante. Tout militant doit la connaître » : il s’agit bien d’une référence commune qui provoque une réaction émotionnelle d’autant plus intense qu’elle est collective, sincère, mais aussi codifiée.
De la même façon, l’arrivée de la Marche de la Dignité d’octobre 2015 sur la place de la Bastille se fait au son de Talkin’ about a revolution de Tracy Chapman, avec les premiers rangs de manifestant·e·s poing levé derrière la banderole de tête où figurent les portraits de nombreuses « victimes de violences policières et de crimes racistes » et le slogan « Dignité, Justice, Réparations ». Cela constitue un moment affectif fort que les personnes présentes évoquent avec émotion même plusieurs mois plus tard. L’association de la musique et des gestes effectués collectivement révèle à la fois le travail de préparation de la marche par les militantes (réalisation de la banderole, choix des chansons) et ce qui se joue sur le moment sur le plan émotionnel, avec la mise en jeu des corps et des affects des manifestant·e·s. Le fait d’effectuer les gestes, de chanter ensemble et dans la rue est ce qui relie l’expression des émotions entre le niveau du « soi », celui du groupe et celui des arènes publiques. Ces pratiques contribuent à la production du « Nous », mobilisé non seulement en approfondissant l’attachement de chacun·e au collectif, mais aussi en rendant celui-ci visible et identifiable dans l’espace public.
Conclusion
Les dimensions émotionnelles de l’engagement et de la pratique militante dans les collectifs antiracistes formés à partir de 2005 s’avèrent centrales dans les processus de production du « Nous » qui prétend incarner l’expression autonome des minoritaires racisé·e·s. D’abord, car l’entrée dans le militantisme antiraciste se fait en partie sous l’effet de la rencontre entre, d’une part, des dispositions critiques et une colère face au racisme, toutes les deux ancrées dans des trajectoires personnelles et familiales, et, d’autre part, un cadre collectif qui permet leur mise en forme grâce à des modes d’action tournés vers la production et la diffusion d’outils de compréhension critique de la domination. Ensuite, car l’attention aux pratiques concrètes des militant·e·s révèle tout un travail militant qui contribue à la communalisation, c’est-à-dire à la production d’un sentiment d’appartenance, et à celle d’une identification « pour soi » qui dépasse et transforme les assignations racistes. Le travail militant émotionnel et relationnel peut ainsi être conçu dans la continuité d’autres formes de travail, « comme production de soi, comme enjeu de lutte potentiellement unificateur, comme levier possible de solidarité et d’émancipation collective » (Galerand et Kergoat, 2014). L’attention aux dimensions émotionnelles élargit ainsi des perspectives de recherche sur les trajectoires biographiques et les processus d’engagement. C’est également le cas concernant les dynamiques de l’action collective et leur articulation avec les rapports majoritaire/minoritaires, au sens où la prise en compte des émotions s’avère fondamentale pour la compréhension des processus de « passage au collectif » (Kergoat, 2012).
Appendices
Notes
-
[1]
Alimentée par la sociologie féministe francophone et par les travaux des Black feminists anglophones, cette approche selon les « rapports minoritaire/majoritaires » (Guillaumin, 1985) considère que les groupes sociaux sont les produits de relations de pouvoir. Elle est donc profondément relationnelle et constructiviste, étant donné qu’aucun des groupes n’est « déjà là » : « selon telle configuration ici et maintenant des rapports sociaux, le genre (ou la classe, la race) sera — ou ne sera pas — unificateur. Mais il n’est pas en soi source d’antagonisme ou source de solidarité » (Kergoat, 2012 : 134).
-
[2]
Loi n°2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics : <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000417977?r=ZC6uDs0BrX>.
-
[3]
Loi n°2005-158 du 23. février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés : <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000444898/2020-10-14/>.
-
[4]
Bien que j’aie observé de nombreux événements publics organisés par un seul des collectifs étudiés, dans un souci d’analyse transversale je privilégie ici ceux coorganisés par au moins deux de ces collectifs, notamment en tant que membres d’un collectif ad hoc (Marche de la Dignité, dont le collectif d’organisation comptait des membres du PIR et de la BAN ; Procès de l’antiracisme politique qui regroupait entre autres des membres du PIR, de la BAN, de RI, des Journées).
Bibliographie
- Ahmed, Sara. 2014. The Cultural Politics of Emotion. Édimbourg, Edinburgh University Press.
- Delphy, Christine. 2008. Classer, dominer. Qui sont les « autres » ? Paris, La Fabrique.
- Demailly, Lise. 2008. Politiques de la relation : approche sociologique des métiers et activités professionnelles relationnelles. Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion.
- De Rudder, Véronique, Christian Poiret et François Vourc’h. 2000. L’inégalité raciste. L’universalité républicaine à l’épreuve. Paris, Presses universitaires de France.
- Dhume, Fabrice. 2013. « L’émergence d’une figure obsessionnelle : comment le "communautarisme" a envahi les discours médiatico-politiques français », Asylons, 8. http://www.reseau-terra.eu/article945.html. Page consultée le 7 mai 2021.
- Dunezat, Xavier et Elsa Galerand. 2014. « La résistance au prisme de la sociologie des rapports sociaux : les enjeux du passage au collectif », dans José-Angel Calderón et Valérie Cohen (dir.). Qu’est-ce que résister ? Usages et enjeux d’une catégorie d’analyse sociologique. Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion.
- Eberhard, Mireille. 2011. « De l’expérience du racisme à sa reconnaissance comme discrimination. Stratégies discursives et conflits d’interprétation », Sociologie, 1, 4 : 479-495.
- Essed, Philomena. 1991. Understanding Everyday Racism, Londres, Sage Publications.
- Galerand, Elsa et Danièle Kergoat. 2014. « Les apports de la sociologie du genre à la critique du travail », Nouvelle Revue du Travail, 4. https://doi.org/10.4000/nrt.1533. Page consultée le 7 mai 2021.
- Guillaumin, Colette. 1985. « Sur la notion de minorité », L’homme et la société, 77 : 101-109.
- Guillaumin, Colette. 1981. « Femmes et théories de la société : remarques sur les effets théoriques de la colère des opprimées », Sociologie et sociétés, 13, 2 : 19-32.
- Haapajärvi, Linda, Samina Mesgarzadeh et Thomas Watkin. 2018. « Introduction. Faire et défaire les solidarités communautaires », Sociétés contemporaines, 1, 109 : 5-10.
- Hochschild, Arlie. 2003. « Travail émotionnel, règles de sentiments et structure sociale », Travailler, 9, 1 : 19-49.
- Jasper, James. 2011. « Emotions and Social Movements: Twenty Years of Theory and Research », Annual Review of Sociology, 37: 285-303.
- Johsua, Florence. 2013. « "Nous vengerons nos pères..." : de l’usage de la colère dans les organisations politiques d’extrême gauche dans les années 1968 », Politix, 4, 104 : 203-233.
- Juteau, Danielle. 1999. L’ethnicité et ses frontières. Montréal, Presses de l’Université de Montréal.
- Kergoat, Danièle. 2012. Se battre, disent-elles. Paris, La Dispute.
- Laplanche-Servigne, Soline. 2011. De l’expérience du racisme à sa politisation. Mobilisations et représentations des « victimes » en France et en Allemagne aujourd’hui. Thèse de doctorat en science politique, Technische Universität Darmstadt.
- Le Lay, Stéphane et Barbara Pentimalli. 2013. « Enjeux sociologiques d’une analyse de l’humour au travail : le cas des agents d’accueil et des éboueurs », Travailler, 29, 1 : 141-181.
- Lorde, Audre. 1977. « Transformer le silence en paroles et en actes », dans Elsa Dorlin (dir.). 2008. Black feminism : anthologie du féminisme africain-américain, 1975-2000. Paris, L’Harmattan.
- Picot, Pauline. 2019. « L’heure de nous-mêmes a sonné ». Mobilisations antiracistes et rapports sociaux en Île-de-France (2005-2018). Thèse de doctorat en sociologie, Université Paris-Diderot.
- Picot, Pauline. 2016. « Quelques usages militants du concept de racisme institutionnel. Le discours antiraciste postcolonial (France, 2005-2015) », Migrations Société, 163, 1 : 47-60.
- Poutignat, Philippe et Jocelyne Streiff-Fénart. 2008. Théories de l’ethnicité. 2e édition. Paris, Presses universitaires de France.
- Ransan-Cooper, Hedda, Selen A. Ercan et Sonya Duus. 2018. « When Anger Meets Joy: How Emotions Mobilise and Sustain the Anti-Coal Seam Gas Movement in Regional Australia », Social Movement Studies, 17, 6 : 635-657.
- Salaris, Coline. 2018. « Vers une ethnographie comparée des émotions : des victimes du Distilbène aux victimes des pesticides », Revue internationale de politique comparée, 25, 3 : 71-97.
- Sayad, Abdelmalek. 2006. L’immigration ou les paradoxes de l’altérité. Paris, Raisons d’agir.
- Sommier, Isabelle. 2010. « Les états affectifs ou la dimension affectuelle des mouvements sociaux », dans Olivier Fillieule, Éric Agrikoliansky et Isabelle Sommier (dir.). Penser les mouvements sociaux. Paris, La Découverte : 185-202.
- Soutrenon, Emmanuel. 1998. « Le corps manifestant. La manifestation entre expression et représentation », Sociétés contemporaines, 31, 1 : 37-58.
- Traïni, Christophe. 2011. « Les émotions de la cause animale. Histoires affectives et travail militant », Politix, 1, 93 : 69-92.
- Zambiras, Ariane. 2011. « Les sens de l’humour. Enquête sur les rapports ordinaires au politique », Politix, 4, 96 : 139-160.

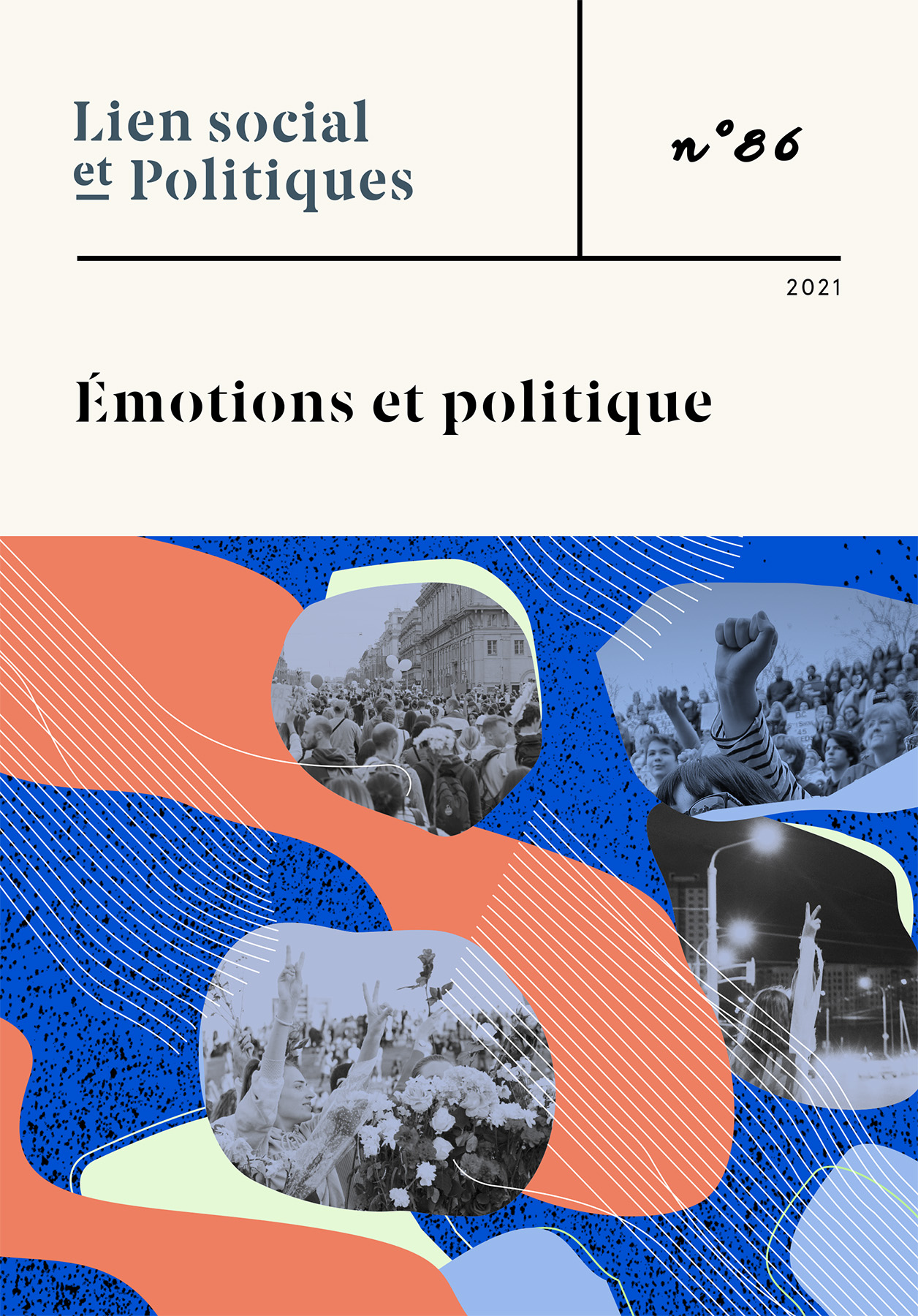
 10.7202/001321ar
10.7202/001321ar