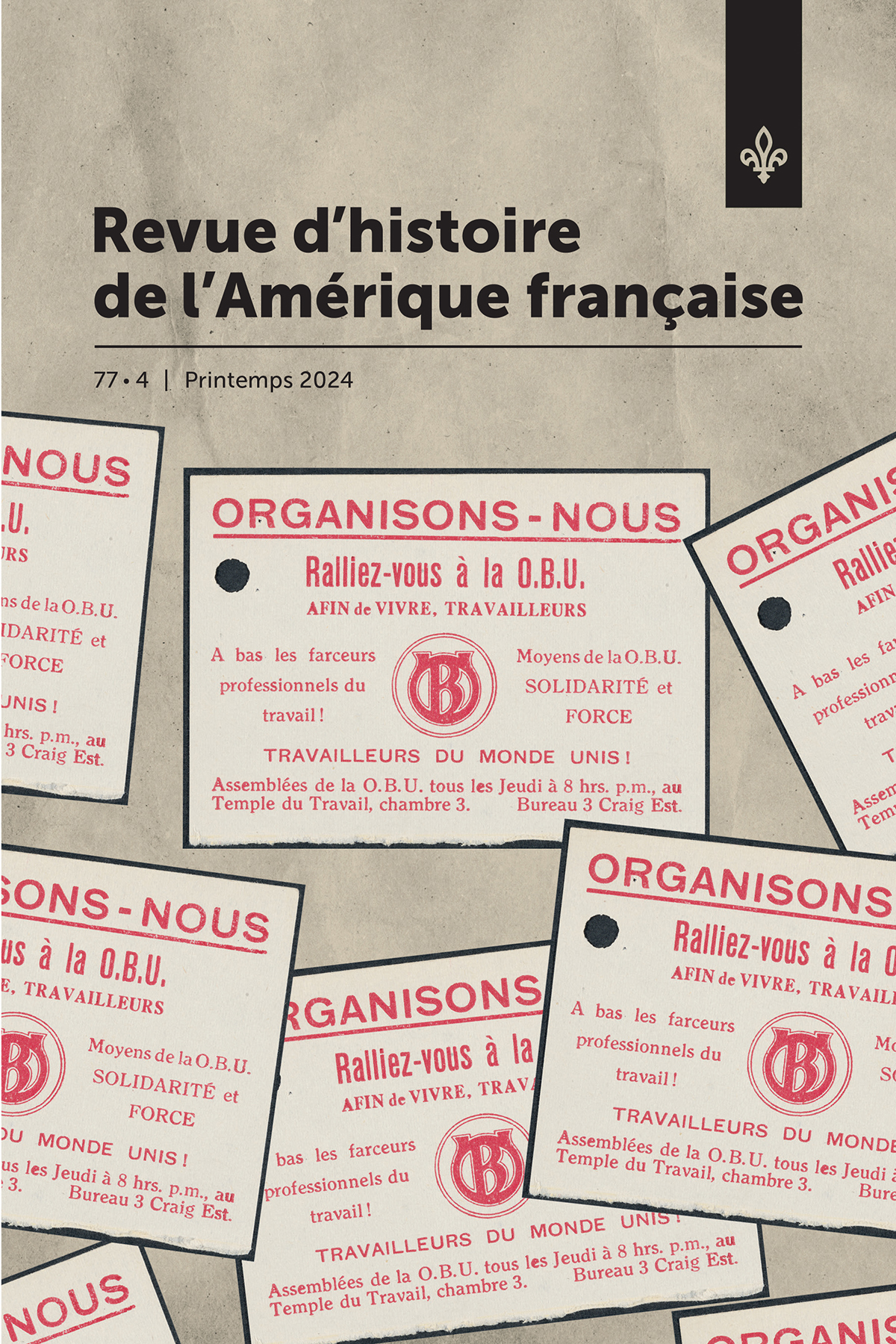Les deux premières parties questionnent les termes de l’équation identitaire posée et rappelée par Yvan Lamonde : « Q = -(F) + (GB) + (USA)2 - R ». Yves Couture souligne les évolutions affectant le rapport à la France. Influencé sur le plan politique par les modèles anglais et américain, le Québec serait longtemps demeuré une « colonie culturelle française ». L’élan modernisateur, décolonial, des années 1960 et les difficultés de la France à se projeter dans la modernité avancée affectent sa condition d’autrui, au-delà des courants républicain et conservateur québécois. Sa conclusion établit un jeu de vases communicants entre les influences concurrentes, ouvrant habilement la voie. Yvan Lamonde dresse un constat paradoxal. Il note la négligence caricaturale dont ferait l’objet une pensée américaine décrite comme proche. Paradoxal, car l’auteur démontre moins l’influence que le refus dont elle ferait l’objet, appelant à y prêter plus d’intérêt, dans une conclusion aux accents performatifs. Marc Chevrier fait montre d’une érudition remarquable en se penchant avec minutie sur la reprise, depuis la Conquête, d’un thème attaché au caractère franco-anglais, synthétisé par une origine normande réinventée. Ce thème se décline depuis la revendication d’une identité politique anglaise chez Papineau, puis se retrouve chez Henri Bourassa — et plus tard Adrien Arcand ou Pierre Elliott Trudeau. Ce thème est à la fois permis et renforcé par la forme politique de l’Empire employée par la métropole britannique. Sylvie Lacombe écrit sur le Canada anglais et le biculturalisme, Serge Miville sur le regard québécois sur le devenir des francophonies minoritaires, tandis que François Charbonneau adopte une perspective inverse sur les rapports entre ces deux pôles de la francophonie désormais conçus de manière distincte. Ils se penchent sur le rapport complexe à la francophonie canadienne et à la mémoire canadienne-française, présentés comme des autrui. Il est surprenant que l’Acadie n’occupe pas plus de place ici, bien que tous les sujets ne puissent être traités, les directeurs de l’ouvrage proposant avant tout un premier regard sur un thème qui justifierait bien des études. Le rapport à la mémoire est approfondi dans un débat désormais fameux entre Jocelyn Létourneau et Jacques Beauchemin. Le lecteur n’y trouvera pas une refonte de leurs positions. On peut souligner l’intérêt de l’approche du premier, sur la fin du rapport problématique à l’autre. Prometteuse sur papier, l’interdépendance que décrit Létourneau doit être interrogée dans sa légèreté (au sens de Kundera). La conclusion du processus de « décolonisation de l’identitaire collectif » peut aussi se lire au jour d’une colonialité assumée, soulevée par Beauchemin à travers les origines de la « mauvaise conscience » québécoise. La partie intitulée « L’autrui fragile » porte sur les autrui irlandais et sud-africain, dont la référence s’éteint après l’indépendance de la première, avec la Seconde Guerre mondiale puis la Révolution tranquille. Jean-François Laniel sur penche sur les paradigmes comparatifs employés pour analyser le Québec. Le texte recense trois grands qualificatifs. La petite nation, employée par lui, Joseph Yvon Thériault, Linda Cardinal ou Jacques L. Boucher, tend à souligner la spécificité et la fragilité du Québec, à valoriser des comparaisons avec d’autres petites sociétés, notamment en Europe centrale. La société neuve, employée presque exclusivement par Gérard Bouchard, souligne la rupture avec la référence européenne ; la mémoire canadienne-française s’inscrirait dans une logique moderniste et américaniste dont l’autrui « contestataire » repose sur un esprit de refondation. Le néonationalisme, réunissant des auteurs aussi divers que Stéphane Paquin, Xavier Hubert Rioux ou Félix Mathieu et Alain-G. Gagnon, et plus largement « l’autodésignée école québécoise de la diversité », concevrait la trajectoire post-Révolution tranquille dans un horizon « mondialiste …
Thériault, Joseph Yvon et Jean-François Laniel (dir.). Le Québec et ses autrui significatifs (Montréal, Québec Amérique, 2021), 448 p.
…more information
Jérémy Elmerich
Université du Québec à Montréal
Access to this article is restricted to subscribers. Only the first 600 words of this article will be displayed.
Access options:
Institutional access. If you are a member of one of Érudit's 1,200 library subscribers or partners (university and college libraries, public libraries, research centers, etc.), you can log in through your library's digital resource portal. If your institution is not a subscriber, you can let them know that you are interested in Érudit and this journal by clicking on the "Access options" button.
Individual access. Some journals offer individual digital subscriptions. Log in if you already have a subscription or click on the “Access options” button for details about individual subscriptions.
As part of Érudit's commitment to open access, only the most recent issues of this journal are restricted. All of its archives can be freely consulted on the platform.
Access options