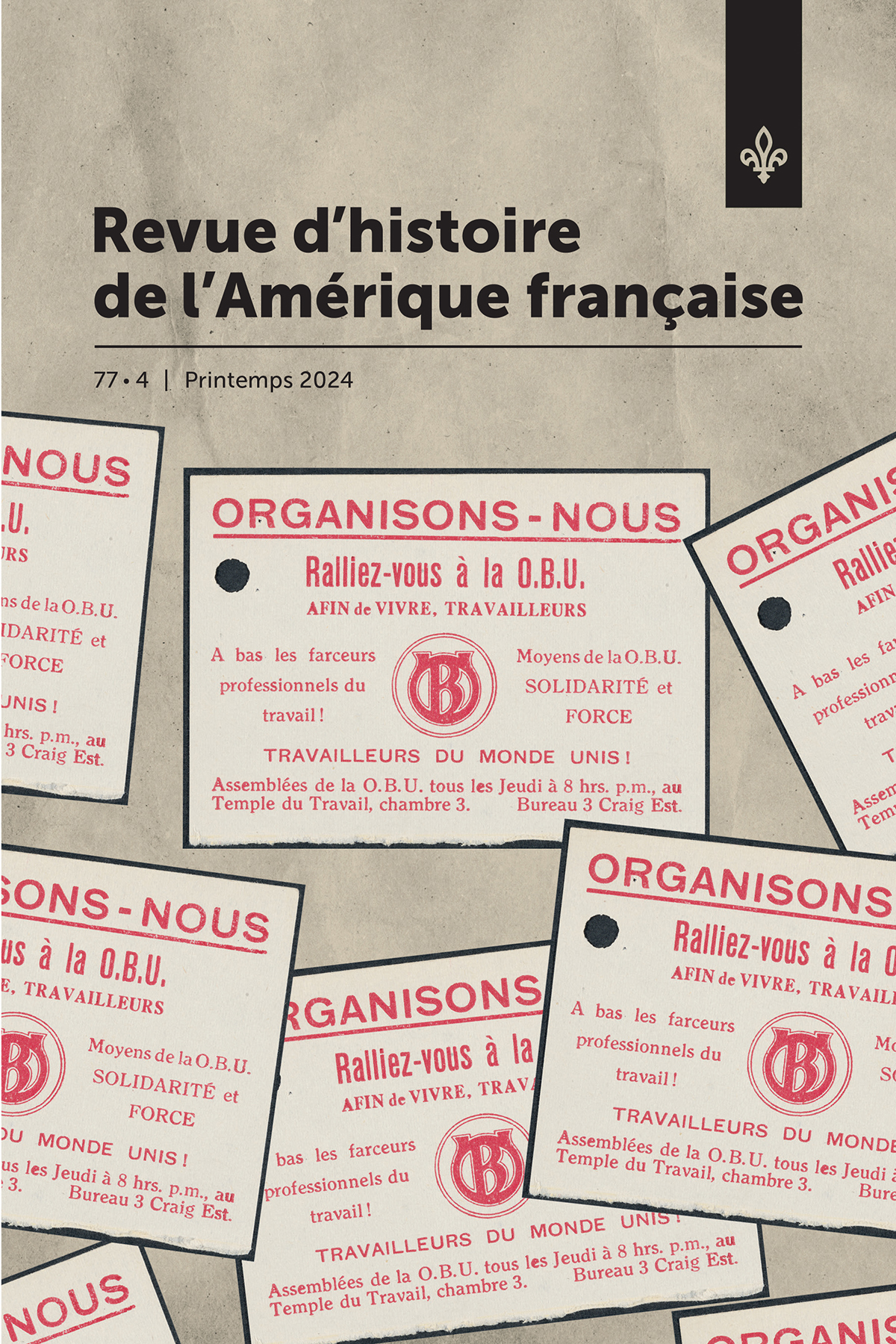Certains livres arrivent sur le marché de façon impromptue mais peuvent devenir indispensables. Ainsi en est-il de l’ouvrage de Sylvain Garel. L’auteur est un des meilleurs connaisseurs du cinéma québécois, dont il s’est fait pendant longtemps le propagandiste en créant et animant des festivals du film québécois en France. Ayant remarqué la forte présence du FLQ dans de nombreux films, il projetait d’étudier la question dans le cadre d’une thèse de doctorat. Parvenu au seuil de la retraite, il jugea que ce projet académique était devenu caduc, mais que l’imposante documentation recueillie valait tout de même une publication. Au lieu d’un ouvrage pointu pour spécialistes, voici un bouquin touffu et érudit, mais toujours pertinent et rigoureux. Après les préfaces et les définitions, le livre débute par une « Chronologie du FLQ » depuis la mort de Duplessis jusqu’au lancement du documentaire Les Rose, par le fils de Paul Rose en 2020. Garel fait ensuite la présentation et l’analyse de son corpus, 113 pages denses exposant les acteurs et leurs gestes, les cinéastes et leurs oeuvres, et implicitement la nation et ses réactions, aux événements comme aux films. Le FLQ est né dans la même mouvance que le véritable cinéma national québécois, qui fut un de ses meilleurs supports, matériel et intellectuel. La mise en contexte souligne l’estime que le FLQ a obtenue, souvent et longtemps, ce qui explique l’important corpus minutieusement décrit dans l’ouvrage. Cette organisation a été fondée dans un contexte international d’intenses luttes contre le colonialisme. Les fondateurs et les membres ont le même âge que les jeunes cinéastes, qui rêvent de leur côté à un cinéma de renouveau inscrit dans la réalité de leur nation. Les films concernant explicitement le FLQ sont inexistants avant octobre 1970, même si existe un courant que Garel nomme « film de guérilla » dont le prototype est Le révolutionnaire (Jean-Pierre Lefebvre, 1965), qui tourne ses héros en dérision. On trouve aussi là Chroniques labradoriennes d’André Forcier, Le chat dans le sac (Gilles Groulx) et quelques autres (p. 66). Le FLQ n’y est présent que de façon allusive ou métaphorique. Les « fictions d’octobre » apparaissent quelques années après et débutent en 1974 avec le film Bingo de Jean-Claude Lord qui évoque les événements de 1970, et Les Ordres de Michel Brault l’année suivante, souvent cité comme le meilleur sur le sujet. La majorité des oeuvres du corpus sont toutefois des documentaires, le premier étant celui de Robin Spry, Les événements d’octobre 1970 (en deux volets : Action et Réaction). L’auteur nous présente ensuite en quelques statistiques l’étendue et la répartition du corpus : 207 films achevés, dont 141 documentaires et 66 fictions, 114 longs métrages et 93 courts. La partie la plus imposante du livre est celle qu’on peut appeler « ouvrage de référence ». Elle s’étend sur 375 pages bien tassées et décrit le corpus en long et en large, film par film, au singulier et au pluriel, les uns avec les autres. Elle débute par une chronologie de toutes les oeuvres produites (pas toutes visionnées, non plus les films en anglais, pourquoi ?). Elle se poursuit par l’encyclopédique description des oeuvres, résumant leur propos et le rôle que le FLQ y joue — majeur actif ou mineur allusif (ceci plus souvent). Elle débute par À tout prendre (Claude Jutra, 1963) et Le chat dans le sac (Gilles Groulx, 1964) et se poursuit avec une longue liste de films antérieurs à octobre (Arcand, Forcier, Labrecque, Lamothe, Leduc, Lefebvre, Portugais), confirmant que la plupart des pionniers de cette époque ont évoqué l’organisation. Après 1970 le nombre croit …
Garel, Sylvain. Le FLQ dans la cinématographie québécoise. Le Front de libération du Québec en 250 oeuvres (Montréal, Somme toute, 2023), 608 p.
…more information
Germain Lacasse
Université de Montréal
Access to this article is restricted to subscribers. Only the first 600 words of this article will be displayed.
Access options:
Institutional access. If you are a member of one of Érudit's 1,200 library subscribers or partners (university and college libraries, public libraries, research centers, etc.), you can log in through your library's digital resource portal. If your institution is not a subscriber, you can let them know that you are interested in Érudit and this journal by clicking on the "Access options" button.
Individual access. Some journals offer individual digital subscriptions. Log in if you already have a subscription or click on the “Access options” button for details about individual subscriptions.
As part of Érudit's commitment to open access, only the most recent issues of this journal are restricted. All of its archives can be freely consulted on the platform.
Access options