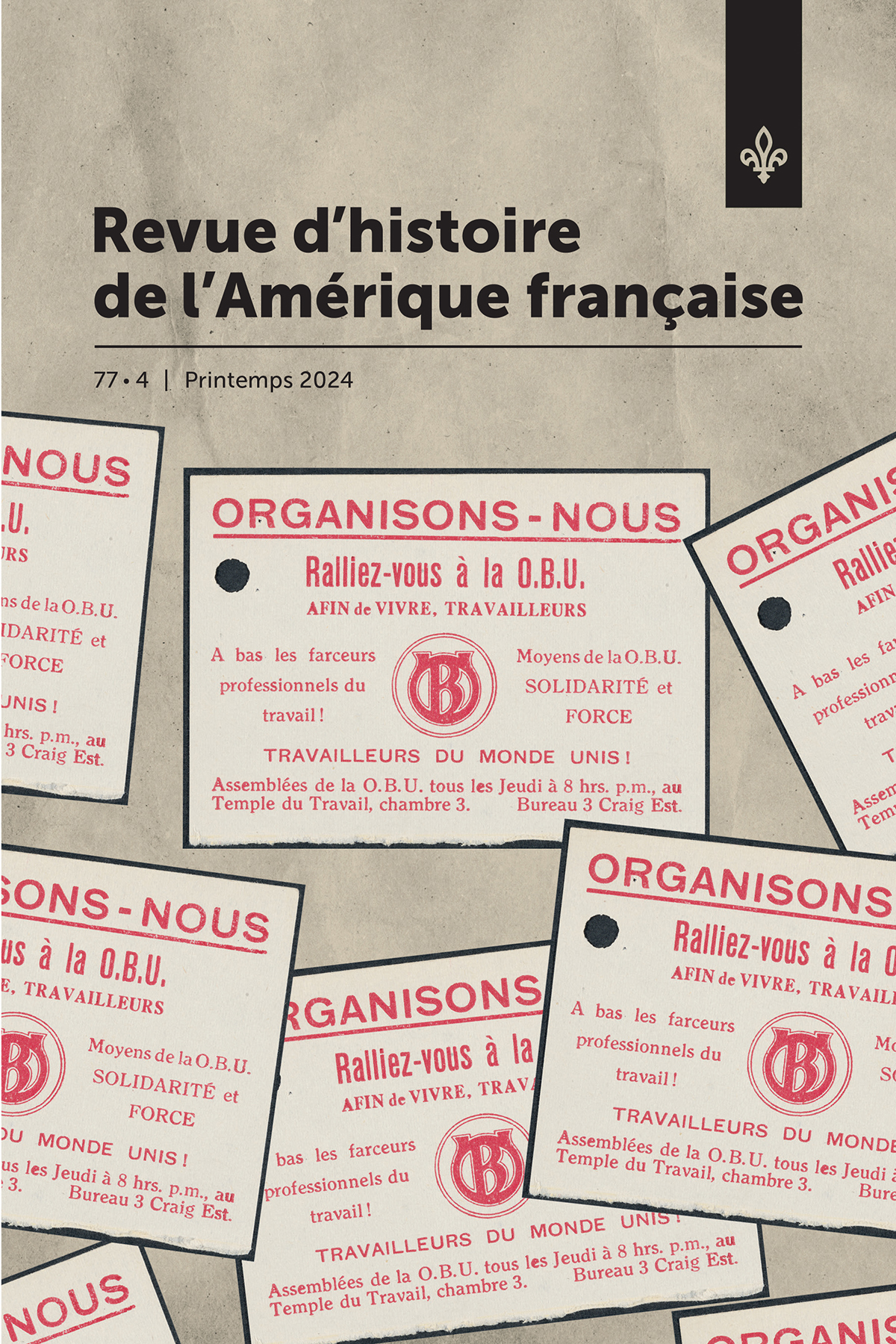Deux canards, face-à-face, devant un disque de feu : une magnifique métaphore illustrant la rencontre des Québécois et des Autochtones. L’équilibre et l’ambivalence qui caractérisent cette oeuvre d’art, conçue par l’artiste atikamekw Eruoma Awashish, déteint sur l’ouvrage qu’elle illustre en page couverture. Les canards, symétriquement positionnés par rapport au soleil, projettent chacun une image déformée dans l’eau, tout comme les sociétés présentées dans ce livre génèrent chacune sa propre historiographie. Le soleil est bas, mais nous ne savons pas si nous sommes au crépuscule ou bien au lever du jour. Sommes-nous devant la fin d’un récit colonial et le début d’une nouvelle histoire, « à parts égales » ? Au gré des neufs chapitres, cette idée se rapproche et s’éloigne du lecteur, prenant la forme tantôt d’une histoire commune, tantôt d’histoires croisées ou parallèles. Le livre dirigé par l’historien François-Olivier Dorais et la politologue Geneviève Nootens est bouleversant : non seulement il réussit à remettre en question le récit canadien-français, mais il installe un doute chez le lecteur, ébranlant la certitude de ses propres connaissances quant aux rapports complexes entre les Québécois et les Autochtones. Les auteurs et les autrices de l’ouvrage sont unanimes à affirmer qu’il faudrait revisiter l’histoire nationale du Québec, d’une part, en faisant ressortir la dualité coloniale, c’est-à-dire le fait d’avoir participé directement à la dépossession territoriale et au refoulement autochtone, tout en étant un peuple conquis, et d’autre part, en créant un récit « intégrateur », dans lequel les peuples autochtones seraient effectivement présents et actifs. Selon eux, ce projet se heurte à de nombreuses difficultés épistémologiques, politiques et culturelles. Il y a d’abord les choix identitaires liés au territoire, que l’historien Brian Gettler présente dans le premier chapitre. Ainsi, l’identité québécoise étant basée sur le territoire de la province, le Québec revendique des pouvoirs sur des terres autochtones. Ce même territoire légitime l’idéal d’un État souverain, ce qui expliquerait, en partie, le scepticisme de la société québécoise quant aux revendications autochtones. Le récit historique qui découle va de pair avec l’homogénéisation des Autochtones et de leur parcours, la mise en place d’une approche où les Autochtones ne font qu’interagir épisodiquement avec les Canadiens français, autour des moments forts qui les concernent peu, comme les Rébellions. Face à ce récit, Gettler convoque les paroles d’Anna Mapachee : « C’est pas moi qui est née au Québec, c’est le Québec qui est né dans mon pays ! » (p. 23). Cette vision des premiers contacts concorde avec les propos de la poète ilnue Marie-Andrée Gill, selon laquelle « c’est nous autres qui avons trouvé les Européens sur nos berges, ils étaient tous malades et nous en avions pris soin » (p. 70), et du fondateur de l’école autochtone de Kahnawake, Kenneth Deer. Les chapitres 2 et 3 détaillent, sous forme d’entretiens avec ces deux figures marquantes, les défis d’écrire l’histoire, tout en ouvrant une fenêtre vers le monde autochtone. Ainsi, en dialoguant avec l’historien Alexandre Dubé, Marie-Andrée Gill affirme que l’histoire autochtone se réfère à un temps circulaire, qui « fait coexister dans le présent à la fois le passé et le futur » (p. 52). Ce qui prévaut c’est le message, qu’on peut décoder en identifiant les mythes et la conception du monde sous-jacents. En racontant davantage son histoire familiale, Marie-Andrée Gill fournit une possible clé de lecture quant aux tensions qui existent entre les Autochtones et les Québécois : « Mon grand-père était clairement fédéraliste … ils étaient plusieurs à s’opposer [au projet d’indépendance du Québec] avec véhémence » (p. 53-54). Nous retrouvons la place importante du fédéral dans les propos de Kenneth Deer, …
Dorais, François-Olivier et Geneviève Nootens (dir.). Québécois et Autochtones. Histoire commune, histoires croisées, histoires parallèles ? (Montréal, Boréal, 2023), 280 p.[Record]
…more information
Catinca Adriana Stan
Université Laval