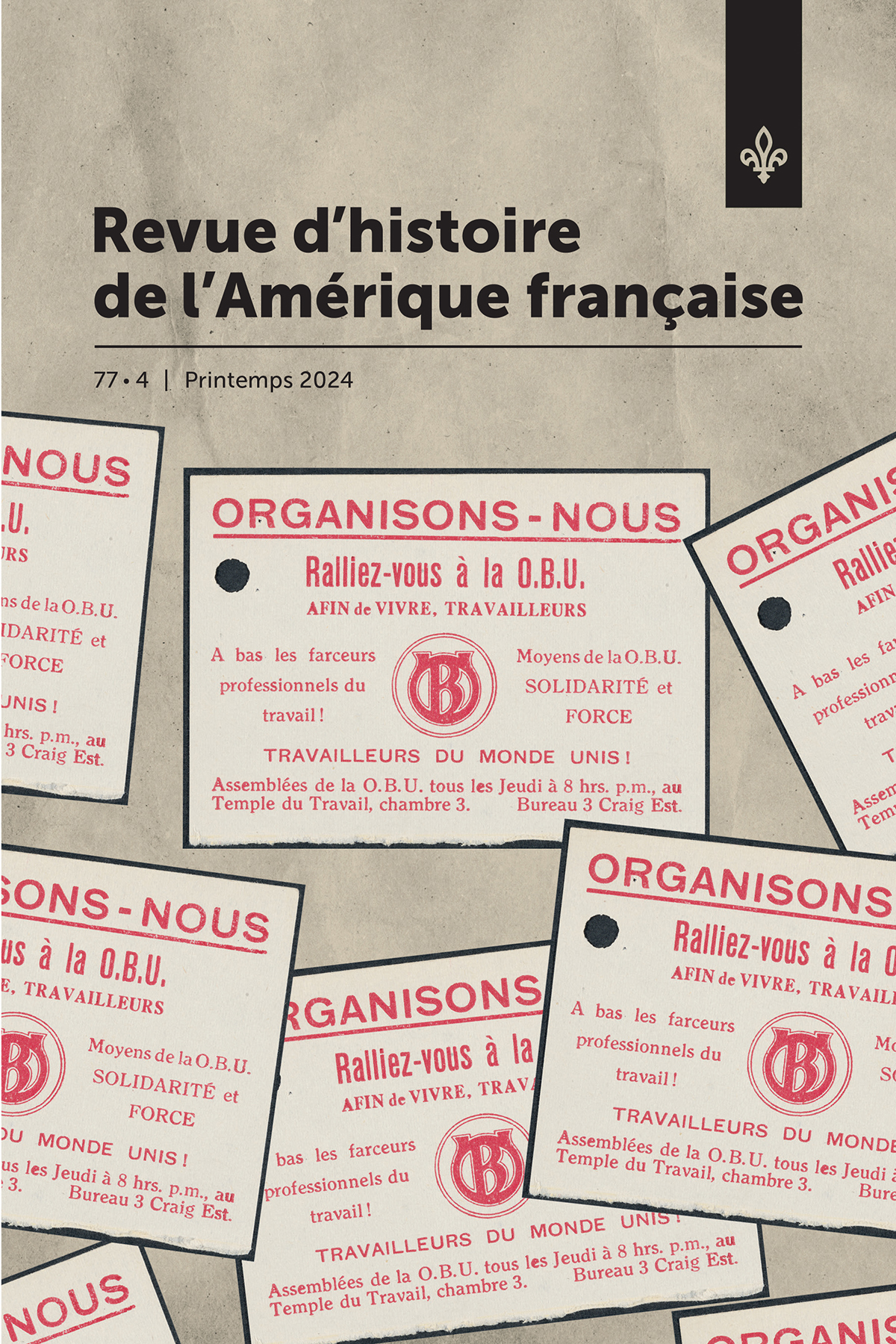Le « temps suspendu » du titre fait référence à la relation conjugale mise sur pause par l’absence prolongée, parfois définitive, de l’un des deux époux, généralement le conjoint. Comme l’a déjà montré l’historiographie, c’est dans l’absence de l’homme que les femmes deviennent davantage visibles. Disponible en libre accès en version numérique (https://una-editions.fr/le-temps-suspendu/), ce collectif vise à mettre en lumière l’expérience de vie des femmes mariées confrontées à l’absence de leur époux, et ce, sur le temps long, soit de l’Antiquité jusqu’à l’époque contemporaine, et dans une diversité d’espaces (terre, mer et outre-mer) tant européens que nord-américains. Deux événements sont à l’origine de cet ouvrage : d’abord, une journée d’étude s’étant déroulée au printemps 2013 à l’Université de Sherbrooke et ayant mené à une première publication (Femmes face à l’absence, Bretagne et Québec [XVIIe-XVIIIe siècles], CIEQ, 2015) ; puis, un colloque international organisé en 2017 à la Corderie Royale de Rochefort, en France, regroupant 30 communications. De ce nombre, 24 ont donné lieu à une contribution dans le présent collectif. L’ouvrage collectif est divisé en trois parties, chacune énoncée sous une forme interrogative : « Subir l’absence ? » ; « Se débrouiller ? » ; « S’affirmer ? ». Contrairement à ce que pouvait laisser penser le vide laissé par l’historiographie jusqu’à la dernière décennie quant aux femmes mariées devant composer avec l’absence de leur époux, celles-ci « [ne sont pas] des êtres passifs qui ont subi l’histoire » (p. 169). Au contraire, la thématique de l’absence, chaque fois étudiée sous l’angle d’itinéraires individuels ou de cohortes limitées, met au jour la multiplicité des expériences féminines du phénomène, allant de la simple résignation jusqu’à une résilience pleine et entière. Choisies et répétées ou au contraire soudaines et imprévisibles, les absences masculines bouleversent sans contredit l’organisation familiale : elles signifient l’absence du chef et père de famille, celle de la source de revenus familiale et, dans certains cas, l’absence de la personne pour qui ces femmes esseulées éprouvent un sentiment amoureux. Une multitude de raisons concourent au départ du foyer avec, en tête de liste, les activités professionnelles — notamment dans le monde maritime, marchand, militaire ou forestier — ainsi que les contextes de guerre. Si, pour les plus lettrées de l’époque contemporaine, l’éloignement géographique peut être en partie compensé par des échanges épistolaires plus ou moins soutenus avec l’absent, la majorité de ces femmes doivent au contraire composer avec le silence assourdissant de l’absence. Nombre de contributions mettent en évidence l’impact de l’éloignement du conjoint sur l’économie conjugale, qui force certaines de ces épouses abandonnées à trouver de nouvelles sources de revenus, qu’elles soient licites (domesticité, par exemple) ou illicites (contrebande, dont le faux-saunage). On constate au fil des exemples que l’incapacité théorique juridique des femmes entrave leur capacité à compenser l’absence temporaire ou prolongée de l’époux, sans pour autant les en empêcher complètement. En effet, outre l’agentivité dont beaucoup de ces femmes esseulées font preuve, l’importance des réseaux de solidarité ne se dément pas et contribue à les épauler dans cet épisode de leur vie souvent difficile. Bien souvent, ces réseaux de solidarité prennent racine dans leurs familles ou se créent entre femmes partageant une expérience de vie similaire. Une multitude de sources ont été employées pour ces études, bien qu’on puisse remarquer une prédominance des archives étatiques et administratives, telles que les archives judiciaires, notariales et de l’état civil. À cela s’ajoutent des corpus d’échanges épistolaires entre les époux séparés, des journaux intimes, des témoignages oraux ainsi que des oeuvres littéraires mettant en scène des femmes esseulées, selon l’idéal romantique …
Charpentier, Emmanuelle et Benoît Grenier (dir.). Le temps suspendu. Une histoire des femmes mariées par-delà les silences et l’absence (Pessac, MSHA [Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine], 2022), 361 p.[Record]
…more information
Louise Lainesse
Université de Montréal