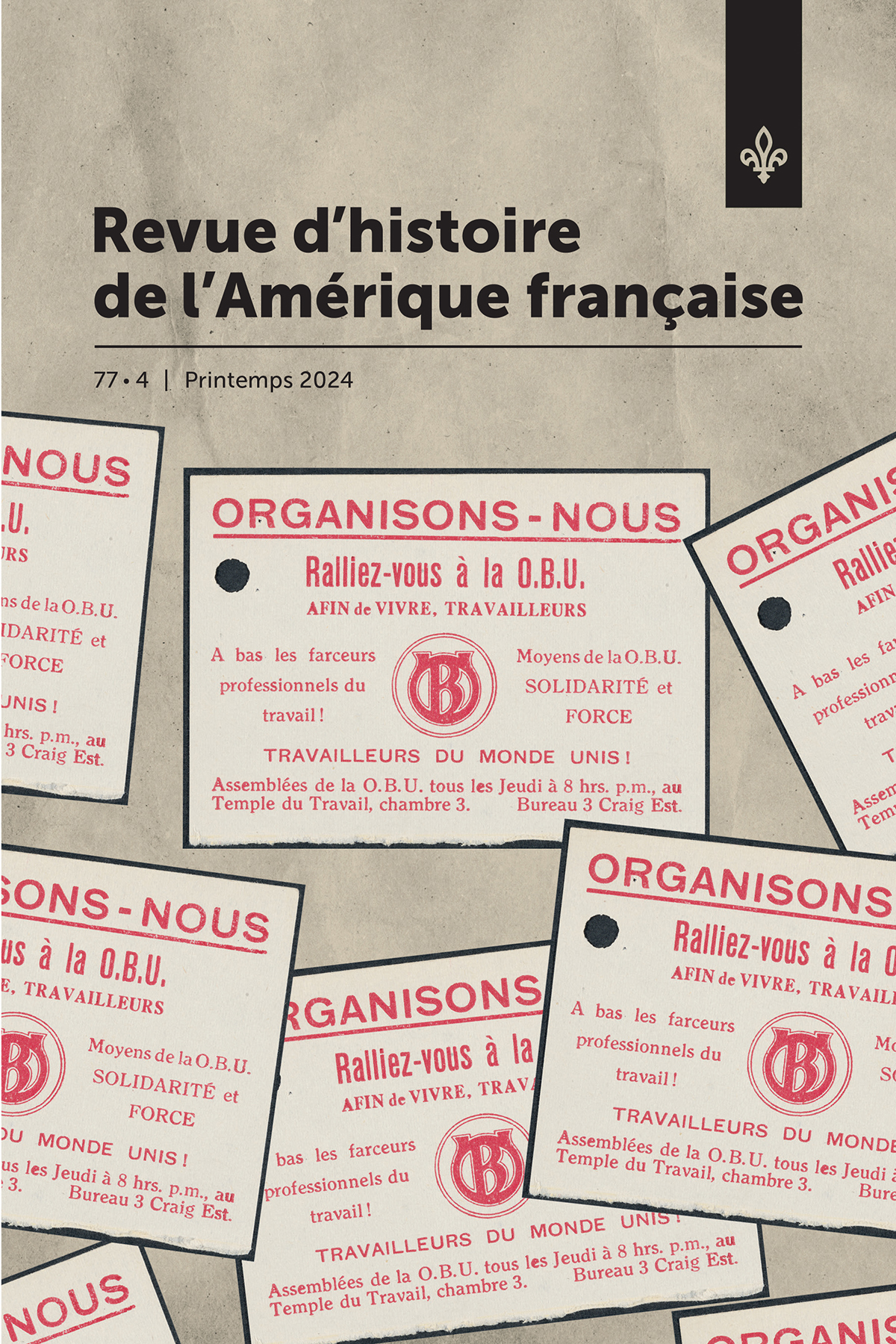En mars 2023, le Vatican rejetait officiellement la doctrine de la découverte (élaborée en 1493) et les bulles papales qui s’y rattachaient. Bien que cela constitue une réponse (tardive) à une demande (ancienne) formulée par des « Autochtones » à travers le monde, il est facile d’imaginer que certains auteurs de la pensée décoloniale, tels qu’Adam J. Barker, n’y ont vu qu’une décision symbolique, incapable de remettre véritablement en question les États coloniaux d’établissement (issus du settler colonialism). Pour cause et en adéquation avec ses écrits antérieurs (mais aussi avec les autres auteurs et autrices qui s’attellent à définir les contours spécifiques du colonialisme d’établissement, aussi appelé « colonialisme de peuplement »), Barker, qui propose dans cet ouvrage de montrer le passé mais surtout la persistance de la logique de l’élimination au sein des colonies d’établissement que sont le Canada et les États-Unis (p. 3), décrit un colonialisme qui a tous les aspects d’un système totalisant. En conséquence, l’objectif avoué de l’auteur est d’offrir une éthique du colonisateur (p. 23) dans ce système totalisant. Pour ce faire, Barker complète voire complexifie une définition du colonialisme d’établissement qu’il nous avait fournie dans un précédent ouvrage collectif (Settler : Identity and Colonialism in 21st Century Canada, 2015). Ainsi, nous retrouvons dans les trois premiers chapitres le processus par lequel les trois caractéristiques du colonialisme d’établissement (l’invasion est une structure, le colonisateur est là pour rester et le but de l’État colonial est de se transcender) vont prendre forme et s’établir au Canada et aux États-Unis. Plus spécifiquement, le chapitre premier expose les logiques coloniales et la manière dont les visions européennes du monde (p. 30) se sont imposées sur les territoires autochtones (p. 45-67). Dans le chapitre 2, Barker identifie cinq grandes étapes de ce qu’il appelle « le développement de la spatialité coloniale » (p. 115). Le chapitre 3 permet de conclure en détaillant les politiques mises en place qui permettent à l’État colonial de faire oublier à sa population les fondements et le présent de ses structures coloniales, rendant de fait ladite population complice de ce colonialisme (p. 119). Même si ces trois premiers chapitres sont intéressants pour un public qui n’a pas l’habitude de lire sur les tenants et aboutissants du colonialisme d’établissement, il faut avouer que l’intérêt de l’ouvrage pour l’avancée des études décoloniales se situe dans les trois derniers chapitres (4, 5 et 6). En effet, si l’auteur pourra s’enorgueillir d’une certaine originalité en appliquant à la définition connue des concepts issus de la discipline géographique, ce sont ses réflexions sur la position inextricable des allochtones (soit les non-autochtones), placés malgré eux (pour la très grande majorité) dans une position de colonisateurs par le système colonial et sa solution pour agir de manière éthique dans une telle situation, qui sont ses apports les plus pertinents à l’état actuel de la littérature. Tout d’abord, Barker offre dans son chapitre 4 une critique bienvenue du colonialisme inconscient au sein des principaux mouvements sociaux récents dans les deux pays nord-américains. Ainsi, et parce qu’il considère que la décolonisation implique d’éliminer la propriété et la souveraineté coloniale (p. 160), il démontre que ces mouvements, qui ne souhaitent ou ne peuvent éliminer cette souveraineté coloniale, perpétuent et renforcent ce système (p. 183-184). En d’autres termes, l’aspect totalisant du colonialisme d’établissement est démontré hors de tout doute raisonnable puisqu’il ressurgit au sein même de mouvements qui se présentent comme anticoloniaux. C’est sur la base de ce constat que Barker offre selon nous, dans ses chapitres 5 et 6, la meilleure réponse philosophique à la question posée à tout colonisateur …
Barker, Adam J. Making and Breaking Settler Space. Five Centuries of Colonization in North America (Vancouver, UBC Press, 2021), 312 p.
…more information
Simon Dabin
Université de Montréal / Université du Québec à Montréal
Access to this article is restricted to subscribers. Only the first 600 words of this article will be displayed.
Access options:
Institutional access. If you are a member of one of Érudit's 1,200 library subscribers or partners (university and college libraries, public libraries, research centers, etc.), you can log in through your library's digital resource portal. If your institution is not a subscriber, you can let them know that you are interested in Érudit and this journal by clicking on the "Access options" button.
Individual access. Some journals offer individual digital subscriptions. Log in if you already have a subscription or click on the “Access options” button for details about individual subscriptions.
As part of Érudit's commitment to open access, only the most recent issues of this journal are restricted. All of its archives can be freely consulted on the platform.
Access options