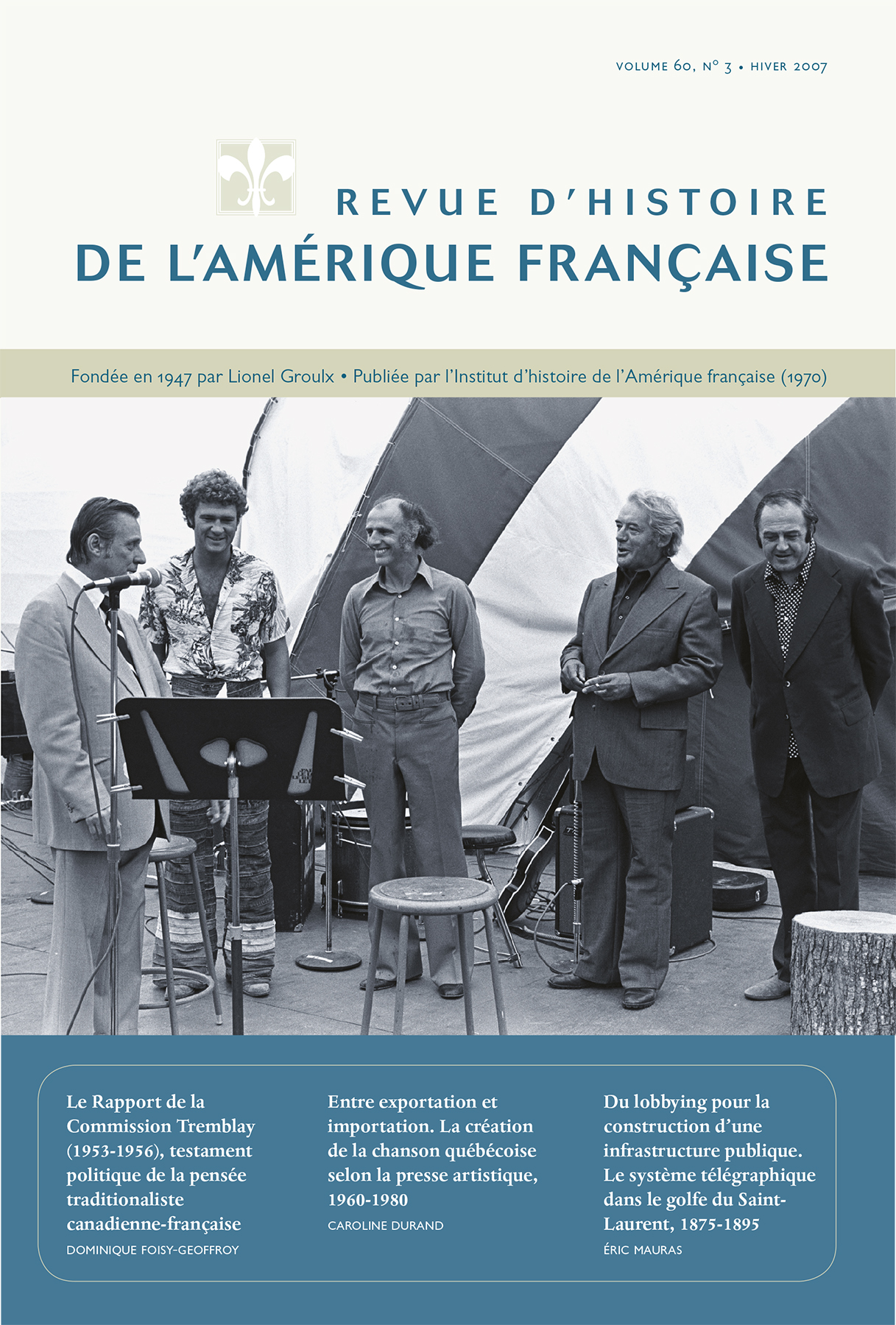En se servant un verre d’eau au robinet, puis en l’évacuant plus tard par la toilette, le Montréalais fait quotidiennement un geste en apparence anodin, mais qui n’est pourtant possible que grâce à l’enchevêtrement de deux réseaux de tuyaux serpentant le sous-sol urbain. Deux réseaux ayant contribué à la transformation de la vie urbaine au xixe siècle, mais dont l’histoire restait à écrire. S’inscrivant dans un courant historiographique en croissance sur l’eau, les infrastructures et les services publics urbains, les récents ouvrages de Dany Fougères et de Robert Gagnon viennent combler ce vide. Ensemble, ils présentent un récit complexe et détaillé de la manière dont l’approvisionnement en eau potable et l’évacuation des eaux usées se sont ancrés non seulement dans les pratiques, mais aussi dans les débats politiques et les conceptions sanitaires des habitants et des dirigeants d’une métropole industrielle en plein essor économique et démographique. Comme le sous-titre de l’ouvrage de Fougères l’indique, l’histoire de l’approvisionnement en eau se présente comme une étude de cas sur le rôle des pouvoirs publics et des intérêts privés dans le champ des services municipaux. À la lumière de documents administratifs, l’auteur examine le cheminement du service d’une sphère à l’autre, transfert qui passe d’abord par la municipalisation du régime de propriété, puis du régime de prestation. Ce faisant, il démontre que la séparation entre le privé et le public est bien plus due aux circonstances du moment et aux choix des acteurs qu’aux principes idéologiques. En effet, si l’entreprise privée fut la première à investir dans l’aventure, c’est bien parce qu’au tournant du xixe siècle, les juges de paix perçoivent l’initiative comme une « curiosité technique » et non comme un service essentiel. Cela leur convient donc très bien de laisser l’entreprise privée assumer les nombreux risques, et c’est dans ce contexte que la Compagnie des propriétaires des eaux de Montréal est créée en 1801. Le projet s’avère toutefois beaucoup plus ardu que prévu sur les plans technique et financier, et la compagnie changera deux fois de mains au cours des quatre décennies suivantes. En expliquant ces méandres, l’auteur plonge aussi dans les questions de coûts reliés au développement et à l’abonnement, les méthodes des entrepreneurs pour subvenir à la demande et les nombreux obstacles techniques auxquels ils font face. Fougères constate que dans la première moitié du siècle, l’utilisation quotidienne de l’eau, à la fois résidentielle et commerciale, demeure relativement peu enracinée dans les moeurs. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la municipalisation du service ne résulte donc pas de l’élargissement de l’utilisation de la ressource, ni même de la lutte aux incendies, dont les autorités se soucieront plutôt de l’organisation inefficace. D’ailleurs, ce n’est qu’au moment du débat sur la municipalisation de la prestation assurant une distribution plus complète de l’eau que la lutte aux incendies sera évoquée comme justification pour le passage au public. Selon l’auteur, c’est plutôt du côté de la salubrité urbaine qu’il faut chercher l’intérêt de la ville pour l’acquisition du réseau d’approvisionnement. À la suite, entre autres, des épidémies de choléra des années 1830, et dans le contexte de la croyance en la théorie miasmatique, selon laquelle le nettoyage des rues serait le gage d’une meilleure santé publique, les autorités municipales se montrent intéressées à se porter acquéreuses. La municipalisation se fera donc pour des raisons de salubrité publique et non de consommation individuelle. En raison de sa cherté, l’abonnement au service reste l’apanage d’une minorité, les moins nantis préférant puiser et transporter leur eau eux-mêmes ou avoir recours aux services des porteurs. Aux prises avec d’importantes contraintes techniques, à la fois …
FOUGÈRES, Dany, L’approvisionnement en eau à Montréal. Du privé au public, 1796-1865 (Sillery, Septentrion, coll. « Cahiers des Amériques », no 8, 2004), 472 p.GAGNON, Robert, Questions d’égouts. Santé publique, infrastructures et urbanisation à Montréal au xixe siècle (Montréal, Boréal, 2006), 263 p.[Record]
…more information
Nicolas Kenny
Université de Montréal
Université Libre de Bruxelles