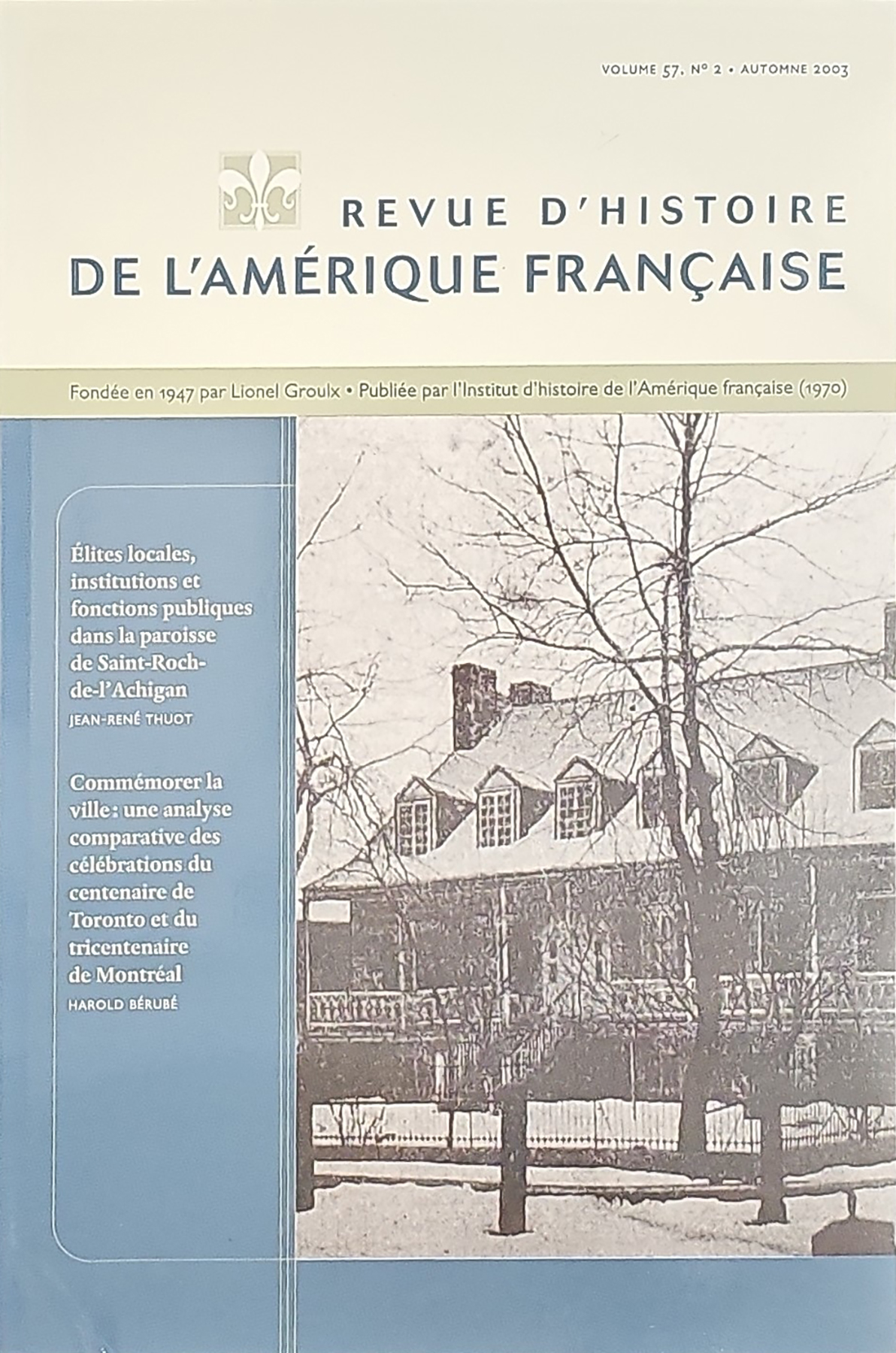Au centre-ouest de Montréal, près d’un marché de produits agricoles, à côté de vendeurs d’antiquités, un lieu de culte ultramoderne attire des milliers de personnes. Fabriqué en béton, plein d’espace éclairé au naturel et au néon, ce temple réunit des gens qui veulent à la fois se rencontrer et se disperser. Ils viennent de partout et ils s’en vont dans toutes les directions. Ils passent devant une sculpture en bois représentant la souche commune de l’humanité pour ensuite s’apercevoir eux-mêmes éclatés dans les reflets d’un mur modelé en acier inoxydable. Ici, ils obéissent aux directives en français et ils s’agenouillent devant le même mythe : que la conquête de l’espace et du temps est possible. C’est la station de métro Lionel-Groulx. L’argument du beau livre de Gérard Bouchard, Les deux chanoines, est là tout entier. Groulx aurait été enchanté et horrifié en même temps par ce temple moderne, ce qui n’étonnerait en rien Bouchard qui répondrait tout simplement, « mais bien sûr », car Groulx n’est rien si ce n’est contradiction. Pour poursuivre l’analogie et dévoiler le but de l’auteur, Bouchard serait à la fois l’architecte de cet endroit et le vérificateur des billets de ceux qui le fréquentent. Il s’intéresse à la structure de la pensée de Groulx et il veut s’assurer que, dorénavant, l’accès à cette pensée sera rendu possible grâce à un ticket obligatoire marqué « contradiction ». D’une main assurée, et ayant lu toute l’oeuvre imprimée de Groulx (ce qui, comme chez Groulx lui-même, n’évite ni les répétitions ni les contradictions), Bouchard démontre, et nous convainc, que la contradiction constitue l’essence même (« l’architecture ») de la pensée de Groulx. Impossible, donc, de tirer Groulx d’un côté ou de l’autre, à l’appui d’une idéologie quelconque. Impossible de l’accuser de ceci ou de cela, car on trouve chez lui tout et son contraire. Son oeuvre contient des graines de tout. D’autres, avant Bouchard, l’avaient déjà souligné ; la nouveauté ici c’est qu’il en fait le fond même de la pensée de Groulx et, plus audacieux encore, essaye de l’expliquer. Ce dont on peut accuser Groulx, d’après Bouchard, c’est de ne pas se rendre compte de ses contradictions, de ne jamais se repenser ni se repentir, et de n’avoir pas articulé un mythe rédempteur. Car, selon l’auteur, les contradictions inhérentes à toute pensée se rachètent au moyen de mythes : la raison, incapable de résoudre ou de tolérer les contradictions, démissionne et laisse la place à quelque chose d’irrationnel : le mythe. De tels mythes peuvent être « efficaces » ou pas, selon leur utilité à « énergiser » une société. Contrairement à d’autres sociétés, que de tels mythes ont « énergisées », cela n’aurait pas eu lieu dans la société canadienne-française du temps de Groulx, et il en serait partiellement responsable. Une certaine tristesse se dégage donc de ce livre : l’incapacité de Groulx à surmonter ses propres contradictions au moyen d’un mythe efficace aurait empêché le Québec de faire... quoi au juste ? Étant donné les constantes que Bouchard prête quand même à Groulx — la priorité à la nation, l’émancipation nationale, la responsabilité des élites et la grande destinée des Canadiens français en Amérique — on peut le deviner. Dans ses trois chapitres explicatifs à la fin du livre, Bouchard essaie d’analyser l’échec de la pensée de Groulx à formuler une vision et des directives cohérentes pour guider les Canadiens français vers un but ultime. Délicatement, il met de côté tous les fragments d’explication qui surgissent dans la tête d’un lecteur historien le long des onze chapitres de la démonstration — questions autour de la …
BOUCHARD, Gérard, Les deux chanoines. Contradiction et ambivalence dans la pensée de Lionel Groulx (Montréal, Boréal, 2003), 313 p.[Record]
…more information
Susan Mann
Université York