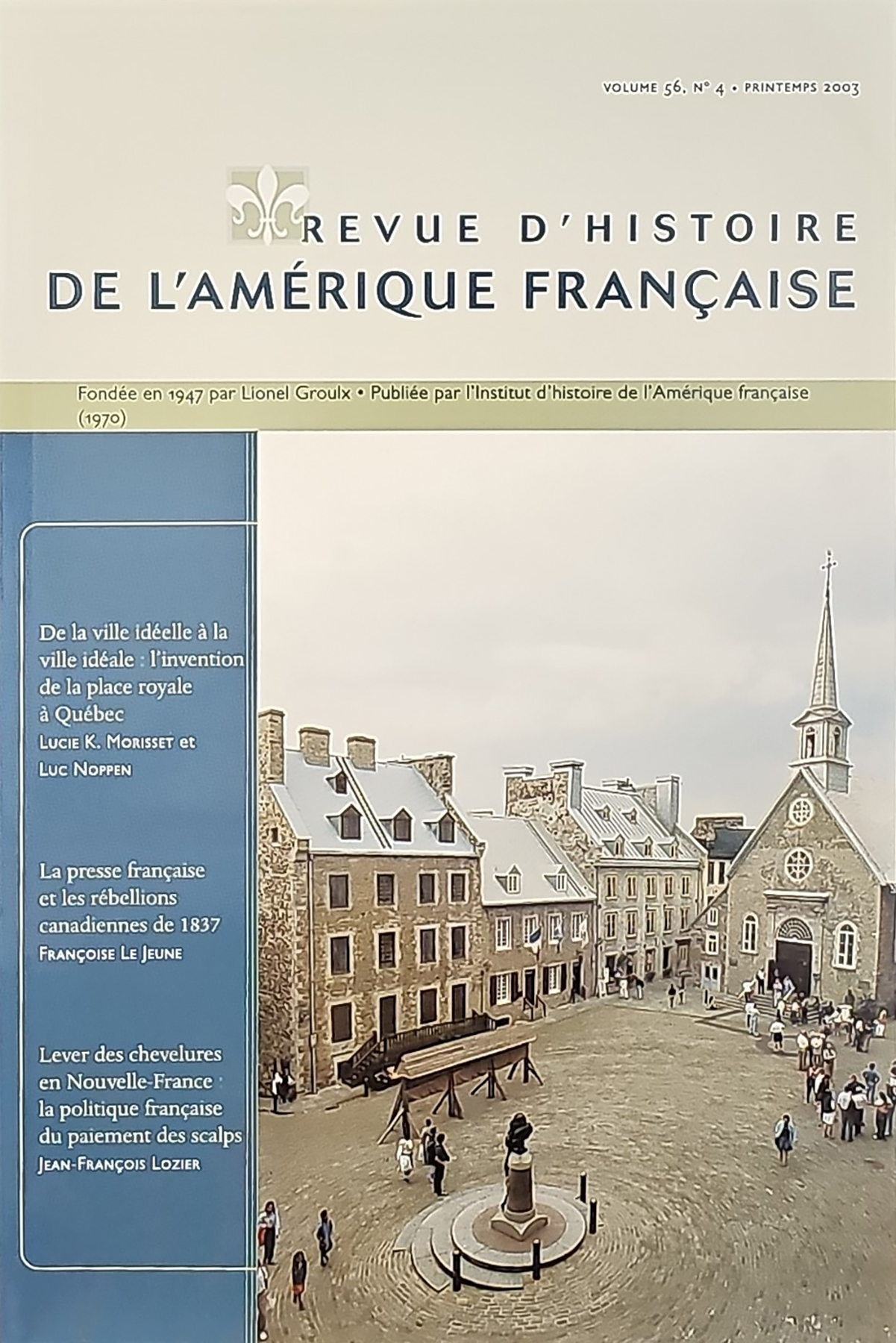Article body
Issu d’une thèse de doctorat soutenue en 1997 à l’Université Laval, ce livre ambitieux dû à un jeune auteur talentueux explore la question des rites d’une manière novatrice, en les considérant comme des instruments de pouvoir. Sacrifiant aux habitudes des historiens ou à la valeur sacrée des chiffres, il divise son propos en trois parties, composées chacune de trois chapitres. La première, théorique, définit l’ordre du discours sur les rites. Il n’est pas certain qu’elle est la plus intéressante, bien qu’elle témoigne d’une admirable connaissance de l’historiographie, religieuse et anthropologique, en particulier des discussions, parfois fort ésotériques, entre grands intellectuels pourfendeurs de réalités triviales au nom de concept raffinés. Le lecteur peut ainsi se délecter de « représentations » opposées à la « beauté du mort » contenue dans la notion de culture dite « populaire » (j’ose à peine employer le terme tant il paraît pour certains relever du tabou, voire du scatologique). Fallait-il tant de pages, force références à Foucault, Bourdieu ou Lévi-Strauss, parmi les cohortes de prestigieux passeurs cités, pour déduire que l’objet d’étude est le rite, constitué par Dieu comme lien institué par Lui et confié à Sa seule Église ? Et que l’activité rituelle constitue l’unique issue s’offrant à l’être humain pécheur pour éviter le bras divin vengeur ? L’idée selon laquelle tout appareil rituel est proposé comme efficace emporte pleinement l’adhésion. D’un point de vue plus anthropologique, n’aurait-il pas été utile de tenter d’expliquer pourquoi et au nom de quoi les rites chrétiens prétendaient (et prétendent toujours) incarner une vérité supérieure aux « superstitions » des autres cultures, notamment à celles des « idolâtres baptisés » peuplant les campagnes d’Occident ou du Canada aux xviie et xviiie siècles. Il aurait pour cela fallu préciser ce qu’est le sacré, sous toutes ses formes. Sans laisser le sentiment qu’un seul discours, issu du concile de Trente, réclamant une parfaite exclusivité, proposait l’unique chemin possible sur la terre comme au ciel.
L’auteur soutient avec raison que le rite se situe dans une dynamique de classement social. Marquant une hésitation au seuil de la désacralisation de son objet d’étude, il trouve le soulagement en affirmant que la culture et la religion populaire sont des faux problèmes. Voire ! C’est exact par référence à une approche chrétienne hégémonique et fermée, précisément inventée au coeur de l’ère moderne, sous la plume de l’abbé Thiers et des contempteurs des « superstitions ». Mais ceux-ci criaient-ils au loup pour se faire peur ? Ou bien avaient-ils, comme moi durant mon enfance, rencontré d’autres rites, d’autres relations au sacré ? Avant de prétendre le contraire, il faudrait pour le moins analyser la trame des sociétés concernées, ce qui n’est en rien l’objet de l’ouvrage : la partie sur le sacrilège, par exemple, ne traite du sujet que de façon théorique, en ignorant (c’est le droit de l’auteur), le « sacre » québécois et les ruptures réelles, involontaires ou non, du consensus rituel.
Les deux parties suivantes me paraissent d’excellente facture, solidement étayées, passionnantes, prometteuses, sans pour autant se risquer, à de rares exceptions près, dans les profondeurs du social. La documentation est essentiellement basée sur les visites pastorales et les livres religieux. Les limites de tels documents sont connues. L’auteur en tire le maximum, avec beaucoup de brio, à propos des prêtres, des rituels comme celui de Saint-Vallier en 1703, puis du « romain tout pur » en 1851, enfin d’un beau corpus d’ouvrages religieux. Après avoir présenté ces structures de contrôle rituel, il définit les pôles de ce dernier dans la troisième partie : le temps, l’espace et le corps. J’ai particulièrement apprécié ces chapitres, inventifs et originaux, ainsi à propos de la ségrégation des morts dans les cimetières, de la place de la pierre d’autel au centre du sacré, des exigences de modestie et de respect imposées aux ouailles... Une des pistes les plus passionnantes concerne la définition du catholicisme comme une religion du geste, alors que les protestants relèvent plus du livre. Une frustration provient cependant du fait qu’il s’agit toujours de normes, même si elles sont subtilement analysées. Les pratiques concrètes sont pourtant accessibles, à travers les riches et volumineux documents notariaux (en particulier les inventaires après décès) ou les pléthoriques archives judiciaires : il faudra bien un jour s’en emparer, pour compléter l’approche normative en s’immergeant réellement dans l’océan du social. Les réalités, en particulier les contestations des rites, méritent aussi une messe ! Qu’en était-il, par exemple, du refus d’absolution préconisé en 1703 pour « nudité de la tête » ? La femme « en cheveux » a-t-elle longtemps réellement représenté l’immodestie féminine ? Comment les rites s’accommodaient-ils des résistances, des transgressions ?
La conclusion a du souffle. Elle mérite d’être méditée. L’auteur y réaffirme que les rites sont des outils du pouvoir, plus précisément de sa légitimation aux yeux des fidèles. L’idéologie cléricale du rite, ainsi que ses procédures de transmission, posent également la question d’une « histoire immobile ». À la différence des chercheurs analysant le catholicisme québécois en portant l’attention sur la nouveauté des pratiques, O. Hubert insiste sur la continuité du processus de structuration, tout en décelant une sensible modification, lors du passage au rite ultramontain, dominant au xixe siècle. Deux étapes sur la même route, en quelque sorte ! Acteurs et spectateurs participent ensemble à la construction d’un sacré issu des leçons de la Réforme catholique et du concile de Trente. La deuxième phase, moins rigoriste que la première, traduit certes une réinsertion dans le siècle, mais pour « résolument échapper aux conceptions neuves du temps proposées par la modernité ». À tel point que l’auteur se demande si ce choix n’a pas contribué à inscrire la population à l’écart de cette même modernité. La remarque fera peut-être grincer des dents, d’autant qu’elle se prolonge vers les identités culturelles construites par la ritualité, et vers le consensus ritualisé, inspirateur de la réalité politique. On pourrait y adjoindre toutes les formes de la sociabilité, de la famille conjugale aux pratiques collectives, en passant par le voisinage, l’amitié ou même la définition de l’Autre incapable de se référer à des valeurs identiques (« maudits Français ! »).
Il fallait assurément un métis culturel, d’origine bretonne, ayant fait du Québec son terrain de recherche, pour bousculer des idoles établies. Je ne lui reprocherai pas de s’être arrêté en chemin, car il est particulièrement ardu de s’extraire de la gangue sociale et culturelle dans laquelle on vit. Moins concerné que lui, j’oserai cependant poser plus vigoureusement des questions dérangeantes. Le vase clos québécois a produit une expérience tridentine complète, à la différence de la France qui bascule dans la Révolution et les délices (ou les horreurs, c’est selon) de la modernité après 1789. La modernisation portée par les villes, l’industrie, les idées de bonheur sur terre, etc., n’aurait-elle pas été ralentie, du côté du Saint-Laurent, par le triomphe du rite catholique (certes paré de plus de douceur liguoriste par le rituel romain), qui continue à asséner le dogme selon lequel la vraie vie est ailleurs qu’en ce monde ? Les conditions spécifiques liées à la tutelle anglaise paraissent avoir fortement légitimé une idéologie peu ouverte au progrès, à l’hédonisme, à la réalisation de soi. Le grand mérite de ce livre est de montrer que les rites structurent le consensus social en produisant un modèle actif dans tous les domaines de l’existence, en particulier dans les formes du politique (j’ajouterai du familial…). Une telle recherche éperdue de fixité, tempérée par la prise en compte de nouveautés parmi les moins dangereuses pour la structure, n’a-t-elle pas joué un rôle fondamental dans l’ensemble du système social québécois ? Ce dernier n’aurait-il pas eu tendance à se figer dans l’attente du ciel tandis que les protestants anglo-saxons prenaient possession de la terre ? Aucune histoire n’est immobile. Certaines sont cependant plus lentes à profiter des mutations ou des progrès, à cause de puissantes pesanteurs culturelles. Grâce à O. Hubert, on sait désormais qu’il y a beaucoup plus de choses dans les rites catholiques que de simples phénomènes de répétition : un message d’éternité dessinant sur la terre les contours d’une société capable de s’adapter à la modernité, mais sans aimer le changement et en refusant la voie de l’exaltation du Moi. Du moins, avant de profondes et récentes évolutions…