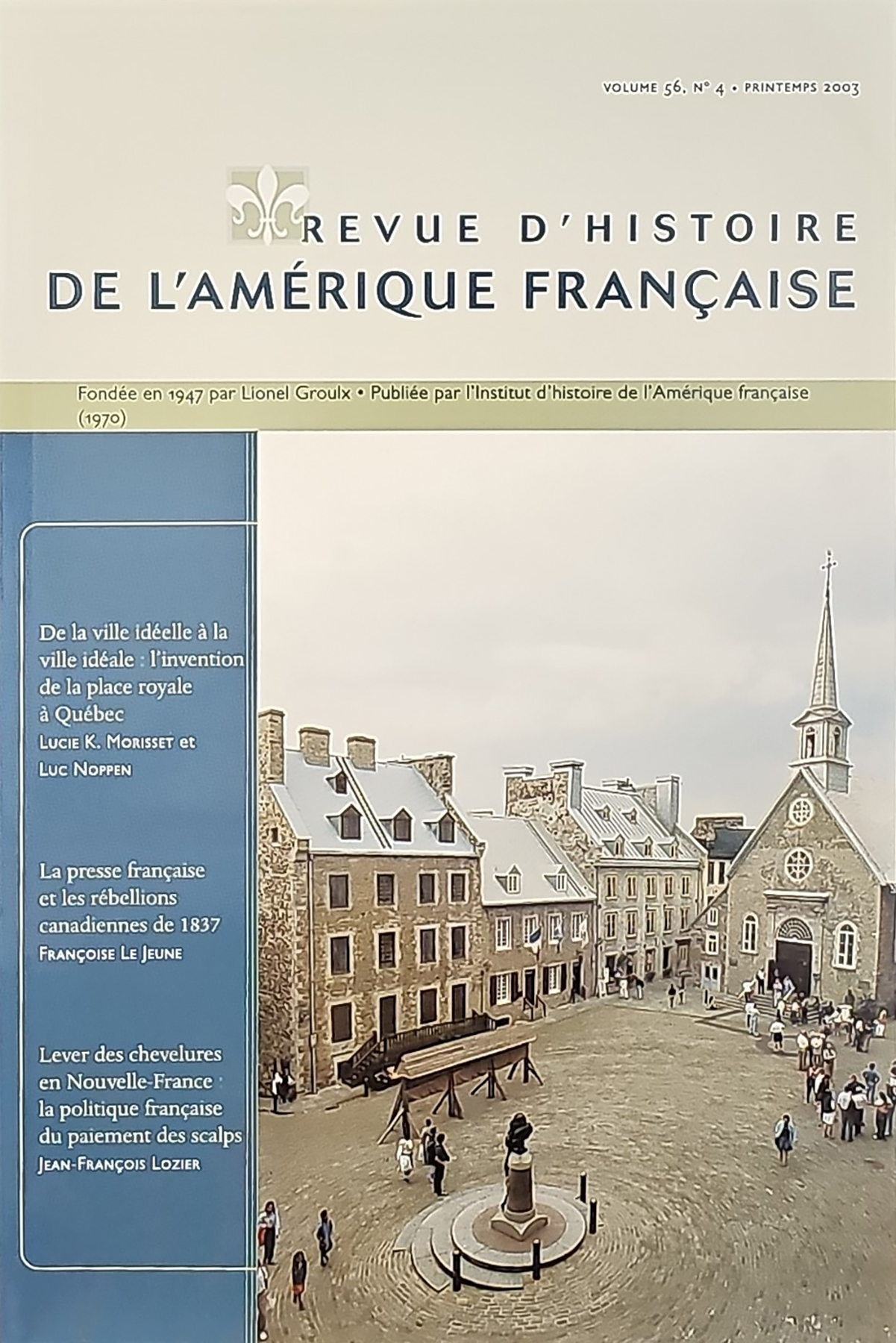Abstracts
Résumé
Entre 1692 et 1760, les autorités coloniales françaises offrirent de façon intermittente des récompenses en marchandises aux guerriers autochtones qui leur apportaient des chevelures ennemies. Plusieurs historiens ont attribué à tort à la politique française de paiement des scalps les mêmes modalités qu’avaient celles des colonies anglaises. Or notre examen du sujet révèle le caractère fort particulier et cohérent de la politique de la Nouvelle-France. Les primes furent perçues comme un des moyens les plus efficaces d’assurer la survie de la présence coloniale française en encourageant les alliés amérindiens à prendre le sentier de la guerre. Elles n’eurent pas pour autant comme effet de dénaturer les coutumes de ces derniers ou de subordonner leur intérêts.
Abstract
Between 1692 and 1760, French colonial authorities intermittently offered trading goods to native warriors as bounties for enemy scalps. While most historians have not differentiated French and English policies, a closer examination of the subject reveals that the former had a very specific and coherent policy. Scalp bounties were considered one of the most effective ways of defending New France by encouraging its native allies to take the war path. Contrary to what has been previously assumed, however, these bounties did not result in the corruption of native customs or in the subordination of native military interests.
Article body
Peu de coutumes amérindiennes ont été aussi vertement condamnées que celle du scalp, pratique qui, nous le savons, consistait à arracher le cuir chevelu d’une victime et à l’emporter en guise de trophée et pour s’assurer d’une victoire sur le plan spirituel. Mémorialistes et historiens, imprégnés d’une éthique militaire occidentale, y virent pendant longtemps une preuve du caractère cruel et barbare des Premières nations. Par la suite, on diffusa l’idée que cette pratique avait été enseignée à ces peuples par les Européens. Si ces croyances erronées survivent toujours dans l’esprit populaire, nul doute ne subsiste au sein de la communauté universitaire quant aux origines précolombiennes du scalp[2]. Au cours des trente dernières années, une poignée d’historiens et d’anthropologues ont sondé les significations de cette coutume dans le contexte culturel autochtone. Leurs précieuses contributions ont facilité la mise au rancart des stéréotypes d’une historiographie qui a trop longtemps dénoncé la pratique du scalp sans faire l’analyse de la rationalisation amérindienne[3].
La facette la plus controversée de cette question demeure sans conteste celle des primes : à divers moments pendant les xviie et xviiie siècles, les autorités coloniales offrirent des récompenses à ceux qui leur présentaient des chevelures ennemies. En fait, c’est pour des têtes entières que furent offertes les premières primes. Dès 1616, les autorités espagnoles se servirent de cette mesure pour mater une insurrection dans l’État de Durango, au Mexique. En 1637, la colonie anglaise du Connecticut offrit des récompenses à ses alliés mahicans pour des têtes de Pequots. En 1641, ce fut au tour des Hollandais de la Nouvelle-Amsterdam d’offrir de telles primes pour des têtes de Raritans. Enfin, au début de la guerre du « Roi Philip » (1675-1676), les autorités de la Nouvelle-Angleterre offrirent aux Narragansetts, ainsi qu’aux colons blancs, des récompenses pour les scalps de leurs ennemis. Avant la fin du xviie siècle, les Français avaient eux aussi adopté cette pratique[4]. Non sans raison, on entend souvent parler des politiques « européennes » à l’égard des scalps, sans qu’aucune distinction nationale ne soit faite. Bien que cette manière de faire puisse être appropriée dans certains contextes, un examen du sujet permet de constater l’existence de différences assez importantes entre les politiques des diverses colonies et souligne les faiblesses d’une telle généralisation.
Si l’importance des scalps et des primes dans les colonies britanniques d’Amérique du Nord a fait l’objet d’une étude rigoureuse[5], il n’en va pas de même pour les colonies françaises. C’est à ce manque que nous tenterons de remédier ici. Compte tenu de l’ampleur du sujet, cette étude se limitera aux questions entourant la politique des primes. Nous n’analyserons pas, par exemple, le cas des quelques Français et Canadiens qui survécurent après avoir été scalpés et laissés pour morts. De même, nous ne chercherons pas à relater toutes les circonstances où les nouveaux venus rencontrèrent la pratique du scalp. Notons cependant que la première description de cette coutume dans la littérature française remonte à Jacques Cartier. À sa suite, nombreux furent les chroniqueurs, mémorialistes et penseurs des xvie au xviiie siècles qui firent allusion à ce sujet dans leurs écrits sur l’Amérique septentrionale. Le vocabulaire utilisé par ces hommes pour décrire le cuir chevelu arraché demeura pendant longtemps irrésolu : « teste », « peau de la teste », « peau écorchée », « peau corroyée », « perruque », « peau couverte de ses cheveux et moustaches », et finalement « chevelure ». L’expression « lever une chevelure », ou un peu plus rarement « enlever », « arracher » ou « faire » une chevelure, se généralisa dès la fin du xviie siècle pour décrire l’opération. Le mot « scalp » et le verbe « scalper » n’existaient pas sous le Régime français et n’apparurent pour la première fois, empruntés à l’anglais, qu’en 1769[6].
Nous examinerons d’abord les circonstances qui virent naître la politique de prime en Nouvelle-France, puis ses développements et ses expressions jusqu’à la Conquête. Pendant la plus grande partie de cette période, elle se distingua par le maintien d’une certaine continuité : dans les prix payés, dans les procédés de paiement, dans le choix des bénéficiaires. Cette politique fut avant tout considérée comme un des moyens les plus économiques de mener la guerre et, parce que l’enjeu était la survie de l’empire colonial français, elle fut très pragmatique dans son ensemble et peu soucieuse des inquiétudes de la morale européenne. Pour bien comprendre la portée des primes françaises, il faut les replacer dans leur contexte, au sein d’un ensemble de présents grâce auxquels on courtisait et subventionnait des guerriers amérindiens... qui ne cessaient pas pour autant de combattre selon leurs propres principes et objectifs.
Le témoignage controversé de Magsigpen
Si la France fut la dernière puissance coloniale à adopter la pratique d’offrir des récompenses pour des têtes ou des scalps, elle a néanmoins acquis une certaine notoriété dans l’historiographie pour avoir été la première à récompenser la prise de chevelures européennes. On peut lire, dans des ouvrages et des articles très sérieux, qu’en 1688, avant même que la guerre ait été officiellement déclarée entre les colonies[7], le gouverneur de la Nouvelle-France promit de payer une prime pour chaque scalp ennemi, d’Amérindien ou de Blanc, qu’on lui rapporterait[8]. Un examen critique de la question remet cependant cette affirmation en cause. Elle n’est en effet fondée que sur un seul document, le compte rendu de l’interrogatoire tenu à Albany d’un Amérindien du nom de Magsigpen, alias Graypoole. Celui-ci raconta avoir rencontré, alors qu’il était à la chasse, onze guerriers autochtones originaires de la Nouvelle-Angleterre à présent domiciliés au Canada. Ceux-ci l’avertirent qu’ils venaient combattre par ordre du gouverneur français, qui les avait invités, parce que les Agniers avaient causé beaucoup de tort dans sa colonie, à se venger aussi bien contre les Christians (Blancs) que contre les Amérindiens. Il leur avait demandé de ne pas ramener de prisonniers, mais uniquement des scalps, pour chacun desquels il avait promis de donner dix peaux de castor[9].
Les témoignages rendus le même mois aux autorités anglaises par Derrick Wessells, John Rosie ainsi que par quatre Agniers, présentent une version différente des faits. Celle-ci porte à croire qu’aucune prime ne fut offerte par les autorités de la Nouvelle-France cette année-là. Wessells et Rosie, qui avaient été envoyés quelques mois plus tôt comme émissaires à Montréal, confirmèrent que le gouverneur Jacques-René de Brisay, marquis de Denonville, les avait avertis que onze guerriers amérindiens s’étaient absentés de la colonie. Il espérait que ceux-ci ne causeraient pas d’ennuis, puisqu’il leur avait ordonné de ne faire aucun mal aux Chrétiens, mais il concéda que « lorsqu’ils sont dans les bois ils font ce qu’ils veulent[10] ». Quatre Agniers, interrogés indépendamment à Schenectady vers la même époque, rapportèrent qu’un parti d’Amérindiens réfugiés de la Nouvelle-Angleterre avait demandé au gouverneur du Canada l’autorisation d’aller près d’Albany attaquer les membres d’une nation ennemie. Ce dernier avait refusé, mais leur avait permis de s’absenter de la colonie à condition qu’ils ne fassent aucun mal à qui que ce soit. Or ils frappèrent quand même en Nouvelle-Angleterre, d’où ils rapportèrent sept scalps amérindiens et une prisonnière amérindienne. Le gouverneur, fâché, avait confisqué ces prises, et, par peur d’autres représailles, les guerriers s’étaient enfuis du Canada[11]. De plus, lorsque Denonville fut questionné par son homologue britannique, sir Edmund Andros, au sujet du meurtre de colons à Casco dans le Maine, il soutint qu’il n’avait ni ordonné ni consenti à ces attaques[12]. De son côté, l’intendant Champigny écrivit au ministre de la Marine que des Abénaquis, frustrés par l’inaction des Français, avaient envoyé un parti qui avait tué quelques Amérindiens ennemis et quelques Anglais, afin de venger ceux des leurs que Thomas Dongan, prédécesseur d’Andros, avait fait prendre et exécuter[13].
Outre ces documents qui contredisent de façon explicite le témoignage de Magsigpen, l’examen de la correspondance officielle de l’administration Denonville pour les années 1687-1689 révèle que la cour demeura, pendant cette période, attachée à une politique intercoloniale pacifique et passive. Jugeant qu’il était bien plus pressant d’orienter son attention et ses ressources vers le conflit qui s’annonçait en Europe, Versailles refusa d’envoyer des troupes et des fonds à la colonie. Même informée du fait que Dongan fournissait armes et munitions aux Iroquois, faisant ainsi par leurs mains et de façon assez peu subtile la guerre à la Nouvelle-France, la cour réitéra cette orientation politique, ordonnant au marquis de Denonville de ne rien entreprendre contre les Anglais et d’éviter tout ce qui pourrait troubler la bonne entente entre les colonies[14]. Il se peut bien que Denonville, qui avait à maintes reprises fait part à ses supérieurs de ses frustrations en dénonçant ouvertement leur politique d’inaction[15], n’ait pas été tout à fait peiné par la mort et l’ablation de la chevelure de quelques colons anglais. Il est néanmoins impensable que ce gouverneur — qui avait obéi aux ordres de la cour concernant l’envoi d’otages iroquois aux galères, malgré de vigoureuses objections personnelles — ait décidé de contrevenir à des ordres aussi catégoriques en offrant à ses alliés des récompenses pour des scalps anglais. Par contre, il est vraisemblable que les guerriers dont Magsigpen fit la rencontre voulurent tromper en prétendant détenir l’approbation du gouverneur. De cette façon, ils s’assuraient que toute nation qui ne désirait pas attirer la hargne française s’abstiendrait de nuire à leur expédition. L’idée du paiement des scalps, quant à elle, faisait déjà partie de leur bagage cognitif : originaires de la Nouvelle-Angleterre, ces guerriers avaient peut-être eux-mêmes été la cible des primes offertes par les autorités anglaises pendant la guerre du « Roi Philip », une douzaine d’années auparavant.
Les historiens doivent donc repousser de quelques années la date de l’apparition en Nouvelle-France des paiements de scalps. Gédéon de Catalogne affirme, dans son Recueil de 1716, que c’est à l’hiver de 1691 que le comte de Frontenac (qui avait remplacé Denonville deux ans plus tôt) promit dix écus à ses alliés autochtones pour chaque scalp qu’ils rapporteraient, « pour animer nos Sauvages alliez à ne point se réconcilier avec l’anglois ». On s’aperçut rapidement que le cuir chevelu était une piètre source de renseignements stratégiques et l’on décida d’offrir des récompenses semblables pour les prisonniers[16]. Cependant, la chronologie de cet auteur est souvent inexacte[17] et la première indication certaine de l’introduction des primes date de l’année suivante.
L’apparition des primes en Nouvelle-France
Dans une lettre du 21 septembre 1692, l’intendant Champigny informa le ministre que lui et Frontenac avaient convenu plus tôt cette même année de payer la somme de vingt écus blancs (66 livres) pour chaque prisonnier ennemi qui leur serait ramené, et de dix écus (33 livres) pour chaque prisonnière ou pour chaque chevelure ennemie, ce qui avait résulté en une « augmentation des dépenses fort considérable[18] ». À quoi doit-on attribuer l’adoption d’une telle politique ? Les causes immédiates ne sont pas évidentes, mais cette décision s’inscrit nettement dans le contexte de l’adoption par Frontenac de mesures favorisant la petite guerre — ce qu’on appellerait de nos jours la guérilla[19]. On peut supposer, en outre, que les primes qu’avait récemment offertes le gouvernement du Massachusetts lui servirent d’inspiration[20].
Cette première lettre déclencha entre la métropole et la colonie un échange épistolaire plutôt cocasse qui dura quelques années. Le roi, dans un mémoire ayant comme thème le « retranchement des choses inutiles, des salaires et des prix excessifs et des vaines liberalitez », fit part au gouverneur et à l’intendant des objections de la couronne aux mesures qu’ils venaient d’adopter. Il leur déclara que la somme de deux écus serait suffisante pour récompenser la capture d’un prisonnier, et qu’un écu conviendrait pour chaque prisonnière ou chaque personne tuée[21]. Frontenac et Champigny répliquèrent bien humblement au ministre qu’ils obéiraient aux directives du roi... si ce dernier le souhaitait véritablement : « Nous croyons être dans l’obligation de la supplier de considérer que c’est la dépense la plus utile que nous puissions faire, étant le moyen le plus sûr pour la destruction des Sauvages Iroquois. » La modeste somme de 30 000 livres assurerait ainsi leur défaite. En revanche, prétendaient-ils, la somme d’un ou deux écus n’était pas suffisante pour encourager des guerriers à aller capturer ou tuer un ennemi à 50 ou 100 lieues de la colonie, car elle ne permettait pas de subvenir aux besoins de leur famille pendant leur absence. Frontenac et Champigny priaient donc Versailles de reconsidérer sa directive. Il est amusant de constater qu’ils donnèrent cette fois comme argument que la dépense encourue par les primes « n’a pas été jusqu’ici à des sommes considérables », contrairement à ce que l’intendant avait initialement prétendu[22]. Dans sa lettre particulière du même jour, ce dernier avoua avoir été surpris des reproches que le ministre lui faisait de ses demandes de fonds « excessives ». Tout en soulignant que c’est au gouverneur et non à lui que la cour devait recommander l’économie et le ménagement, Champigny concéda qu’il serait difficile de faire de grandes diminutions aux dépenses, « ayant à mettre en action tous les sauvages alliez qui sont dans la Colonie, à l’Acadie et dans les lieux esloignez d’en haut[23] ». Frontenac et Champigny — d’ordinaire inconciliables — semblent avoir été d’accord au sujet de l’utilité des primes.
Vers la fin de l’année 1694, le gouverneur et l’intendant, dans une lettre commune au ministre, feignirent d’abord de se plier à la directive royale : « Nous obéissons dès à présent à l’ordre que sa majesté nous donne de cesser le paiement aux Sauvages chrétiens... » Seulement, ils énumérèrent ensuite derechef les diverses raisons pour lesquelles ils considéraient que ces paiements étaient nécessaires. Ceux-ci, soulignèrent-ils à nouveau, n’avaient coûté presque rien à la couronne : 6 326 livres 16 sols depuis leur introduction. Une fois de plus, Frontenac et Champigny esquivaient : « Ainsi, nous supplions Monseigneur d’avoir égard à ces raisons et nous pardonner si nous n’exécutons pas encore entièrement ce que Sa Majesté désire sur cela, nous croyant obligés par le zèle que nous avons pour son service d’en user de cette manière, jusqu’à ce qu’elle nous ait fait savoir, après avoir su nos raisons, qu’elle le souhaite absolument[24]. » Le roi répliqua d’un ton sec qu’il voulait toujours qu’ils se conforment à l’ordre donné l’année précédente. Aux yeux de Versailles, cette dépense ne pouvait être supportée. Le roi évoqua son inefficacité : la promesse de primes payées pour les scalps et les prisonniers n’avait pas empêché les guerriers domiciliés de faciliter la fuite d’Agniers après un raid français sur leur village. Il rajouta, narquois, que si la fuite de quelque 200 prisonniers n’avait pas été favorisée, le fonds des dépenses du Canada n’aurait pas été suffisant pour en récompenser la capture. Enfin, le roi enjoignit au gouverneur et à l’intendant de remettre « les choses à cet esgard en l’estat où elles l’estaient avant qu’ils l’eussent résolue, puisque la dépense de leur subsistance et les autres fournitures qui se font à ces Sauvages lorsqu’ils sont employez à la guerre sont entièrement sur le compte de sa Majesté[25] ». En juin 1695, la cour informa encore une fois Frontenac et Champigny qu’elle ne « trouvait point à propos » qu’ils continuassent de payer ces sommes. Le roi leur recommanda de trouver d’autres moyens pour engager les Amérindiens domiciliés à aller en guerre contre les Iroquois, puisque l’argent, la « protection et les autres grâces » qu’on leur donnait déjà devaient suffire pour assurer leur coopération sur le plan militaire[26].
Le 10 novembre 1695, le gouverneur et l’intendant écrivirent enfin au ministre qu’ils avaient décidé de suivre « exactement ce que Sa Majesté nous prescrit à l’égard [... de] la gratification qui étoit accordée pour chaque iroquois tué ou prisonnier que nous retrancherons comme elle nous l’ordonne[27] ». Mais, de toute évidence, les remontrances royales n’eurent pas l’effet escompté sur la politique coloniale pendant l’administration de Frontenac, puisqu’on payait toujours la somme de trente livres par chevelure vers la fin de la Guerre de la Ligue d’Augsbourg[28].
S’il est difficile d’identifier avec précision à quelles époques au cours du Régime français on récompensa la prise de scalps, c’est avant tout parce que l’offre de paiements était à la discrétion du gouverneur. Tout porte à croire que lorsque ce dernier décidait — conjointement avec l’intendant, car celui-ci devait approuver toutes les dépenses — d’en offrir, il en informait tout simplement ses alliés autochtones en personne ou par l’entremise de ses représentants, et la nouvelle se répandait de façon informelle, de bouche à oreille. Aucune ordonnance, aucun arrêt n’était édicté à cette occasion. Par contre, dans les colonies anglaises, les primes étaient promulguées en bonne et due forme par les assemblées législatives qui publiaient des scalp acts (ou scalp laws). Lorsque les hostilités prenaient fin, le gouverneur français expédiait des courriers afin d’avertir ses alliés qu’on ne récompenserait plus l’enlèvement de chevelures ou la capture de prisonniers. Cet avertissement ne les dissuadait cependant pas automatiquement, et ils continuaient souvent à guerroyer afin de satisfaire leurs propres objectifs[29].
De la Guerre de Succession d’Espagne jusqu’à la Guerre de Sept Ans
Les autorités canadiennes n’offrirent aucune prime pour des scalps pendant les premières années de la Guerre de Succession d’Espagne, sans doute à cause des directives réitérées de la cour. En septembre 1706, le gouverneur de la Nouvelle-France, Philippe de Rigaud, marquis de Vaudreuil, reçut les plaintes d’Abénaquis qui lui dirent que depuis que la guerre était commencée, ils n’en avaient retiré aucun profit, bien que leurs cabanes fussent pleines de scalps anglais. Le gouverneur leur rappela qu’il les avait avertis dès le début des hostilités qu’il ne payerait pas les chevelures, car cette mesure lui « sembloit trop inhumaine ». La guerre, poursuivit-il, ne leur avait pas pour autant été moins profitable, puisqu’ils prenaient beaucoup de butin dans leurs raids et parce que les Français rachetaient les prisonniers anglais à grand prix. Cependant, il leur promit qu’il leur ferait donner des munitions supplémentaires en dédommagement pour leurs services[30]. Cela dit, le marquis de Vaudreuil semble par la suite avoir abandonné ses scrupules moraux, car des documents anglais suggèrent que quelques années plus tard, les autorités coloniales françaises avaient recommencé à récompenser la prise de chevelures[31].
La cessation des hostilités et la signature du Traité d’Utrecht en 1713 mirent fin au paiement des scalps. L’absence de primes pendant la période qui mena jusqu’à la Guerre de Succession d’Autriche (1744-1748) ne semble pas pour autant avoir diminué l’ardeur guerrière des alliés de la France, qui arrachèrent des chevelures en grand nombre lors des campagnes contre les Renards[32]. Plusieurs Canadiens « sensés » suggérèrent aux autorités d’offrir des sommes assez élevées aux guerriers domiciliés et à ceux des Pays-d’en-haut qui ramèneraient des scalps de Chicachas, afin d’encourager l’offensive. Cette mesure ne semble cependant pas avoir été adoptée et les chevelures rapportées de ces expéditions lointaines ne furent pas payées[33].
Si les Chicachas, qui habitaient la région de l’État actuel du Mississipi, ne compromettaient pas la sécurité immédiate de la colonie laurentienne, ils constituaient une menace manifeste pour la Louisiane. Encore toute jeune et mal établie, cette colonie n’avait pas encore réussi à épuiser et à apaiser les tribus avoisinantes, comme le Canada était parvenu à le faire en concluant la Grande Paix de 1701 après presque un siècle d’intermittents mais durs combats. Par conséquent, les autorités louisianaises eurent recours aux primes pendant la plus grande partie de la première moitié du xviiie siècle, dans l’espoir d’encourager la décimation des nations hostiles.
En 1703 déjà, Jean-Baptiste Le Moyne de Bienville, commandant en second de la Louisiane, avait prié ses alliés d’aller en guerre contre les Chetimachas et les Alibamons. Il avait promis, en cette occasion, de payer dix écus par chevelure d’homme ou par prisonnier qu’ils feraient[34]. Ces petites nations furent vaincues sans trop de peine et, de toute évidence, on cessa de payer les scalps par souci d’économie en 1712, lorsque l’administration de la colonie passa aux mains d’une compagnie privée. Neuf ans plus tard, Bienville recommanda que l’on recommence à payer les scalps aux alliés Chactas « sur le même pied que du temps du Roy », afin de les encourager à mener vigoureusement la guerre qui venait d’être déclarée contre les Chicachas, ces « Iroquois du sud ». La décision tarda un peu, pour des raisons bureaucratiques semble-t-il, mais l’on décida en 1723 de se conformer à la politique d’avant 1712[35]. On continua ainsi à encourager et à subventionner les guerres contre les Chicachas pendant les décennies qui suivirent[36]. Lorsque ces derniers, décimés par les sorties des Français et de leurs alliés, tentèrent de pactiser, Bienville répondit qu’il voulait bien faire la paix avec eux... mais qu’il ne pouvait obliger ses alliés chactas à faire de même parce que ceux-ci combattaient légitimement, pour des raisons qui leur étaient propres. Qui plus est, il déclara qu’il ne pouvait cesser de payer aux Chactas les scalps qu’ils rapportaient parce que c’était lui qui les avait encouragés à prendre le sentier de la guerre[37].
Dès le début de la Guerre de Succession d’Autriche et l’ouverture des hostilités avec les colonies anglaises, la politique de primes reprit de plus belle au Canada et à l’Île Royale. Les partis de guerre revinrent avec des prisonniers et des chevelures de façon régulière. Il en fut de même pendant les premières années de la Guerre de Sept Ans (1754-1760).
Cependant, la guerre s’établit rapidement en Amérique du Nord sur le modèle européen, avec ses armées, ses campagnes, son artillerie, ses sièges, ses batailles rangées et ses règles de conduite. Dans ce nouveau contexte militaire, la pratique du scalp paraissait à la fois barbare et futile. Le marquis de Montcalm en avisa le gouverneur d’alors, Pierre de Rigaud, marquis de Vaudreuil : « Ce n’est plus le temps où quelques chevelures, quelques maisons brûlées soient un avantage, soient même un objet. Les petits moyens, les petites idées, les petits conseils de détail sont aujourd’hui dangereux, ils consomment de la matière et du temps. Les circonstances exigent des mesures qui tranchent et qui décident[38]. » En raison de ce changement de doctrine militaire, aussi bien que du piètre état des finances de la colonie, les primes offertes pour les scalps ainsi que pour les prisonniers diminuèrent sensiblement pendant les dernières années du conflit[39].
Une anatomie des primes en Nouvelle-France
On ne sait pas avec certitude si les autorités françaises cherchèrent en récompensant la prise de scalps à encourager de façon consciente une coutume particulièrement horripilante, propre à traumatiser l’ennemi. Chose certaine, les Canadiens connaissaient bien le terrible effet que cette pratique pouvait avoir sur le moral, ayant eux-mêmes constaté pendant les guerres iroquoises que « rien n’étoit à la vérité plus triste que d’être dans des inquiétudes continuelles de se voir enlever sa chevelure à la porte de sa maison[40] ». Le but de la politique française était, avant tout, d’encourager les Amérindiens à mener des expéditions guerrières. On reconnaissait tout simplement qu’on offrait des primes « pour mieux exciter leur ambition[41] ».
Les buts visés par ces paiements étaient donc indissociables de ceux de la petite guerre, doctrine militaire qui permettait de contrebalancer la faiblesse du peuplement en prenant plein avantage de l’environnement naturel du Nouveau-Monde et des techniques guerrières amérindiennes. En effet, les autorités coloniales françaises croyaient fermement que rien n’était « plus propre à dégoûter les peuples de ces colonies [anglaises] et à leur faire désirer le retour à la paix » que les attaques réitérées des partis de guerre autochtones[42]. Or ces guerriers revenaient de campagne les vêtements déchirés, les mocassins usés, sans munitions ; pendant leur absence, leur famille manquaient de tout. Il fallait donc, afin de permettre aux alliés d’aller au combat, leur offrir continuellement des présents ainsi qu’un soutien logistique ininterrompu. Ainsi, de même qu’on offrait de nombreux présents lors de cérémonies périodiques afin d’entretenir les alliances, on en distribuait également autant au départ des partis de guerre, « pour les engager à faire leur devoir », qu’à leur retour, « par reconnaissance lorsqu’ils ont donné des marques de leur valeur[43] ». Il va sans dire que les prisonniers et les scalps, preuves tangibles du succès d’une expédition, constituaient les marques par excellence de valeur guerrière.
Pour mieux comprendre le phénomène des primes, il est utile de reconstituer le déroulement des événements qui suivaient le combat et l’enlèvement d’une chevelure. Une fois en lieu sûr et lorsque le temps le permettait, le guerrier victorieux préparait le ou les scalps qu’il avait levés. Selon la coutume, ces dépouilles étaient raclées, tendues dans un cerceau de bois, peintes du côté chair, et attachées au bout de tiges de bois longues de quelques mètres[44]. Ainsi préparées, elles étaient ramenées avec les prisonniers jusqu’au village du vainqueur — ou bien jusqu’à une ville ou un poste français, s’il s’en trouvait en chemin et si une récompense était anticipée. Arrivés aux abords de ce village, de cette ville ou de ce poste, les guerriers s’arrêtaient un moment, suivant l’usage. Entonnant alors la « chanson de la chevelure », ils poussaient autant de cris qu’ils avaient levé de scalps. À ces bruits, des curieux accouraient à leur rencontre[45]. L’anecdote d’un Métis nommé Dubosq donne une bonne idée de ce qui s’ensuivait typiquement lorsqu’un guerrier ou un parti de guerre entrait en ville. Entouré de curieux, celui-ci se rendit jusque chez le gouverneur de Montréal, « où il entra, avec un air majestueux, tenant d’une main huit grandes baguettes au bout desquelles pendaient huit longues chevelures, et de l’autre ses deux prisonnières qu’il faisait marcher devant ». Puis, « Monsieur de Callières le reçut fort favorablement, et écouta son récit avec autant d’admiration et d’étonnement ». On remit ensuite à Dubosq 240 livres en marchandises, à raison de trente livres par chevelure apportée[46]. Habituellement, les scalps étaient présentés à mesure que les partis de guerre revenaient d’expédition, à peu près comme nous venons de le décrire. Toutefois, il n’était pas rare qu’on les présentât lors de cérémonies annuelles[47].
Les registres financiers suffisamment détaillés ne sont pas assez nombreux pour permettre l’analyse systématique des bénéficiaires des primes[48]. Toutefois, la correspondance officielle de la colonie, les écrits d’observateurs contemporains ainsi que les quelques états financiers qui notent de façon explicite cette dépense révèlent non seulement que l’on venait parfois de très loin pour recevoir une récompense, mais aussi que celles-ci étaient payées aux « sauvages chrétiens » et aux « sauvages alliés[49] ». Sur ce point, la politique française tranche avec celle des colonies anglaises, où les primes promulguées par les scalp acts étaient plus souvent qu’autrement destinées aux colons[50]. Chose certaine, des Franco-Canadiens adoptèrent l’usage amérindien et scalpèrent sans scrupules leurs ennemis. Et pourtant, les sources d’époque (anglaises autant que françaises) qui témoignent de ce phénomène sont plutôt rares[51]. De même, nous n’avons retrouvé aucun cas dans les annales de la Nouvelle-France où une prime fut promise ou remise à un colon ou à un soldat. Ces constatations porteraient à croire que le tabou contre l’adoption de cet usage autochtone était plus vif dans la société coloniale française que chez les voisins britanniques... si les commentateurs français qui rapportèrent cette pratique dans leurs écrits n’avaient pas excusé et loué la conduite de leurs compatriotes qui avaient adopté les méthodes de l’ennemi[52]. On peut donc supposer que c’est plutôt par souci d’économie et parce que le service militaire était obligatoire en Nouvelle-France — et non volontaire, comme dans les colonies anglaises — qu’on ne récompensait pas les scalpeurs blancs : les miliciens étant contraints au combat par la loi, il n’était pas nécessaire pour l’État d’animer leur esprit martial en déliant les cordons de sa bourse. Les administrateurs reconnaissaient cependant qu’on ne pouvait s’assurer la collaboration militaire indispensable des Premières nations qu’en entretenant les alliances et en courtisant les guerriers par la distribution de présents et d’indemnités, dans le cadre desquelles s’inscrivaient les primes.
En termes financiers
L’ensemble de la documentation disponible permet une constatation inattendue : le prix payé par les autorités françaises pour les scalps demeura d’environ 30 livres pendant presque tout le Régime français et dans toutes les colonies[53]. Au cours de cette même période, le prix payé pour les prisonniers fluctua beaucoup plus, mais fut toujours de deux à quatre fois plus élevé : 60 à 140 livres[54]. Il faut bien entendu comprendre par ces sommes, plutôt que de l’argent sonnant, une valeur payée en diverses marchandises et fournitures : fusils, munitions, outils, couvertures, habillement, tabac, contenants de fer ou de cuivre, tissu, aiguilles et ainsi de suite. En comptant de telles marchandises à haut prix, les autorités parvenaient à faire quelques économies[55].
À quelques reprises, on offrit plus que les 30 livres habituelles pour un scalp. On remboursa, par exemple, à l’abbé Le Loutre les 1 800 livres qu’il avait payées à ses ouailles micmaques pour 18 chevelures[56]. À part ce cas, les sommes plus importantes furent offertes dans des circonstances punitives, lorsqu’on avait mis à prix la tête d’individus ou de groupes considérés particulièrement dangereux pour la sécurité de la colonie. En 1751, pour encourager une expédition contre les Miamis rebelles, on promit de payer 100 écus pour chaque prisonnier remis au fort Détroit et 50 écus pour chaque chevelure[57]. Quelques années plus tôt, on avait offert en Louisiane une récompense faramineuse — deux pièces de Limbourg, 48 couvertures, 10 fusils, 4 livres de vermillon, 100 livres de poudre, 40 livres de balles, 40 chemises et quelques autres babioles — pour le scalp de Soulier Rouge, un chef chacta rebelle[58].
Quoi qu’il en soit, de tels cas font exception, car sous le Régime français le taux de rémunération habituel demeura d’une trentaine de livres, indépendamment de l’âge ou du sexe de la victime. Cette régularité relative est encore plus étonnante quand on la compare à la complexité des scalp acts dans les colonies anglaises. La valeur d’une prime y était souvent déterminée en partie par l’identité de celui qui avait levé le scalp : on payait la plus basse somme aux soldats réguliers, une somme plus élevée aux miliciens volontaires qui recevaient une solde et la plus haute somme à ceux qui n’en recevaient pas[59]. De même, la valeur de ces primes dépendait habituellement aussi de l’âge et du sexe de la victime. Par exemple, on adopta au Massachusetts, dès 1696, une échelle de paiement « humanitaire » conformément à laquelle on ne payait rien pour des scalps d’enfants de moins de 14 ans... comme s’il était possible de distinguer avec certitude l’origine d’une de ces dépouilles[60]. À cet égard, la politique de prime française peut être considérée avec raison comme plus proche de la coutume amérindienne, selon laquelle le scalp de femme ou d’enfant avait autant de valeur que celui d’un homme puisqu’il démontrait qu’un guerrier, pour le prendre, avait pénétré jusqu’au coeur du territoire ennemi[61].
Comme nous l’avons souligné plus haut, les sommes payées pour le rachat des captifs en Nouvelle-France furent toujours de deux à quatre fois plus élevées que celles remises pour les chevelures. Cet écart est représentatif de l’importance relative de ces prises de guerre aux yeux des Français et des Amérindiens. Pour les uns comme pour les autres, il était plus profitable de capturer que de tuer. Chez les Français, les prisonniers étaient considérés comme des « lettres vivantes » susceptibles de fournir après interrogatoire de précieux renseignements stratégiques sur l’ennemi[62]. En outre, ils avaient une valeur diplomatique, puisqu’ils pouvaient être remis en liberté en signe de bonne foi, ou échangés contre des ressortissants français qui avaient été capturés. La chevelure n’avait en revanche que l’avantage de démontrer qu’un ennemi avait été mis hors d’état de nuire ; comme prise de guerre, elle était donc moins estimée qu’un captif. Il en allait de même chez les Premières nations, mais pour des raisons différentes. Les femmes, hommes et enfants capturés à la guerre pouvaient selon les circonstances être intégrés à la tribu par adoption, gardés ou échangés comme esclaves, ou suppliciés pour satisfaire à des exigences spirituelles[63]. Néanmoins, malgré une préférence marquée pour ce butin vivant, il n’était pas toujours possible de faire parcourir à un ou plusieurs captifs les longues distances qui séparaient un parti du premier poste ami sans mettre en danger la sécurité des guerriers — la chevelure devenait dans ces cas-là une sorte de prix de consolation.
La plupart des états de dépenses des colonies sont d’une utilité très réduite si l’on cherche à mesurer l’importance économique du phénomène des primes, car les sommes consacrées au paiement des scalps et des prisonniers sont habituellement comprises de façon implicite sous des titres plus généraux du genre « présents et indemnités aux sauvages » ou bien « sommes pour les sauvages alliés ». Dans les états du roi ainsi que dans les projets de fonds proposés à Versailles par les intendants, on a affaire à des désignations encore plus larges : « dépenses pour la guerre » ou « fonds pour la guerre et les fortifications ». Ainsi, la rareté des registres financiers suffisamment détaillés ne permet malheureusement pas de retracer avec précision la fluctuation annuelle des sommes affectées au paiement des scalps. Néanmoins, les quelques chiffres qui sont disponibles démontrent qu’elles furent relativement peu élevées en comparaison aux sommes payées pour le rachat de prisonniers, et encore plus faibles lorsqu’on les compare à l’ensemble des dépenses militaires. Par exemple, du mois de septembre 1746 au mois d’août 1747, en pleine guerre de Succession d’Autriche, on ne distribua à Montréal qu’une valeur de 1867 livres en paiement pour 56 chevelures, tandis que pendant la même période, 92 prisonniers furent achetés aux guerriers autochtones pour la somme de 12 686 livres[64]. À Québec, on paya 1 875 livres en 1746, puis 2 508 livres l’année suivante pour le rachat de prisonniers et de scalps, alors que les dépenses pour la guerre totalisaient 138 064 livres[65] ; de janvier à septembre 1748, on paya 826 livres 14 sols pour des chevelures, comparativement à 9 109 livres 4 sols pour le rachat de prisonniers anglais et pour l’achat d’esclaves amérindiens qui serviraient aux échanges de prisonniers[66]. Un facteur qui semble avoir permis de limiter les dépenses est qu’on ne payait pas, en règle générale, de récompense pour les scalps « quand il y a des gros partis de Français et Sauvages mêlés ensembles » et qu’on tâchait de « trouver des prétextes pour en payer le moins possible[67] ». Manifestement, les sommes consacrées à ces paiements n’étaient qu’une goutte d’eau dans la mare des dépenses militaires coloniales. Bien qu’elles aient fait rechigner la couronne (comme la plupart des dépenses coloniales, d’ailleurs), elles se révélaient économiques, puisqu’elles étaient bien inférieures à celles encourues lorsqu’on organisait des grandes expéditions « à l’européenne[68] ».
Fraudes et supercheries
La politique du paiement des scalps donna naissance à toutes sortes de fraudes et de supercheries. On est allé jusqu’à prétendre que lorsque les autorités britanniques offraient des récompenses plus importantes que celles offertes en Nouvelle-France, les Canadiens achetaient des scalps pour les revendre à profit chez leurs voisins du sud[69]. D’autres historiens ont soutenu avec plus de sérieux que, dès la fin du xviie siècle, les autorités canadiennes commencèrent à soupçonner que certains de leurs alliés tuaient des autochtones amis et des habitants de la colonie dans le but de faire passer leurs chevelures pour des dépouilles ennemies et de recevoir ainsi une récompense qui n’était pas méritée[70]. Il va sans dire que seulement dans des cas exceptionnels pouvait-on deviner l’origine d’un scalp par son apparence : notamment, les chevelures rouges distinguaient « assez ordinairement » les habitants des colonies anglaises[71]. On comprendra donc que l’origine des dépouilles dont on leur demandait de récompenser la capture ait préoccupé les autorités coloniales. Aussi, un journal bostonnais rapporta, vers la fin de 1757 (tout en émettant quelques doutes quant à l’authenticité de ce fait), qu’on avait récemment cessé de payer les scalps à Louisbourg pour cette raison[72]. L’explication jusqu’ici proposée pour ce phénomène — c’est-à-dire que plusieurs Amérindiens, avides de primes, préféraient assassiner leurs voisins plutôt que d’aller combattre au loin — est insatisfaisante. Il faut plutôt y voir un signe que les guerriers ne se sentaient pas contraints, par l’offre de telles récompenses, à adopter les objectifs des gouvernements coloniaux. Aussi, si ce type de fraude fut plus fréquent chez les Britanniques et chez leurs alliés[73], c’est en bonne partie parce que ces premiers géraient leur réseau d’alliances avec moins de subtilité et de perspicacité que ne le faisaient les Français.
Certains autochtones ingénieux, afin d’obtenir une récompense qui n’était pas méritée, imaginèrent la ruse de préparer de la peau de cheval de la même façon qu’un chevelure humaine[74]. Une autre supercherie, sans doute plus répandue, consistait à diviser un scalp en plus d’un morceau. L’exemple le plus célèbre provient des écrits de Bougainville, qui constata que le parti de guerre amérindien mené par le sieur Marin avait rapporté 32 chevelures, alors qu’on savait bien que les Anglais n’avaient eu que onze tués et quatre blessés : « d’une, ils savent en faire deux et même trois », remarqua-t-il dans son journal[75]. Les autorités cherchèrent à réprimer de tels abus en examinant de plus près les scalps avant de les payer et en ayant recours à des certificats de garantie que pouvaient faire les missionnaires, principaux habitants, ou officiers des troupes de la colonie qui accompagnaient très souvent les partis de guerre[76]. Or Bienville, lorsqu’il s’aperçut que ses alliés chactas divisaient leurs scalps, fut irrité et décida, afin de diminuer les dépenses et de mettre fin à ces abus, qu’on ne paierait ces dépouilles qu’en fonction de leur taille[77]. Diron d’Artaguiette rapporta à la couronne que l’ardeur guerrière des Chactas avait diminué en conséquence et critiqua sévèrement les mesures de Bienville[78]. On peut donc supposer que les autorités fermèrent très souvent les yeux, considérant qu’il était plus sage d’être indulgent — quitte à y perdre des marchandises d’une valeur de quelques livres — que risquer de blesser la sensibilité d’indispensables alliés militaires.
Afin qu’on ne récompense pas plus d’une fois la prise d’une seule chevelure, les scalp acts des colonies britanniques stipulaient généralement que ces dépouilles devaient être remises aux autorités avant qu’un colon, soldat ou guerrier soit payé. Elles devaient ensuite être brûlées ou enterrées dans un endroit secret en présence d’un comité législatif ou judiciaire[79]. Ce que le sort réservait aux scalps en Nouvelle-France est malheureusement moins clair. Surtout, il ne faut pas sauter à la conclusion qu’ils étaient remis aux autorités[80]. Il est en effet fort probable qu’on ne saisissait pas les scalps afin de ménager la sensibilité des alliés et parce qu’on considérait que les officiers, missionnaires et habitants qui accompagnaient habituellement les partis sauraient prévenir les abus les plus graves[81]. Quelques indices appuient cette hypothèse, notamment le fait que plusieurs contemporains constatèrent que de nombreux scalps étaient pendus aux cabanes des villages d’Amérindiens domiciliés pour afficher la valeur des guerriers qui y habitaient[82]. L’ensemble des sources consultées dans le cadre de cette étude suggèrent que le guerrier n’avait, en temps normal, qu’à présenter sa prise pour obtenir une prime ; il ne l’aurait remis aux autorités qu’occasionnellement, en signe particulier de son dévouement à la cause militaire commune qui l’unissait aux Français.
Une politique contraire aux « loix de l’humanité » ?
Tout porte à croire que la population des colonies françaises d’Amérique n’eut pas, en son ensemble, la conscience très troublée par la question du scalp et par la politique de primes. Cela s’explique en partie par le fait qu’à l’époque, les usages judiciaires français (et européens en général) étaient à bien des égards aussi violents et sanguinaires que n’importe quelle coutume autochtone[83]. Surtout, c’est au pragmatisme suscité par la précarité de la vie coloniale que l’on doit attribuer l’adoption de pratiques comme celle-là. Nombreux étaient ceux qui croyaient que lorsqu’on avait affaire à des gens qui usaient de pareils moyens lorsqu’ils faisaient la guerre, il devenait légitime de les adopter soi-même afin d’assurer sa propre survie. C’est ce qui fit commenter à des nouveaux venus aux colonies que « l’air qu’on respire ici est contagieux pour l’accoutumance à l’insensibilité[84] ». Si l’opinion de l’habitant moyen demeure conjecturale, l’attitude de certains milieux plus instruits est plus facile à saisir : la question du scalp ne manqua pas de soulever des protestations, mais celles-ci furent généralement bien moins vigoureuses qu’on aurait pu l’anticiper.
Comme nous l’avons indiqué plus haut, les premières critiques furent formulées par les autorités métropolitaines dès qu’on les avisa de l’adoption d’une politique de prime. Or les objections de la couronne ne furent pas morales, mais plutôt financières. Le roi, tout en demandant à Frontenac et à Champigny d’user de « moyens moins onéreux à Sa Majesté » pour inciter les alliés à aller en guerre, leur recommanda d’encourager ceux-ci « à ne pas ménager des ennemis qui ne gardent aucunes mesures d’humanité, ny du droit des gens[85] ». Quelque temps pendant la Guerre de Succession d’Espagne, cependant, la politique de prime reçut l’approbation de la couronne. Si cette approbation se manifesta peut-être à l’occasion par des encouragements explicites, elle prit plus souvent la forme d’une tolérance tacite. En témoigne, par exemple, l’aise avec laquelle les officiers et les administrateurs coloniaux parlèrent des chevelures et des primes dans leur correspondance avec Versailles[86].
Contrairement à la torture et à l’anthropophagie, le scalp fut considéré par de nombreux hommes d’Église comme un usage guerrier admissible. Chez certains, y compris Mgr de Saint-Vallier, on entrevoit cette tolérance dans la façon nonchalante dont ils font référence à cette pratique dans leurs écrits[87]. De leur côté, les missionnaires réprimandaient sévèrement le traitement inhumain des prisonniers et le cannibalisme, exhortant leurs ouailles à faire « légitimement, raisonnablement, et noblement la guerre ». L’abbé Maillard, missionnaire chez les Micmacs, expliqua qu’il fallait respecter les « loix de l’humanité » ; lorsque son ennemi demandait quartier, il fallait le lui donner et le faire prisonnier. Toutefois, ce clerc concéda que
s’il y a des cas où on soit comme nécessité à ne pas laisser vivre les prisonniers à qui on a fait quartier, c’est quand on ne le peut vrayment faire qu’à son préjudice ; alors quand on voit qu’il n’y a point d’autre parti à prendre que de s’en défaire, on les regarde comme un butin qui embarrasse, qu’on ne peut ni garder avec soi, ni transporter ailleurs sans courir évidemment risque de sa propre vie ; on se défait donc de ces gens-là, puisqu’il faut s’en défaire, par les voyes les plus simples, les plus courtes, et en même temps les plus douces[88].
Aux yeux d’un clergé missionnaire pour qui les intérêts militaires de la France et de ses colonies étaient indissociables de ceux de la religion catholique, l’ablation du cuir chevelu d’une victime déjà morte ne paraît pas avoir été jugée contraire aux « loix de l’humanité ». On peut supposer que plusieurs ne tolérèrent cette coutume qu’à reculons, par peur de rebuter de précieux alliés, ou se virent obligés de l’intégrer par syncrétisme à la doctrine catholique afin de faciliter les conversions[89]. D’autres, en revanche, l’encouragèrent plus activement. Un officier métropolitain estima, lors de la Guerre de Sept Ans, que les guerriers domiciliés n’étaient pas moins cruels que les non-domiciliés, bien qu’ils ne fussent plus anthropophages : « les missionnaires qui les accompagnent quand ils marchent en nombre leur prêchent de faire des chevelures pour la gloire de Dieu[90]. » Aussi, certains missionnaires, tel que l’abbé Le Loutre, servirent d’intermédiaires dans le paiement des primes et le rachat des prisonniers[91].
L’attitude des officiers de l’armée et de la marine française, qui visitèrent la colonie lors de la Guerre de Sept Ans, se caractérise, peut-être encore plus que celle du clergé, par une résignation paradoxale. D’une part, ces hommes s’élevèrent contre la barbarie et la cruauté des coutumes guerrières autochtones. Par leur culture littéraire et philosophique, ils avaient été nourris du mythe du noble Sauvage — et étaient par conséquent prédisposés à être choqués et déconcertés par la réalité nord-américaine. On leur avait aussi inculqué une culture militaire, héritée des idéaux chevaleresques médiévaux et du raffinement du Grand Siècle, selon laquelle l’ennemi devait être traité avec courtoisie, les prisonniers avec considération et les non-combattants avec douceur. En somme, l’officier se devait d’agir en « honnête homme[92] ». À ces facteurs culturels s’ajoutaient peut-être aussi quelques considérations plus pragmatiques. En effet, on peut supposer qu’à l’instar de certains de leurs homologues britanniques, quelques officiers français jugèrent que la cruauté des usages amérindiens ne pouvait avoir comme effet que d’attiser la hargne des ennemis et de les inciter à se venger de façon analogue[93]. Quoi qu’il en soit, ces officiers métropolitains qui exprimaient régulièrement leur exaspération face à la barbarie de leurs alliés se résignaient presque toujours à la regarder « comme une fortune de guerre inévitable en Amérique[94] ». Au chapitre du scalp et des primes en particulier, peu d’entre eux jugèrent de façon catégorique qu’il s’agissait de pratiques tout à fait honteuses et carrément inconciliables avec les règles de la guerre[95]. Plusieurs constatèrent en revanche l’existence de ces usages d’un ton tout à fait indifférent (ce qu’ils ne faisaient presque jamais lorsqu’ils traitaient du cannibalisme ou de la torture) et allèrent même jusqu’à les excuser de façon explicite et sans équivoque, soulignant que leurs adversaires faisaient la guerre par des moyens aussi sauvages[96].
Les officiers des troupes de la colonie, Canadiens de naissance ou « canadianisés » pour la plupart, eurent encore moins de scrupules au sujet du scalp que leurs collègues de la métropole. Menant ou accompagnant régulièrement au combat les partis de guerre autochtones qui rapportaient des chevelures, le scalp était à leurs yeux, comme à ceux des Premières nations, une mesure du succès militaire plutôt qu’un objet de dégoût[97].
Tout au cours du Régime français, les plus vigoureuses et constantes protestations émanèrent des colonies britanniques. En temps de guerre, les gouverneurs et l’état-major de ces colonies entretenaient généralement une correspondance très polie avec leurs homologues français ; ils n’y manquaient pas de se plaindre du comportement des French Indians en général, et de la distribution de primes en particulier. Bien qu’elles eussent elles-mêmes recours aux scalp acts, les autorités coloniales britanniques protestaient : la coutume autochtone de l’enlèvement des chevelures était horrible et cruelle, et la politique de prime adoptée par leurs rivaux était « tout à fait contraire au Christianisme » et aux « lois de la guerre observées par toutes les nations civilisées ». Puis, elles menaçaient de traiter les sujets français d’Amérique de façon aussi cruelle si ceux-ci ne cessaient pas d’encourager et de soutenir les guerriers des Premières nations[98]. Ces protestations étaient habituellement perçues en Nouvelle-France comme des marques de faiblesse, des signes que les Anglais craignaient les incursions françaises et amérindiennes ; les menaces proférées n’étaient pas prises au sérieux. On choisissait parfois tout simplement de ne pas y répondre. Très souvent, on esquivait la question des primes, et on répondait simplement que « [les alliés autochtones] ne sont pas assez dans notre dépendance pour leur faire changer leurs coutumes et leurs moeurs » ou bien « que ceux qui connaissent cette nation savent qu’elle ne respecte aucun ». Les autorités coloniales françaises exprimaient aussi assez fréquemment un certain regret (peu sincère, on peut l’imaginer), déplorant le sort que leurs alliés réservaient à leurs ennemis et s’excusant de ne pouvoir adoucir leurs moeurs. Tout de même, elles assuraient qu’elles tâcheraient de faire racheter les prisonniers anglais aux autochtones et qu’elles feraient tout en leur possible pour que ces derniers se conduisent mieux[99]. Lorsque les Français daignaient répondre de façon spécifique aux accusations concernant les primes de scalps, c’était en déclarant que la France ne pouvait malheureusement pas cesser d’en payer, car elle devait avant tout respecter les engagements — les promesses de primes, en l’occurrence — qu’elle avait pris au préalable avec ses alliés. Autrement, c’était en soulignant que les colonies anglaises avaient été les premières à en offrir et qu’en ce domaine, les Français n’avaient fait que suivre leur exemple[100].
L’effet des scalp acts, adoptés dans l’espoir d’assurer la sécurité des frontières et de décourager les Français et leurs alliés de mener la guerre d’une façon « sauvage », demeura bien limité[101]. Néanmoins, le spectre d’ennemis qui combattaient selon des méthodes contraires aux prétendues lois de l’humanité devint une des armes rhétoriques les plus puissantes dans l’arsenal des démagogues coloniaux. Certainement autant que les considérations économiques ou expansionnistes, la crainte des partis de guerre et la colère ressentie envers ceux qui les subventionnaient contribuèrent à unifier les efforts des colonies britanniques et à susciter le concours de la mère patrie contre la Nouvelle-France[102]. L’hypocrisie apparente des Anglo-Américains, qui insistaient sur la barbarie de la politique française tout en promulguant leurs scalp acts, mérite une explication. Il faut sans doute y voir un reflet des préjugés ethniques qui régnaient alors : les habitants des colonies britanniques estimaient que les primes offertes par leurs voisins étaient illégitimes, car elles incitaient les guerriers amérindiens au massacre d’« innocents » colons blancs. En revanche, jugeait-on, les scalp acts étaient excusables, puisqu’ils cherchaient avant tout à subventionner la destruction de ces dangereux et sauvages autochtones, plutôt que de colons de descendance européenne.
L’effet des primes sur les Premières nations
Quelles répercussions le paiement français des scalps eut-il sur les populations amérindiennes ? D’abord, rien ne suggère que l’offre de telles récompenses eut un effet démographique. La politique française de primes a longtemps été tenue pour une des causes principales de la disparition des Béothuks. Cependant, les historiens sont aujourd’hui d’avis qu’il est fort peu probable, voire impossible, que celle-ci ait eu un rôle à jouer dans l’extinction de ce peuple[103].
L’effet culturel de la politique française est un problème historiographique plus intéressant. Selon une interprétation, le scalp n’aurait été connu pendant la période précolombienne que des peuplades du Saint-Laurent, des Grands Lacs et du bas de la vallée du Mississipi. L’arrivée des Européens a traditionnellement été tenue pour cause de la propagation de cette coutume à travers l’ouest américain : les rivalités économiques et internationales des Européens intensifièrent des conflits tribaux qui existaient auparavant ; l’introduction d’armes à feu ainsi que de pointes de flèches en fer rendirent ces guerres plus mortelles ; l’introduction de couteaux de fer facilita le prélèvement du scalp, qui jadis se pratiquait avec des couteaux de pierre ou d’os ; finalement, les récompenses offertes par les Européens encouragèrent des tribus à adopter cette pratique[104]. Or le bilan de nos recherches suggère que ces récompenses furent offertes exclusivement à des nations chez qui cette coutume était déjà établie depuis longtemps. Bien qu’il soit incontestable que l’arrivée des Européens, par l’intensification des conflits et l’apparition d’un outillage plus approprié, ait joué un rôle important dans la diffusion de la pratique du scalp, rien ne permet d’affirmer que les paiements offerts en Nouvelle-France y contribuèrent de façon directe ou indirecte.
Par ailleurs, plusieurs auteurs ont suggéré que la politique coloniale entraîna une corruption, une dégénérescence de la coutume autochtone. Certes, les témoins européens ne semblent pas avoir compris la signification culturelle profonde de la guerre et de l’enlèvement des chevelures chez les Premières nations. Aux yeux de Bougainville et de tant d’autres, la guerre n’était pour celles-ci que « l’occasion d’acquérir une grande renommée en levant une quantité prodigieuse de chevelures ». Ces dépouilles devenaient et demeuraient « leurs trophées, leurs obélisques, leurs arcs de triomphe ; les monuments qui attestent aux autres nations et consignent à la postérité, la valeur, les exploits des guerriers et la gloire de la cabane[105] ». Les interprétations récentes suggèrent de façon assez convaincante qu’il ne s’agit-là que d’une compréhension superficielle[106]. Et pourtant, l’opposition entre la logique militaire européenne et la logique guerrière amérindienne ne fut pas pour autant irréconciliable. Au contraire, les primes témoignent de leur complémentarité.
On a affirmé que les guerriers, devenus de véritables mercenaires, n’étaient plus motivés à combattre par les raisons traditionnelles (pour acquérir du prestige personnel et tribal, pour faire des captifs, etc.), mais plutôt par l’appât d’une récompense en marchandise. Le scalp devint tout simplement un moyen de gagner des biens, un « article de traite », et la coutume fut transformée en « business[107] ». Cette idée reçue n’est convaincante que si l’on s’en tient aux apparences trompeuses. Elle repose avant tout sur la présomption qu’on a affaire à une opération commerciale, c’est-à-dire que les chevelures étaient vendues par des autochtones qui trahissaient de façon plus ou moins consciente leurs coutumes en renonçant à la conservation de ces dépouilles. On a cité, à l’appui de cette thèse, l’anecdote d’un chef cherokee qui refusa de remettre aux autorités du Maryland les chevelures que ses hommes avaient prises. Citant comme cause qu’elles étaient des trophées les plus glorieux (et, on peut le supposer, parce qu’elles détenaient un sens spirituel), celui-ci préféra s’en retourner chez lui sans toucher de prime. En fait, c’est la destruction des scalps, en conformité avec la consigne de la législature du Maryland, que ce chef trouvait inadmissible. L’abandon de scalps en guise de présents (selon le bon vouloir des autochtones) ne paraît cependant pas avoir suscité les mêmes sentiments[108]. Au contraire, la chevelure était « le plus grand present que les Sauvages puissent faire, & ils pretendent faire connoître par là l’attachement qu’ils ont aux intérêts de ceux à qui ils le presentent[109]... ». Aussi, l’échange apparent d’un scalp pour une prime française (si celui-ci se produisait vraiment) doit être considéré non pas comme une opération commerciale, mais plutôt comme une opération diplomatique parfaitement conforme à la tradition amérindienne. L’affaire avait plus en commun avec les présentations rituelles de branches et de colliers de porcelaines lors des conseils qu’avec une transaction commerciale : le scalp était offert comme présent, afin de démontrer son dévouement à une cause et de raffermir une alliance, et la prime était offerte comme présent réciproque en considération du sentiment. En guise de preuve à l’appui, on notera que la politique française à l’égard des primes et des présents était ordonnée mais souple. Il arrivait assez souvent qu’on donnât aux partis qui revenaient de guerre bredouilles une quantité de marchandises équivalentes à celle qu’on donnait à ceux qui revenaient avec quelques chevelures. Ainsi, on reconnaissait qu’un guerrier, se voyant pressé par l’ennemi, n’avait souvent pas le temps de lever les chevelures de ceux qu’il avait tués ou se voyait obligé d’abandonner ses prises lorsqu’il était poursuivi.
On peut avancer l’hypothèse que les primes furent un leurre pour les autorités coloniales françaises. Comme nous l’avons de temps à autre signalé dans le cadre de cette étude, les documents des xviie et xviiie siècles soutiennent simplement que ces primes étaient offertes pour encourager les alliés à diriger des partis de guerre contre l’ennemi. Et pourtant, l’ensemble des présents inconditionnels qui leur étaient remis paraît avoir suffi à entretenir les alliances militaires et à inciter les guerriers à entreprendre des expéditions contre l’ennemi. Il se peut donc que les Français, en promettant de récompenser les scalps levés, cherchaient non seulement à ajouter une facette supplémentaire à cet ensemble de présents, mais surtout à assurer leur investissement en encourageant les Amérindiens à mener leurs expéditions jusqu’au bout. L’éthique guerrière autochtone permettait en effet aux membres d’un parti de rebrousser chemin sans y perdre honneur pour un grand éventail de raisons jugées banales par les Européens ; de même, elle permettait de considérer une expédition comme réussie (et donc terminée) dès qu’on avait fait une ou deux victimes[110]. Par la promesse d’une valeur fixe offerte pour chaque chevelure enlevée, on espérait sans doute inciter les guerriers à ne pas se contenter de si peu. Cependant, puisque la plupart de ceux auxquels on remit des primes ne rapportèrent qu’une ou deux dépouilles, on peut supposer que cette mesure n’eut pas l’effet escompté et que les autochtones demeuraient fidèles à leurs habitudes. Par sa politique de primes, les Français reconnaissaient et encourageaient la « guerre parallèle » que menaient leurs alliés. Les présents qu’on offrait pour équiper les partis de guerre lors de leur départ et les récompenses qu’on offrait à leur retour donnaient les moyens de combattre à des guerriers qui restaient toujours motivés par des objectifs et des principes propres à la logique amérindienne — recherche de prestige personnel et tribal, acquisition de matériel et de prisonniers. Le fait que les alliés des Français continuaient souvent à faire la guerre et à prendre des chevelures, après qu’on les eut averti de la cessation des hostilités et qu’on ne leur payerait plus leurs prises, démontre effectivement que la coutume n’était pas subordonnée aux politiques européennes[111].
Conclusion
Le paiement des scalps demeurera sans doute toujours un des aspects les plus controversés de la politique indigène française. Cependant, nous osons espérer que cette brève étude saura jeter la lumière sur le sujet et remettre en question quelques idées reçues. S’il existe plusieurs interprétations erronées à ce sujet, c’est que la matière est bourrée d’apparences trompeuses. Une ressemblance superficielle entre les politiques françaises et anglaises quant au paiement des chevelures a poussé de nombreux auteurs à généraliser et à parler de politiques « européennes ». Et pourtant, on constate bel et bien l’existence d’une politique française cohérente et unifiée, contraire sur bien des plans aux mesures analogues adoptées par les autorités britanniques vers la même époque. Cette dissimilitude fut le produit de contextes coloniaux bien différents, principalement en ce qui concerne la façon de percevoir les autochtones. Alors que les Amérindiens étaient généralement perçus par les habitants des colonies britanniques comme une entrave au peuplement du nouveau continent, leurs voisins français reconnurent très tôt que leurs alliances étaient nécessaires si l’on voulait assurer la survie et la vigueur de la colonie. Cependant, pour assurer la survie et la vigueur de ces alliances, les Français devaient distribuer de grandes quantités de présents. La prime doit être considérée non pas comme un paiement offert pour l’achat d’une dépouille, mais plutôt comme un type de présent parmi tant d’autres. On considérait que de tels paiements étaient un des moyens les plus efficaces et économiques de mener une guerre agressive et soutenue. Il est malheureusement impossible de confirmer qu’ils eurent tout l’effet escompté : bien qu’on puisse supposer que les primes, comme les présents, donnèrent à des guerriers qui y étaient disposés les moyens de prendre le sentier de la guerre, il est extrêmement douteux que certains partirent au combat uniquement dans le but de lever des chevelures, afin de toucher cette récompense. Rien ne permet de croire que les Amérindiens menèrent leurs expéditions de façon plus agressive qu’ils ne l’auraient fait autrement ; ce soutien matériel ne faisait que faciliter des entreprises qu’ils menaient comme ils l’entendaient.
Ce qu’il faut retenir avant tout, c’est que les primes, bien qu’elles aient contribué à inciter au combat les alliés des Français, n’atteignirent pas leur véritable objectif. Il est vrai que les raids dévastateurs encouragés en partie par cette mesure permirent de limiter, pour un temps, l’expansion britannique. Néanmoins, la doctrine de la petite guerre, et par extension la politique du paiement des chevelures, bien qu’elle fût une réussite tactique, demeura un échec stratégique car, bien qu’elle terrorisât les colons, elle ne parvint jamais à étouffer les foyers de la puissance britannique en Amérique. Elle se retourna même contre la Nouvelle-France : le sentiment de crainte et d’impuissance ressenti dans les colonies britanniques se muta en une agressivité qui rendit possible la Conquête. La « guerre contre le terrorisme » n’est pas une invention du xxie siècle !
Appendices
Notes
-
[1]
L’auteur tient à remercier Jan Grabowski, sous la direction duquel ce mémoire de recherche a été entrepris, ainsi que les évaluateurs de la Revue pour leurs commentaires judicieux.
-
[2]
C’est surtout à l’article de James Axtell et William Sturtevant que l’on doit cette démythification : « The Unkindest Cut, or Who Invented Scalping ? », William & Mary Quarterly, 37,3 (1980) : 451-472. Dorénavant W&MQ.
-
[3]
A. Starkey, European and Native American Warfare, 1675-1815 (Norman, University of Oklahoma Press, 1998), 12-13 ; Cornelius J. Jaenen, Friend and Foe : Aspects of French-Amerindian Cultural Contact in the Sixteenth and Seventeenth Centuries (New York, Columbia University Press, 1976), 120 ; Roland Viau, Enfants du néant et mangeurs d’âmes : guerre, culture et société en Iroquoisie ancienne (Montréal, Boréal, 2000), 110-118.
-
[4]
J. Axtell et W. Sturtevant, loc. cit., 470 ; James Axtell, The European and the Indian : Essays in the Ethnohistory of Colonial North America (New York, Oxford University Press, 1981), 223 ; Georg Friederici, Skalpieren und Ähnliche Kriegsgebräuche in Amerika (Braunschweig, 1906), 46-47, 56.
-
[5]
C’est l’ouvrage d’Axtell qui demeure la meilleure synthèse sur ce sujet. Op. cit.
-
[6]
G. Friederici, op. cit., 2, 5 ; W. Smith, Relation historique de l’expédition contre les Indiens de l’Ohio en MDCCLXIV (Amsterdam, Chez Marc-Michel Rey, 1769), 13.
-
[7]
La Guerre de la Ligue d’Augsbourg, entamée en Europe dès 1688, ne s’étendit aux colonies nord-américaines que l’année suivante. Le traité de Ryswick y mit fin en 1697.
-
[8]
R. Viau, op. cit., 111 ; J. Axtell et W. Sturtevant, loc. cit., 470 ; J. Axtell, op. cit., 244 ; G. Friederici, op. cit., 47-48.
-
[9]
Déposition de Magsigpen, 15 septembre 1688, dans Broadhead, O’Callaghan et Fernow, Documents Relative to the Colonial History of the State of New York (Albany, Weed & Parsons, 1853-1887), III : 561-562. Dorénavant CDNY.
-
[10]
Dépositions de John Rosie et de Derrick Wessells, 25 septembre 1688, CDNY, III : 563-564.
-
[11]
Communication du magistrat de Schenectady, 29 septembre 1688, CDNY, III : 565.
-
[12]
Denonville à Andros, 23 octobre 1688, CDNY, III : 569-570.
-
[13]
Champigny au Ministre, 19 octobre 1688, dans Blanchet et Faucher de Saint-Maurice, Collection de manuscrits contenant lettres, mémoires et autres documents historiques relatifs à la Nouvelle-France (Québec, 1883-1885), I : 439, 444. Dorénavant Coll. Man.
-
[14]
Thérèse Prince-Falmagne, Un marquis du grand siècle, Jacques-René de Brisay de Denonville, gouverneur de la Nouvelle-France, 1637-1710 (Montréal, Leméac, 1965), 203-205.
-
[15]
Ibid., 201-202, 230 ; J. Leclerc, Le marquis de Denonville : gouverneur de la Nouvelle-France, 1685-1689 (Montréal, Fides, 1976), 219, 267 ; Mémoire sur l’état présent des affaires du Canada, 27 octobre 1687, Archives nationales du Canada, MG1 C11A, vol. 9, fol. 133. Dorénavant ANC.
-
[16]
Gédéon de Catalogne, « Recueil de ce qui s’est passé au Canada, au sujet de la guerre tant des Anglais et des Iroquois, depuis l’année 1682 », dans Robert Le Blant, Histoire de la Nouvelle-France (Dax, P. Pradeau, 1940), 213-214.
-
[17]
Par exemple, il place à l’hiver de 1688 une attaque contre Albany qui eut lieu en 1690 et à l’hiver de 1692 une expédition organisée au début de 1693. Ibid., 194, 227.
-
[18]
Frontenac et Champigny au Ministre, 11 novembre 1692, Rapport de l’Archiviste de la Province de Québec, 1927-28, 125. Dorénavent RAPQ.
-
[19]
Au sujet de cette politique de petite guerre, voir W. J. Eccles, Frontenac : The Courtier Governor (Toronto, McClelland and Stewart, 1968), chapitres 13 et 15 en particulier.
-
[20]
Le 2 juillet 1689, l’assemblée du Massachusetts convint de payer 8 livres aux Agniers pour chaque tête ou scalp de combattant ennemi qu’ils rapporteraient, afin de susciter leur aide contre les Abénaquis. Colin G. Calloway, dir., Dawnland Encounters, Indians and Europeans in Northern New England (Hanover, University Press of New England, 1991), 144-145.
-
[21]
Mémoire du roi à Frontenac et Champigny [s.d.], RAPQ 1927-28, 139, 143-144.
-
[22]
Frontenac et Champigny au Ministre, 4 novembre 1693, RAPQ 1927-28, 174.
-
[23]
Champigny au Ministre, 4 novembre 1693, ANC, MG1 C11A, vol. 12, fol. 267-267v.
-
[24]
Frontenac et Champigny au Ministre, 9 novembre 1694, RAPQ 1927-28, 202.
-
[25]
Mémoire du roi à Frontenac et Champigny, [s.d.], RAPQ 1927-28, 90-91.
-
[26]
Mémoire du roi à Frontenac et Champigny, 14 juin 1695, Coll. Man., vol. II, 183.
-
[27]
Frontenac et Champigny au Ministre, 10 novembre 1695, ANC, MG1 C11A, vol. 13, fol. 302.
-
[28]
« Extrait d’une lettre écrite, en 1703, par M. D*** à son frère » dans Cyprien Tanguay, À travers les registres... (Montréal, 1886 [1978]), 91-95.
-
[29]
« Extrait en forme de journal », 1748, Coll. Man., III : 414.
-
[30]
Paroles des Abénakis et de Vaudreuil, 14 septembre 1706, Coll. Man., II : 457, 459.
-
[31]
Sunderland au Council of Trade and Plantations, 24 mai 1709, dans Cecil Headlam, Calendar of State Papers, Colonial Series, America and West Indies, 1708-1709 (London, H. M. Stationary Office, 1922), document 533 ; Dudley au Council of Trade and Plantations, 1er mars 1709, ibid., doc. 391 ; Vaughan au Council of Trade and Plantations, 16 juillet 1708, ibid., doc. 19.
-
[32]
R. D. Edmunds et J. L. Peyser, The Fox Wars : The Mesquakie Challenge to New France (Norman, University of Oklahoma Press, 1993), 129, 168.
-
[33]
Hocquart au Ministre, 3 octobre 1741, ANC, MG1 C11A, vol. 75, fol. 329-330 ; Beauharnois au Ministre, 24 septembre 1742, ibid., vol. 77, fol. 108-112v.
-
[34]
Relation de Pénicaut, dans P. Margry, Mémoires et documents pour servir à l’Histoire des origines françaises des pays d’outre-mer (Paris, Maisonneuve et C. Leclerc, 1879-1888), V : 435.
-
[35]
Délibérations du Conseil de la Louisiane, 8 février 1721 et al., ANC, MG1 C13A, vol. 7, fol. 141v-143 ; Bienville au Conseil de la Marine, 8 août 1721, ibid., vol. 6, fol. 172-72v.
-
[36]
P. Margry, op. cit., vol. V, 480, 483 ; Le Petit à d’Avaugour, 12 juillet 1730, dans Reuben Gold Thwaites, dir., The Jesuit Relations and Allied Documents (Cleveland, Burrows, 1898-1901), LXVIII : 194. Dorénavant Jes. Rel. Voir aussi la correspondance louisianaise : ANC, MG1 C13A, vol. 18, fol. 177-178v ; vol. 19, fol. 109-110, 148v-149v, 157v-158, 169.
-
[37]
Journal de la campagne faite par le détachement du Canada sur les Chicachas en février 1740, 15 juin 1740, dans RAPQ 1922-1923, 178.
-
[38]
« Réflexions générales sur les mesures à prendre pour la défense de cette colonie », 1758, ANC, MG1 C11A, vol. 103, fol. 200.
-
[39]
Paroles des Iroquois, Loups et Chouanons venant du fort Duquesne et réponse de Monsieur de Neyon, novembre 1760, Coll. Man., IV : 281-282.
-
[40]
C. C. Bacqueville de la Potherie, Voyage de l’Amérique (Amsterdam, Chez Henry des Bordes, 1723), II : 123.
-
[41]
J. C. B., op. cit., 114 ; D’Aleyrac, op. cit., 35.
-
[42]
Frontenac et Champigny au Ministre, 9 novembre 1694, RAPQ 1927-28, 202 ; Vaudreuil au Ministre, 8 juin 1756, ANC, MG1 C11A, vol. 101, fol. 22 ; « Reflexions politiques et militaires sur le Canada pour servir à son rétablissement » [s.d.], ANC, MG1 C11E, vol. 10, fol. 270.
-
[43]
Frontenac et Champigny au Ministre, 4 novembre 1693, RAPQ 1927-28, 174 ; État de la dépense..., ANC, MG1 C11A, vol. 113, fol. 77-77v.
-
[44]
J. F. Lafitau, Moeurs des sauvages ameriquains comparées aux moeurs des premiers temps (Paris, Chez Saugrain l’aîné, 1724), III : 232-233.
-
[45]
Duquesne au ministre, 10 octobre 1754, Coll. Man., III : 515-516.
-
[46]
C. Tanguay, op. cit., 91-95. Tanguay suggère que le Dubosq dont parle cette lettre serait le Dubos mentionné par Charlevoix, ce qui place ces événements vers 1697.
-
[47]
G. du Boscq de Beaumont dir., Les derniers jours de l’Acadie (1748-1758), Correspondances et mémoires : Extraits du portefeuille de M. Le Courtois de Surlaville (Genève, Slatkine-Megariotis Reprints, 1975 [1899]), 187.
-
[48]
Un rare « Bordereau des dépenses générales dont les acquis ont été payés par le trésorier de Québec sur les fonds de l’exercice de l’année [1748] depuis le premier janvier jusqu’au dernier septembre de ladite année » est très descriptif. On y retrouve une vingtaine d’entrées où l’on indique parfois le nom, sinon au moins l’origine géographique des chefs et des guerriers qui reçurent des paiements pour des scalps. Ce sont des Abénaquis de Bécancour, des guerriers de Narantsouak, de Penadranske, de Chedaye et de l’Île Royale qui figurent dans cette liste. Sur une vingtaine de partis, un peu plus de la moitié ne rapportèrent qu’une seule chevelure ou un seul prisonnier, quelques-uns rapportèrent quelques prisonniers et quelques chevelures ; un chef de l’Île Royale apporta onze chevelures. 1er novembre 1748, ANC, MG1 C11A, vol. 138, partie 1, fol. 241-242.
-
[49]
« État de la dépense qui a été faite à Québec à l’occasion de la guerre pendant les années 1746 et 1747 » signé Hocquart, 15 octobre 1747, ANC, MG1 C11A, vol. 88, fol. 206 ; Frontenac et Champigny au Ministre, 9 novembre 1694, RAPQ 1927-28, 202 ; D’Aleyrac, op. cit., 35, 38.
-
[50]
P. Mancall, « Scalp Bounties » dans Alan Gallay, dir., Colonial Wars of North America, 1512-1763, An Encyclopedia (New York, Garland, 1996), 669-670. Il faut peut-être y voir un reflet de la confiance qu’avaient les colons britanniques en leurs propres moyens militaires... ou plutôt de la méfiance et du dédain qu’ils avaient à se servir d’autochtones comme troupes auxiliaires.
-
[51]
C. C. Bacqueville de la Potherie, Histoire de l’Amérique septentrionale (Paris, Chez Jean-Luc Nion et François Didot, 1722), II : 296 ; A. F. Lucier, dir., French and Indian War Notices Abstracted from Colonial Newspapers (Bowie, Heritage Books, 1999), I : 230 ; C. Le Clerq, Premier etablissement de la foy dans la Nouvelle France (Paris, Chez Amable Auroy, 1691), 293 ; Margry, op. cit., V : 480 ; F. Parkman, Montcalm and Wolf (Boston, Little, Brown, 1884), II : 221.
-
[52]
Margry, op. cit., 479-480.
-
[53]
Voir, par exemple, Note de service sur l’Acadie, 1748, ANC, MG1 C11D, vol. 10, fol. 144-145 ; Bordereau, 20 décembre 1756, ANC, MG1 C11B, vol. 36, fol. 241-242 ; P. Margry, op. cit., V : 435. Comme nous l’avons mentionné plus haut, il y eut une certaine diminution des sommes offertes vers la fin de la Guerre de Sept Ans. James de Lancey et Charles Craven à William Johnson, 13 août 1756, The Papers of Sir William Johnson (Albany, University of the State of New York, 1921-1965), I : 541 ; Déposition de Jean Nerban, 27 juin 1757, ibid., 719.
-
[54]
Voir, par exemple, RAPQ, 1927-28, 125 ; ANC, MG1 C11D, vol. 10, fol. 144-145 ; ANC, MG1 C11B, vol. 36, fol. 241-242 ; P. Margry, op. cit., V : 435.
-
[55]
Frontenac et Champigny au Ministre, 4 novembre 1693, RAPQ 1927-28, 174.
-
[56]
Prévost au Ministre, 16 août 1753, ANC, MG1 C11B, vol. 33, fol. 197v.
-
[57]
Paroles de La Jonquière, 1751, ANC, MG1 C11A, vol. 97, fol. 42.
-
[58]
Vaudreuil au Ministre, 17 septembre 1747, ANC, MG1 C13A, vol. 31, fol. 98-101 ; Louboey au Ministre, 16 février 1748, ibid., vol. 32, 211-212 ; Vaudreuil au Ministre, 5 novembre 1748, ibid., 122.
-
[59]
W. Douglass, A Summary, Historical and Political, of the First Planting, Progressive Improvements, and Present State of the British Settlements in North-America (Boston, R. Baldwin, 1755), 557.
-
[60]
R. Viau, op. cit., 111 ; J. Axtell et W. Sturtevant, loc. cit., 471.
-
[61]
A. Starkey, op. cit., 30.
-
[62]
Journal de Bougainville, RAPQ 1923-24, 260 ; Vaudreuil à Lévis, 26 juillet 1756, 14 août 1756, 12 septembre 1758, dans H.-R. Casgrain, dir., Collection des manuscrits du maréchal de Lévis : lettres du marquis de Vaudreuil au chevalier de Lévis (Québec, 1895), XVIII : 15, 26, 55. Dorénavant Mss. Lévis.
-
[63]
Relation de M. Poulariès à Montcalm, RAPQ 1931-32, 62 ; D. K. Richter, « War and Culture : The Iroquois Experience », W&MQ, 40,4 (1983) : 534-535 ; R. Viau, op. cit., 138-199.
-
[64]
« État des paiements qui ont été ordonnées à Montréal pour les diverses dépenses faites à l’occasion de la guerre pendant les quatre derniers mois de 1746 et les huit premiers mois de la présente année 1747 », 1er septembre 1747, ANC, MG1 C11A, vol. 88, 241-242.
-
[65]
« État de la dépense qui a été faite à Québec à l’occasion de la guerre pendant les années 1746 et 1747 », 15 octobre 1747, ANC, MG1 C11A, vol. 88, fol. 206.
-
[66]
« Bordereau des dépenses générales... », 1er novembre 1748, ANC, MG1 C11A, vol. 138, partie 1, fol. 241-242.
-
[67]
Frontenac et Champigny au Ministre, 9 novembre 1694, RAPQ 1927-28, 202.
-
[68]
« Remarques sur ce qui paroist important au service du Roy pour la conservation de la Nouvelle France » [s.d., vers 1691], ANC, MG1 C11A, vol. 11, fol. 275.
-
[69]
Hans Reese, « The History of Scalping and Its Clinical Aspects », The 1940 Year Book of Neurology, Psychiatry and Endocrinology (Chicago, Year Book Publishers, 1940), 17. Cette affirmation invraisemblable paraît avoir été le fruit d’un quiproquo impliquant la contrebande des peaux de castor, qui eut longtemps cours entre les colonies anglaises et françaises.
-
[70]
J. P. Baxter, The Pioneers of New France in New England (Albany, J. Munsell, 1894), 266 ; F. Parkman, Count Frontenac and New France (New York, Literary Classics of the United States, 1983 [1899]), 217. Bien que plausible, nos recherches ne permettent pas de confirmer l’existence de cette pratique.
-
[71]
Lettre du père Roubaud, 21 octobre 1757, dans Jes. Rel., LXX : 188.
-
[72]
A. F. Lucier, op. cit., I : 311-312.
-
[73]
Ce phénomène, qu’on nommait alors private scalping, paraît avoir beaucoup fait souffrir les plus faibles nations alliées aux Britanniques. A. Starkey, op. cit., 31.
-
[74]
J. C. B., Voyage au Canada dans le nord de l’Amérique septentrionale fait depuis l’an 1751 à 1761 (H.-R. Casgrain, dir., [Québec], 1887), 115.
-
[75]
Journal de Bougainville, RAPQ 1923-24, 281.
-
[76]
J. C. B., op. cit., 115. ; Frontenac et Champigny au Ministre, 4 novembre 1693, RAPQ 1927-28, 174.
-
[77]
Diron au Ministre, 15 juillet 1734 et 1er septembre 1734, ANC, MG1 C13A, vol. 19, fol. 123, 127-135 ; Bienville au ministre, 26 août 1734, ibid., vol. 18, fol. 179, 183-186.
-
[78]
Diron au Ministre, 15 juillet 1734, ibid., vol. 19, fol. 123-124.
-
[79]
J. Axtell, op. cit., 218, 220.
-
[80]
L’utilisation, fort rare d’ailleurs, du terme « racheté » (on utilisait généralement le terme « payé ») est le seul indice que nous ayons trouvé dans le cadre de nos recherches qui suggérerait que les scalps étaient échangés. Cependant, étant donné le contexte syntaxique où ce terme apparaît — lorsqu’on parle du « rachat de prisonniers et de chevelures angloises », par exemple — on peut estimer qu’il s’agit-là d’un usage trompeur du langage et considérer que cet indice n’est pas du tout convaincant. Voir par exemple l’état de la dépense, signé Hocquart, 15 octobre 1747, ANC, MG1 C11A, vol. 88, fol. 206.
-
[81]
J. Axtell, op. cit., 220 ; Frontenac à M. de Langy, 2 novembre 1695, RAPQ 1928-29, 268.
-
[82]
Journal de Bougainville, 12 juillet 1758, RAPQ 1923-24, 343 ; Robert Rogers, Journals of Major Robert Rogers (Londres, J. Millan, 1765), 154.
-
[83]
Thomas Abler, « Scalping, Torture, Cannibalism and Rape : An Ethnohistorical Analysis of Conflicting Cultural Values in War », Anthropologica, 34,1 (1992) : 13.
-
[84]
Journal de Bougainville, RAPQ 1923-24, 228 ; voir, dans la même veine, Le Petit à D’Avaugour, 12 juillet 1730, dans Jes. Rel., vol. LXVIII : 198.
-
[85]
Mémoire du roi à Frontenac et Champigny, 14 juin 1695, Coll. Man., II : 183 ; Frontenac et Champigny au Ministre, RAPQ 1927-28, 139, 143-144.
-
[86]
Maurepas à Bienville, ANC, MG1 C13A, vol. 19, 237.
-
[87]
Saint-Vallier, Estat présent de l’Église et de la colonie française dans la Nouvelle-France (Québec, A. Coté, 1856 [1688]), 98-99. Voir aussi C. Le Clerq, op. cit., 1691, 244.
-
[88]
« Lettres de M. l’Abbé Maillard sur les Missions de l’Acadie et particulièrement des Missions Micmacques » dans Les Soirées Canadiennes (1863), 323-324 ; dans la même veine, voir la Relation des Jésuites de 1644-1645, Jes. Rel., XXVII : 234.
-
[89]
Lettre de Jacques Bruyas, 21 janvier 1668, dans Jes. Rel., LI : 128 ; Claude Dablon, Relation de ce qui s’est passé de plus remarquable aux missions des pères de la Compagnie de Jesus en la Nouvelle France, les annés 1672 et 1673 (New York, Presse Cramoisy, 1861 [1673]), 129.
-
[90]
Relation de M. Poulariès, loc. cit., 61-62. À la lumière d’un témoignage pareil, la suggestion que l’adoption d’une politique de prime par les Français serait une indication que la conversion des domiciliés avait réduit leur goût pour la guerre et la brutalité paraît peu vraisemblable. C. Jaenen, op. cit., 127.
-
[91]
Prévost au Ministre, 16 août 1753, ANC, MG1 C11B, vol. 3, fol. 229-236.
-
[92]
Susan W. Henderson, The French Regular Officer Corps in Canada, 1755-1760 : A Group Portrait, thèse de Ph.D, University of Maine, 1975, 159-165. En ce qui a trait au stéréotype du noble Sauvage dans la littérature française : Olive P. Dickason, Le mythe du sauvage (Sillery, Septentrion, 1993) ; Gilbert Chinard, L’Amérique et le rêve exotique dans la littérature française au xviie et au xviiie siècles (Paris, Droz, 1934).
-
[93]
Martin Lathe Nicolai, On a Distant Campaign : French Officers and their Views on Society and the Conduct of War in North America During the Seven Years’ War, mémoire de maîtrise, Queen’s University, 1986, 192-193.
-
[94]
Montcalm à Lévis, 2 août 1759, Mss. Lévis, VI : 213.
-
[95]
Cet avis fut tout de même tenu par certains. Voir, par exemple Couagne à Ascaron, 4 novembre 1760, ANC, MG1 C11C, vol. 8, fol. 88v.
-
[96]
D’Aleyrac, op. cit., 44.
-
[97]
La Corne au Ministre, 1er octobre 1747, ANC, MG1 C11A, vol. 89, fol. 192.
-
[98]
Exemples de plaintes : Lettre de Dudley à Vaudreuil, 21 août 1704, Coll. Man., I : 426 ; « Message que Hagouirrès, Sauvage du village de Gannaouaghe est chargé de rendre au gouverneur de Canada » [16 juillet 1744], ANC, MG1 C11A, vol. 81, 340 ; Pierre-François-Xavier de Charlevoix, Histoire et description générale de la Nouvelle France (Paris, Chez la veuve Ganeau, 1744), III : 341.
-
[99]
Exemple de réponses : Réponse de Hocquart, 22 juillet 1744, ANC, MG1 C11A, vol. 81, fol. 341-346 ; Vaudreuil à Nicholson, 11 janvier 1711, cité dans C. Jaenen, Les relations franco-amérindiennes en Nouvelle-France et en Acadie (Ottawa, Affaires indiennes et du Nord Canada, 1985), 144 ; Frontenac à Bellomont, 21 septembre 1698, dans Charlevoix, op. cit., III : 343-346 ; Vaudreuil à Dudley, 26 mars 1705, Coll. Man., II : 430 ; Vaudreuil à Saunders, 1759, cité dans J.-A. Maurault, Histoire des Abenakis, depuis 1605 jusqu’à nos jours (Sorel, 1866), 483.
-
[100]
Les Français furent outragés — ou plutôt feignirent d’être outragés — par les mesures de leurs ennemis, mais beaucoup plus rarement et avec moins de vigueur que ceux-ci. Beauharnois à Shirley, 26 juillet 1747, Coll. Man., III : 375 ; J. P. Baxter, op. cit., 328.
-
[101]
Goldsbrow Banyar à William Johnson, 26 juillet 1755, The Papers of Sir William Johnson, I : 772-773 ; S. G. Drake, A Particular History of the Five Years French and Indian War in New England and Parts Adjacent (Albany, J. Munsell, 1870), 133-134.
-
[102]
Voir par exemple, Charlevoix, op. cit., IV : 84.
-
[103]
À ce sujet, voir Ingeborg Marshall, A History and Ethnography of the Beothuk (Montréal, McGill-Queen’s University Press, 1996), 46-48 ; Frederick Rowe, Extinction : The Beothuks of Newfoundland (Toronto, McGraw-Hill Ryerson, 1977), 103 ; L. F. S. Upton, « The Extermination of the Beothuks », Canadian Historical Review, 58,2 (1977) : 146-150.
-
[104]
C. Jaenen, op. cit., 126-127.
-
[105]
Journal de Bougainville, 12 juillet 1758, RAPQ 1923-24, 343.
-
[106]
J. Axtell, op. cit., 214 ; R. Viau, op. cit., 110-118.
-
[107]
D’Aleyrac, op. cit., 48n ; R. Viau, op. cit., 110 ; A. Starkey, op. cit., 31 ; Mancall, loc. cit., 669 ; Abler, loc. cit., 7 ; Patricia Dillon Woods, The Relations Between the French of Colonial Louisiana and the Choctaw, Chickasaw and Natchez Indians, 1699-1762, thèse de Ph.D, Louisiana State University, 1978, 149.
-
[108]
J. Axtell, op. cit., 214, 219-220.
-
[109]
Bacqueville de la Potherie, Voyage de l’Amerique, III : 129.
-
[110]
Journal de Bougainville, RAPQ 1923-24, 346.
-
[111]
Duquense au Ministre, 10 octobre 1754, Coll. Man., III : 515-516.