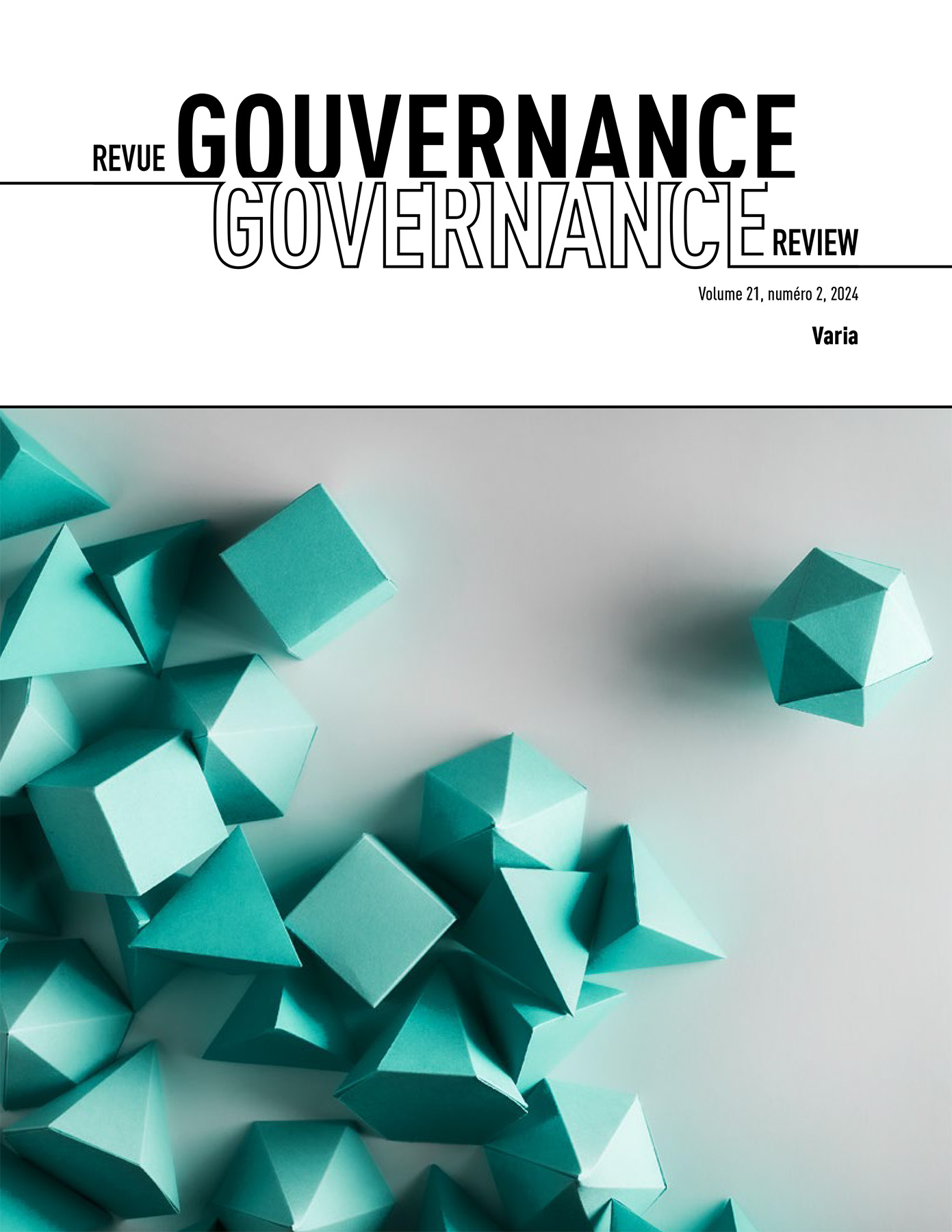Abstracts
Résumé
Cet article se consacre à une analyse approfondie des mécanismes complexes inhérents au transfert et à la réception du budget participatif en République démocratique du Congo. Il met en exergue les facteurs critiques qui expliquent l’échec des Instruments d’action publique (IAP) promus en Afrique par des organisations internationales de développement, à l’instar de la Banque mondiale. En s’appuyant sur les théories du transfert de politiques et des IAP, cette étude dissèque les relations subtiles qui prévalent entre la Banque mondiale, le gouvernement congolais et les entités territoriales décentralisées (ETD) dans le contexte du budget participatif. La méthodologie de l’enquête repose sur une série d’entretiens menés auprès des divers acteurs impliqués dans le processus de transfert et de réception. Les résultats obtenus mettent en lumière le rôle prépondérant des consultants de la Banque mondiale qui ont orienté le budget participatif en fonction des priorités et des intérêts institutionnels de la Banque plutôt que de ceux des autorités congolaises. Malgré l’acceptation formelle du budget participatif par ces dernières, un soutien politique et financier substantiel pour une mise en oeuvre réussie n’a pas accordé. De plus, le budget participatif est déployé au sein des ETD, où les autorités nationales maintiennent un contrôle financier, et où les autorités locales ne sont pas prêtes à partager le pouvoir avec les citoyens, bloquant ainsi la redevabilité.
Mots-clés :
- budget participatif,
- transfert d’Instrument d’action publique,
- Banque mondiale,
- décentralisation,
- autorités nationales,
- République démocratique du Congo
Abstract
This article undertakes an in-depth analysis of the intricate mechanisms pertaining to the transfer and reception of the participatory budget in the Democratic Republic of Congo. It highlights critical factors that account for the inefficacy of Public Action Instruments (PAIs) advocated in Africa by international development organizations such as the World Bank. Building on policy transfer and PAI theories, this study dissects the nuanced relationships that prevail between the World Bank, the Congolese government, and the decentralized territorial entities (DTEs) in the context of the participatory budget. The research methodology includes a series of interviews conducted with a variety of stakeholders engaged in the transfer and reception process. The findings reflect the pivotal role of World Bank consultants, who steered the participatory budget in alignment with the Bank’s institutional priorities and interests, as opposed to those of the Congolese authorities. Despite the formal endorsement of the participatory budget by Congolese authorities, they did not extend substantial political and financial support for its successful implementation. Moreover, participatory budget is implemented within decentralized territorial entities where national authorities maintain financial control, and local authorities are not willing to share power with citizens, thus hindering accountability.
Keywords:
- participatory budget,
- transfer of public action instrument,
- World Bank,
- decentralization,
- national authorities,
- Democratic Republic of Congo
Article body
Introduction
L’analyse des politiques publiques en Afrique révèle l’influence qu’ont les organisations internationales sur le choix et l’appropriation d’instruments par les acteurs nationaux. Les Programmes d’ajustement structurels (PAS) des années 1970-1980 ont imposé des mesures néolibérales, affaiblissant ainsi les administrations africaines (Lavigne Delville, 2016 ; Badie, 1992 ; Harrison, 2010). Les échecs des PAS ont conduit à la réorganisation des stratégies d’intervention dans les années 1990 (Soriat, 2020 ; Mathieu et Lavigne-Delville, 2020).
La participation citoyenne a alors émergé, plaçant les citoyens au coeur de l’action publique (Sintomer et Blondiaux, 2002). Les organisations de développement ont adopté ce discours, traitant les citoyens comme des acteurs du changement (Parizet, 2016). La Banque mondiale (BM) a recommandé la participation dans ses projets avec le Budget participatif (BP) comme principal instrument encouragé (Goldfrank, 2012). Le BP implique les citoyens dans les décisions sur l’allocation des fonds publics municipaux (Sintomer, Herzberg et Allegretti, 2014). Il a été diffusé à l’échelle mondiale avec des « ambassadeurs » le promouvant (Porto de Oliveira, 2016). Il s’est exporté du Brésil vers d’autres pays d’Amérique latine (Abers, 2000 ; Baiocchi, 2005 ; Avritzer, 2006 ; Gret, 2002). En Europe, le BP a été diffusé via des réseaux d’experts et d’organisations régionales (Garibay, 2015 ; Sintomer, Herzberg et Rocke, 2008). Des adaptations ont été nécessaires entre le BP de Porto Alegre et celui de l’Europe (Sintomer, Herzberg et Rocke, 2008).
En Afrique, l’ONU-Habitat et la BM ont favorisé la mise en oeuvre du BP (Porto de Oliveira, 2010, 2017a, 2017b). Des « ambassadeurs du BP » ont contribué à son implantation (Porto de Oliveira, 2016). Certains considèrent le BP comme un échec (Manduna, Zinyama et Nhema, 2015 ; Sintomer, Herzberg et Allegretti, 2014) en Afrique, notamment en RDC (Kanyurhi, 2018 ; Batumike, 2014).
Partant de ce constat, cet article entreprend une démarche différente en mettant plutôt l’accent sur le processus de transfert du BP et sa réception par les autorités congolaises. L’objectif est de démêler les dynamiques complexes entre la BM, le gouvernement congolais et les ETD pour comprendre les diverses influences et les enjeux explicatifs de l’échec du BP. Ainsi, notre réflexion s’articule autour des questions suivantes : comment comprendre le transfert du BP en RDC ? Quelle a été sa réception par les acteurs congolais, et quels sont les effets sur la mise en oeuvre ? Cet article argumente que le processus du transfert du BP en RDC s’est appuyé sur les intérêts institutionnels de la BM sans prendre en considération la complexité des enjeux sociopolitiques du pouvoir en RDC, ce qui fait que les autorités congolaises acceptent le BP de manière superficielle, sans réel engagement dans son succès. Cette absence de soutien se reflète dans la mise en oeuvre du BP, notamment en ce qui a trait aux ETD.
L’importance de cette étude réside dans sa capacité à mettre en lumière l’influence subtile de la BM sur l’orientation des politiques publiques en RDC. Dans l’optique de ce phénomène, cette analyse jette un éclairage précieux sur la manière dont les instruments sont implicitement imposés aux administrations africaines et détournés par les acteurs nationaux. Cette recherche est pertinente en ce qu’elle se fonde, d’une part, sur la grille d’analyse inspirée des travaux de Dolowitz et Marsh (1996, 2000) sur le transfert de politiques et, d’autre part, sur le travail qu’ont mené Lascoumes et Le Galès (2004) ainsi que Halpern, Lascoumes et Le Galès (2014) sur les instruments d’action publique (IAP). Ces deux grilles ont été développées dans un contexte occidental. Ce travail se distingue en ce qu’il met de l’avant la contribution africaine dans les débats sur le transfert des IAP et leur mise en oeuvre. Le transfert de politiques met l’emphase sur le rôle d’une série d’acteurs dans l’orientation du choix du BP par le gouvernement congolais. À ce sujet, nous verrons comment les consultants et les chercheurs recrutés par la BM ont réussi à faire circuler le BP en suivant les valeurs promues par la BM et en s’appuyant sur leur expertise et leur position. Cela dit, l’analyse inspirée de l’IAP déconstruit les fines stratégies de résistance développées par les autorités congolaises vis-à-vis du BP (Halpern et Lascoumes, 2011) afin de le détourner malgré l’acceptation de ce transfert de la BM.
Cette étude est issue de nos recherches doctorales. La méthodologie employée a permis d’analyser diverses sources : articles spécialisés, rapports de la BM, rapports gouvernementaux et actes juridiques tels que la Constitution de la RDC. Ces sources nous ont aidés à comprendre les théories et la mise en pratique du BP. Cependant, l’accès à certains documents a été difficile en raison de problèmes de conservation et de l’accès à l’information en RDC. Pour pallier ces limitations, des entretiens semi-directifs ont été réalisés et nous ont fourni des informations détaillées et nuancées.
Ainsi, nous avons mené 56 entretiens semi-directifs avec divers acteurs, y compris des consultants de la BM, des agents gouvernementaux, des bourgmestres et des membres de la société civile. Ces entretiens ont été réalisés en présentiel et en virtuel entre novembre 2021 et avril 2023. La collecte de données a nécessité des stratégies spécifiques d’établissement de confiance avec les participants, comme des rencontres initiales en personne et l’adaptation de nos méthodes en fonction des disponibilités des répondants. La pandémie de COVID-19 a également influencé notre approche, nécessitant des adaptations comme l’utilisation de plateformes virtuelles. Malgré ces défis, les entretiens ont permis de précieuses incursions dans l’expérience des acteurs quant aux défis et succès qu’ils ont rencontrés dans la mise en oeuvre du BP en RDC.
Cet article se structure comme suit : dans la première section, nous abordons le contexte général de la RDC, la deuxième section examine le processus du transfert du BP en RDC, et la troisième section se concentre sur la réception et la mise en oeuvre du BP au sein des ETD.
1. Le contexte général du BP en RDC
Le BP en RDC s’inscrit dans le cadre de deux réformes menées simultanément par le gouvernement central de la RDC : la décentralisation et la réforme de la gestion des finances publiques. Depuis l’indépendance du pays en 1960, la RDC fonctionnait sous un système centralisé plaçant tous les pouvoirs politiques, administratifs et financiers entre les mains des autorités centrales. Celles-ci nommaient et révoquaient les responsables politiques et administratifs des provinces comme des entités locales (Ndaywel, 2008). L’année 2006 marque la fin d’une longue transition politique débutée en 1990, qui fut suivie de conflits armés qui ont ensanglanté le pays entier. En 2006, donc, une nouvelle Constitution fut adoptée, augurant un nouvel ordre politique. Au cours des débats sur l’adoption de la Constitution, les constituants ont opté pour la décentralisation comme mode de gouvernance du pays (Englebert et Mungongo, 2016). La nouvelle Constitution stipule également que les dirigeants de toutes les institutions de l’État doivent être élus par les citoyens.
La nouvelle architecture administrative instaure trois paliers de gouvernement : le gouvernement central, les provinces et les ETD (Constitution du 18 février 2006). La répartition des compétences entre le gouvernement central et les provinces est définie dans la Constitution de 2006, qui distingue les compétences exclusives au gouvernement central et aux provinces des compétences pour lesquelles les deux niveaux concurrent (articles 201, 202, 203, 204 de la Constitution de la RDC). Par ailleurs, les compétences des ETD sont enchâssées aux Lois organiques : l’une porte sur la libre administration des provinces, et l’autre sur l’organisation et le fonctionnement des ETD. Toutes deux furent adoptées en 2008. Pour financer ces nouvelles entités, la Constitution prévoit que 40 % des recettes nationales doivent être allouées aux provinces, qui doivent à leur tour remettre 40 % de leurs recettes aux ETD, et ce, proportionnellement à leurs capacités contributives.
Parallèlement à ces réformes, le gouvernement central renoue sa coopération avec le Fonds monétaire international et la BM (COREF, 2010). Ces organisations internationales jouissent d’une expérience dans les pays post-conflits et aident le gouvernement congolais à diagnostiquer son appareil étatique ainsi qu’à créer une feuille de route et un calendrier des réformes à entreprendre (Trefon, 2010). Le diagnostic de la gestion des finances publiques fait état de plusieurs faiblesses : faible affectation du budget aux priorités de développement, incohérence entre le budget et les stratégies nationales de développement, manque de crédibilité budgétaire, pauvre contrôle des finances publiques, difficulté d’accès du public à l’information budgétaire, etc. (COREF, 2010).
Pour concrétiser les objectifs et résoudre les problèmes identifiés, les autorités nationales sollicitent, et obtiennent, le soutien de la BM. À cet égard, on met en place le Plan stratégique de la réforme des finances publiques (PSRFP) en 2010. Ce plan s’articule autour de plusieurs axes prioritaires et préconise l’instauration d’un budget-programme, le renforcement de la transparence dans le processus budgétaire et l’introduction de la participation citoyenne (PSRFP, 2010). Ceci advient après que les autorités nationales de la RDC, toujours avec le soutien de la BM, aient mis en oeuvre le Projet de renforcement des capacités en gouvernance (PRCG) dans quelques provinces du pays. Au moment de son échéance, c’est le Projet de renforcement de la redevabilité (PROFIT-CONGO), dans le cadre du PSRFP, qui voit le jour. Il a notamment comme objectif de réformer la gestion des finances publiques à l’échelle locale.
La particularité de ce projet réside dans le fait qu’il promeut et exige la participation citoyenne suivant la réforme des finances publiques au sein des ETD. Plus précisément, le BP est promu au niveau des ETD par la BM. La section qui suit explique le processus de transfert du BP et comment celui-ci a été diffusé en RDC.
2. Processus de transfert du BP
Dans cette section, nous discuterons des actions entreprises par ces chercheurs pour promouvoir le BP et du rôle des consultants dans l’orientation du BP lors de l’organisation du forum national.
2.1 Le travail précurseur des chercheurs congolais dans la promotion du BP au Sud-Kivu et à Kinshasa
En 2010, dans le cadre de son soutien à la réforme de la gestion des finances publiques au sein des ETD, la BM a commandé une étude de faisabilité du BP dans la province du Sud-Kivu. Pour cette étude, elle a sollicité des chercheurs locaux, dont une grande partie étaient des membres d’organisations de développement sélectionnés pour leurs connaissances du contexte congolais et leur expérience dans la promotion de la participation de la société civile à la gouvernance locale. Ces chercheurs ont joué un rôle crucial dans la diffusion du BP en RDC en organisant des conférences et en publiant des documents de recommandations à l’intention des autorités.
Leurs profils variés, allant du doctorat en science politique au doctorat en science économique, ainsi que leur expertise en développement local et en sensibilisation des autorités les ont rendus particulièrement aptes à mener l’étude. L’un d’eux, par exemple, est titulaire d’un doctorat en science politique de l’Université Paris 7 et a oeuvré en développement local pendant toute une décennie. Un autre est docteur en économie et professeur universitaire, en plus de diriger une organisation de la société civile qui produit des rapports trimestriels sur la gestion des finances publiques et la participation des organisations de la société civile. Pour produire leur rapport de recherche, ces chercheurs se sont appuyés sur les rapports trimestriels produits par les organisations locales de développement, que l’un d’eux gère d’ailleurs.
Pendant notre enquête de terrain, un chercheur qui a pris part à cette étude de faisabilité explique :
Je suis parmi ceux qui ont rédigé l’étude de faisabilité du BP. J’avais remarqué que les prévisions budgétaires du gouvernement provincial sont réalisées à 30 % et, pour les ETD, c’était pire : certaines n’atteignant même pas les 15 % du montant attendu. En revanche, les potentialités de la province m’ont convaincu que le BP était possible et allait être une opportunité de renflouer les caisses de l’État. Dans cette étude, nous avons montré que la solution de beaucoup de problèmes des ETD allait provenir du BP. Nous avons présenté nos résultats au gouverneur de la province, à qui nous avions expliqué l’importance d’un BP dans les ETD de la province
Chercheur A de la BM, juillet 2022
Ce sont ces recommandations de l’étude de faisabilité qui ont servi de base au lancement du programme pilote du BP dans les ETD de la province du Sud-Kivu. Deux ans plus tard, en 2014, après l’expérience pilote du BP au Sud-Kivu, la BM a commandé une deuxième étude pour démontrer l’adaptabilité du BP dans un contexte congolais et harmoniser ces initiatives participatives avec d’autres projets financés par des bailleurs comme l’Agence britannique de développement et la Coopération technique belge. Cette deuxième étude, intitulée La participation citoyenne aux finances publiques locales, visait à évaluer la participation citoyenne aux finances publiques locales en RDC, à cibler les bonnes pratiques dans le monde et à formuler des recommandations pour harmoniser la participation à l’échelle nationale (ministère des Finances, 2015, p. 2). Les conclusions de cette recherche ont suggéré que le BP est le seul instrument adapté à la mise en oeuvre d’une réforme de la gestion des finances publiques dans les ETD du pays. Un chercheur consultant de la BM qui a participé à cette étude a déclaré ce qui suit :
Nous devions recenser les initiatives de la participation citoyenne dans toutes les provinces de la RDC et proposer celle qui devrait être mise en place dans les ETD. À l’époque, plusieurs agences internationales proposaient chacune à sa manière des mécanismes de participation dans les ETD. Il fallait faire la synthèse de tous ces mécanismes pour expliquer leur théorie de changement et proposer un mécanisme approprié au contexte de la RDC. C’est après cette étude que nous avons proposé le budget participatif qui est mis en oeuvre actuellement »
Chercheur B, juillet 2022
Pour atteindre leurs objectifs, ces chercheurs ont mis en place plusieurs stratégies. Ils ont réalisé des études comparatives et synthétisé les bonnes pratiques internationales de manière à les adapter au contexte congolais. Ils ont également organisé des forums et des conférences pour diffuser leurs conclusions et obtenir l’adhésion des décideurs politiques.
Ces recherches ont permis aux acteurs congolais de comprendre l’utilité du BP dans la décentralisation et les réformes de gestion des finances publiques. Les travaux scientifiques ont servi d’arguments pour orienter la réforme des finances publiques au sein des ETD, et ce, en tenant compte de la rétroaction des autorités et des acteurs de la société civile.
Je dois vous avouer que j’entendais parler du BP, sans en connaître les contours. Lorsque les responsables du PRCG et de la BM m’ont envoyé les conclusions de l’étude qu’ils ont menée dans notre province, j’étais émerveillé. Cette étude a détaillé notre contexte et comment [sic] le BP allait renforcer la gouvernance de nos ETD. Et, comme j’avais déjà entendu des merveilles du BP, je n’ai pas hésité à donner mon accord »
Entretien avec le gouverneur de la province du Sud-Kivu, avril 2022
Les recherches ont non seulement démontré l’utilité du budget participatif dans les réformes de la gestion des finances publiques et la décentralisation en RDC, mais ont également servi de fondement pour élaborer des stratégies de mise en oeuvre adaptées au contexte local. Les recommandations issues de ces études ont permis de justifier l’adoption du BP comme instrument clé pour les ETD. Pour aller plus loin dans l’intégration de ces pratiques, le rôle des consultants internationaux s’est avéré crucial. En effet, la BM a mobilisé des experts de renommée internationale pour organiser des ateliers de renforcement des capacités et des forums de discussion soutenant la mise en place du BP.
2.2 Le rôle des consultants internationaux dans la promotion du BP dans le cadre des ateliers de renforcement des capacités et du forum national
Les résultats de recherches antérieures ont servi de base aux consultants recrutés par la BM pour diffuser leurs idées sur le BP. Ces derniers ont organisé des ateliers de renforcement des capacités ainsi que des sessions de formation pour améliorer les compétences en gestion des finances publiques et en participation citoyenne. Un forum national réunissant divers acteurs a aussi été organisé, où ces derniers ont pu discuter de l’orientation et de la mise en oeuvre du BP.
Le premier atelier de renforcement des capacités sur le BP en RDC s’est tenu à Murhesa, sur le territoire de Kabare au Sud-Kivu, du 25 au 29 avril 2011. Il a rassemblé des délégués issus des 27 ETD de la province. Cinq consultants internationaux soigneusement sélectionnés ont animé les sessions. Parmi eux, nommons un professeur d’université docteur en planification urbaine, territoriale et environnementale possédant une expérience en consultation pour la BM et la Commission européenne, ainsi qu’un consultant spécialisé en participation dans les pays en développement ayant collaboré avec le Programme des Nations-Unies pour le développement.
Dans le cadre de cet atelier, les consultants ont défini la participation au BP comme un remède à la pauvreté, largement causée, selon eux, par la mauvaise gouvernance et la corruption. Cette rhétorique a été utilisée pour justifier la plupart des ateliers de renforcement des capacités en BP.
J’ai été sélectionné en tant qu’animateur de cet atelier précédant le lancement du programme pilote du BP dans la province du Sud-Kivu. Les modalités de mon contrat ont explicitement insisté sur l’importance de puiser dans notre expérience pour ramener [sic] les Congolais vers le BP. Pour ma part, j’ai concentré mes efforts sur l’autonomisation des populations cibles, les incitant à devenir des acteurs du développement. C’est par ce canal que l’on peut combattre la pauvreté
Consultant international C, janvier 2023
Le Forum national sur le BP qui s’est tenu en novembre 2015 à Kinshasa a réuni divers acteurs qui ont discuté de la mise en oeuvre du BP dans l’ensemble des ETD du pays. Cet événement avait pour objectif d’élaborer des stratégies communes de promotion et de renforcement du processus à travers le pays. Les consultants internationaux ont développé un discours justificatif du BP. Leurs exposés portaient sur l’importance de l’accès à l’information et de la redevabilité pour garantir une transparence dans la gestion des finances publiques des ETD. Ils ont aussi insisté sur la décentralisation dans une bonne mise en oeuvre du BP. Selon eux, celui-ci permet au gouvernement de rendre son action transparente et de renforcer la participation citoyenne, favorisant ainsi une gestion plus inclusive et responsable des finances publiques. Parmi les consultants, l’un est reconnu comme architecte du BP en Afrique et possède une expertise pointue en gouvernance locale. Lors de notre entretien, il a formulé des critiques quant à la vision promue par la BM pour le BP, soulignant que la BM ne devrait pas dicter à quoi doit ressembler le BP dans les administrations africaines.
Je me suis brouillé avec eux à deux reprises. J’ai failli interrompre le contrat avec la BM. C’était en pleine mission. Pourquoi ? C’est parce qu’ils ont des aspects spécifiques du BP qu’ils veulent seulement aborder et d’autres non. Pourtant, le BP ne devrait pas être ce qu’eux [sic] pensent être bon pour les administrations africaines
Consultant international D, avril 2023
Le forum national sur le BP s’est conclu par la signature d’une charte nationale. Les consultants ont préparé un projet de charte soumis aux participants pour y insérer leurs propositions. Les discussions ont eu lieu pendant le forum, après les exposés des consultants, et ont abouti à un document final devant constituer le fondement du BP. Les bourgmestres et autres responsables des ETD ont exprimé leurs préoccupations quant au financement du BP, notamment vu la faible mobilisation des recettes locales par les ETD. Ils ont toutefois été rassurés par les autorités politiques, qui se sont engagées à respecter le principe de rétrocession des fonds aux provinces et aux ETD.
Nous, on voulait des garanties que la province et l’État central vont nous accompagner dans ce nouvel exercice. Nous leur avions accordé le bénéfice du doute. Nous espérions que la province allait considérablement nous appuyer
Bourgmestre A d’une ETD de Kinshasa, décembre 2021
Les acteurs de la société civile ont proposé la création de comités locaux de BP au sein des ETD qui géreraient le BP en collaboration avec les autorités locales. Cette proposition a été bien accueillie par les consultants de la BM, qui ont suggéré d’en faire un organe de contrôle citoyen.
L’idée de mettre en place des comités locaux de BP était très prometteuse. Non seulement cela renforcerait la collaboration entre les citoyens et les autorités locales, mais cela pourrait également servir de mécanisme de contrôle citoyen, garantissant une transparence accrue dans la gestion des finances publiques
Consultant international A, juillet 2022
La charte nationale prévoit la mise en oeuvre du BP dans l’ensemble des ETD du pays avec des recommandations qui donnent les contours du BP comme une transparence garantie par l’accès du public à l’information budgétaire, la redevabilité assurée par le contrôle citoyen, et l’accélération de la décentralisation financière pour doter les ETD des budgets d’investissement. Ces trois éléments constituent les fondements du BP qui doivent être mis en oeuvre dans les ETD au pays.
En bref, du transfert du BP en RDC émergent des dynamiques complexes mettant en lumière la participation de plusieurs acteurs faisant circuler cet IAP. Ici, c’est la BM qui a mobilisé les consultants, les chercheurs et les autorités nationales de la RDC. En effet, Ganuza et Baiocchi (2012) soutiennent que l’appropriation du BP par les organisations internationales a transformé ce dispositif en un instrument de renforcement de la gouvernance. Nos observations en RDC corroborent cette thèse et dévoilent la manière dont le BP a promu une gouvernance inclusive et transparente. Les ateliers de renforcement des capacités organisés par les consultants de la BM ont intégré les recommandations des chercheurs locaux, soulignant ainsi le rôle crucial de la gouvernance dans la mise en oeuvre du BP.
Porto de Oliveira (2016, 2017) met l’emphase sur le rôle des « ambassadeurs du BP » dans le transfert de l’IAP. Nos résultats montrent que ces ambassadeurs, bien qu’ils soient de fervents partisans du BP, n’agissent pas en RDC de manière isolée. Ils interviennent souvent en tant que consultants pour des organisations internationales comme la BM. Ainsi, des responsables de l’organisation ENDA ECOPOP identifiés par Porto de Oliveira comme des ambassadeurs du BP ont participé à des ateliers de renforcement des capacités à Kinshasa et au Sud-Kivu sous l’égide de la BM. Cette observation nuance l’idée que les ambassadeurs agissent de manière indépendante et révèle plutôt leurs affiliations institutionnelles.
Sintomer, Herzberg et Allegretti (2014) ainsi que Wampler, McNulty et Touchton (2021) notent que les organisations internationales peuvent imposer aux pays africains la mise en oeuvre du BP en échange d’un appui institutionnel. Nos recherches ajoutent une dimension supplémentaire en soulignant que malgré l’appui institutionnel de la BM et toutes les contraintes associées, la pérennité du BP dépend principalement de sa réception par les acteurs locaux.
3. La réception du BP et sa mise en oeuvre dans les provinces du Sud-Kivu et de Kinshasa
Cette section examine la réception et l’appropriation du BP par les acteurs congolais chargés de sa mise en oeuvre. L’analyse nous permet de comprendre de quelle manière les autorités provinciales et des ETD du Sud-Kivu et de Kinshasa ont adopté ou non le BP, et pourquoi celui-ci n’a pas répondu aux attentes.
3.1 La réception du BP par les autorités provinciales et des ETD du Sud-Kivu
La province du Sud-Kivu, l’une des 26 provinces de la RDC, teste le BP depuis 2012. C’est une province pilote où la mise en place du BP ne s’est pas faite sans heurts, et ce, même si les autorités provinciales ont considéré les recommandations issues du forum national et consignées dans la charte. L’engagement personnel du gouverneur Marcellin Cishambo a été déterminant. Doté d’une grande expérience en politique, il s’est avéré être l’une des pièces maîtresses du déploiement du BP dans sa province. Il a d’abord signé l’arrêté numéro 12/031 GP/SK rendant obligatoire le BP dans les ETD de la province. De plus, son soutien politique se manifeste dans sa participation active et symbolique aux ateliers et des déclarations fortes comme « la balle est dans notre camp » à Cishambo, en 2011. Il a également sollicité un accompagnement financier de la BM et a coopéré avec des compagnies de télécommunication locales pour utiliser les technologies de l’information. « Le processus du BP requiert une forte participation de la population », a-t-il soutenu (Rapport BP de la commune de Kadutu, 2014, p. 8).
Cependant, le soutien du BP au sein de l’exécutif provincial du Sud-Kivu s’est arrêté au terme du mandat du gouverneur Cishambo en 2016. Ses successeurs n’ayant pas réservé le même accueil au BP, on note un relâchement en termes d’appui financier aux ETD et de suivi des activités de cet IAP, comme le précise un bourgmestre.
Nous avons commencé à rencontrer des difficultés lorsque le gouverneur Cishambo a été remplacé à la tête de la province. Les fonds qu’il nous envoyait ne venaient plus. Pourtant, cela nous permettrait de faire fonctionner notre BP
Bourgmestre d’une ETD du Sud-Kivu, novembre 2021
Dans les ETD où s’est déroulée l’expérimentation pilote, le BP a reçu un écho favorable des bourgmestres. À Kadutu et Ibanda, ceux-ci ont organisé les exercices du BP de 2012 à 2015, notamment les forums des quartiers et les assemblées communales menant aux choix citoyens quant à différents projets. Parmi les projets phares, notons la construction d’un terrain de volleyball à Kadutu et des marchés Nyawera et Nguba, dans l’ETD d’Ibanda.
Le BP dans ces entités a été porté par les bourgmestres de ces communes. À Kadutu, le bourgmestre est un autodidacte au passé militant, impliqué dans les organisations culturelles et la gestion des équipes de football. Dans la commune d’Ibanda, la réception du BP s’est révélée ambiguë. Le bourgmestre en place en 2012 était partisan de la participation citoyenne, mais a été remplacé 18 mois après le lancement du BP. Son successeur, un fonctionnaire sceptique devant l’avenir du BP, considérait que des préalables comme des fonds et une meilleure compréhension des rouages budgétaires par les citoyens étaient nécessaires. C’est, croit-il, la raison pour laquelle on a moins recouru au BP durant son mandat.
Dans la commune de Bagira, le BP n’a pas été reçu sans heurt, surtout à cause des changements fréquents de bourgmestres qui ont fragilisé sa mise en oeuvre. Le BP a ressuscité en 2018 avec l’arrivée d’un nouveau bourgmestre jadis impliqué dans des organisations de développement non gouvernementales. Ses actions, notamment ses initiatives participatives, ont redynamisé le BP et lui ont assuré le soutien de ses pairs et des autorités provinciales.
Cependant, dès 2016, le BP dans les ETD identifiées est devenu l’ombre de lui-même. La raison avancée par nos répondants est que le gouverneur Cishambo, qui exigeait le BP des bourgmestres, venait d’être remplacé, et que son successeur n’avait pas la même motivation. Même les fonds provinciaux pour soutenir les ETD n’arrivaient plus. À Ibanda, le nouveau bourgmestre était sceptique vis-à-vis du BP, ce qui a contribué à son déclin. La seule exception reste l’ETD de Kadutu, où le BP a été mis en oeuvre dans sa forme la plus minimale avec les ressources propres à l’ETD, grâce à l’engagement fervent du bourgmestre local. Cette situation met en évidence la nécessité d’un soutien politique constant pour assurer la pérennité du BP dans les ETD de la RDC.
3.2 La réception du BP à Kinshasa : faible implication des autorités provinciales et présence du consultant national du BP
À Kinshasa, le BP n’a pas reçu le même accueil de la part des autorités provinciales et des ETD que dans le Sud-Kivu, où les autorités provinciales se sont montrées réceptives devant l’expérimentation pilote. Le gouverneur de Kinshasa a plutôt affiché peu d’intérêt, posture qui s’est traduite par son absence d’implication directe, et ce, malgré la pression de la BM et du COREF. Un consultant international a d’ailleurs souligné l’absence d’implication du gouverneur :
On n’a pas senti l’appropriation du BP par le gouverneur de province. Pourtant, c’est lui qui devrait piloter le processus et encourager les bourgmestres à adhérer au BP
Consultant international A, juillet 2022
Si on se fie aux propos recueillis dans nos entretiens, le gouverneur avait d’autres priorités administratives et politiques qui ont relégué le BP au second plan. Voilà pourquoi le gouverneur a failli à soutenir activement le projet, malgré l’importance qu’il donne à la gouvernance participative. Le vice-gouverneur de Kinshasa, en revanche, a adopté un profil de participation différent : il a porté le BP à l’Assemblée provinciale, participé à plusieurs séances liées au BP et promis de convaincre le gouverneur de signer la charte nationale du BP. Il a aussi soutenu la participation citoyenne dans ses discours, entre autres celui qu’il a prononcé devant les bourgmestres réunis à l’hôtel Béatrice, en juin 2016. Cependant, son engagement s’est vu limité par ses autres responsabilités et le manque de soutien du gouverneur. Si sa proactivité institutionnelle est évidente, ses efforts n’ont pas suffi à faire du BP une priorité stratégique pour Kinshasa.
Dans les ETD de Kinshasa, le BP tient grâce au dynamisme du consultant national du BP. Ce consultant, diplômé en planification et développement et auteur d’un mémoire sur la participation citoyenne dans la gestion des finances publiques en RDC, est recruté par le COREF. Il oeuvre depuis plusieurs années en tant qu’expert en développement au sein d’ONG. Le COREF l’a recruté pour implanter le BP sur tous les territoires de la RDC et accompagner les chercheurs et consultants dans la préparation du forum national sur le sujet.
Le consultant national a mis son expertise et sa position à profit pour faire adopter les recommandations du forum aux ETD de Kinshasa. Il a participé, avec certains bourgmestres, à l’élaboration de décisions introduisant officiellement le BP aux ETD. Il a aussi rédigé un règlement intérieur fixant les modalités de fonctionnement du BP dans certaines ETD. De plus, sa position lui a permis de subordonner le soutien financier aux ETD à la mise en oeuvre d’un BP et au financement de son organisation logistique au sein des ETD.
Nonobstant l’implication du consultant national, le BP dans les ETD de Kinshasa n’a pas été approprié par les autorités locales. Dans les ETD de Selembao et de Bumbu, le BP semble ne subsister que grâce aux fonds subordonnés que le COREF met à disposition pour les ETD mettant en oeuvre cette initiative. En réalité, le BP ne figure pas parmi les priorités de ces autorités locales, qui semblent davantage attirées par les petits avantages qui accompagnent ce processus. Le consultant national semble être conscient de cette situation. Il le précise de cette manière :
Sans cette aide, il est probable que le BP ne serait pas mis en oeuvre. Cette dépendance financière démontre un manque de volonté locale d’investir des ressources propres dans le BP, ce qui révèle un engagement limité des autorités locales
Extrait d’entretien avec le consultant national du BP, décembre 2021
Les autorités locales paraissent plus intéressées par les avantages personnels liés au BP, tels que des allocations de fonds spécifiques ou des opportunités de visibilité. Cet opportunisme détourne le BP de ses objectifs initiaux, le transformant en un outil de bénéfice personnel plutôt qu’en un moyen de renforcer la participation citoyenne et la gouvernance locale.
Le BP nous oblige à partager des décisions avec les citoyens, ce qui n’est pas toujours compatible avec nos priorités locales. Nous avons des projets urgents et des pressions politiques qui nécessitent des décisions rapides et centralisées
Bourgmestre d’une ETD de Kinshasa, novembre 2021
Pourtant, la mise en oeuvre du BP nécessite un changement dans les pratiques de gouvernance. La réticence à adopter le BP et les pratiques participatives s’explique par la crainte de perdre le contrôle du pouvoir, car le BP impliquant une plus grande transparence et une implication accrue des citoyens. Le manque d’appropriation par les bourgmestres reflète également l’absence d’efforts pour sensibiliser et mobiliser les citoyens. Les autorités locales n’ont pas entrepris les démarches nécessaires pour inclure la communauté dans le processus du BP, limitant ainsi son acceptation et son efficacité.
En somme, nos résultats corroborent largement la littérature existante sur le BP et soulignent l’importance d’un soutien politique dans la réussite du BP. Le contraste entre le Sud-Kivu et Kinshasa illustre à quel point le soutien ou le manque de soutien politique peut influencer la mise en oeuvre et la durabilité du BP. Cette observation cadre avec la littérature actuelle, qui fait du soutien politique une condition essentielle à la réussite du BP (Wampler, 2007 ; Lehtonen, 2022). Le cas du Sud-Kivu, où le soutien au BP s’est estompé après le remplacement du gouverneur Cishambo en 2016, illustre bien cette dynamique. Cette perte de soutien a affaibli le BP et confirmé les conclusions de Soukop, Saradin et Zapletalova (2021), qui notent que l’absence de soutien politique peut expliquer l’échec du BP, comme ce fut le cas en République tchèque.
La littérature montre en outre que le leadership d’une autorité politique peut faciliter l’acceptation et la mise en oeuvre du BP. O’Miel et Mongy (2014) ont prouvé que le leadership de Ségolène Royal en Poitou-Charentes a permis l’acceptation réussie du BP. Similairement, Wampler, McNulty et Touchton (2021) associent le succès du BP à Lambayeque, au Pérou, au leadership du maire de la ville. Dans notre recherche, l’efficacité initiale du BP au Sud-Kivu sous le leadership de Cishambo corrobore ces études. La situation de Kinshasa diverge en ce que l’implication des autorités provinciales y fut très limitée, voire inexistante, entravant ainsi la mise en oeuvre du BP.
Par ailleurs, le succès du BP à Porto Alegre et Belo Horizonte, des municipalités brésiliennes fortement soutenues par leurs maires et le Parti des travailleurs (PT), prouve l’importance d’un appui politique considérable (Abers, 1998 ; Wampler, 2007). Ce soutien a assuré la disponibilité des moyens financiers et la participation citoyenne aux discussions budgétaires. Nos résultats vont dans le sens de ces observations au Sud-Kivu, où le soutien initial de Cishambo a engendré des progrès dans le BP. Cependant, la divergence apparaît avec l’exemple de Kinshasa et du Sud-Kivu après le mandat de Cishambo, où le manque de soutien politique peut être considéré comme l’une des causes de l’échec du BP. Le cas congolais suit les conclusions de Manduna, Zinyama et Nhema (2015) quant à l’échec du BP à Harare, au Zimbabwe, causé par l’absence de soutien politique. Par ailleurs, cette recherche a relevé d’autres défis auxquels le BP est confronté dans les différentes ETD du pays.
3.3 Les défis de la mise en oeuvre du BP dans les ETD du Sud-Kivu et de Kinshasa
La mise en oeuvre du BP dans les ETD des provinces du Sud-Kivu et de Kinshasa a également souffert de deux problèmes majeurs : la centralisation du pouvoir et le blocage des mécanismes de redevabilité par les bourgmestres. Le manque d’effectivité de la décentralisation a vidé le BP de sa substance, et ce, malgré les recommandations du forum national voulant que le BP soit financé par des transferts de fonds des gouvernements central et provincial. Ces transferts, qui représentent 60 % des budgets globaux des ETD, ne sont pas effectués comme promis, si bien que les ETD sont maintenus dépendants financièrement.
Lorsqu’on a adopté le BP, le gouvernement central a promis qu’il respectera [sic] le transfert de fonds aux provinces. Cela permettrait que les investissements se fassent à travers le BP. Mais rien de tel n’est malheureusement respecté
Bourgmestre d’une ETD de Kinshasa, novembre 2021
L’absence de financement a plusieurs conséquences : les projets choisis par les citoyens ne sont pas réalisés, démobilisant ainsi les citoyens et les acteurs de la société civile. Dans les ETD de Bagira, d’Ibanda, de Selembao et de Bumbu, par exemple, peu de projets ont été exécutés depuis la mise en place du BP. Les forums des quartiers se vident progressivement, réduisant ainsi la crédibilité du BP. Un acteur de la société civile explique que « chaque année, nous avons retenu des propositions dans nos forums sans que rien ne soit exécuté. C’est un drame qui compromet la crédibilité du BP aux yeux de ceux qui se mobilisent ». La mise en oeuvre du BP dans les ETD sélectionnées soulève des préoccupations sur l’efficacité du contrôle citoyen. Bien que des organes de contrôle tels que les comités locaux du BP aient été établis, les bourgmestres ont obstrué ces mécanismes en plaçant des membres fidèles dans les organes de contrôle, en restreignant l’accès à l’information et en détournant ainsi ces structures de leur mission initiale.
Où avez-vous déjà vu une personne se choisir des personnes pour les contrôler ? Si l’on vous laisse cette possibilité de porter votre choix sur X ou Y personne, cela veut dire que l’on n’a aucunement besoin d’un contrôle »
Acteur de la société civile de Kinshasa, décembre 2021
Dans de nombreuses ETD comme Kadutu, Ibanda ou Bagira au Sud-Kivu et Selembao ou Bumbu à Kinshasa, les bourgmestres éloignent les acteurs critiques et entravent ainsi le contrôle citoyen prévu. Les réunions des comités locaux, souvent contrôlées par les autorités des ETD, manquent d’indépendance. Par exemple, à Bagira et Selembao, les acteurs de la société civile censés jouer un rôle de surveillance ont une trop grande proximité avec les autorités communales pour être effectifs.
Les comités locaux sont chargés d’évaluer trimestriellement la gestion des fonds du BP et de rédiger des rapports présentés aux citoyens lors des Tribunes d’expression populaire (TEP). Ces TEP constituent le seul moyen de rendre les bourgmestres redevables envers les citoyens. Cependant, les bourgmestres évitent souvent d’organiser ces réunions. À Kinshasa, si les TEP étaient régulières au début du BP, elles se sont raréfiées avec le temps. Contrairement au Sud-Kivu, où une TEP a lieu annuellement dans chaque ETD, les bourgmestres de Kinshasa sont réticents à affronter les critiques des citoyens sur la non-réalisation des projets et la gestion des recettes. Ces séances deviennent tendues et peuvent être interrompues en raison des tensions entre les participants et les autorités.
Ce constat corrobore les écrits de Ryan (2021) voulant que le contrôle citoyen ne puisse aboutir sans le soutien des autorités bureaucratiques et politiques. Si ces dernières ne sont pas disposées à faciliter ce contrôle, on ne peut espérer aucun résultat positif. Bien que l’action forte des organisations de la société civile puisse faire bouger les lignes, dans les cas des ETD analysés, nous constatons que les organisations de la société civile sont très limitées par le manque de financement. Ce constat illustre le fait que le BP, à travers le mécanisme de redevabilité, a failli à modifier de façon considérable les relations État-société en RDC : le contrôle citoyen n’est pas effectif étant donné que les citoyens n’ont pas un accès facile aux informations budgétaires et que les bourgmestres tiennent à maintenir leur influence sur les organes de contrôle citoyen. Nos conclusions contrastent avec la littérature sur le BP en Amérique latine, où Célérier et al. (2015) notent que, sur le continent, le BP est l’une des initiatives les plus réussies de redevabilité. Les auteurs soulignent d’ailleurs qu’il offre une opportunité d’émancipation des citoyens dans la mesure où ceux-ci s’approprient l’initiative en demandant des comptes aux gouvernants. Dans le cas brésilien, par exemple, on compte de nombreuses preuves du potentiel du BP dans la promotion du contrôle citoyen.
Certains auteurs notent que l’engagement des citoyens dans le BP a permis à ces derniers de faire leurs revendications et de contrôler la gestion des finances publiques de leur municipalité (Baiocchi et al., 2011 ; Shah, 2007 ; Wampler, 2007). À Belo Horizonte, au Brésil, le BP comprenait des comités de surveillance permettant de limiter la corruption et le gaspillage des ressources publiques. Par ailleurs, McNulthy (2019) note que dans le cas du BP au Pérou, les membres des comités de surveillance, en majorité des acteurs bénévoles de la société civile, ont failli à leur mission parce qu’ils ne recevaient aucun dédommagement pour leurs frais de déplacement sur les lieux des projets du BP. En effet, il arrivait qu’ils se trouvent dans l’incapacité de se déplacer, variable expliquant la contre-performance du BP au Pérou.
Conclusion
L’objectif de cet article est de comprendre les dynamiques complexes entre la BM, les consultants, les autorités politico-administratives du gouvernement congolais et les ETD pour expliquer les raisons de l’échec du BP. Pour appréhender ce phénomène, nous avons formulé les questions suivantes : comment le BP a-t-il été transféré en RDC ? Quelle a été sa réception par les acteurs congolais, et quels ont été les effets sur sa mise en oeuvre ? L’article utilise les approches par le transfert de politiques (Dolowitz et Marsh, 2000) et les IAP (Lascoumes et Le Galès, 2004 ; Halpern, Lascoumes et Le Galès, 2014) pour analyser ce phénomène. Les résultats montrent que l’échec du BP dans les ETD de la RDC peut être attribué à plusieurs facteurs interdépendants, notamment le manque de soutien politique, la centralisation du pouvoir et l’absence de mécanismes de redevabilité.
Les résultats de cette recherche apportent une compréhension plus profonde des obstacles à la mise en oeuvre du BP en RDC. La variabilité du soutien politique, illustrée par l’exemple du Sud-Kivu et de Kinshasa, a montré que la pérennité du transfert du BP dépend de la constance de l’engagement politique des acteurs receveurs. La centralisation excessive du pouvoir a empêché les autorités locales de disposer de l’autonomie nécessaire pour gérer efficacement leurs budgets, limitant ainsi leur capacité à répondre aux besoins propres à leurs communautés. De plus, l’absence de redevabilité a permis aux autorités locales de détourner les fonds alloués au BP ou de négliger les processus participatifs, augmentant la méfiance et le désengagement des citoyens. Ainsi, les efforts de la BM pour promouvoir le BP dans ses interventions ont souvent été contrecarrés par des pratiques locales qui n’ont pas permis d’atteindre les objectifs de la réforme des finances publiques au sein des ETD.
D’autres recherches sont nécessaires pour comprendre les causes de l’échec du BP dans des contextes autres que celui de la RDC. En particulier, il serait pertinent d’analyser les échecs du BP en Afrique pour relever des tendances communes et des particularités contextuelles. Il serait utile d’explorer davantage la place du leadership dans la réussite ou l’échec du BP. Comment renforcer l’engagement politique envers des initiatives participatives comme le BP et en assurer un soutien continu ? Enfin, comment instaurer des mécanismes robustes de redevabilité qui encouragent la transparence et la participation citoyenne ? Ces pistes d’analyse sont cruciales pour améliorer la mise en oeuvre du BP et autres initiatives participatives en RDC et au-delà.
Appendices
Note
-
[1]
Christian Mushagalusa Nkunzi est Professeur associé au Département de science politique à l’Université Pédagogique Nationale en RDC et Professeur à temps partiel au programme d’administration publique au Collège Boréal au Canada (Ontario). Il est le fondateur du Centre d’évaluation et d’analyse des politiques publiques CEAPP. ORCID : 0009-0003-2408-6814
Bibliographie
- Abers, R. (1998). From clientelism to cooperation: Local government, participatory policy, and civic organizing in Porto Alegre, Brazil. Politics & Society, 26(4), 511–537. https://doi.org/10.1177/0032329298026004004
- Abers, R. (2000). Inventing local democracy: Grassroots politics in Brazil. Lynne Rienner Publishers.
- Allegretti, G. et Herzberg, C. (s. d.). Participatory budgets in Europe.
- Arhip-Paterson, W. (2020). Les budgets participatifs sont encore partisans. (Dé-) partisanisation des budgets participatifs parisiens (2014-2020). Participations, 26-27(1), 135-164. https://doi.org/10.3917/parti.026.0135
- Avritzer, L. (2002). Democracy and the public space in Latin America. Princeton University Press. https://www.jstor.org/stable/j.ctt7t8xv
- Avritzer, L. (2006). New public spheres in Brazil: Local democracy and deliberative politics. International Journal of Urban and Regional Research, 30(3), 623- 637. https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2006.00692.x
- Bacqué, M.-H., Rey, H. et Sintomer, Y. (2005). Gestion de proximité et démocratie participative. La Découverte. https://doi.org/10.3917/dec.bacqu.2005.01.0009
- Badie, B. (1992). L’État importé : essai sur l’occidentalisation de l’ordre politique. Fayard.
- Batumike, P. (2014). Institutionnaliser le Budget participatif sans décentraliser : une pratique dichotomique au Sud-Kivu ? https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/2363-6262_2014_3_495.pdf?download_full_pdf=1
- Blondiaux, L. et Sintomer, Y. (2002). L’impératif délibératif. Politix. Revue des sciences sociales du politique, 15(57), 17-35. https://doi.org/10.3406/polix.2002.1205
- Chevallier, J. (2003). La gouvernance, un nouveau paradigme étatique ? Revue française d’administration publique, 105-106(1-2), 203-217. https://doi.org/10.3917/rfap.105.0203
- Commune de Kadutu (2020). Condensés des rapports d’exécution du Budget participatif de la commune.
- Commune d’Ibanda (2019). Rapport d’exécution du Budget participatif de la commune et tableaux synoptiques des réalisations.
- Commune de Bagira (2020). Rapport d’exécution du Budget participatif de la commune depuis 2018.
- Comité de la réforme des finances publiques. (2010). Le plan stratégique pour la réforme de la gestion des finances publiques.
- Comité de la réforme des finances publiques. (2020). Rapport budget participatif dans les ETD de la province de Kinshasa.
- Constitution de la RDC du 18 février 2006. Journal officiel de la RDC. http://www.leganet.cd/JO.htm
- Cornwall, A. et Brock, K. (2005). What dobBuzzwords do for development policy? A critical look at “participation”, “empowerment” and “poverty reduction.” Third World Quarterly, 26(7), 1043–1060.
- De Sousa Santos, B. (1998). Participatory budgeting in Porto Alegre: Toward a redistributive democracy. Politics & society, 26(4), 461–510.
- Dolowitz, D. P. et Marsh, D. (2000). Learning from abroad: The role of policy transfer in contemporary policy-making. Governance, 13(1), 5-23. https://doi.org/10.1111/0952-1895.00121
- Englebert, P. et Mungongo, E. K. (2016). Misguided and misdiagnosed: The failure of decentralization reforms in the DR Congo. African Studies Review, 59(1), 5–32.
- Ganuza, E. et Baiocchi, G. (2012). The power of ambiguity: How participatory budgeting travels the globe. Journal of Deliberative Democracy, 8(2), Article 5. https://doi.org/10.16997/jdd.142
- Ganuza, E. et Francés, F. (2015). Le défi participatif : Délibération et inclusion démocratique dans les budgets participatifs (D. Garibay, trad.). Participations, 11(1), 167-190. https://doi.org/10.3917/parti.011.0167
- Garibay, D. (2015). Vingt-cinq ans après Porto Alegre, où en est (l’étude de) la démocratie participative en Amérique latine ? Participations, 11(1), 7-52. https://doi.org/10.3917/parti.011.0007
- Goldfrank, B. (2007). The politics of deepening local democracy: decentralization, party institutionalization, and participation. Comparative Politics, 39(2), 147–168.
- Goldfrank, B. (2012). The World Bank and the globalization of participatory budgeting. Journal of Deliberative Democracy, 8(2), Article 2. https://doi.org/10.16997/jdd.143
- Halpern, C., Lascoumes, P. et Le Galès, P. (2014). L’instrumentation de l’action publique. Presses de Sciences Po. https://doi.org/10.3917/scpo.halpe.2014.01.0015
- Harrison, G. (2010). Neoliberal Africa: The impact of global social engineering. Bloomsbury Publishing.
- Kanyurhi, L. (2018). Processus participatif au Sud-Kivu: Entre pratique démocratique et slogan idéologique. Harmattan.
- Lavigne Delville, P. (2018). Les réformes de politiques publiques en Afrique de l’Ouest, entre « polity », « politics » et extraversion. Eau potable et foncier en milieu rural (Bénin, Burkina Faso). Gouvernement et action publique, 7(2), 53-73. https://doi.org/10.3917/gap.182.0053
- Le Bourhis, J.-P. et Lascoumes, P. (2014). En guise de conclusion/Les résistances aux instruments de gouvernement. Essai d’inventaire et de typologie des pratiques. Dans C. Halpern, P. Lascoumes et J.-P. Le Bourhis (dir.), L’instrumentation de l’action publique (p. 493-520). Presses de Sciences Po. https://doi.org/10.3917/scpo.halpe.2014.01.0493
- Le Bourhis, J.-P. et Lascoumes, P. (2011). Les résistances aux instruments de gouvernement. Essai d’inventaire et de typologie des pratiques. Colloque international Les instruments d’action publique : mise en discussion théorique. https://hal.science/hal-00569347
- Lehtonen, P. (2022). Policy on the move: The enabling settings of participation in participatory budgeting. Policy Studies, 43(5), 1036‑1054. https://doi.org/10.1080/01442872.2021.1895981
- Manduna, K., Zinyama, T, et Nhema, A. G. (2015). Local government participatory budget system in Zimbabwe: The case of Harare City council, 1995–2013. Public Policy and Administration Research, 5(11). https://www.researchgate.net/publication/305547273
- Mathieu, M. et Lavigne Delville, P. (2020). L’impossible harmonisation des instruments budgétaires de l’État et des donateurs. Contradictions institutionnelles, bricolages et manipulations du « budget programme par objectifs » au Bénin (eau potable et assainissement de base). Revue internationale de politique comparée, 27(2-3), 137-163. https://doi.org/10.3917/ripc.272.0137
- Mazeaud, A., Nonjon, M. et Parizet, R. (2016). Les circulations transnationales de l’ingénierie participative. Participations, 14(1), 5-35. https://doi.org/10.3917/parti.014.0005
- Miraftab, F. et Kudva, N. (2014). Cities of the Global South Reader. Routledge.
- Ndaywel, I. (2008). Histoire politique du Congo : des origines à nos jours. Le Cri.
- Nylen, W. R. (2014). Participatory budgeting in a competitive-authoritarian regime: A case study (Maputo, Mozambique). Instituto de Estudos Sociais e Económicos.
- Porto de Oliveira, O. (2017a). Participatory budgeting transfers in Southern Africa: Global players, regional organizations and local actors. Dans M. Hadjiisky, L. A. Pal et C. Walker (dir.), Public policy transfer (p. 195–221). Edward Elgar Publishing. https://www.elgaronline.com/edcollchap/edcoll/9781785368035/9781785368035.00017.xml
- Porto de Oliveira, O. (2017b). International Policy Diffusion and Participatory Budgeting: Ambassadors of Participation, International Institutions and Transnational Networks (p. 199–227). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-43337-0_7
- Porto de Oliveira, O. (2016). La diffusion globale du budget participatif : Le rôle des « ambassadeurs » de la participation et des institutions internationales. Participations, 14(1), 91-120. https://doi.org/10.3917/parti.014.0091
- Porto De Oliveira, O. 2010. Le transfert d’un modèle de démocratie participative : Paradiplomatie entre Porto Alegre et Saint-Denis. De l’IHEAL. https://doi.org/10.4000/books.iheal.2671
- O’Miel, J. et Mongy, A. (2014). Réformer par l’expérimentation : La réception du budget participatif des lycées en région Nord–Pas-de-Calais. Participations, 9(2), 207-237. https://doi.org/10.3917/parti.009.0207
- OSMONT, A. (2003). Les villes, la gouvernance, la démocratie locale : réflexion sur l’expertise. Dans C. Milani, C. Arturi et G. Solinis (dir.), Démocratie et gouvernance mondiale. Quelles régulations pour le XXIe siècle ? (p. 175-190).
- Parizet, R. (2016). Le « pauvre d’abord ». Une analyse des dynamiques circulatoires de la participation populaire au développement. Participations, 14(1), 61-90. https://doi.org/10.3917/parti.014.0061
- Soukop, M., Šaradín, P. et Zapletalová, M. (2021). Participatory budgeting: Case study of possible causes of failures. Slovak Journal of Political Sciences, 21(2), 139–160.
- Ravallion, M., Chen, S. et Sangraula, P. (2007). New evidence on the urbanization of global poverty. Population and Development Review, 33(4), 667–701.
- Rose, R. (1991). What is lesson-drawing? Journal of Public Policy, 11(1), 3-30. https://doi.org/10.1017/S0143814X00004918
- Saurugger, S. et Terpan, F. (2013). Analyser les résistances nationales à la mise en oeuvre des normes européennes : Une étude des instruments d’action publique. Quaderni, 80, 5-24.
- Sintomer, Y., Herzberg, C. et Allegretti, G. (2014). Les budgets participatifs dans le monde. https://cdn.ca.yapla.com/company/CPYO9qxj5LhP6vbo8lrLkiEO/asset/files/herzberg_01.pdf
- Sintomer, Y., Herzberg, C. et Röcke, A. (2008). Les budgets participatifs en Europe (p. 154-174). La Découverte. https://www.cairn.info/les-budgets-participatifs-en-europe–9782707156488-p-154.htm
- Soriat, C. (2020). Bureaucratisation par le haut, bureaucratisation par le bas. Diffusion et réception d’un instrument managérial dans le contexte de la santé au Bénin. Revue internationale de politique comparée, 27(2-3), 111-136. https://doi.org/10.3917/ripc.272.0111
- Trefon, T. (2010). Les obstacles administratifs à la réforme en République démocratique du Congo. Revue Internationale des Sciences Administratives, 76(4), 735-755. https://doi.org/10.3917/risa.764.0735
- Van Hulst, M. et Yanow, D. (2016). From policy “frames” to “framing”: Theorizing a more dynamic, political approach. The American Review of Public Administration, 46(1), 92-112. https://doi.org/10.1177/0275074014533142
- Wampler, B., McNulty, S. et Touchton, M. (2021). Participatory budgeting in global perspective. Oxford University Press.
- Wampler, B. (2007). A guide to participatory budgeting. Dans A. Shah (dir.), Participatory Budgeting. Public Sector Governance and Accountability (p. 21–54). World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/6640