L’objectif de ce numéro est de lire, éclairer et analyser quelques-uns des liens entre épidémies et mort. Il ambitionne notamment de mieux comprendre les relations qui se construisent en période épidémique entre les vivants d’une part, et les proches en fin de vie ou décédés d’autre part. Comment, dans de telles situations de crise, les individus, les familles, les populations, adaptent-ils leurs pratiques d’accompagnement et de soins des morts; comment les autorités sanitaires et les acteurs institutionnels ou professionnels gèrent-ils cette articulation entre exigences biosécuritaires et impératifs funéraires. Évènements majeurs dans l’histoire de l’humanité, les épidémies – dont la COVID-19 n’est que l’avatar le plus récent – induisent de multiples transformations des relations entre les vivants et leurs morts, et – par extension – avec la mort de manière globale. Bien des pays dits « riches », dans lesquels les États et les populations imaginaient que de tels évènements étaient enfouis dans les méandres de leur passé ou réservés à d’autres aires géographiques, viennent de vivre douloureusement – le plus souvent dans le silence du moment – ce que mourir en temps d’épidémie signifie. Plusieurs régions, notamment dans les Nords, ont été confrontées à des contextes de mort de masse. Des images insoutenables ont fait le tour du monde dans les médias ou sur les réseaux sociaux, par exemple en Lombardie (figure 1) au nord de l’Italie (Alfieri et al., 2022, 2020; Sams et al., 2021). De nombreux pays qui n’avaient plus connu de tels évènements depuis bien longtemps viennent d’être confrontés à des récits de décès dans des conditions qui leur semblaient jusqu’alors inenvisageables, impossibles sous leurs latitudes, d’un autre âge. Beaucoup parmi les familles, les soignants ou encore les bénévoles d’associations ont été projetés, sans préparation, au coeur de la gestion de situations de mort à distance, de mort sans contact, de mort sans les proches, de mort sans rituel, de mort dans la solitude. Les travaux produits depuis le début de la pandémie sur ce thème montrent la mobilisation des sciences sociales sur l’une des questions les plus polémiques de cette période pandémique. Ils dépeignent avec force la sidération des individus, des familles, des populations et des institutions de soins (par exemple : Gaglio et al., 2022 ou Hazif-Thomas et Seguin, 2022). Ils documentent également l’impréparation des États face à la violence de l’évènement dans le champ du funéraire (par exemple : Alfieri et al., 2022, 2020 ou Moulin, 2022 dans ce numéro) et ce, malgré les appels répétés de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) depuis plusieurs années à mieux se préparer aux éventuelles épidémies, notamment au travers du concept disease X (Sams et al., 2022). Or cette gestion improvisée des épidémies aboutit en général à une exacerbation de la situation de crise (Bolat et Bourmaud, 2021; Borraz et Bergeron, 2020). Paradoxalement, de tels bouleversements ne sont pas entièrement nouveaux. Il importera donc de lire et d’analyser les liens entre pandémies et mort à la lumière de ce qui s’est passé antérieurement ou ailleurs pour d’autres maladies infectieuses, ou en lien avec les canicules, les terrorismes, les guerres et conflits, les catastrophes naturelles, etc. Il est impératif de mieux comprendre les effets des pandémies sur les pratiques funéraires et mortuaires sous contrainte biosécuritaire; les expériences pour les familles et les proches de ces morts avec des rites funéraires absents, altérés ou transformés; la construction du deuil qui s’ensuivra, les perceptions; ou encore les pratiques professionnelles des soignants et des accompagnants de la fin de vie. Il est tout aussi indispensable d’étudier les manières de raconter les morts brutales et les représentations …
Appendices
Bibliographie
- Abiven, M. (2004). Pour une mort plus humaine. Expérience d’une unité hospitalière de soins palliatifs. Masson.
- Albert, J.-P. (1999). Les rites funéraires. Approches anthropologiques. Les cahiers de la faculté de théologie, (4), 141‑152. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00371703/
- Alfieri, C., Desclaux, A., Sams, K. et Egrot, M. (2020). Mourning while fighting for justice: The first months of the NOI DENUNCEREMO association, Bergamo, Italy. Somatosphere. http://somatosphere.net/2020/mourning-while-fighting-for-justice.html
- Alfieri, C., Egrot, M., Desclaux, A. et Sams, K. (2022). Recognising Italy’s mistakes in the public health response to COVID-19. The Lancet, 399(10322), 357‑358. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02805-1
- Allmark, P. (2002). Death with dignity. Journal of Medical Ethics, (28), 255‑257.
- Andrianaivoarimanana, V., Kreppel, K., Elissa, N., Duplantier, J.-M., Carniel, E., Rajerison, M. et Jambou, R. (2013). Understanding the persistence of plague foci in Madagascar. PLOS Neglected Tropical Diseases, 7(11), Article e2382. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0002382
- Anoko, J. N. (2014a). Communication with rebellious communities during an outbreak of Ebola Virus Disease in Guinea: An anthropological approach. Ebola Response Anthropology Platform. http://www.ebola-anthropology.net/case_studies/communication-with-rebellious-communities-during-an-outbreak-of-ebola-virus-disease-in-guinea-an-anthropological-approach/
- Anoko, J. N. (2014b). La réparation de la malédiction générale suite à l’enterrement d’une femme enceinte avec le bébé dans le ventre [Blog en ligne]. https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2225/files/2015/01/La-r%C3%A9paration-de-la-mal%C3%A9diction-g%C3%A9n%C3%A9rale-Julienne-Anoko-2014-12-22.pdf
- Anoko, J. N. et Doug, H. (2019). Removing a community curse resulting from the burial of a pregnant woman with a fetus in her womb. An anthropological approach conducted during the Ebola virus epidemic in Guinea: Medical, anthropological, and public health perspectives. Dans D. A. Schwartz, J. N. Anoko et S. A. Abramowitz (dir.), Pregnant in the Time of Ebola: Women and Their Children in the 2013-2015 West African Epidemic (p. 263‑277). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-97637-2_18
- Ariès, P. (1975). Les grandes étapes et le sens de l’évolution de nos attitudes devant la mort / The major stages and meaning of the evolution of our attitudes towards death. Archives des sciences sociales des religions, 39(1), 7‑15. https://doi.org/10.3406/assr.1975.2763
- Bacqué, M.-F. (2006). Du cadavre traumatogène au corps mort symboligène. Études sur la mort, 129(1), 59. https://doi.org/10.3917/eslm.129.0059
- Bardosh, K. L., de Vries, D. H., Abramowitz, S., Thorlie, A., Cremers, L., Kinsman, J. et Stellmach, D. (2020). Integrating the social sciences in epidemic preparedness and response: A strategic framework to strengthen capacities and improve Global Health security. Globalization and Health, 16(1), 1‑18. https://doi.org/10.1186/s12992-020-00652-6
- Bardosh, K., de Vries, D., Stellmach, D., Abramowitz, S., Thorlie, A., Cremers, L. et Kinsman, J. (2016). Towards People-Centred Epidemic Preparedness & Response: From Knowledge to Action (2711000). Wellcome Trust. https://www.glopid-r.org/wp-content/uploads/2019/07/towards-people-centered-epidemic-preparedness-and-response-report.pdf
- Beauvieux, F., Egrot, M. et équipe CoMeSCov (2022a). Faire de la recherche en temps de pandémie. Quelle place pour une recherche « extemporanée »? Anthropologie et Covid-19 – Colloque Amades, Marseille, 15-16-17 juin.
- Beauvieux, F., Egrot, M. et Magnani, C. (2022b). De la peste au covid-19. Une étude comparée des réactions face aux « indésirables » et aux « vulnérables » à Marseille en temps d’épidémie. Dans F. Bost, P. Delettre, P. Odou, A. Ranvier et F. Thuriot (dir.), Les épidémies au prisme des SHS (p. 143‑154). Éditions des archives contemporaines. https://doi.org/10.17184/eac.6000
- Berliner, D. (2004). Perception des fièvres hémorragiques à virus Ebola sur la frontière congo-gabonaise. Civilisations, 52(1), 117‑120.
- Bolat, F. et Bourmaud, P. (2021). Une société impréparée? Expériences des épidémies et caricature en Turquie, du choléra au COVID-19. Dans B. Balcı, P. Bourmaud et S. Kaya (dir.), Analyses pluridisciplinaires sur la crise sanitaire COVID-19 en Turquie. Institut français d’études anatoliennes. https://doi.org/10.4000/books.ifeagd.3732
- Borraz, O. et Bergeron, H. (2020). Covid-19 : impréparation et crise de l’État. AOC media - Analyse Opinion Critique. https://aoc.media/analyse/2020/03/30/covid-19-impreparation-et-crise-de-letat/
- Boumandouki, P., Formenty, P., Epelboin, A., Campbell, P., Atsangandoko, C., Allarangar, Y., Leroy, E. M., Kone, M. L., Molamou, A. et Dinga-Longa, O. (2005). Prise en charge des malades et des défunts lors de l’épidémie de fièvre hémorragique due au virus Ebola d’octobre à décembre 2003 au Congo. Bulletin de la Société de Pathologie Exotique, 98(3), 218‑223.
- Broqua, C. (1998). De quelques expressions collectives de la mémoire face au sida. Ethnologie française, 28(1), 103‑111.
- Broqua, C., Loux, F. et Prado, P. (1998). Sida : deuil, mémoire, nouveaux rituels. Ethnologie française, 28(1), 5‑9.
- Brunnquell, F. et Epelboin, A. (réal.) (2007). Ebola, ce n’est pas une maladie pour rire [Film]. CAPA. https://www.canal-u.tv/video/smm/ebola_ce_n_est_pas_une_maladie_pour_rire.13710
- Burrell, A. et Selman, L. E. (2020). How do funeral practices impact bereaved relatives’ mental health, grief and bereavement? A mixed methods review with implications for COVID-19. OMEGA - Journal of Death and Dying, Article 003022282094129. https://doi.org/10.1177/0030222820941296
- Castex, D. (2019). Les anomalies démographiques : clefs d’interprétation des cimetières d’épidémies en archéologie. Dans I. Cartron (dir.), Épidémies et crises de mortalité du passé (p. 109‑138). Ausonius Éditions. http://books.openedition.org/ausonius/729
- Castex, D. et Kacki, S. (2013). Funérailles en temps d’épidémie. Croyances et réalité archéologique. Les nouvelles de l’archéologie, (132), 23‑29. https://doi.org/10.4000/nda.2069
- Chrościcki, J. A., Hengerer, M. et Sabatier, G. (dir.) (2012). Les funérailles princières en Europe, XVIe - XVIIIe siècle. Le grand théâtre de la mort (vol. 1). Éditions de la Maison des sciences de l’homme. https://doi.org/10.4000/books.editionsmsh.17534
- Clavandier, G. (2020). Contextualiser le deuil dans une ritualité funéraire perturbée. Revue de neuropsychologie, 12(2), 243-246.
- Coope, C. M. (1997). Death with dignity. Hastings Center Report, 27(5), 37‑38. https://doi.org/10.2307/3527803
- Corpuz, J. C. G. (2021). Beyond death and afterlife: The complicated process of grief in the time of COVID-19. Journal of Public Health, 43(2), e281-e282. https://doi.org/10.1093/pubmed/fdaa247
- Croix-Rouge française, Tran-Minh, T. et Soubriard, C. (2016). Répondre à une épidémie de maladie à virus Ebola : guide opérationnel. Croix-Rouge française.
- Desclaux, A. et Touré, A. (2018). Quelle « préparation » aux dimensions sociales des épidémies en Afrique? Une expérience de formation à Conakry. Médecine et Santé Tropicales, 28(1), 23‑27. https://doi.org/10.1684/mst.2018.0749
- Eisma, M. C. et Stroebe, M. S. (2021). Emotion regulatory strategies in complicated grief: A systematic review. Behavior Therapy, 52(1), 234‑249. https://doi.org/10.1016/j.beth.2020.04.004
- Eisma, M. C., Tamminga, A., Smid, G. E. et Boelen, P. A. (2021). Acute grief after deaths due to COVID-19, natural causes and unnatural causes: An empirical comparison. Journal of Affective Disorders, 278, 54‑56. https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.09.049
- Epelboin, A. (2004). Ebola au Congo en février 2003 : virus, sorciers & politique [Vidéo]. Canal-U. https://www.canal-u.tv/68025
- Epelboin, A. (2009). L’anthropologue dans la réponse aux épidémies : science, savoir-faire ou placebo? Bulletin Amades, (78). http://amades.revues.org/1060
- Epelboin, A. (2012). Rapport de mission anthropologique sur l’épidémie d’Ebola : Isiro, RD Congo, 4 au 30 septembre 2012. CNRS-MNHN, OMS. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01090304/document
- Epelboin, A. (2014). Approche anthropologique de l’épidémie de FHV Ebola 2014 en Guinée Conakry [Rapport de recherche]. Organisation mondiale de la santé. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01090291/document
- Epelboin, A., Formenty, P., Anoko, J. et Allarangar, Y. (2008). Humanisation and informed consent for people and populations during responses to VHF in central Africa (2003-2008). Dans Humanitarian Borders, Dec 2007, Geneva, Switzerland (p. 25‑37). http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00399961
- Esoavelomandroso, F. (1981). Résistance à la médecine en situation coloniale : la peste à Madagascar. Annales. Histoire, Sciences Sociales, 36(2), 168‑190. https://doi.org/10.3406/ahess.1981.282726
- Fabre, G. (1991). La Peste en l’absence de Dieu. Image votives et représentations du mal lors de la peste provençale de 1720. Archives de Sciences Sociales des Religions, 73, 141‑158. https://doi.org/10.3406/assr.1991.1581
- Fairhead, J. (2014). The Significance of Death, Funerals and the After-Life in Ebola-Hit Sierra Leone, Guinea and Liberia: Anthropological Insights into Infection and Social Resistance. https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/handle/20.500.12413/4727
- Faye, S. L. (2015). L’« exceptionnalité » d’Ebola et les « réticences » populaires en Guinée-Conakry. Réflexions à partir d’une approche d’anthropologie symétrique. Anthropologie & Santé, (11). https://doi.org/10.4000/anthropologiesante.1796
- Fellous, M. (1998). Le Quilt : un mémorial vivant pour les morts du sida. Ethnologie française, 28(1), 80‑86.
- Fribault, M. (2015). Ebola en Guinée : violences historiques et régimes de doute. Anthropologie & Santé, (11). https://doi.org/10.4000/anthropologiesante.1761
- Fureix, E. (2011). La construction rituelle de la souveraineté populaire : deuils protestataires (Paris, 1815-1840). Revue d’histoire du XIXe siècle, (42), 21‑39. https://doi.org/10.4000/rh19.4102
- Gaglio, G., Calvignac, C. et Cochoy, F. (2022). Chronique d’un « mensonge » : déclarations gouvernementales sur l’« inutilité » du port du masque en « population générale » et réactions indignées du public. Lien social et Politiques, (88), 194‑212. https://doi.org/10.7202/1090987ar
- Gall, H. L. (2020). Demandes de rituel dans des situations inhabituelles. Jusqu’à la mort accompagner la vie, 140(1), 83‑86. https://www.cairn.info/revue-jusqu-a-la-mort-accompagner-la-vie-2020-1-page-83.htm
- Gastineau, B., Golaz, V., Flahaux, M.-L. et Santos, S. D. (2022). L’épidémie de COVID-19 en France : la prudence s’impose face aux chiffres. Statistique et Société, 10(1), 9‑18. http://statistique-et-societe.fr/article/view/840
- Gesi, C., Carmassi, C., Cerveri, G., Carpita, B., Cremone, I. M. et Dell’Osso, L. (2020). Complicated grief: What to expect after the coronavirus pandemic. Frontiers in Psychiatry, 11(489). https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.00489
- Gourarier, Z. (1998). Mémoire et musée. Ethnologie française, 28(1), 112‑114.
- Goveas, J. S. et Shear, M. K. (2020). Grief and the COVID-19 pandemic in older adults. The American Journal of Geriatric Psychiatry, 28(10), 1119‑1125. https://doi.org/10.1016/j.jagp.2020.06.021
- Grmek, M. D. (1969). Préliminaires d’une étude historique des maladies. Annales. Histoire, Sciences Sociales, 24(6), 1473‑1483. https://doi.org/10.3406/ahess.1969.422182
- Grmek, M. D. (1983). Les maladies à l’aube de la civilisation occidentale : recherches sur la réalité pathologique dans le monde grec préhistorique, archaïque, et classique. Payot.
- Grmek, M. D. (1990). Histoire du sida : début et origine d’une pandémie actuelle. Payot.
- Hanus, M. (1998). Sida et travail de deuil. Ethnologie française, 28(1), 31‑36. https://www.jstor.org/stable/40989953
- Hazif-Thomas, C. et Seguin, J.-P. (2022). Les funérailles à l’épreuve de la pandémie de COVID-19. Regards croisés d’un directeur d’espace de réflexion éthique et d’un guide de funérailles sur le bouleversement des rites funéraires lors de la crise sanitaire. Éthique & Santé, 19(3), 134‑142. https://doi.org/10.1016/j.etiqe.2022.06.001
- Hébert, J. (1998). Témoignages : Le Patchwork des Noms. Ethnologie française, 28(1), 87‑89. https://www.jstor.org/stable/40989962
- Hewlett, B. S. (2007). Ebola, Culture and Politics: The Anthropology of an Emerging Disease. Cengage Learning.
- Hewlett, B. S., Epelboin, A., Hewlett, B. L. et Formenty, P. (2005). Medical anthropology and Ebola in Congo: Cultural models and humanistic care. Bulletin de la Société de pathologie exotique (1990), 98(3), 230‑236. https://europepmc.org/article/med/16267966
- Hewlett, B. L. et Hewlett, B. S. (2005). Providing care and facing death: Nursing during Ebola outbreaks in Central Africa. Journal of Transcultural Nursing, 16(4), 289-297 https://doi.org/10.1177/1043659605278935
- Jakšić, M. et Fischer, N. (2021). Les morts encombrants. Du gouvernement politique des cadavres. Cultures & Conflits, 121(1), 7‑14. https://doi.org/10.4000/conflits.22549
- Kokou-Kpolou, C. K., Fernández-Alcántara, M. et Cénat, J. M. (2020). Prolonged grief related to COVID-19 deaths: Do we have to fear a steep rise in traumatic and disenfranchised griefs? Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 12(S1), S94‑S95. https://doi.org/10.1037/tra0000798
- Kra, F., Egrot, M. et Akindès, F. (2018). La dignité dans les rites funéraires en période épidémique [Communication orale]. Colloque international, Regards éthiques pluridisciplinaires en sciences sociales, environnement et santé. Expériences et perspectives en Afrique de l’Ouest, 6-8 février, Conakry.
- Kra, F., Egrot, M., Akindès, F. et Zina, O. (à paraître, 2023). Ebola et politiques de communication préventive en Côte d’Ivoire (2014-2016). Anthropologie et Sociétés, 46(3).
- Kra, F. et Schmidt-Sane, M. (2021). L’Afrique contre les épidémies : principales considérations en matière de préparation et de riposte aux épidémies en Côte d’Ivoire [Étude]. Institut of Development Studies.
- Kra, F., Taverne, B., Mininel, F., Akindès, F., Laborde-Balen, G. et Egrot, M. (2020). L’anthropologie impliquée à l’hôpital en contexte d’épidémie de covid-19 pour accompagner les fins de vie et les décès hospitaliers. The Conversation, 5. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02956525
- Kra, W. et Zran, A. (2017). L’éthique médicale à l’épreuve de l’urgence sanitaire : une analyse de gestion de « cas suspects » de la Maladie à Virus Ebola dans le contexte pré-épidémique ivoirien. Dans T. Fouquet et V. Troit (dir.), Transition humanitaire en Côte d’Ivoire (p. 103-122). Karthala. https://doi.org/10.3917/kart.fouqu.2017.01.0103
- Laflamme, D. (2020). Les trajectoires du mourir et du deuil. Frontières, 32(1). https://doi.org/10.7202/1072748ar
- Larson, P. M. (2001). Austronesian mortuary ritual in history: Transformations of secondary burial (Famadihana) in Highland Madagascar. Ethnohistory, 48(1‑2), 123‑155. https://doi.org/10.1215/00141801-48-1-2-123
- Le Marcis, F. (2015). « Traiter les corps comme des fagots » Production sociale de l’indifférence en contexte Ebola (Guinée). Anthropologie & Santé, (11). https://doi.org/10.4000/anthropologiesante.1907
- Lee-Kwan, S. H., DeLuca, N., Bunnell, R., Clayton, H. B., Turay, A. S. et Mansaray, Y. (2017). Facilitators and barriers to community acceptance of safe, dignified medical burials in the context of an Ebola epidemic, Sierra Leone, 2014. Journal of Health Communication, 22(sup1), 24‑30. https://doi.org/10.1080/10810730.2016.1209601
- Marty-Lavauzelle, A. et Broqua, C. (1998). Témoignages : Les rituels de deuil de l’association AIDES. Ethnologie française, 28(1), 97‑102.
- Massé, R. (2005). Analyse anthropologique et éthique des conflits de valeurs en promotion de la santé. Dans C. Fournier, C. Ferron, S. Tessier, B. S. Berthon et B. Roussile (dir.), Éducation pour la santé et éthique (p. 25-51). Éditions du Comité français d’éducation pour la santé.
- Mauss, M. (1924). Essai sur le don : forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques. L’Année sociologique, 1, 30‑186. http://classiques.uqac.ca/classiques/mauss_marcel/socio_et_anthropo/2_essai_sur_le_don/essai_sur_le_don.html
- Messinger, K. S. (2019). Death with dignity for the seemingly undignified. The Journal of Criminal Law & Criminology, 109(3), 633‑674. https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=7655&context=jclc
- Milet, M. (2022). Sociologie politique de la menace et du risque. Armand Colin.
- Moran, M. H. (2017). Missing bodies and secret funerals: The production of « safe and dignified burials » in the Liberian Ebola crisis. Anthropological Quarterly, 90(2), 399‑421. http://www.jstor.org/stable/26645883
- Mortazavi, S. S., Assari, S., Alimohamadi, A., Rafiee, M. et Shati, M. (2020). Fear, loss, social isolation, and incomplete grief due to COVID-19: A recipe for a psychiatric pandemic. Basic and Clinical Neuroscience, 11(2), 225‑232. https://doi.org/10.32598/bcn.11.covid19.2549.1
- Moulin, A. M. (2022). La fin de la pandémie de Covid‑19 : quel statut pour les morts de l’épidémie? Frontières, 33(2). https://doi.org/10.7202/1095221ar
- Organisation mondiale de la santé (OMS) (2014). Recommandations transitoires : comment inhumer sans risque et dans la dignité les personnes décédées de maladie à virus Ebola suspectée ou confirmée. https://apps.who.int/iris/handle/10665/149397
- Otani, I. (2010). « Good manner of dying » as a normative concept: « Autocide, » « granny dumping » and discussions on euthanasia/death with dignity in Japan. International Journal of Japanese Sociology, 19(1), 49‑63. https://doi.org/10.1111/j.1475-6781.2010.01136.x
- Paicheler, G. (1998). Risques de transmission du sida et perception de la contagion. Communications, 66(1), 87‑109. https://doi.org/10.3406/comm.1998.2005
- Pearce, C., Honey, J. R., Lovick, R., Zapiain Creamer, N., Henry, C., Langford, A., Stobert, M. et Barclay, S. (2021). « A silent epidemic of grief »: A survey of bereavement care provision in the UK and Ireland during the COVID-19 pandemic. BMJ Open, 11(3), Article e046872. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-046872
- Piarroux, R. (2019). Choléra : Haïti 2010-2018, histoire d’un désastre. CNRS éditions.
- Sams, K., Alfieri, C., Beauvieux, F., Egrot, M., Kra, F., Magnani, C., Mininel, F. et Musso, S. (2021). « …but not gagged »: Responding to Covid‐19 and its control measures in France, Italy and the USA. Anthropology Today, 37(6), 5‑8. https://doi.org/10.1111/1467-8322.12685
- Sams, K., Desclaux, A., Anoko, J., Akindès, F., Egrot, M., Sow, K., Taverne, B., Bila, B., Cros, M., Keïta-Diop, M., Fribault, M. et Wilkinson, A. (2017). Mobilising experience from Ebola to address plague in Madagascar and future epidemics. The Lancet, 390(10113), 2624‑2625. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)33088-X
- Sams, K., Grant, C., Desclaux, A. et Sow, K. (2022). Disease X and Africa: How a scientific metaphor entered popular imaginaries of the online public during the COVID-19 pandemic. Medicine Anthropology Theory, 9(2), 1. https://doi.org/10.17157/mat.9.2.5611
- Signoli, M. (2008). Archéo-anthropologie funéraire et épidémiologie. Réflexions autour des sépultures de crise liées aux épidémies de peste du passé. Socio-anthropologie, (22), 107‑122. https://doi.org/10.4000/socio-anthropologie.1155
- Signoli, M., Chevé, D., Boetsch, G. et Dutour, O. (1998). Du corps au cadavre pendant la Grande Peste de Marseille (1720-1722) : des données ostéo-archéologiques et historiques aux représentations sociales d’une épidémie. Bulletins et Mémoires de la Société d’anthropologie de Paris, 10(1), 99‑120. https://doi.org/10.3406/bmsap.1998.2505
- Simpson, N., Angland, M., Bhogal, J. K., Bowers, R. E., Cannell, F., Gardner, K., Gheewala Lohiya, A., James, D., Jivraj, N., Koch, I., Laws, M., Lipton, J., Long, N. J., Vieira, J., Watt, C., Whittle, C., Zidaru-Bărbulescu, T. et Bear, L. (2021). « Good » and « bad » deaths during the COVID-19 pandemic: Insights from a rapid qualitative study. BMJ Global Health, 6(6), Article e005509. https://doi.org/10.1136/bmjgh-2021-005509
- Sodikoff, G. (2019). Multispecies Infrastructures of the Plague in Madagascar. Dans F. Keck, A. H. Kelly et C. Lynteris (dir.), The Anthropology of Epidemics (p. 104‑120). Routledge.
- Taverne, B., Akindès, F., Berthe, A., Bila, B., Caremel, J.-F., Desclaux, A., Dagobi, A. E. Egrot, M., Fournet, F. et Houngnihin, Roch (2015). Anticiper les flambées épidémiques à virus Ebola : pas sans les sciences sociales! Global Health Promotion, 22(2), 85‑86. http://ped.sagepub.com/content/early/2015/05/12/1757975915582299.extract
- Thomas, L.-V. (1975). Anthropologie de la mort. Payot.
- Thomas, L.-V. (1982). La mort africaine. Idéologie funéraire en Afrique noire. Payot.
- Thomas, L.-V. (1985). Rites de mort. Pour la paix des vivants. Fayard.
- Thomas, L.-V. (2013). Cinq essais sur la mort africaine (2e éd.). Karthala.
- Trompette, P. (2008). Le marché des défunts. Les Presses de Sciences Po.
- van der Geest, S. (2004). Dying peacefully: Considering good death and bad death in Kwahu-Tafo, Ghana. Social Science & Medicine, 58(5), 899‑911. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2003.10.041
- Verdery, K. (1999). The Political Lives of Dead Bodies: Reburial and Postsocialist Change. Columbia University Press.
- Veyrié, N. (2019). Le deuil des êtres chers, une épreuve intime et sociale. Sociographe, 12(5), 165‑184. https://www.cairn.info/revue-le-sociographe-2019-5-page-165.htm
- Wondji, C. (1972). La fièvre jaune à Grand-Bassam (1899-1903). Revue française d’histoire d’outre-mer, 59(215), 205‑239. https://doi.org/10.3406/outre.1972.1596
- Wondji, C. (1976). Bingerville, naissance d’une capitale, 1899-1909. Cahiers d’études africaines, 16(61), 83‑102. https://doi.org/10.3406/cea.1976.2893

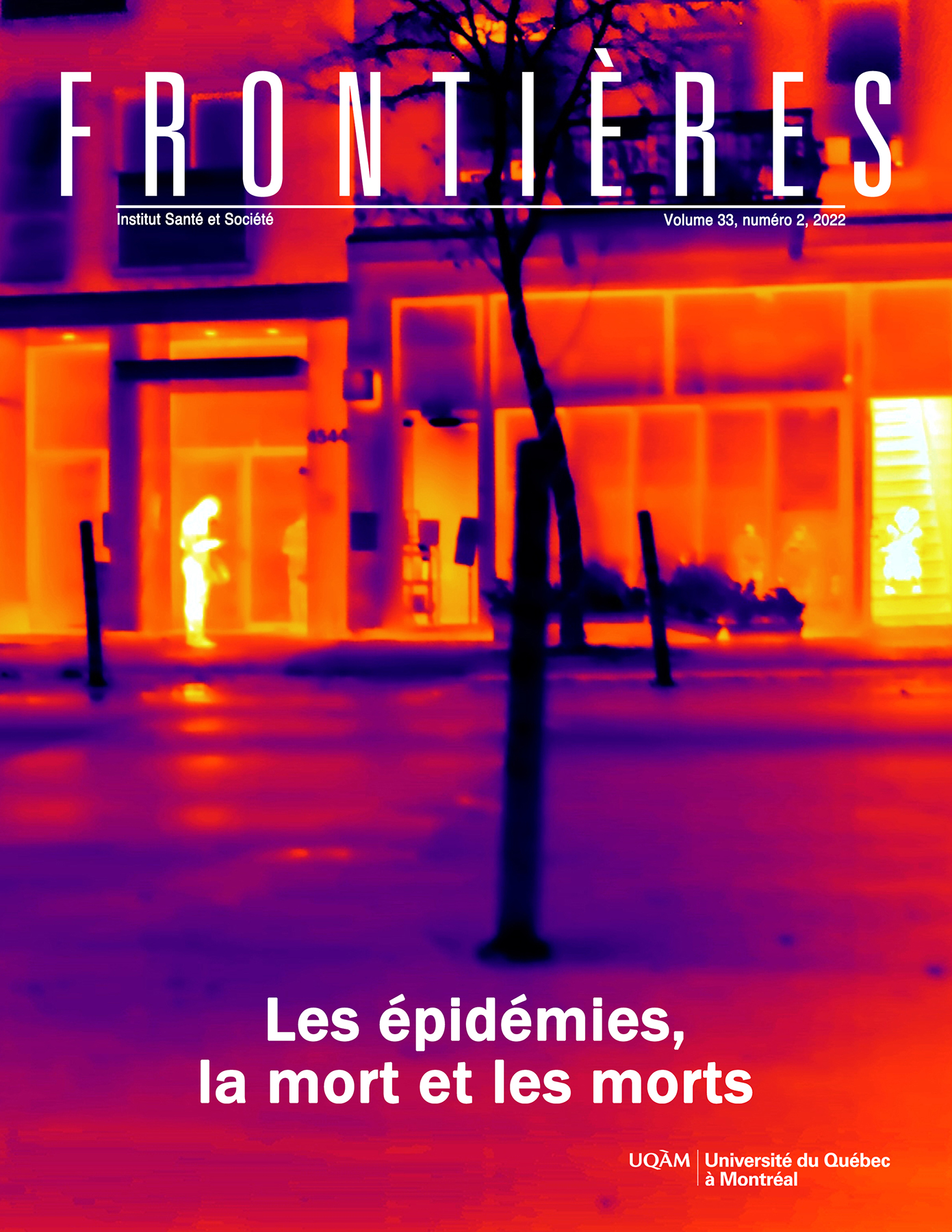
 10.7202/1090987ar
10.7202/1090987ar