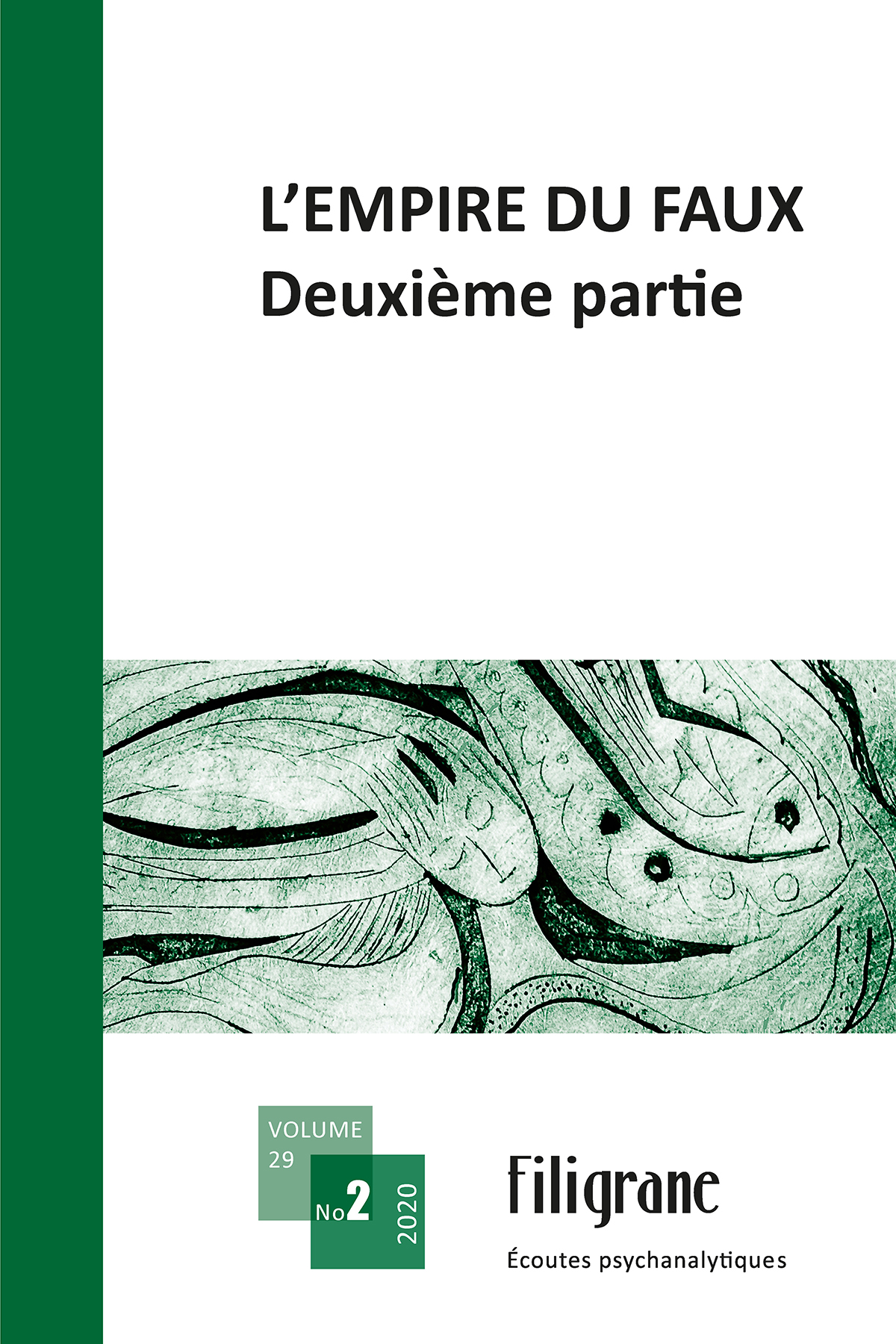Abstracts
Résumé
Après avoir rappelé la tentative de réaménagement psychique que peut représenter le recours à l’acte de fuguer, cet article propose une lecture de la trajectoire adolescente marquée par ce type d’expérience. La psychothérapie de Sophie, qui s’est déroulée sur une quinzaine d’années, autorise une observation en après-coup d’une trajectoire de fugue adolescente. Il pourrait être tentant de parler ici d’une forme de résilience. Toutefois, il apparait plus juste d’évoquer l’accès à une « relativement bonne adaptation sociale » sur des personnalités restées en souffrance, au bord de décompensations, au-delà de leur adaptation. La discussion porte sur les effets positifs ou délétères d’un tel recours à l’acte, en insistant sur la différence fugue/errance ainsi que sur l’intérêt de la psychothérapie d’inspiration analytique dans l’après-coup de tels contextes extrêmes, à forte occurrence limite.
Mots-clés :
- errance,
- fugue,
- incestuel,
- procédé autocalmant,
- recours à l’acte,
- passage initiatique
Abstract
After an overview of the ways in which running away can be conceptualized as a move toward psychic reorganization, this paper proposes to explore the impact of an adolescence marked by such an experience. Spanning about 15 years, Sophie’s psychotherapy serves as the lens through which to observe the deferred impact of her adolescent runaway experience. It is tempting to think in terms of a form of resilience. However, it may be more accurate to refer to a “good enough adaptation” in personalities that continue to suffer and are at frequent risk of decompensation. The discussion centres on the positive and adverse future consequences of this form of acting out—while making a distinction between running away and truancy—, and on the potential benefits of an analytic-type psychotherapy to work on the aftermath of extreme experiences combined with borderline dynamics.
Keywords:
- truancy,
- running away,
- incestuous,
- self-soothing,
- acting out,
- rite of passage
Download the article in PDF to read it.
Download
Appendices
Note biographique
Olivier Jan est psychologue clinicien, et pratique au Centre Hospitalier du Rouvray, à Rouen.
Bibliographie
- Abraham, N. et Törok, M. (1999). 1959-1975. L’écorce et le noyau. Paris : Flammarion.
- Bergeret, J. (1996). La personnalité normale et pathologique. Paris : Dunod.
- Caro, F. A. (2005). Voyage pathologique : historique et diagnostiques différentiels [mémoire, Université Paris VII].
- Ciavaldini, A. (1999). Psychopathologie des agresseurs sexuels. Paris : Masson.
- Kiley, D. (1983). The Peter Pan Syndrom: Men Who Have Never Grown Up. New York : Mead.
- Donabedian, D. (1993). Procédé autocalmant, état oniroïde, décharge ? Revue française de psychosomatique, 4 (2), 117-128.
- Douville, O. (2000). Des adolescents en errance de lien. L’information psychiatrique, 1, 29-34.
- Duclos, K. (2002). Au sujet d’une modalité particulière de recours à l’activité physique : les procédés autocalmants. Philosophia Scientiae, 6 (1), 93-103.
- Freud, S. (1924). La perte de la réalité dans la névrose et dans la psychose. Dans Névrose, psychose et perversion (p. 299-303). Paris : Presses universitaires de France.
- Follin, S. (1998). Vivre en Délirant. Le Plessis-Robinson : Institut Synthélabo.
- Gaulejac, V. de (2011). Les sources de la honte. Paris : Seuil.
- Gaulejac, V. de, Taboada, L. I., Blondel, F. et Boullier, D. (2015). La lutte des places. Paris : Desclée de Brouwer.
- Jacques, E. (1979). Mort et crise du milieu de la vie. Dans R. Kaës (dir.), Crise, rupture et dépassement (p. 277-305). Paris : Dunod.
- Jan, O. (2016). Ce qu’errer veut dire. Étude psychopathologique et anthropologique de l’errance à partir des cliniques de la grande précarité. Proposition du concept d’errance essentielle [thèse de doctorat, Université de Rouen].
- Jan, O. (2020). Éléments sur l’usage de la contrainte en psychiatrie aujourd’hui. Émergence de logiques péremptoires dans le champ psychiatrique. Vie Sociale et Traitements, 1 (145), 55-62.
- Green, A. (1983). Le complexe de la mère morte. Dans Narcissisme de vie, narcissisme de mort. Paris : Minuit.
- Laborit, H. (1976). Éloge de la fuite. Paris : Robert Laffont.
- Lesourd, S. (2000). La frustration de l’acte et de l’adolescent. Dans C. Hoffman (dir.), L’agir adolescent (p. 21-32). Ramonville : Eres.
- Maleval, J.-C. (1981). Le délire hystérique n’est pas un délire dissocié. Dans Folie hystérique et psychose dissociative. Paris : Payot.
- Raoult, P.-A. (2006). Clinique et psychopathologie du passage à l’acte. Bulletin de psychologie, 1 (481) 7-16.
- Smadja, C. (2001). Clinique d’un état de démentalisation. Revue française de psychosomatique, 19, 11-27.
- Trastour, G. (2000). Partis de nulle part et revenus de tout. Champ psychosomatique, 20, 7-19.
- Tisseron, S. (1992). La honte. Psychanalyse d’un lien social. Paris : Dunod.