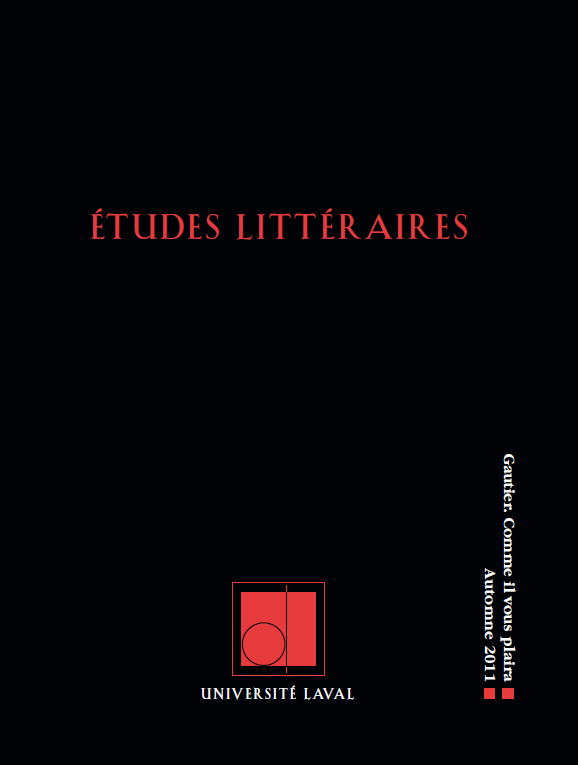Abstracts
Résumé
La fortune et l’influence d’E.T.A. Hoffmann sur la production fantastique de la France du XIXe siècle sont bien connues. Théophile Gautier lui-même a été subjugué par le grand maître allemand : Les Jeunes-France — et Onuphrius notamment — portent les signes visibles de cette fascination ; mais toute son oeuvre fantastique est pétrie, dans ses interstices, de la lectio de « Hoffmann, le fantastiqueur », pour reprendre l’épithète duquel la France littéraire l’affubla. Cet engouement l’amena même à réfléchir sur l’oeuvre « hoffmannique » (comme Baudelaire aimait à dire) en tant que critique. Si son premier article sur l’auteur allemand (resté inédit jusqu’à la fin du XIXe siècle), rédigé quand il n’avait que 19 ans, montre l’enthousiasme exaspéré et un peu naïf de la jeunesse romantique en assumant beaucoup de poncifs de la vogue hoffmannienne, l’essai suivant (Les contes d’Hoffmann, 1836) apporte un point de vue tout à fait nouveau sur la production de ce conteur. Une réflexion fort lucide et ponctuelle, d’une logique infaillible, démystifiant tout cliché, qui va au-delà de l’analyse de l’oeuvre d’Hoffmann, pour proposer une ébauche de la théorie générale du fantastique (au sens propre), qui anticipe les théorisations de la critique du XXe siècle (Castex, Caillois, Todorov, Bessière).
Abstract
E. T. A. Hoffmann’s fame and influence on the fantasy genre in 19th century France are well known. Even Théophile Gautier was won over by this great German master, a fascination evidenced in Les Jeunes-France and Onuphrius, among others. Yet beyond that, every facet of Gautier’s fantasy oeuvre pays tribute to Hoffmann, an author who literary France dubbed the “fantasticor”. Gautier’s infatuation led him to ponder the “Hoffmannian output” (as Baudelaire was wont to say) from his viewpoint as a critic. His first take on the German writer, written when he was but 19 years old and not published until the end of the 19th century, is suffused with naïve, intense, youthful enthusiasm, and embraces many hoffmannian stereotypes. Gautier’s next essay (the 1836 Les contes d’Hoffmann) casts a brand new light on the German’s works. It is an extremely lucid and timely take, the inescapable logic of which demystifies all clichés, going beyond a mere analysis and into a proposed general theory on fantasy as a genre, forecasting such theoretical critics of the 20th century as Castex, Caillois, Todorov or Bessière.
Appendices
Références
- Caillois, Roger, Images, images…, Paris, José Corti, 1966.
- Castex, Pierre-Georges, Le conte fantastique en France de Nodier à Maupassant, Paris, José Corti, 1951.
- Egmont, Henry, « Notice sur la vie et les ouvrages d’Hoffmann », Contes fantastiques de E. T. A. Hoffmann, Paris, Perrotin, 1840, t. 1, p. V-XXXI.
- Lovenjoul, Charles Spoelberch de, Histoire des oeuvres de Théophile Gautier, Paris, Charpentier, 2 t., 1887.
- Gautier, Théophile, « Les contes d’Hoffmann », Souvenirs de théâtre, d’art et de critique, Paris, Charpentier, 1883, p. 41-50.
- Teichmann, Elizabeth, La fortune d’Hoffmann en France, Genève, Droz, 1961.