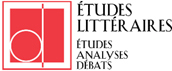Article body
Lorsque j’atteignis l’âge de douze ans, comme le Christ présenté au Temple, le moment était venu pour moi de reconnaître ma vocation. Cela hantait mon âme depuis des années, mais je n’avais jamais pris le temps de m’arrêter pour considérer cette tentation dans les yeux, afin d’y découvrir ce pour quoi la Providence m’avait créé et mis au monde, comme je pouvais le lire dans mon petit Catéchisme que je finis par connaître bien mieux que mon nom et mon identité, deux choses qui ne me seront longtemps révélés que par les dires de mes proches, de même que leurs souhaits les plus stérilisant pour mon originalité
À cette époque, devenir un saint ne me tourmentait d’aucune façon. J’avais l’âme remplie de lumière et courais dans la poussière de la route, mon être rempli d’une joie que je savourais, sans m’en rendre compte. J’étais en bonne santé, et je réussissais même, dans les meilleurs moments de ma vie, à m’amadouer l’amour de ma mère. Il ne me manquait donc rien, sinon de conquérir cet amour maternel d’une façon permanente et, pour ainsi dire, éternelle. Devenir, donc, en cachette, comme elle le souhaitait, sans se l’avouer, son amant dévoué et obéissant. C’est grâce à un songe que je finis par comprendre que le recours à ma vocation pourrait m’aider à réaliser ce voeu.
⁂
Il y a des choses qui ne se révèlent à nous qu’au compte goutte, souvent même, comme ce fut mon cas, qu’au bout de notre âge ou presque. Le reste du temps, on se contente d’à peu près ou, pire encore, de banales vérités nous tenant lieu de dogmes et de religion. C’est dans ces eaux que je nageais au moment où la question de ma vocation vint me hanter. Je venais de rater mon certificat de septième année, avec très grande distinction. Ce qui faisait de moi un candidat idéal pour la vie errante passée à servir n’importe quel maître, en espérant qu’il accepte que je lui rende service, moyennant un casse-croûte occasionnel ou un verre d’eau fraîche, à condition que l’amour me prenne dans ses bras. C’est certain que cette dernière condition ne va pas de soi. L’amour, on en entend parler, même avant notre naissance. Tout le monde le dit : c’est la chose la plus merveilleuse du monde, il n’y a rien de plus beau que de tomber dedans sans même s’en apercevoir : suffit que le soleil brille, que le petit bois soit hanté, et que la belle dorme dans son cercueil de verre, en attendant la résurrection des morts et la délivrance des âmes du purgatoire. Une bagatelle, quoi.
Cela peut arriver à n’importe qui. Suffit que les astres soient bien alignés et que le coeur nous tourne dans la direction contraire à celle des aiguilles d’une montre. Malheureusement, je ne connaissais pas la direction des aiguilles d’une montre, parce le cadran familial était solaire. Mais j’avais du coeur à revendre et de la bonne volonté plein mes bottines. C’est pourquoi je battais le lièvre régulièrement malgré la lenteur proverbiale avec laquelle je m’acquittais des tâches journalières imposées à mon emploi du temps par mon père.
Je venais donc de rater magistralement les examens qui m’auraient permis, si je les avais réussis, de rêver à je ne sais quel avenir nimbé d’ambitions et nourri à la ferveur d’être reconnu par les gens qui ont de la galette dans leur poche, du mépris pour tout ce qui n’est pas eux-mêmes, et un château sis au pied d’une montagne, en face d’une mer étale et d’un lever de soleil en perpétuelle ébullition. Mais la Providence, qui connaît par coeur ce qui convient le mieux à chacun des sujets soumis à son autorité, dont moi, permit que je ne sache pas extraire la racine carrée du nombre pi, ni nommer à la seconde, la capitale du Zimbabwe, ou celle de la Californie. Je fus donc recalé dans mon ignorance et mis aux enchères de la pauvreté sur la place publique, juste devant la porte centrale de l’église paroissiale, comme les petits cochons de la Toussaint.
Tout le monde put railler mon ignorance sans égard pour la sienne, et mon père fit comme s’il ne s’était aperçu de rien, trop occupé qu’il était à compter les oeufs qui s’accumulaient dans le panier de mes douze ans. Toujours est-il que je marchais vers moi-même avec l’opiniâtreté d’un lynx lancé à toute allure sur le sentier de sa proie. Je ne savais pas d’où je venais ni, encore moins, où je m’en allais. J’étais là, tout penaud et surpris moi-même d’y être, en ces temps et lieux. Pas surprenant que la question de ma vocation me frappât en plein visage comme un coup de vent venu on ne sait d’où, mais rempli d’une violence à laquelle il est quasi impossible de résister. Cela me prit, d’une façon toute particulière, au moment où je servais la messe du révérend Père Lafontaine, c.s.c, digne représentant des Pères de Sainte-Croix, responsable de la bonne marche des fidèles autour de l’Oratoire érigé sur les sommets de la chrétienté québécoise par les bons soins du frère André. Je connaissais déjà les saints lieux, ma mère étant abonnée aux Annales du bon Saint-Joseph-du-Mont-Royal, et mon grand-père ayant déjà visité le thaumaturge de la montagne, qui le guérit instantanément de son mal de genou. Ce qui permit à mon aïeul de recommencer à fuir un destin qui le poursuivait depuis sa naissance.
Je fus d’autant plus saisi par la personnalité du digne représentant de cette communauté qu’il me manifesta un semblant d’intérêt que je pris pour une invitation pressante à le suivre sur les chemins d’une vocation supérieure. Cette nuit-là, je rêvai que je parcourais la belle Province, enveloppé dans une flamboyante soutane ornée d’un ceinturon, avec un beau gros crucifix jaune or accroché à mon cou. Ce rêve était d’ailleurs récurrent dans ma vie. Je me voyais régulièrement transfiguré en homme de Dieu, debout devant une assemblée de fidèles suspendus à mes lèvres et prêts à m’entendre réciter des béatitudes : bienheureux les pauvres en esprit, car ils posséderont la paix ; bienheureux ceux qui suent pour la venue du Royaume de Dieu, car ils seront rafraîchis par la grâce ; bien heureux ceux qui pleurent, car les cieux s’ouvriront en eux…
Il arrivait parfois que la foule se détournât de mes sermons proférés avec ferveur et humilité. Saint Antoine de Padoue venait à mon secours en m’indiquant la façon de procéder pour asseoir l’autorité de ma parole. « Suffit de quitter ton piédestal pour te rendre en face du lac, me disait le saint homme, en catimini, et de laisser les paroles sortir de la bouche de Dieu confondu avec la tienne devant l’assemblée des poissons qui ne demandant pas mieux que de croire. » Le saint franciscain expérimenta lui-même l’efficacité de sa recette. Durant la harangue qu’il s’adressait à lui-même par le biais de la nature ouverte à ses prières, les poissons sortirent la tête de l’eau et commencèrent à respirer l’air libre qui circulait tout autour. Il y avait même, dans mon livre de lecture, une photo très impressionnante de la scène.
Je fus tellement ému par la contemplation de l’ensemble que je formulai le voeu de devenir moi-même franciscain afin de pouvoir, moi également, apprivoiser les animaux sauvages qui habitaient mes cavernes intérieures, et me rendre ainsi libre d’obéir aux voix qui parlaient dans le silence de mon âme. Saint François d’Assise était passé maître dans ce domaine et avait fondé une communauté vouée à la louange du Seigneur qui se manifeste à nous à travers tout ce qui nous entoure, et dont nous pouvons percevoir l’existence lorsque nous allumons nos phares antibrouillard.
J’aurais bien voulu devenir moi-même compagnon de ce stigmatisé par la grâce, en me joignant à ses descendants qui avaient pignon sur rue dans le vieux Trois-Rivières, où je me rendais parfois, avec mon oncle, marchand de bois, pour en livrer quelques cordes, afin de permettre aux bons pères de réchauffer l’atmosphère qui avait tendance à se refroidir avec l’arrivée des neiges et de la poudrerie, même dans leur monastère. Mais ayant appris par ce même oncle que les franciscains devaient se déplacer pieds nus dans leurs sandales aussi bien en hiver qu’en été, l’idée de devenir franciscain me quitta plus vite qu’elle ne m’était venue. J’ai toujours eu froid aux pieds.
Mais rien n’était définitivement perdu puisqu’il me restait l’Oratoire du Mont-Royal et la communauté des pères Sainte-Croix dont l’un des représentants prêchait, en ce moment, dans le désert de ma paroisse natale à l’occasion du Carême. Je m’ouvris donc à lui de mon désir de devenir prêtre pour l’éternité selon l’ordre de Melchisédech, comme le stipulait la formule consacrée que je pouvais lire dans mon missel, tous les dimanches. Mon voeu ne fut pas pris au sérieux par le collègue du frère André. C’est à peine s’il écouta ma demande d’admission dans son programme de vie, demande à laquelle il me répondit par un sourire qui en disait long sur ma naïveté et me révéla la place que j’occupais dans l’échelle de ses valeurs admiratives. Je continuai quand même à lui servir la messe jusqu’à la fin de son séjour, mais son refus poli eut sur mon enthousiasme l’effet qu’on peut deviner. Je commençai à grelotter dans le fond de mon être et à regretter amèrement d’avoir loupé mon entrée sur la scène intellectuelle, en ratant mes examens du Département de l’Instruction publique.
J’errais donc en moi-même à la recherche de ma vocation, parce qu’il n’était pas possible, pensais-je dans ma naïveté plus vivace que le chiendent, que j’aie été créé et mis au monde pour rien. Mais pourquoi ai-je été créé ? Personne ne pouvait répondre à mes questions parce que personne ne s’intéressait à elles, pas plus d’ailleurs que quiconque ne s’intéressait à moi. Ce qui était normal. Qui peut s’intéresser à quelqu’un qui a terminé ses études primaires par un beau plongeon dans une piscine vide ? Personne, bien entendu, comme j’ai fini par le comprendre, en me laissant couler la vie sur la carapace qui me servait d’abri.
J’errais, donc, cherchant entre mon ennui et ma solitude une épaule prête à me laisser tomber au moment où je m’y attendrais le moins. Ce fut celle d’Anne-Marie qui se présenta. Ce qu’elle était belle, cette épaule. Ronde, chaude, colorée par le soleil et tellement dodue que je devais me retenir pour ne pas la mordre.
Voyant l’intérêt que je manifestais pour son épaule, la belle si tu voulais me la prêta sans se faire prier. Je m’agenouillai donc et commençai mon heure d’adoration devant son saint sacrement exposé à l’admiration de mon assiduité. Je venais, il me semble, de trouver ma vocation. En effet, tout le temps que dura la contemplation, je ne me posai aucune question concernant le sens du monde, le nombre de galaxies qui peuplent l’univers, le quotient intellectuel des singes ou les mensurations de Deborah Kerr. J’étais comblé, gaga, satisfait jusqu’à l’ultime ravissement du corps dans l’âme et de l’âme dans l’éternité.
Malheureusement, comme chacun s’en doute, le serpent ne voyait pas d’un bon oeil qu’un humble mortel doué de surcroît d’une intelligence plus que moyenne parvienne à goûter des joies que lui, le plus intelligent des anges, ne peut même pas rêver s’approcher. Et le serpent serpenta le long du chemin conduisant aux bleuets où je trouvai Anne-Marie au bras du Rossignolet. J’en fus quitte pour ma déconvenue que j’avalai comme j’avalai toutes les déceptions que la Providence a eu la générosité de laisser tomber dans les goussets de mon humanité souffrante sur le bord du néant.
Je venais, si on peut dire, de perdre ma vocation. Contempler ne me suffisait plus parce que je ne pouvais plus me fier à mon instinct de participation. J’errais donc dans la forêt des symboles à la recherche d’un alibi susceptible de me donner confiance en moi, et de me lancer dans les hautes sphères de la dignité reconquise.
Ô vocation, existes-tu, ou es-tu seulement un leurre qui permet au petit âne de tirer sa charge en attendant de voir ses yeux fermés par la mort ? Où es-tu, beau chant que j’ai entendu monter des profondeurs de la lumière qui venait, chaque matin, lécher les pieds de mon enfance debout sur le perron d’où elle pouvait regarder courir le temps sur les murs de la grange posée comme une arche abritant tous les animaux qui vivaient au fond de mon être ?
Je ne sais plus où j’en suis, ô vocation, après toutes ces années de culs-de-sac et de transsubstantiation. Je hume à nouveau l’air qui se dégageait de mon âme éprise d’absolu et qui ne cherchait rien de moins que Dieu dans tous les gestes qu’elle posait dans la ferveur de mon corps. Je t’ai cherchée sur les chemins étroits de la vie religieuse sur lesquels vont ceux qui ont choisi de parcourir l’invisible revêtu de la foi vive, de l’espérance attentive à tous les signes que le ciel déroule sous nos yeux incrédules et de la charité qui commence par une grande admiration pour le cosmos lancé à toute allure par la main d’un géant qui dirige l’imprévu du fond de sa carriole.
Et je te cherche encore, ô vocation, après toutes ces années passées à suivre mon cours dans une salle de classe remplie d’esprits attentifs à eux-mêmes, comme la chose est normale lorsqu’on nage dans les grandes écluses de l’amour de soi qui se cherche un ancrage pour accoster son navire avant qu’il ne prenne eau de toute part. Et c’est alors, du plus profond des naufrages que chacun doit vivre au jour le jour, que résonne, au plus intime de l’être, la question de la possible vocation grâce à laquelle chacun peut entendre parler le silence dans les corridors de sa solitude choisie pour elle-même par tous ceux qui en ont découvert le prix et la fécondité.
Appendices
Note biographique
Jean-Noël Pontbriand
Jean-Noël Pontbriand enseigne depuis plus de 50 ans. Il a oeuvré à tous les niveaux de l’enseignement public et privé, y compris à l’Université. Il est membre du personnel enseignant du Département des littératures de l’Université Laval depuis 35 ans et y enseigne la création littéraire depuis 1982. Il a publié trois essais sur l’enseignement de la poésie et de la création littéraire, une dizaine de recueils de poésie et deux récits à saveur autobiographique : Taches de naissance (Québec, Éditions de la Huit, 2005) et Vous serez comme des dieux (Québec, Éditions de la Huit, 2008).