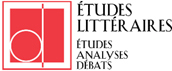Abstracts
Résumé
Cet article s’interroge sur les caractéristiques formelles du verset moderne, considéré comme une forme intermédiaire entre le vers libre et le poème en prose. Dans un premier temps, l’auteure s’intéresse à la composante graphique des versets (la typographie et la ponctuation). Elle aborde ensuite la question controversée de la « survie » de la tradition métrique dans la poésie moderne. Pour finir, elle s’efforce de montrer comment l’unité du verset est assurée par son organisation rythmique, phonétique et syntaxique. Une place importante est accordée aux constructions parallèles et répétitives participant à l’organisation structurelle des poèmes. Les analyses portent sur les recueils de Claudel, Saint-John Perse et Senghor.
Abstract
In the present study we propose to describe the formal characteristics of the modern verset, considered as the cross-over point between vers libre and the prose poem. Firstly, the fundamental typographical problems are summarized briefly. Then the controversial question of the “survival” of the tradition in the modern poetry is discussed. Finally, we examine how the unity and cohesiveness of the verset are ensured by its rhythmic, phonetic and syntactical organisation. Particular attention is called to repetitions and parallelism. We analyse the volumes of poetry by Claudel, Saint-John Perse and Senghor.
Article body
Les pratiques formelles des poètes modernes et contemporains sont très diversifiées. À côté du vers régulier dont la tradition (bien que marginalisée) se maintient tout au long du XXe siècle, ce sont essentiellement les nouvelles formes poétiques (le poème en prose, le vers libre et le verset) qui représentent les principaux modèles d’écriture. Reconnues aujourd’hui par les critiques et perçues par les lecteurs comme des poèmes, ces formes modernes continuent à soulever des débats, et donnent lieu à des approches différentes.
Dans cet article, nous proposons de nous interroger sur les caractéristiques formelles du verset, de loin la forme poétique moderne la moins étudiée. La diversité des textes auxquels les poètes ou les commentateurs ont attribué la qualité de verset depuis le début du XXe siècle, l’absence de frontières nettes le séparant d’autres formes littéraires proches rendent problématique toute tentative de définition. Son autonomie même n’est pas unanimement reconnue par les critiques. Quelques-uns l’admettent comme « l’une des écritures possibles du poème en prose[1] », voire comme « une prose[2] », d’autres (les plus nombreux) le rangent parmi les « formes particulières d’écriture versifiée[3] » en tant que « variante du vers libre[4] ».
Tout en insistant sur sa spécificité, nous considérons le poème écrit en versets comme une forme intermédiaire entre le vers libre et le poème en prose. Situé à l’intersection de ces deux formes, il intègre certains de leurs traits caractéristiques que nous tenterons de dégager et de décrire. Nos analyses se basent sur trois recueils poétiques : Cinq grandes Odes (1910) de Paul Claudel, Éloges (1911) de Saint-John Perse et Chants d’ombre (1945) de Léopold Sédar Senghor[5]. La prise en compte des éléments constitutifs de leurs poèmes devra faire ressortir la variété et les constantes (s’il y a lieu) de leur pratique poétique et, par là, celles du verset.
Le verset, en tant que poème, présente un travail spécifique sur les divers plans de la matière langagière. Nous en considérerons successivement les composantes typographique, métrique, rythmique, phonétique et syntaxique. Une place importante sera accordée aux constructions parallèles et répétitives participant aux effets de rythme et à l’organisation structurelle des poèmes. Notre travail s’inscrit dans l’approche linguistique des formes poétiques. Nous aurons recours aux nouveaux outils d’analyse, introduits ces dernières années par les travaux de Michèle Aquien, Jean-Louis Backès, Gérard Dessons et Henri Meschonnic, entre autres.
L’apparition du vers libre (et déjà celle du poème en prose) a attiré l’attention sur l’importance de l’inscription du poème sur la page. Les procédés typographiques et la disposition donnent une première vision des textes, ils orientent le lecteur vers l’écriture prosaïque ou poétique.
La dimension des poèmes écrits en versets ou en vers libres n’est pas pertinente : ils peuvent être de longueur variée allant de quelques lignes[6] à une dizaine de pages[7]. Malgré l’existence des versets et des vers libres d’une dimension très importante, par exemple chacune des Cinq grandes Odes claudéliennes, il est exagéré de parler de « la restauration du poème long[8] », comme le fait Claudel, d’autant plus que la pratique du poème long n’a jamais cessé d’exister. La brièveté, considérée pendant longtemps — à la suite de Suzanne Bernard[9] — comme l’un des traits définitoires du poème en prose, commence à être discutée à cause de son imprécision[10]. La plupart des critiques se contentent de nos jours de dire que la « longueur du poème en prose ne saurait excéder plus de quelques pages[11] ».
Le simple découpage typographique des poèmes en versets ou en vers libres de différente longueur, sans l’introduction des interlignes, crée à lui seul un rythme visuel. Des lignes de blanc peuvent être insérées entre des ensembles de versets[12] et de vers libres, mais aussi entre les « couplets » des poèmes en prose (ceux d’Aloysius Bertrand, par exemple) qui prennent ainsi des allures de strophes. La présentation compacte de quelques textes de Saint-John Perse (« Le parasol de chèvre[13] » et « L’arc[14] »), rappelant la densité de la prose, ne manque pas de mettre en doute leur statut de verset.
L’unité typographique et rythmique du verset se situe entre le vers et le paragraphe[15]. On continue à se servir du terme « vers » sans se référer aux deux facteurs (le mètre et la rime) qui l’ont défini pendant des siècles. Depuis l’apparition du vers libre, en effet, le trait qui différencie le vers de la prose se réduit à son formatage graphique. Selon les termes de Meschonnic, « le vers libre a montré la ligne, puisque c’est tout ce qu’il gardait du vers[16] ».
Contrairement au vers libre, le verset — en tant qu’unité typographique — ne se définit pas par le retour à la ligne. Il se poursuit le plus souvent bien au-delà de la marge de droite. En ce qui concerne la présentation graphique, il y a deux possibilités. On peut marquer la première ligne du verset par le retrait d’alinéa et commencer les autres lignes à la marge (Claudel et Saint-John Perse procèdent de cette manière). Le recours à l’alinéa est d’ailleurs le propre du poème en prose.
Vous ne trouverez point de rimes dans mes vers ni aucun sortilège. Ce sont vos phrases mêmes. Pas aucune de vos phrases que je ne sache reprendre[17] !
Chez Senghor, en revanche, tous les débuts de versets sont alignés à la marge de gauche, mais il y a un retrait à droite au début de la ligne suivante. L’alignement à gauche des débuts de versets rappelle la disposition des vers libres.
C’est le temps de partir, d’affronter l’angoisse des gares, le vent courbe qui
rase les trottoirs dans les gares de Province ouvertes
L’angoisse des départs sans main chaude dans la main[18].
Il arrive que la dimension du verset soit inférieure à celle de la ligne, voire qu’il se réduise à un seul mot. Le mot isolé sur une ligne est le plus souvent un substantif (« Palmes[19] ») ou un verbe (« J’oublie[20] »), mais exceptionnellement un mot de négation (« Ni[21] ») ou un pronom interrogatif (« Quelle[22] ») peuvent également se trouver dans cette position. La présence du blanc final apparente alors le verset plus bref que la ligne au vers (libre). La typographie aérée des versets dépassant à peine la largeur de la page oriente également le lecteur vers la forme versifiée. Il est légitime de parler dans ce dernier cas d’ « une sorte de vers libre élargi[23] » ou d’ « un vers libre de grande longueur[24] ».
Dans le vers libre, écrit Remy de Gourmont, « l’alexandrin s’allonge et s’accourcit selon que l’idée a besoin d’ampleur ou de resserrement[25] ». Si les théoriciens du vers libre désapprouvent l’emploi des vers libres « beaucoup plus long[s] que l’alexandrin », c’est pour maintenir, comme l’explique Jean-Pierre Bobillot,
l’unité du vers — en évitant qu’il ne risque de se décomposer en deux ou plusieurs cellules rythmiques, syntaxiques ou sémantiques — et son identité — en évitant qu’il ne se confonde purement et simplement avec la prose[26].
C’est justement le risque que courent les versets très longs. En effet, dès qu’ils s’allongent démesurément (il y a par exemple un verset de 16 lignes dans « Éloges IV » de Saint-John Perse[27]), ils sont perçus comme des paragraphes. Les poèmes aux longs paragraphes sont précisément ceux dont la qualité de versets peut faire problème. C’est en se référant à ce critère, à quoi s’ajoute l’abandon de la majuscule initiale, que quelques critiques[28] préfèrent parler de poème en prose à propos de la poésie persienne. Le fait que Claudel et Senghor maintiennent la majuscule initiale au début de chaque verset et non seulement au début des phrases est considéré par les commentateurs comme un indice important de la poéticité de leurs textes.
Loin d’être supprimée, comme il arrive souvent dans les vers libres du XXe siècle, la ponctuation reste chez Claudel, Saint-John Perse et Senghor[29] un important facteur de segmentation interne. Ils ont recours à des procédés de marquage variés pour rendre dans leurs poèmes le dynamisme de la voix, avec son intonation, ses pauses. Le nombre exceptionnellement grand des points d’exclamation indique dans les trois recueils la dominance de la modalité exclamative. Les nombreuses occurrences à l’intérieur des lignes, en segmentant les versets, contribuent également à dessiner l’image extérieure des textes (« O mon amie ! ô Muse dans le vent de la mer ! ô idée chevelue à la proue[30] ! »). Les majuscules à l’initiale des noms communs — très fréquentes chez les trois poètes — mettent en relief les mots autrement passés inaperçus : « le Vide[31] », « la Nuit[32] », « la Maison[33] », pour ne citer que quelques exemples au hasard. Les italiques signalent une citation ou une formule d’origine étrangère (« Non serviam[34] ! » ; « Kor Siga[35] ! »). Ils peuvent également attirer l’attention sur les mots importants pour le poète : « la parole exprimée[36] », « un homme juste[37] ». Dépassant la fonction traditionnelle de l’accentuation, l’italique va tout dominer chez Saint-John Perse et se constituer comme l’un des « signes extérieurs de [sa] singularité[38] ». La parenthèse perd également chez lui (dans une moindre mesure chez Claudel aussi) son rôle habituel, celui de commenter, préciser, contester, pour produire des effets de contraste, de variation ou de redondance. Le dernier verset mis entre parenthèses du poème persien (« Pour fêter une enfance V »), par exemple, récapitule (sous forme développée) les lignes initiales des deux premières strophes : « (… Ô j’ai lieu de louer ! Ô fable généreuse, ô table d’abondance[39] !) »
Les choix typographiques des poètes ne sont pas sans signification. Les différents types de marquage que l’on vient de passer brièvement en revue fonctionnent comme des signes de poésie, par différence avec la prose.
Les métriciens de la période classique n’ont vu dans la répartition des blancs sur la page — principalement dans leur disposition en fin de ligne — qu’un simple artifice typographique. Les théories nouvelles en revanche y découvrent l’essence même de la poésie moderne. On peut constater chez les critiques et les poètes une valorisation symbolique du blanc. Il suffit de citer quelques formules célèbres de Claudel pour s’en convaincre. Définissant le vers « essentiel et primordial » comme « une idée isolée par du blanc[40] », il décrit ce dernier comme « la condition même de [l’existence du poème], de sa vie et de sa respiration[41] ». Le blanc final possède une fonction démarcative, il peut indiquer à lui seul (en l’absence des contraintes métriques) les frontières du vers libre, mais aussi celles du verset, leur confère par là un statut d’unité autonome. C’est au nom de cette unité que les premiers théoriciens du vers libre (Gustave Kahn, Édouard Dujardin[42]) proscrivent l’enjambement. Cependant, la pratique des poètes montre que ce mode de segmentation n’implique pas forcément la coïncidence des unités typographiques et linguistiques. Le verset peut montrer les mêmes décalages que le vers libre entre la limite typographique et la structure syntaxico-sémantique. Sur ce point, Claudel se réfère à l’exemple de Shakespeare :
Il y aurait beaucoup à dire sur le vers des derniers drames shakespeariens dont l’élément prosodique principal paraît être l’enjambement, the break, le heurt, la cassure aux endroits les plus illogiques, comme pour laisser entrer l’air et la poésie par tous les bouts[43].
Les mots disloqués sur deux versets différents, coupés en fonction de l’articulation syllabique (« Co » / « Mment », « cri » / « Ez »), voire en fonction de l’articulation des phonèmes (« v » / « Ous »), n’apparaissent que dans ses premiers drames[44]. Les nombreux enjambements des Cinq grandes Odes, tout comme ceux des Éloges de Saint-John Perse, remplissent une fonction suspensive et/ou emphatique. La division des temps composés (« sont » / « Expliqués[45] ») ou celle de la construction possessive (« douceur » / « d’une vieillesse[46] »), la séparation de l’article et du substantif (« un » / « Ouvrage[47] ») ou de l’adjectif et du substantif (« beaux » / « insectes[48] ») donnent un accent à des mots autrement inaccentués. Le prédicat, dissocié de son objet (« refaire » / « La chose[49] ») ou de son sujet (« je » / « pleure[50] »), se trouve en position accentuée, à la fin ou à l’attaque des lignes. L’enjambement peut également relier des versets appartenant à des « strophes » différentes (« et le nageur » / a une jambe en eau tiède[51] »). Les Chants d’ombre de Senghor n’ont recours qu’exceptionnellement à la discordance syntaxique. Citons l’un des rares exemples du recueil (la rupture intervient ici après la préposition qui introduit le complément d’objet indirect du verbe) :
Que je respire l’odeur de nos Morts, que je recueille et redise leur voix vivante, que j’apprenne à
Vivre avant de descendre, au-delà du plongeur, dans les hautes profondeurs du sommeil[52].
La possibilité de l’enjambement due à la présence du blanc final (que le poète en fasse un usage fréquent ou rare) est donc un indice important qui permet d’apparenter le verset en tant qu’unité typographique au vers et de le différencier du paragraphe. Suivant la formule de Jan Baetens, « là où il y a aujourd’hui enjambement, la ligne tend à se reconstituer en vers[53] ». Il est vrai que ce trait distinctif perd de son importance dans la poésie contemporaine où les blancs sont parfois introduits à l’intérieur même des textes (André du Bouchet, Jacques Roubaud). C’est pourtant en se référant principalement à ce critère que les critiques (Jean-Louis Backès, André Guyaux, Michel Murat) essaient de trancher la question d’appartenance générique de certains poèmes en prose rimbaldiens. Backès[54] explique par l’absence de l’enjambement que l’on refuse en général le statut de vers libres à « Veillées I[55] ». Selon Murat, l’alinéa enjambé du premier paragraphe d’« Après le Déluge » « ouvre […] la voie au vers libre[56] ». Guyaux parle de « verset dans Angoisse, Après le Déluge ou Nocturne vulgaire, où occasionnellement le fait d’aller à la ligne ne coïncide pas avec une ponctuation forte[57] » (les trois textes contiennent un paragraphe relativement bref, terminé par une virgule.) De même, les poèmes en prose de Marie Krysinska, au lieu d’inaugurer le vers libre, annoncent plutôt la forme du verset[58].
Rappelons que le terme « verset » désigne à l’origine les divisions numérotées de la Bible et d’autres textes sacrés. Le verset hébraïque a « une systématique accentuelle qui lui est propre […] avec une hiérarchie complexe d’accents disjonctifs et conjonctifs[59] ». Ce rythme accentuel n’est pas gardé par les traducteurs dans les langues européennes modernes qui se contentent le plus souvent d’assurer l’autonomie du verset hébraïque par le moyen typographique de l’alinéa. La fin d’un verset biblique correspond toujours à une fin de groupe syntaxique et sémantique, le plus souvent elle coïncide avec la fin d’une phrase[60]. Le verset moderne, ayant souvent recours à l’enjambement, diffère sur ce point aussi de son modèle biblique.
Claudel se réfère ouvertement aux versets bibliques (« le vers des Psaumes et des Prophètes[61] ») lorsqu’il expérimente cette forme poétique d’abord dans ses premiers drames (La ville, Tête d’Or), ensuite dans son recueil lyrique (Cinq grandes Odes). Il y réfléchit sur le fonctionnement de la poésie, conçue comme moyen d’accès au divin. Le verset claudélien s’impose dans la suite comme une référence quasi incontournable. La parenté avec l’éloquence sacrée ne sera pas pourtant toujours si évidente chez les autres poètes en versets (comme André Suarès, Léon-Paul Fargue), ce qui peut rendre problématique l’emploi du terme. La spécificité du verset moderne résidera alors moins dans les relations qu’il entretient avec la spiritualité que dans les caractéristiques formelles le distinguant du poème en prose et du vers libre.
Les versets de Claudel, d’une part, et ceux de Saint-John Perse et de Senghor, de l’autre, se ressemblent par leur tonalité générale, qu’il s’agisse de la célébration de Dieu ou de l’éloge du monde et de la nature, mais ils se distinguent par leur organisation. Il est habituel d’identifier des segments syllabiques rappelant des types de vers familiers dans les versets dits « métriques » de Saint-John Perse et de Senghor. Quant au verset claudélien, qualifié souvent de verset « cadencé », il repose sur la succession de groupes accentuels distribués selon un ordre croissant (cadence majeure) ou décroissant (cadence mineure), parfois selon une périodicité régulière. La restriction de nos analyses aux recueils de Claudel, Saint-John Perse et Senghor a eu pour effet de laisser de côté la problématique posée par le verset dit « amorphe » qui « ne présente pas de distribution notable de ses éléments[62] ». Gérard Dessons exprime ses réserves concernant ce type de catégorisation. Il refuse surtout que l’on « postule l’existence d’un verset métrique » et propose de parler « d’un seul verset, de nature rythmique-accentuelle[63] ». Il est évident qu’un verset ne peut pas être métrique, puisqu’il est libre, par définition, de toute mesure prédéterminée. Il peut en revanche (tout comme le vers libre ou le poème en prose) accepter des « mètres virtuels identifiables hors de tout contexte métrique[64] ». Le phénomène représente un enjeu plus ou moins important suivant les poètes. Chez Saint-John Perse et Senghor, la dominance des groupes binaires (principalement de six, de huit et de douze syllabes) est tout à fait remarquable. Le repérage de ces éléments enrichit et complexifie notre lecture. Il ne s’agit nullement d’aller à la recherche de passages métriques au nom d’une norme disparue, pour en conclure à « la survie » du système classique. Il importe pourtant de voir quelle est la part de la tradition métrique dans la poésie des poètes étudiés.
L’identification des types de vers traditionnels dans un contexte libre est plus problématique qu’elle ne le paraît. Par défaut de « pression métrique[65] » faisant critère, on ne peut plus donner d’une manière évidente la longueur syllabique des lignes. Seule la scansion des segments où aucun « e » muet intérieur n’est susceptible d’être apocopé, et où nous n’avons pas deux voyelles en contact, ne pose aucun problème. En ce qui concerne la suppression du « e » muet dans la poésie moderne, il n’y a pas de règles précises. La lecture peut dépendre d’un choix subjectif du poète ou du lecteur. La solution la plus simple serait de suivre la prononciation de la langue courante. Il arrive pourtant que l’application des règles de la versification classique révèle la présence des mètres.
Enfance, mon amour, n’était-ce que cela ?… (12 : 6-6)
Enfance, mon amour… (6) ce double anneau de l’oeil et l’aisance d’aimer… (12 : 6-6)
Il fait si calme et puis si tiède, (8)
il fait si continuel aussi, (8)
qu’il est étrange d’être là (8), mêlé des mains à la facilité du jour[66]… (12 : 4-8)
Cette séquence « régulière » est précédée dans le poème (« Éloges V ») par un long verset occupant quatre lignes. Le nombre total de ses syllabes est bien trop grand pour être perçu globalement. On peut le décomposer, recourant parfois à l’élision de tel ou tel « e » muet, en groupes de quatre, six, huit et douze syllabes. Ce découpage est possible parce que ces groupes rythmiques correspondent à des unités syntaxiques, séparées par des signes de ponctuation (virgule, point).
Le pont lavé, (4) avant le jour, (4) d’une eau pareille en songe au mélange de l’aub(e), (12 : 6-6) fait un(e) bell(e) relation du ciel. (8) Et l’enfance adorabl(e) du jour, (8) par la treille des tent(e)s roulées, (8) descend à même ma chanson[67]. (8)
L’équivalence des groupes de huit syllabes (octosyllabes) y est clairement perceptible, parce que la forme est récurrente. Considéré comme le mètre « officiel » et le symbole de la versification française pendant trois siècles, l’alexandrin continue à faire l’objet d’une attention particulière dans la poésie moderne. Il se reconnaît même isolé, grâce à sa valeur culturelle, mais surtout à cause de l’égalité respective de ses hémistiches (6-6).
Dans son drame La ville, où la forme poétique du verset est utilisée pour la première fois, Claudel donne l’impression d’avoir systématiquement cherché à éviter les éléments traditionnels comme l’alexandrin et les rimes[68]. Il est évident que le verset claudélien non plus n’est pas dépourvu de proportions récurrentes. Une notation simple, traduisant par des nombres syllabiques la segmentation syntaxique, mettra à jour sans difficulté des régularités numériques. Mais ces « modules rythmiques[69] » n’ont pas l’intention de se référer au système métrique. En effet, pour Claudel, comme le souligne Bozon-Scalzitti, « l’essentiel n’est pas le chiffre mais le rapport entre les chiffres, la proportion ineffable d’où naît la mesure sainte, libre, toute puissante, créatrice[70] ». Claudel organise ses phrases et ses versets afin de faire sentir des rapports de quantités. Conformément à la loi rhétorique des masses croissantes, liée aux propriétés rythmiques et intonatives de la langue française, il favorise la distribution des segments syntaxiques selon un ordre croissant. Cette dominance est tout à fait nette dans la deuxième partie du recueil, devenu de plus en plus équilibré. On relève un nombre remarquable de versets à cadence majeure, produisant des effets d’amplification, de progression : « – Ô part ! ô réservée ! ô inspiratrice ! ô partie réservée de moi-même ! ô partie antérieure de moi-même[71] ! »
L’effet de rétrécissement lié à la fois à la cadence mineure et à la chute de la phrase sur un segment court est plutôt rare, il apparaît parfois dans les deux premières odes, évoquant l’amour coupable du poète pour Rose et leur rupture : « Et voici que, comme quelqu’un qui se détourne, tu m’as trahi, tu n’es plus nulle part, ô rose[72] ! »
À ces deux types de construction rythmique correspondent en général dans les odes de Claudel deux types de phrases[73]. La phrase ample « à reprise élargissante[74] », rappelant les périodes classiques, est de cadence majeure. La phrase segmentée, d’aspect souvent nominal et énumératif, est parfois de cadence mineure. Le recours à de longues énumérations, coordonnées ou simplement juxtaposées, ainsi que la fréquence élevée des phrases nominales, sont des caractéristiques syntaxiques communes aux recueils de Claudel, Saint-John Perse et Senghor. Les nominalisations, les appositions et les incises s’inscrivent également dans une tendance générale accordant plus d’autonomie aux divers constituants grammaticaux. En imposant un arrêt, tous ces procédés créent des effets de rupture dans le déroulement syntaxique des poèmes. Ils attirent l’attention des lecteurs sur le langage poétique pour lui-même.
La segmentation syntaxique et rythmique peut être mise en valeur par l’assonance des phonèmes terminaux des groupes.
Les adjectifs verbaux du deuxième exemple ont en plus en commun de se terminer par un « e » muet, considéré par Claudel « comme une vibration de l’âme qui prolonge le son[77] ».
Saint-John Perse et Senghor exploitent d’une manière encore plus appuyée que Claudel les effets musicaux et rythmiques des échos phoniques. Ils accordent un rôle organisateur, structural à l’allitération et à l’assonance. La perception des groupes binaires peut également être facilitée par la distribution des homophonies. Donnons un exemple : « Pluie pure de rosée (6) quand saigne la mort du Soleil (8) sur la plaine marine (6) et les vagues des guerriers morts[78]. (8) »
Citons encore la répétition de l’interjection « ô » (une variété particulière de l’allitération) qui caractérise surtout le recueil de Claudel (« Ô grief ! ô revendication[79] ! ») et celui de Saint-John Perse (« Ô clartés ! ô faveurs[80] ! »). Il est à noter que les formes interjectives sont en rapport étroit avec le style nominal : on les rencontre presque toujours dans des constructions dépourvues de verbes. Suivies d’un substantif ou d’un adjectif, elles expriment, dans le style soutenu, une apostrophe ou une invocation, renforçant la tonalité lyrique des poèmes.
Tous ces jeux de sonorités éloignent les versets du langage courant. Ils s’associent pour renforcer leur cohérence et sont à l’origine de leur musicalité. Ils peuvent également produire un effet d’incantation. Sans entrer ici dans les détails, rappelons que la rhétorique classique exerce encore une influence considérable sur les poètes en versets. De longueur en général beaucoup plus importante que le vers libre, le verset peut recourir aux procédés rhétoriques exploités plutôt par la prose. Il fait un usage assez large des figures particulièrement aptes à évoquer le style oratoire.
Depuis que Roman Jakobson, à la suite des recherches de Robert Lowth menées au XVIIIe siècle sur le verset hébraïque, a proposé de faire des structures répétitives et parallèles la caractéristique distinctive du langage poétique, on accorde à celles-ci une importance particulière. Elles sont non seulement primordiales pour des raisons rythmiques, mais elles jouent un rôle dans l’élaboration des réseaux de signification aussi. Les reprises se manifestent à tous les niveaux linguistiques. Outre les récurrences phoniques, les trois recueils présentent de nombreux cas de répétitions lexicales, morphologiques, syntaxiques et sémantiques. Il n’est pas question d’observer toutes les répétitions et parallélismes, cela exigerait de longs développements. Cet aspect des oeuvres a donné lieu à des ouvrages de première importance comme ceux de Gérald Antoine[81] et de Madeleine Frédéric[82]. Dans ce qui suit, on se contente d’évoquer brièvement les types de répétition les plus importants.
Les termes répétés sous forme identique (un seul mot ou un groupe de mots) peuvent se suivre immédiatement. Il est habituel de leur attribuer une fonction d’insistance (« Paix paix et paix[83] »). Des segments entiers peuvent être repris — à l’identique ou avec de légères variations — d’une strophe à l’autre, voire d’un poème à l’autre, en assurant une sorte de continuité aux recueils (« Palmes ! et la douceur / d’une vieillesse des racines[84]… ! »).
Étant donné que la longueur des versets peut varier dans une mesure importante, le point d’accentuation principal se déplace de la position finale à la position initiale. Les anaphores, très nombreuses dans les trois recueils, acquièrent une force structurante comparable à celle des rimes. L’élément répété au début de plusieurs versets à la suite (à quoi s’ajoutent les occurrences intérieures) peut être un substantif (« bénédiction[85] »), une forme verbale (« Donne-moi[86] »), un terme présentatif (« voici[87] »), une préposition (« sur[88] »), un adverbe (« soudain[89] ») ou un pronom personnel (« elle[90] »). Après avoir nommé dans la première ode Mnémosyne, la Muse de la Mémoire, Claudel ne s’y réfère dans la suite que par le pronom personnel à la troisième personne du singulier, au féminin. Les pronoms « elle » forment une longue chaîne (treize occurrences dans la strophe de onze versets, dont six occurrences en position initiale). Dans la dernière ode, lors de la présentation des quatre vertus cardinales, le poète procède de la même manière. La reprise en anaphore de la conjonction « et » au début de plusieurs unités typographiques consécutives est très fréquente chez les trois poètes[91]. Elle ne manque pas d’évoquer les psaumes ou les litanies médiévales. L’enchaînement de séquences syntaxiques brèves par la conjonction « et » rappelle également le langage biblique.
Et ces clameurs, et ces silences ! et ces nouvelles en voyage et ces messages par marées, ô libations du jour !… et la présence de la voile, grande âme malaisée, la voile étrange, là, et chaleureuse révélée, comme la présence d’une joue… Ô[92]
La reprise des unités lexicales au début et/ou à l’intérieur des versets signale le plus souvent des constructions de parallélisme syntaxique.
Ténèbres de l’intelligence ! ténèbres du son !
Ténèbres de la privation de Dieu ! ténèbres actives qui sautent sur vous comme la panthère[93],
Le parallélisme est construit ici sur la répétition en anaphore du substantif « ténèbres » avec variation de son expansion (groupe prépositionnel, adjectif, subordonnée relative). Le rythme essentiel de l’Afrique, celui du tam-tam, est fondé selon Senghor sur la répétition avec variation, ce qu’il appelle les « parallélismes asymétriques[94] ». Le parallélisme syntaxique peut se développer au niveau de la phrase, sans aucune reprise lexicale. Les trois premiers versets de « Éloges III » de Saint-John Perse, par exemple, suivent la même construction grammaticale : sujet, verbe, complément.
Les rythmes de l’orgueil descendent les mornes rouges.
Les tortues roulent aux détroits comme des astres bruns.
Des rades font un songe plein de têtes d’enfants[95]…
Tout au long de cette enquête, nous avons essayé de dégager les caractéristiques formelles du verset moderne, à travers l’examen de trois recueils poétiques : ceux de Claudel, de Saint-John Perse et de Senghor (nos constatations demanderaient à être vérifiées et complétées à la lumière des faits rassemblés sur un corpus beaucoup plus important). Nous avons mis l’accent sur les emprunts que cette forme poétique spécifique fait au vers libre et au poème en prose. Lors de la description de son unité constitutive, nous avons insisté sur les points qui différencient un verset d’un vers, d’une part, et d’un paragraphe, d’autre part. Ce faisant, nous étions obligé de prendre position sur la question fondamentale de la poéticité. Selon la définition typographique (définition minimale), la seule présence du blanc (et par conséquent la possibilité de l’enjambement) autorise à traiter les versets comme des vers et suffit à leur garantir un statut poétique. Tout en reconnaissant l’importance de l’agencement spatial dans la poésie moderne, on attend du verset, comme de tout poème, qu’il manifeste un travail spécifique sur la matière langagière. Nous nous sommes interrogé sur quelques procédés linguistiques mis en oeuvre dans les recueils étudiés qui prennent également en charge l’organisation des versets. Ces faits de langue sont à notre avis représentatifs de l’écriture de Claudel, de Saint-John Perse et de Senghor, et de la forme poétique du verset en général. Les équivalences phonétiques, rythmiques et syntaxiques relevées dans les versets contredisent la linéarité du langage discursif. Offrant des effets formels analogues à ceux que la poésie versifiée met en oeuvre, elles contribuent à fonder le sentiment poétique.
Appendices
Note biographique
Ildikó Szilagyi
Ildikó Szilagyi est chercheure postdoctorale au département de français de l’Université de Debrecen (Hongrie) depuis 2004. Elle enseigne la poésie française moderne. Elle s’intéresse au renouvellement des formes poétiques aux XIXe et XXe siècles. Elle a publié des articles sur Jules Laforgue, Arthur Rimbaud, Paul Claudel, ainsi qu’une thèse sur Les tendances évolutives de la versification française à la fin du XIXe siècle. La problématique du vers libre (Debrecen, 2004).
Notes
-
[1]
Michel Sandras, Lire le poème en prose, 1995, p. 41.
-
[2]
Suzanne Bernard, Le poème en prose de Baudelaire jusqu’à nos jours, 1994, p. 592. Bernard traite brièvement de la problématique du verset sous le titre « une orientation nouvelle de la prose ». Selon Yvette Bozon-Scalzitti, « le verset est une prose qui se resserre plus ou moins selon la tension dramatique ou lyrique » (Le verset claudélien. Une étude du rythme (Tête d’Or), 1965, p. 14).
-
[3]
Yves Vadé, Le poème en prose et ses territoires, 1996, p. 13.
-
[4]
Michel Murat, « Vers rythmique, “verset” », dans Michel Jarrety (dir.), Dictionnaire de poésie de Baudelaire à nos jours, 2001, p. 502.
-
[5]
Les éditions utilisées : Paul Claudel, Cinq grandes Odes, dans Oeuvre poétique, 1957, p. 221-292 ; Saint-John Perse, Éloges, dans Oeuvres complètes, 1972, p. 3-52 ; Léopold Sédar Senghor, Chants d’ombre, dans Oeuvre poétique, 1990, p. 9-54.
-
[6]
Saint-John Perse, « La graine », dans Éloges, op. cit., p. 19.
-
[7]
Léopold Sédar Senghor, « Que m’accompagnent kôras et balafong », dans Chants d’ombre, op. cit., p. 30-39.
-
[8]
Paul Claudel, Oeuvres en prose, 1965, p. 42.
-
[9]
Suzanne Bernard, Le poème en prose, op. cit., p. 15. Les critères de Bernard (unité, brièveté, gratuité) doivent beaucoup à l’influence du structuralisme qui conçoit le poème comme un système structuré, clos et autonome.
-
[10]
André Guyaux pense que « l’absence de nécessité de longueur » est plus déterminante que la brièveté, puisque « beaucoup de genres conventionnels, la maxime, la fable, la nouvelle, l’épigramme, la plupart des poèmes à forme fixe tels que le sonnet, sont courts » (Poétique du fragment. Essai sur les « Illuminations » de Rimbaud, 1985, p. 192).
-
[11]
Yves Vadé, Le poème en prose, op. cit., p. 179.
-
[12]
Il arrive qu’un seul verset soit isolé par ce moyen typographique. Détaché du reste du poème, il acquiert un accent plus important (voir Paul Claudel, Cinq grandes Odes, op. cit., p. 238 et 248 ; Saint-John Perse, Éloges, op. cit., p. 26, 37 et 49). S’il est placé en fin de texte, il fonctionne comme une sorte de clausule (voir ibid., p. 25, 28, 30, 40, 45, 47, 48, 50 et 51).
-
[13]
Saint-John Perse, « Le parasol de chèvre », dans Éloges, op. cit., p. 17.
-
[14]
Saint-John Perse, « L’arc », dans ibid., p. 18.
-
[15]
Michèle Aquien, La versification appliquée aux textes, 1993, p. 35 ; Michèle Aquien et Jean-Paul Honoré, Le renouvellement des formes poétiques au XIXe siècle, 1997, p. 100.
-
[16]
Henri Meschonnic, Critique du rythme.Anthropologie historique du langage, 1982, p. 606.
-
[17]
Paul Claudel, Cinq grandes Odes, op. cit., p. 265.
-
[18]
Léopold Sédar Senghor, Chants d’ombre, op. cit., p. 40.
-
[19]
Saint-John Perse, Éloges, op. cit., p. 23 et 29.
-
[20]
Léopold Sédar Senghor, Chants d’ombre, op. cit., p. 24.
-
[21]
Paul Claudel, Cinq grandes Odes, op. cit., p. 236.
-
[22]
Ibid., p. 237.
-
[23]
Édouard Dujardin, Mallarmé par un des siens, 1936, p. 127.
-
[24]
Jean-Louis Backès, Le vers et les formes poétiques dans la poésie française, 1997, p. 138.
-
[25]
Remy de Gourmont, Esthétique de la langue française, 1899, p. 242.
-
[26]
Jean-Pierre Bobillot, « Rimbaud et le “vers libre” », 1986, p. 213.
-
[27]
Saint-John Perse, « Éloges IV », dans Éloges, op. cit., p. 36.
-
[28]
Michel Sandras, Lire le poème en prose, op. cit., p. 41 et 98 ; Monique Parent, Saint-John Perse et quelques devanciers. Études sur le poème en prose, 1960.
-
[29]
« La ponctuation expressive », revendiquée par Senghor, permet l’absence de signes de ponctuation dans certains cas (Oeuvre poétique, op. cit., p. 172 [souligné par l’auteur]).
-
[30]
Paul Claudel, Cinq grandes Odes, op. cit., p. 233.
-
[31]
Ibid., p. 251.
-
[32]
Léopold Sédar Senghor, Chants d’ombre, op. cit., p. 16.
-
[33]
Saint-John Perse, Éloges, op. cit., p. 48.
-
[34]
Paul Claudel, Cinq grandes Odes, op. cit., p. 252.
-
[35]
Léopold Sédar Senghor, Chants d’ombre, op. cit., p. 18.
-
[36]
Paul Claudel, Cinq grandes Odes, op. cit., p. 247.
-
[37]
Ibid., p. 252.
-
[38]
Mireille Sacotte, Éloges et La gloire des rois de Saint-John Perse, 1999, p. 66.
-
[39]
Saint-John Perse, Éloges, op. cit., p. 28.
-
[40]
Paul Claudel, Oeuvres en prose, op. cit., p. 3.
-
[41]
Ibid., p. 77.
-
[42]
Voir Gustave Kahn, « Préface », dans Premiers poèmes, 1897 ; Édouard Dujardin, Mallarmé par un des siens, op. cit. L’interdiction de l’enjambement a été reprise par Roubaud aussi : « Le vers libre doit toujours être une unité syntaxique fermée » (La vieillesse d’Alexandre. Essais sur quelques états récents du vers français, 1988, p. 127).
-
[43]
Paul Claudel, Oeuvres en prose, op. cit., p. 6.
-
[44]
Ces exemples sont tirés de la première version de Tête d’Or (1890). Cités par Gérard Dessons dans Introduction à l’analyse du poème, 1991, p. 24 et 112.
-
[45]
Paul Claudel, Cinq grandes Odes, op. cit., p. 247.
-
[46]
Saint-John Perse, Éloges, op. cit., p. 23.
-
[47]
Paul Claudel, Cinq grandes Odes, op. cit., p. 241.
-
[48]
Saint-John Perse, Éloges, op. cit., p. 24.
-
[49]
Paul Claudel, Cinq grandes Odes, op. cit., p. 261.
-
[50]
Saint-John Perse, Éloges, op. cit., p. 26.
-
[51]
Ibid., p. 49.
-
[52]
Léopold Sédar Senghor, Chants d’ombre, op. cit., p. 17.
-
[53]
Jan Baetens, « A. R. Ammons et la question de l’enjambement », dans Formes poétiques contemporaines, 2003, p. 309.
-
[54]
Jean-Louis Backès, Le vers et les formes poétiques, op. cit., p. 140.
-
[55]
Il est à noter que « Veillées I » (tout comme « Départ » et « Enfance III ») est considéré comme un vers libre par Bobillot. Voir Jean-Pierre Bobillot, Rimbaud. Le meurtre d’Orphée. Crise de verbe & chimie des vers ou la Commune dans le poëme, 2004, p. 157.
-
[56]
Michel Murat, L’art de Rimbaud, 2002, p. 312.
-
[57]
André Guyaux, Duplicités de Rimbaud, 1991, p. 178.
-
[58]
Michèle Aquien et Jean-Paul Honoré, Le renouvellement, op. cit., p. 98-100.
-
[59]
Gérard Dessons et Henri Meschonnic, Traité du rythme. Des vers et des proses, 1998, p. 108.
-
[60]
Jean-Louis Backès, Le vers et les formes poétiques, op. cit., p. 135.
-
[61]
Paul Claudel, Oeuvres en prose, op. cit., p. 5.
-
[62]
Michèle Aquien, La versification, 2004, p. 39.
-
[63]
Gérard Dessons, Introduction à l’analyse du poème, op. cit., p. 105-106. Souligné par l’auteur.
-
[64]
Michel Murat, L’art de Rimbaud, op. cit., p. 457.
-
[65]
Expression utilisée par Benoît de Cornulier dans Théorie du vers, 1982, p. 143.
-
[66]
Saint-John Perse, Éloges, op. cit., p. 37.
-
[67]
Id.
-
[68]
Selon Backès, la pièce entière ne contient qu’une vingtaine de vers de douze syllabes (Le vers et les formes poétiques, op. cit., p. 135-136).
-
[69]
Expression utilisée par Michel Murat dans L’art de Rimbaud, op. cit., p. 422.
-
[70]
Yvette Bozon-Scalzitti, Le verset claudélien, op. cit., p. 20. Les citations sont tirées de la deuxième ode de Claudel.
-
[71]
Paul Claudel, Cinq grandes Odes, op. cit., p. 273.
-
[72]
Ibid., p. 245.
-
[73]
La dimension du verset peut être inférieure, égale ou supérieure à celle de la phrase.
-
[74]
Gérald Antoine, Les Cinq grandes Odes de Claudel ou la poésie de la répétition, 1959, p. 51.
-
[75]
Léopold Sédar Senghor, Chants d’ombre, op. cit., p. 38.
-
[76]
Paul Claudel, Cinq grandes Odes, op. cit., p. 231.
-
[77]
Paul Claudel, Oeuvres en prose, op. cit., p. 457.
-
[78]
Léopold Sédar Senghor, Chants d’ombre, op. cit., p. 51.
-
[79]
Paul Claudel, Cinq grandes Odes, op. cit., p. 233.
-
[80]
Saint-John Perse, Éloges, op. cit., p. 24.
-
[81]
Gérald Antoine, Les Cinq grandes Odes de Claudel, op. cit.
-
[82]
Madeleine Frédéric, La répétition et ses structures dans l’oeuvre de Saint-John Perse, 1984.
-
[83]
Léopold Sédar Senghor, Chants d’ombre, op. cit., p. 51.
-
[84]
Saint-John Perse, Éloges, op. cit., p. 23 et 29.
-
[85]
Paul Claudel, Cinq grandes Odes, op. cit., p. 262.
-
[86]
Léopold Sédar Senghor, Chants d’ombre, op. cit., p. 53.
-
[87]
Paul Claudel, Cinq grandes Odes, op. cit., p. 276, et Léopold Sédar Senghor, Chants d’ombre, op. cit., p. 16.
-
[88]
Saint-John Perse, Éloges, op. cit., p. 13.
-
[89]
Paul Claudel, Cinq grandes Odes, op. cit., p. 234.
-
[90]
Ibid., p. 222-223 et 287.
-
[91]
Par exemple, Claudel, ibid., p. 239 ; Saint-John Perse, Éloges, op. cit., p. 38 ; Léopold Sédar Senghor, Chants d’ombre, op. cit., p. 49-50.
-
[92]
Saint-John Perse, Éloges, op. cit., p. 41.
-
[93]
Paul Claudel, Cinq grandes Odes, op. cit., p. 270.
-
[94]
Léopold Sédar Senghor, Dialogue sur la poésie francophone, dans Oeuvre poétique, op. cit., p. 400.
-
[95]
Saint-John Perse, Éloges, op. cit., p. 35.
Références
- Antoine, Gérald, Les Cinq grandes Odes de Claudel ou la poésie de la répétition, Paris, Lettres Modernes (Langues et styles), 1959.
- Aquien, Michèle, La versification, Paris, Presses universitaires de France (Que sais-je ?), 2004 [1990].
- — — —, La versification appliquée aux textes, Paris, Nathan (128), 1993.
- Aquien, Michèle et Jean-Paul Honoré, Le renouvellement des formes poétiques au XIXe siècle, Paris, Nathan (128), 1997.
- Backès, Jean-Louis, Le vers et les formes poétiques dans la poésie française, Paris, Hachette, 1997.
- Baetens, Jan, « A. R. Ammons et la question de l’enjambement », dans Formes poétiques contemporaines, Paris-Bruxelles, Les impressions nouvelles, 2003, p. 306-318.
- Bernard, Suzanne, Le poème en prose de Baudelaire jusqu’à nos jours, Paris, Nizet, 1994 [1959].
- Bobillot, Jean-Pierre, « Rimbaud et le “vers libre” », dans Poétique, no 66 (1986), p. 199-216.
- — — —, Rimbaud. Le meurtre d’Orphée. Crise de verbe & chimie des vers ou la Commune dans le poëme, Paris, Honoré Champion (Romantisme et modernités), 2004.
- Bozon-Scalzitti, Yvette, Le verset claudélien. Une étude du rythme (Tête d’Or), Paris, Minard (Archives des lettres modernes, no 63), 1965.
- Claudel, Paul, Cinq grandes Odes, dans Oeuvre poétique, Paris, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 1957, p. 221-292.
- — — —, Oeuvres en prose, Paris, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 1965.
- Cornulier, Benoît de, Théorie du vers, Paris, Éditions du Seuil, 1982.
- Dessons, Gérard, Introduction à l’analyse du poème, Paris, Bordas, 1991.
- Dessons, Gérard et Henri Meschonnic, Traité du rythme. Des vers et des proses, Paris, Dunot, 1998.
- Dujardin, Édouard, Mallarmé par un des siens, Paris, Albert Messein, 1936.
- Frédéric, Madeleine, La répétition et ses structures dans l’oeuvre de Saint-John Perse, Paris, Gallimard (Publications de la Fondation Saint-John Perse), 1984.
- Gourmont, Remy de, Esthétique de la langue française, Paris, Mercure de France (Les introuvables), 1899.
- Guyaux, André, Duplicités de Rimbaud, Paris-Genève, Honoré Champion-Slatkine, 1991.
- — — —, Poétique du fragment. Essai sur les « Illuminations » de Rimbaud, Neuchâtel, À la Baconnière (Langages), 1985.
- Jarrety, Michel (dir.), Dictionnaire de poésie de Baudelaire à nos jours, Paris, Presses universitaires de France, 2001.
- Kahn, Gustave, « Préface », dans Premiers poèmes, Paris, Mercure de France, 1897.
- Meschonnic, Henri, Critique du rythme.Anthropologie historique du langage, Verdier, Paris, 1982.
- Murat, Michel, L’art de Rimbaud, Paris, José Corti, 2002.
- Parent, Monique, Saint-John Perse et quelques devanciers. Études sur le poème en prose, Paris, Klincksieck, 1960.
- Roubaud, Jacques, La vieillesse d’Alexandre. Essais sur quelques états récents du vers français, Paris, Ramsay, 1988 [1978].
- Sacotte, Mireille, Éloges et La gloire des rois de Saint-John Perse, Paris, Gallimard (Foliothèque), 1999.
- Saint-John Perse, Éloges, dans Oeuvres complètes, Paris, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 1972, p. 3-52.
- Sandras, Michel, Lire le poème en prose, Paris, Dunod, 1995.
- Senghor, Léopold Sédar, Oeuvre poétique, Paris, Éditions du Seuil, 1990 [1964].
- Vade, Yves, Le poème en prose et ses territoires,Paris, Belin, 1996.