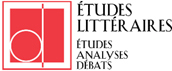Abstracts
Résumé
Comment distinguer le verset du vers libre ? Comment le distinguer de la prose ? Suspendu entre ces deux catégories qui souvent se l’annexent et en effacent le nom, le verset apparaît sur la carte moderne du vers comme une réalité intersticielle, hantée par son aspect volatile, presque impossible à isoler à l’état pur. Loin de vouloir combler ce vide d’essence, cet article voudrait interroger le sens qu’il pourrait prendre dans la modernité qui est la nôtre. Chez Jean Grosjean, notamment, c’est le verset qui sert d’icône prosodique au « dieu en perdition » : l’épuisement de la voix qu’entraîne souvent sa récitation recoupe l’ontologie d’un dieu défaillant, dont l’expiration est le principal mode d’existence. « Verset » n’est donc pas seulement le nom d’un type de vers, c’est aussi la proposition d’une forme de pensée historique dont on cherche ici à interroger la fécondité.
Abstract
What distinguishes the “verset” from free verse ? From prose ? Barely existing, located between these two categories, the “verset” has always been understood as an elusive verbal reality, almost impossible to isolate in itself. Instead of trying to fill this void by a strict definition, we would like here to question its significance. What can it reveal about modernity ? In Jean Grosjean’s work, for instance, the “verset” can be viewed as the prosodic icon of the “waning god” : exhausted by the reading of highly charged “versets”, the reader, his voice nearly gone out, is often in a condition where he can experience the very true nature of the failing god, who is, in Grosjean’s view, in a perpetual state of expiring. Thus “verset” is not only a term designating a certain type of verse. It also constitutes a possible form of historical thought, as we would like to suggest in conclusion.
Article body
Puisque pour dire le dieu qui se perd, le langage doit se perdre lui-même…
Jean Grosjean, La gloire
L’élastique sans repos
Commentant la situation prévalant en France dans la poésie au tournant du XXe siècle, Jacques Roubaud écrit dans La vieillesse d’Alexandre
qu’en empruntant une comparaison au vocabulaire historique du parlementarisme anglais, on peut dire que le vers libre occupe dans une Chambre des communes du vers le côté whig ou libéral et s’oppose, avec une violence qui masque mal une identité de vues plus profondes, à un parti adverse, le côté conservateur ou tory[1].
Prolongeons les implications de cette scène et réservons à quelques mânes élus qui y siègent le destin que pourrait leur assigner une Comedia prosodique du siècle. La dissymétrie des forces est évidente. Vaincus depuis peu par la mince avance que confère aux whigs le surnombre et la séduction d’une concomitance accrue avec leur époque, les tories de l’alexandrin leur cèdent à regret le livre de lois ancestrales, après que les anciens députés Hugo, Rimbaud et Mallarmé en aient pourtant amendé presque l’essentiel, du moins jusqu’au point limite où leur charte se serait détruite d’elle-même. De l’autre côté, impuissants à créer à partir du néant une charte nouvelle, tout aussi réticents néanmoins à avérer l’ancienne qui contredit leur raison d’état, les whigs du vers libre (surréalistes en tête) doivent adopter la logique de la dette négative et insolvable, situant au centre de leur programme l’interdiction absolue de répéter les anciennes lois, ou, pour le dire autrement, l’obligation ironique de commémorer sans cesse cette révocation.
Mais cette séparation est-elle vraiment sans dehors, comme la scénographie politique de Roubaud pourrait le laisser croire ? L’ « interrègne » du début du siècle, l’intervalle du « desserrement » où le vers français s’échappe de son moule afin d’explorer ses variantes ne compte-t-il comme député indépendant que ce notable Pierre Reverdy, dont la position de dégagement sans interdictions esquiverait les pièges jumeaux de la rechute dans l’orthodoxie et de la liberté paradoxalement contrainte[2] ? Interpréter comme Roubaud les éventuelles figures complexifiant ce parlementarisme à deux options comme des cas exceptionnels, uniques, réfractaires aux ensembles, revient à méconnaître qu’il suffirait d’un simple déplacement de catégorie pour faire apparaître à même l’archipel de la Chambre un troisième ensemble fantomatique : groupe trop inconsistant pour se laisser penser comme un parti autonome, quoique trop insistant pour qu’on passe sous silence l’effet de commune mesure qui rassemble ses noms. Car face aux métaphoriques camps de politique victorienne qui forment d’un bout à l’autre de La vieillesse d’Alexandre les deux pôles d’une dialectique et, comme tels, s’exigent l’un l’autre pour ne pas perdre leur légitimité, de considérables députés indépendants observent un silence d’abstention. Il ne serait pas difficile d’y lire une opposition à l’opposition elle-même telle que le transfert de pouvoir vient d’en fixer la figure. Saint-John Perse, sans doute le seul poète d’alors à avoir réservé au verset la dignité d’une vocation, sinon d’un sacerdoce ; Claudel, dont les Cinq grandes Odes font entendre « l’immense octave[3] » de leurs innombrables variations ; Segalen, revenu de Chine avec les « formes qui sont peu connues, variées et hautaines[4] » des Stèles : au moment décisif du suffrage rythmique, ces magistères épars du verset joignent certes parmi d’autres leur voix à celles des whigs libristes, en sorte qu’il serait tentant comme Roubaud de les confondre avec eux, et pourtant l’adhésion n’est jamais telle qu’elle ne laisse subsister un résidu tenace, presque imperceptible, et pourtant inassimilable par la nouvelle doctrine de la répudiation inachevée. À première vue, la donne terminologique moderne, telle qu’elle s’est imposée depuis que les cartes du vers ont été redistribuées autour de la triade vers fixe-vers libre-prose, semble construite de façon à ce que le léger supplément du verset ne puisse s’y inscrire : il lui est impossible de faire valoir une propriété distincte qui ne soit aussitôt annexable par la voracité presque infinie du vers libre ou de la prose[5]. Ni la longueur excessive des unités autonomes du verset, ni l’irrégularité constante de son déploiement n’arrivent à l’arracher à cette condition ancillaire de « vers libre à disposition de prose » auquel le rattache visiblement Roubaud dans son esquisse d’une typologie du vers « desserré[6] ». Et le silence analogue qu’entretiennent sur lui les théories de prosodie moderne, de Mazaleyrat dans ses Éléments de métrique française à De Cornulier dans sa Théorie du vers, montre assez bien que la persistance du terme ne saurait aller de soi, tant le vide de propriétés qu’il recouvre semble inciter à le dissoudre dans une dénomination plus vaste.
S’il est ainsi un moyen de déplacer légèrement l’optique de Roubaud et de distinguer le verset du vers libre, provoquant de la sorte une fission au sein de ce dernier concept qui semble de prime abord indivisible, c’est donc moins en raison de composantes intrinsèques à l’un et à l’autre de ces rites qu’au regard de la valeur historique dont ils sont chargés. Car « vers libre » n’est pas seulement le nom donné à un dégagement prosodique, opération aussi neutre en elle-même qu’un phénomène sans observateur. Depuis que Mallarmé a fixé les bases durables d’un scénario révolutionnaire[7], et voué les exégètes futurs à noircir de gloses les marges de Crise de vers, le terme fait aussi référence au coup de hache qui vient casser l’histoire du vers français en deux et, partant, reconfigurer celle-ci à l’aune d’une théologie du temps irréversible. De celle-ci, la commodité générale a pris valeur d’évidence et la main invisible continue de dicter nos récits, autrement dit nos conditions de réception du vers tel qu’il comparaît devant cet inéluctable partage. Ainsi, à la lumière de ce partage constamment ressuscité, tout ce qui surgit en amont du « desserrement » sera considéré avec une présomption initiale d’obsolescence, quel que soit du reste le verdict d’innocence qui pourrait être prononcé par la suite ; et tout ce qui apparaît en aval, dans le royaume des flûtistes aux rythmes inédits, jouira des bénéfices de cette téléologie progressiste, quelle que soit, là encore, la preuve irréfutable de stagnation qui pourrait être apportée contre l’oeuvre d’une liberté pétrifiée, sombrant dans sa parodie.
Exagérerait-on sa spécificité en affirmant que seul peut-être dans ce récit de guillotine, de destitution monarchique et de nouvelle mythologie « libriste », le verset échappe aux deux présomptions qui accueillent les productions des whigs et des tories, en ce que seul il semble perturber la météorologie temporelle qui donne aux discussions sur le vers leur climat de sécularisation laïque ? Là où il est capital pour la modernité du vers libre que celui-ci se pose sans précédent et soit, pour ainsi dire, consubstantiel à l’ère d’art démocratique qui le fait naître — à la « société sans stabilité, sans unité[8] » dont Mallarmé avait éprouvé le retentissement —, le verset comparaît a priori comme une forme extrêmement ancienne, dont les modèles, si divers soient-ils, ont tous en commun le privilège de surgir d’un temps d’avant l’histoire ou, à tout le moins, fantasmé comme tel par ceux qui en font leur séjour[9]. « Et cette histoire n’est pas nouvelle que le Vieux Monde essaime à tous les siècles[10] », écrit Saint-John Perse dans Exil, formulant avec netteté un type de court-circuit historique dont les odes orchestrales de Claudel ou les sobres inscriptions de Segalen sont elles aussi prodigues. Si le verset semble reconduire avec une telle vocation à l’incantation continue d’un passé impérissable, dont le présent marque moins l’usure que le continuum, la ligne de crête, l’extrême rebord d’un jaillissement, c’est peut-être qu’il est lui-même une forme sauvée des eaux. À l’expression d’un monde vieux qui ne peut pas vieillir, et dont la jubilation marque tant de fois l’approche chez Perse et Claudel, rien ne saurait mieux convenir qu’une forme ancienne qui ne peut devenir vétuste, une forme en somme dont seul l’ondoiement presque infini semble dicter le destin.
À cet égard, et malgré qu’il n’y ait là qu’une analogie structurale, il se pourrait que le recours au verset corresponde à la seconde voie de l’hérésie mystique telle qu’analysée par Gershom Scholem dans ses études sur la Kabbale juive. S’il est une première expérience de révélation dont la pure extériorité suscite le désir de fonder une autre orthodoxie, en butte avec celles qui sont déjà constituées, il en est aussi une seconde qui ouvre la voie d’une dérive indéfinie hors des dogmes, dont la vérité tient tout entière dans ce voeu d’éviter toute forme de retombée prescriptive. En raison même de leur acharnement à honorer la mort de l’alexandrin et à imposer à tout vers futur le devoir de fêter éternellement cette ligne de fracture, les hérésiarques négatifs — assermentés en tant que légataires testamentaires par le vieux moule — que furent les « libristes » appartiennent à la première catégorie. À l’inverse, les « versetistes » sont des hérétiques absolus — au sens propre d’absolutum : « déliés » — dont l’instrument interrompt ce mouvement de re-condensation avant qu’il n’ait pu s’accomplir : il n’y a pas de cristallisation orthodoxe du verset, parce que cette forme ne porte pas en elle la dette de l’ancien pendule à exorciser, parce qu’elle n’est pas, autrement dit, l’ombre négative de l’alexandrin, mais un dehors que n’annexe aucune des deux options antagonistes qui sont entrées en conflit lors de la crise de vers.
On peut à la rigueur imaginer une rencontre de l’alexandrin à l’état pur, réduit au degré zéro, à cet état nul d’un scintillement harmonique dont toutes les autres incarnations seraient des variations[11]. Inversement, troublé à son principe, inséparable du mouvement qui le déporte hors de lui-même, le verset ressemble à un élastique qui ne pourrait jamais cesser de se distendre ; une forme instable dont il est impossible, même par la mise en commun de ses diverses apparitions, de donner un exemple qui réussisse à apaiser l’inquiétude persistante de se savoir ici confronté à une forme sans exemplarité — élastique sans repos, contingence sans archétype, existence sans essence, errance sans patrie. Telle serait l’hypothèse d’une loi : le « verset » n’est pas une forme dont les possibles demeurent captifs d’un centre, mais le nom donné à une dérive continue de singularités, que ne retient aucune force de gravité « exemplaire » et qui engendrent donc les unes les autres leurs légers décalages. Ainsi de la « longue période latine » retrouvée dans une variation « vraiment française » par les grandes odes claudéliennes, dont Jean Grosjean marque dans une importante préface le caractère « perpétuellement imprévisible » :
Et chaque verset a son autonomie complète, insolite ; aucune ressemblance entre eux […]. C’est peu dire qu’ils ne riment pas, ils ont chacun leur vie propre, unique, incomparable, absolue. […] Il faudrait une définition pour chacun. Chaque ode est gouvernée par la même rigueur sans règles[12].
« Plus le dieu s’exténue et mieux l’âme le respire[13] »
Tel qu’il apparaît dans l’exposition de cette « rigueur sans règles », soit un type de vers dont la définition est d’être sans définition (« Il faudrait une définition pour chacun »), le verset semble obéir ici à une loi de dissension perpétuelle, comme s’il lui fallait, pour se prémunir du péril de la stase ou de la congestion métrique, circuler dans un rythme fluide où il ne lui est possible de revenir à soi que sous forme nouvelle. Or, ces phrases sur la « vie propre, unique, incomparable » du verset ondoyant, délié, « perpétuellement imprévisible », les lecteurs de Grosjean en auront perçu la familiarité : ce sont les mêmes qui lui servent à cerner l’approche du dieu en perdition dont les pages méditatives de La gloire (1969) ont fixé l’image — ou plutôt, la non-image d’une notion a priori déphasée, en partance, interdisant toute forme de mise au point clinique par l’esprit. Modulé d’un bout à l’autre de ce court traité de théologie intuitive où de denses spéculations alternent avec des versets poétiques, le dieu furtif de Grosjean exècre l’immobilité. Au point que, dès que la conceptualisation de son mouvement semble un peu trop le fixer, Grosjean le laisse s’échapper à intervalles réguliers vers les versets où il retourne s’ensauvager dans son ignorance de soi, interpeller le Fils, verbaliser sa souffrance, bref, se vocaliser au lieu de devenir l’objet d’une logique étrangère à son échappée. Lui qui « ne peut rester semblable à soi qu’en apparence », qui « ne cesse de se délivrer de soi autant et plus que toute vie intense[14] », qui est en somme, « dès le principe, privé de soi-même et sans substance[15] », il surgit donc sous le signe de l’expiration : « Sa nature est de s’exiler de soi pour aller expirer dans son expression[16]. »
Et tel, on ne déshonorera pas son inhérente complexité en affirmant qu’il est un dieu défaillant. Non par suite d’une infaillibilité perdue jadis, en amont du temps — Grosjean n’a rien d’un gnostique — mais, inversement, parce qu’on ne saurait concevoir pour le dieu d’autre existence que l’éternité d’une défaillance qui n’arrive jamais à s’accomplir[17]. « Défaillir » ne signifie pas seulement « s’affaiblir » ou, plus radicalement, « s’évanouir ». Jusqu’au XVIIe siècle, le vocable pouvait avoir le sens de « faire défaut », un spectre étymologique qui hante encore le dieu exténué — plus exactement : le dieu s’exténuant — dont l’ombre accompagne l’oeuvre de Grosjean. Sous cet angle, la défaillance est tout autant une origine qu’une finalité : le dieu, qui éprouve son défaut et ne peut dès lors se recueillir dans le vide dont il est fait, s’expulse hors de celui-ci pour exister jusqu’à la défaillance et se vérifier par la défaillance. La « gloire » n’est rien d’autre que le sillage laissé par cette propulsion du dieu « qui sait que vivre est être mourant, pas mort mais mourant[18] » ; et ce sillage, lui, n’a pas d’autre lieu que le langage, car « dieu ne s’aperçoit de soi qu’en s’entendant parler » :
Or si tout le dieu se perd en langage et si le langage ne ment pas, le langage ne dit qu’un dieu qui se perd. Puisqu’il y a de la perdition en Dieu, le langage s’en souvient et revit cette perdition qui est le principe de Dieu, car le langage est mémoire du dieu. Le langage qui reçoit tout le dieu, le change en une sorte de temps pour rapporter vers sa source exsangue un dieu devenu manifestement friable[19].
Or, comment écrire de façon à « revivre cette perdition » du dieu friable ? Sinon en élaborant des partitions où la voix semble vouée à refaire à chaque fois l’expérience de son épuisement, comme s’il lui fallait se rendre jusqu’au point où elle risque elle-même de défaillir pour que l’épiphanie lui soit rendue d’un dieu s’affaiblissant, s’évanouissant, qui ne semble jamais plus pur qu’au moment de s’éteindre ? Qu’on considère le poème suivant tiré du recueil Nathanaël, avec ses versets typiques de la manière propre à Grosjean. Qu’on l’approche surtout en s’assurant que la parole écrite « retourne à l’oral […] recto tono et uniformément lente », comme l’écrivain y insiste en évoquant la juste tonalité d’une récitation qui serait « très détérioriée par la déclamation[20] » :
Entre les branches à demi dépouillées déjà de leurs feuilles par les souffles frais de l’automne, regarde, malgré ta douleur, moins flâner à travers les prés la rivière que rôder au ras de l’horizon dans le ciel tendre l’allégresse du dernier petit nuage blanc de l’année.
À l’approche du soir ton visage s’éclaire comme, à la fin des jours terrestres, ce soleil horizontal du grand âge plus près de nous au moment de disparaître pour ne plus laisser place qu’à l’âme qui entend déjà le vent murmurer son nom comme un sanglot de l’onde sous l’aune.
Les balayures de braise sur les plages en fusion encombrent l’ouest du ciel au-dessus des cimes noires d’une forêt pareille à celle dont nous revînmes pour nous asseoir dans une réverbération de crépuscule qui sanctifiait si bien les meubles de la chambre qu’aucune lampe n’en aurait profané les ombres avant que tout ne soit plus que ténèbres[21].
La profération de ce dernier verset océanique nous mène à l’extrême du souffle. Une proposition, une relative, une articulation syntaxique de plus et la voix risquerait de s’étrangler, déjà menée dans l’état actuel au seuil du râle vers la finale féminine de « ténèbres ». À l’inverse, Grosjean eût-il disposé pour la respiration des aires de repos, distribuant les virgules afin de réguler le flux, ou eût-il abrégé la durée du verset terminal, la voix n’y aurait pas connu une telle mise à l’épreuve, elle eut été soustraite à l’aventure d’exténuation qui lui est ici assignée afin qu’elle puisse « vivre sa perdition ». La production de la défaillance, ou à tout le moins la prémonition physique de sa possibilité, est ainsi soumise à cette technique d’exigence et d’ajournement de la voix — une science dont les versets exemplaires réunis ci-dessus incarnent une variante particulière, mais dont les recueils Apocalypses (1962), Élégies (1967) et Nathanaël (1996) fournissent chez Grosjean suffisamment de constantes pour que l’on y puisse déceler la loi secrète de son verset, la variante unique par laquelle celui-ci gère le souffle de son récitant. Là où Claudel et Perse jouent souvent de durées inégales, contractant un verset en deux ou trois mots pour laisser le suivant s’éployer brusquement comme un parapluie, le verset coagulé ou agglutiné de Grosjean est uniformément dépliable en propositions : il exige à chaque fois une profonde inspiration avant de s’étendre dans la voix. Quelque différent qu’il puisse être de celui qui le précède ou le suit, chacun de ses avatars réserve à qui le scande une expérience d’expiration où le souffle est périodiquement en mesure d’éprouver sa précarité, autrement dit le risque de défaillance qui lui est intégral. De la voix, on peut donc dire qu’il faut ébranler sa force pour se souvenir qu’on peut la perdre ; et du verset, qu’il est précisément ici le catalyseur chimique de cette réminiscence. Icône prosodique de l’extinction, semblable à l’âme qui « chemine par une seule vie vers une seule mort », il « consume le plus lentement possible le vacillement dont l’embrasa le dieu[22] ».
Le tertium quid divin du verset
De quelque côté qu’on cherche à le reverser, il semble que le verset ne puisse que demeurer le signe d’un excès silencieux sur les catégories qui lui sont mitoyennes, si volatil par ailleurs dans sa définition qu’on pourrait le tenir à bon droit pour inexistant, ou à tout le moins négligeable — une conclusion à laquelle parviennent d’évidence plusieurs théoriciens actuels du vers, qui en oublient jusqu’à la nécessité du nom et ne ressentent pas le besoin de creuser sa distinction. Sans doute le verset est-il presque de la prose et comme tel risque-t-il toujours d’y être intégré ; presque du vers libre et ainsi à peine au-delà d’une autre forme d’absorption terminologique. Mais il importe peut-être moins de chercher à réduire cette ontologie flottante de la notion ou d’ignorer sa défaillance que de s’accorder avec elle. Si le verset nous concerne dans sa logique de dérive infinie, voire fantomatique, c’est précisément en raison de sa promiscuité avec un néant d’essence, parce qu’il est une forme subtile au sens ancien de subtilis : « qui passe entre les mailles du filet », dont celui que tendent nos classifications actuelles. De même que le dieu subtil qui nous hante depuis l’effondrement des orthodoxies a pris la forme d’un presque indéfinissable surcroît sur l’horizontalité de l’« universel reportage » — un silence reluisant par intermittence sur les signes, qu’aucun d’entre eux n’arrive à traduire mais aucun non plus à oublier —, de même le verset est-il, lui aussi, un supplément sans consistance, le nom d’un déplacement dont les traces renvoient à des actes qui ne renvoient peut-être, ceux-ci, à aucun corps — de doctrine.
Mais il faut ajouter que cette inconsistance se renverse aisément en une consistance plus résistante, quoique plus secrète, que celle dont peut s’autoriser tout ce qui porte en soi la possibilité de fonder un dogme.
C’est parce que notre civilisation n’a pas voulu admettre ce qu’il y a de vulnérable dans le Dieu vivant, écrit significativement Grosjean dans Araméennes, qu’elle a fini par dire qu’il était mort[23].
Un dieu parfait ne pouvait connaître qu’une mort parfaite. Un dieu défaillant, blessé, souffrant, agonique, peut à l’inverse circuler durablement dans l’histoire, pourvu de la force insoupçonnée que confère la faiblesse, de l’invulnérabilité que procure la vulnérabilité, ou, si l’on veut, de la persistance diffuse, expirée, auxquelles ont droit les entités semi-existantes, dont la disparition est depuis toujours imminente et qui sont ainsi vouées à vivre dans l’ombre de cette annonce. Depuis que ce dieu faible a trouvé refuge dans les interstices qui séparent et relient nos catégories, depuis en somme qu’il s’est trouvé durablement lié aux rhétoriques de l’intervalle qui régissent maintenant nos grammaires d’intelligibilité[24], c’est peut-être la forme la plus intercalaire qui soit, à peine perceptible et identifiable entre le vers libre et la prose, qui est en mesure de lui servir de forme dans la pensée. Si le verset est de la prose où s’éprouve le souffle, s’il ne peut répudier, au contraire de la phrase, le souvenir d’une récitation avec laquelle il fut marié, il pourrait devenir le signe de la prose qui ne s’est pas encore parachevée : de la prose, somme toute, où s’attarde la mémoire d’un autre règne qui lui refuse son autarcie, cet autre ordre dût-il être aussi propre à refuser les noms qu’on lui donne que la prose l’est à déclarer les siens interchangeables, en transit, mortels, relatifs, historiques.
N’y aurait-il pas là de quoi déjouer, à tout le moins, les récits de fossoyeurs qui irriguent tant de versions de la modernité ? En raison de la séduction qu’ils exercent sur l’esprit, et donc de leur propension à convaincre par eux-mêmes plutôt que par les phénomènes dont ils sont supposés rendre compte, les scénarios de renversement brutal, de sécularisation accélérée, de vaste traduction profane de nos obsessions ont toujours paru à Grosjean les indices d’une « fausse mort ». « Ce sera bientôt jadis mais je ne mourrai pas. Le faux dieu mourra, je le crains, et le faux néant, ce sera terrible, mais nous ne mourrons pas[25]. » L’apocalypse, qui donne son nom au recueil dont est tiré ce dernier verset, doit donc être entendue au sens strict : une « révélation » par la catastrophe du dieu tel qu’il surgit lorsque s’écaille le Dieu orthodoxe de la « fausse mort », soit une forme de déhiscence à l’oeuvre, si l’on se souvient que ce terme de botanique réfère aux organes clos (anthères, fruits) qui s’ouvrent d’eux-mêmes pour livrer passage à leur contenu. D’où cette ultime adresse : « Ton regard las s’est retourné sans adieux qu’ambigus[26]. » Les adieux ambigus sont ceux dont ni l’orthodoxie ni sa négation symétrique n’arrivent à rendre compte. Sans doute pour les entendre faut-il opérer une gigantesque metanoia de l’esprit où l’histoire devient un dédale de rythmes implicites ; et notre temps, lui, celui d’un long verset où la voix la plus ancienne s’attarde, presque évanouie, presque impuissante à poursuivre, presque fléchie par une fatigue mortelle, au seuil de sa perte qu’elle n’arrive pas à consommer. Le ferait-elle que le verset comme proposition de forme et surtout de pensée retournerait sans doute à l’oubli. Tout s’achèverait en prose, royaume de l’horizontalité. Et la prose, elle — réservons à notre situation la courtoisie d’un conditionnel —, indifférente à son triomphe, éliminerait peut-être jusqu’au souvenir qu’elle ait pu réverbérer par moments une autre diction que la sienne.
Appendices
Note biographique
Jean-François Bourgeault
Jean-François Bourgeault prépare à l’Université McGill une thèse de doctorat sur la comparution de la poésie moderne devant le thème de la Fin de l’Histoire. Cofondateur et secrétaire de rédaction des cahiers littéraires Contre-Jour, il a publié ici et là quelques articles et, en collaboration, La littérature en puissance. Autour de Giorgio Agamben (Trois-Pistoles, VLB éditeur, 2006).
Notes
-
[1]
Jacques Roubaud, La vieillesse d’Alexandre. Essai sur quelques états récents du vers français, 1978, p. 15.
-
[2]
Notable est cette posture en raison même de son curieux isolement dans l’esquisse de taxinomie élaborée par Roubaud, qui réserve à Reverdy seul le privilège de ce déplacement hors du damier des interdictions anti-alexandrines gravitant autour du vers libre « standard » : « Le vers libre de Reverdy partage avec le vers libre standard la plupart de ses caractéristiques. Mais il en diffère en cela qu’il n’est pas exclusivement un anti-alexandrin. Je dirai qu’il est non pas non compté, non rimé et non césuré, mais — ce qui est très différent — pas compté, pas rimé, pas césuré. Autrement dit, compter, rimer, césurer n’est pas sa règle, mais il se peut qu’il s’y trouve, parmi d’autres, des vers traditionnels, des vers rimés et des vers segmentés » (ibid., p. 133).
-
[3]
Paul Claudel, Cinq grandes Odes, 1957, p. 42.
-
[4]
Segalen cité par Pierre-Jean Rémy (« Préface » aux Stèles de Victor Segalen, dans Victor Segalen, Stèles, 1973, p. 11).
-
[5]
D’autant que le terme, dans ses transmigrations philologiques, ne semble s’être « imposé » dans un sens profane qu’au sein de la tradition française. Que l’anglais, notamment, ne fasse aucune distinction formelle entre le verset et le vers, les amalgamant tous deux au sein d’un même terme — verse —, montre à cet égard à quel point la catégorie ne saurait être interrogée ailleurs que dans le système où l’imprimeur Robert Estienne en a breveté l’emploi. Là où l’anglais sépare en vue d’attributions différentes le versicle du verse, réservant le premier à l’oraison prononcée par le prêtre sur la chaire (ou dans le cas du memorial verse, à la mémorisation intime de fragments bibliques), et le second au livre de poèmes, le français ignore souvent ce partage entre situations sacrées et profanes. Verset oscille au gré des locuteurs de la forme vide — de la proposition rythmique — au fragment religieux qui introduit ou suit un psaume, une ambiguïté constitutive dont le mot ne s’est jamais départi depuis qu’il a commencé à errer hors de la Bible pour laquelle il avait été créé.
-
[6]
Concevant de toute évidence le verset comme une enclave au sein du vers libre, et une enclave que rien dans le strict champ des propriétés formelles n’impose de prendre à part, à aucun moment Roubaud ne le nomme dans son récit, en dépit d’une indication par juxtaposition de noms propres qui ne laisse aucun doute sur le passager secret visé à travers « le vers à disposition de prose (disposition dans la page, mise en page, typographie) de Claudel ou du premier Sain-John Perse, encore Léger » (La vieillesse d’Alexandre, op. cit., p. 115).
-
[7]
Scénario dont la valeur patrimoniale est telle qu’on rappellera seulement ici la pseudomorphose subtile qu’il opère entre le culte et le social. À nouvelle société, nouveaux cultes : l’histoire du vers troublé devient dès lors celle d’une résonance tardive du social dans le littéraire, phénomène d’écho classique dans la prémonition duquel Mallarmé ouvre notamment la conférence de La Musique et les Lettres : « Les gouvernements changent ; toujours la prosodie reste intacte : soit que, dans les révolutions, elle passe inaperçue ou que l’attentat ne s’impose pas avec l’opinion que ce dogme dernier puisse varier » (Igitur. Divagations. Un coup de dés, 1976, p. 351).
-
[8]
Ibid., p. 388.
-
[9]
L’antécédence chronologique de l’alexandrin sur le verset, en France, joue ici un rôle négligeable. Si ce qui allait devenir plus tard la « cadence nationale » apparaît vers 1170 par l’intermédiaire d’un surplus sur le décasyllabe en vigueur (ajouté par Lambert le Tort de Chateaudun dans son appropriation du roman alexandrin), le verset, qui apparaît comme dispositif typographique près de quatre siècles plus tard, est compromis dès sa naissance avec le règne des purs commencements : il organise la Bible. Cette scène primitive semble l’avoir lié avec une solennité indémaillable, redevable sans doute à ce que le verset était justement à l’origine un dispositif de lecture, et, comme tel, voué à vivre dans l’expectative d’une voix qui le décline. Dette vocale du vers qu’honoreront tous ses héritiers modernes, à un degré ou un autre, et qui n’a pas joué pour peu, sans doute, dans les réputations outrancièrement déclamatoires qui ont écrasé — et continuent parfois à le faire — certaines oeuvres de Claudel et Saint-John Perse.
-
[10]
Saint-John Perse, Éloges suivi de La gloire des rois, Anabase, Exil, 1960, p. 215.
-
[11]
Libre à chacun de fixer dans sa mémoire le seuil de cet état de perfection vibratoire. « J’aime le son du cor le soir au fond des bois » : les voyelles ouvertes qui enchâssent cet alexandrin de Vigny (aime-bois), les sourdes nasales qui se font écho (son-fond), jusqu’aux sonorités rudes qui rebondissent de part et d’autre de l’hémistiche (cor-soir), ces éléments d’une réciprocité introublée, s’ils ne se confondent pas avec le vide du pur alexandrin, en ont toujours incarné à mes yeux la meilleure convoitise.
-
[12]
Jean Grosjean, « Préface », dans Paul Claudel, Cinq grandes Odes, 1966, p. 8-10.
-
[13]
Jean Grosjean, La gloire, 1969, p. 202.
-
[14]
Ibid., p. 179.
-
[15]
Ibid., p. 203.
-
[16]
Ibid., p. 181.
-
[17]
Renversant la collusion entre théologie chrétienne et métaphysique aristotélicienne où Dieu était parfait parce qu’infaillible, au-delà même de ses réfutations logiques, Grosjean évoque dans des entretiens intitulés Araméennes un dieu qui fait gloire de sa chute : « Il nous est révélé un Dieu inimaginable dont la perfection consiste en une espèce de défaillance, comme si Dieu ne pouvait supporter d’être Dieu que dans un autre » (Araméennes, 1988, p. 12).
-
[18]
Jean Grosjean, La gloire, op. cit., p. 181.
-
[19]
Id.
-
[20]
« Cette profonde efficacité de la parole écrite est tout à fait ignorée par une lecture visuelle et très détériorée par la déclamation. Elle ne peut guère retourner à l’oral que recto tono et uniformément lente » (Jean Grosjean, Araméennes, op. cit., p. 65).
-
[21]
Jean Grosjean, Nathanaël, 1996, p. 130.
-
[22]
Jean Grosjean, La gloire, op. cit., p. 204.
-
[23]
Jean Grosjean, Araméennes, op. cit., p. 157.
-
[24]
Dans son ethos grammatical, une époque se caractérise peut-être moins par le culte qu’elle voue aux substantifs que par la faveur inconsciente qu’elle réserve aux conjonctions qui les unissent — ou les désunissent. La nôtre entretient une dévotion pour la lévitation de l’ « entre », ou le mouvement pour lui-même, dont le règne est si flagrant qu’il a déjà pris valeur d’évidence, voire de consensus, témoin cette réjouissante épochè de Pierre Nepveu dans Lectures des lieux : « Transferts, transports, déplacements, croisements, mélanges, échanges, interactions, correspondances, traversées, intertextes, transculture, altérité : la liste de ces équivalences, leur abondance même illustrent probablement plus que tout la facilité que nous avons à faire surgir dans notre pensée des concepts qui concernent les passages, les entre-deux (ou les entre-plusieurs), qui disent l’espèce d’affection intellectuelle que nous avons pour ce qui bouge, pour tout ce qui ne trouve pas son assise en soi-même et n’a pas de lieu propre. Barthes et surtout Derrida ont laissé leur marque : le sens lui-même serait un incessant transfert, un infini déplacement, toujours ailleurs, toujours remis à plus tard » (Lectures des lieux, 2004, p. 209).
-
[25]
Jean Grosjean, Apocalypse, dans La gloire, op. cit., p. 32.
-
[26]
Ibid., p. 193.
Références
- Claudel, Paul, Cinq grandes Odes, Paris, Gallimard (Poésie), 1957.
- Grosjean, Jean, Araméennes, Paris, Éditions du Cerf, 1988.
- — — —, La gloire, Paris, Gallimard (Poésie), 1969.
- — — —, Nathanaël, Paris, Gallimard, 1996.
- — — —, « Préface », dans Paul Claudel, Cinq grandes Odes, Paris, Gallimard, 1966 [1957], p. 5-13.
- Mallarmé, Stéphane, Igitur. Divagations. Un coup de dés, Paris, Gallimard (Poésie), 1976.
- Nepveu, Pierre, Lectures des lieux, Montréal, Boréal (Papiers collés), 2004.
- Rémy, Pierre-Jean, « L’exil le plus absolu… », dans Victor Segalen, Stèles, Paris, Gallimard (Poésie), 1973, p. 5-15.
- Roubaud, Jacques, La vieillesse d’Alexandre. Essai sur quelques états récents du vers français, Paris, Maspéro, 1978.
- Saint-John Perse, Éloges suivi de La gloire des rois, Anabase, Exil, Paris, Gallimard, 1960.