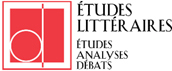Article body
Les remarques formulées par François-Emmanuël Boucher soulèvent l’une des difficultés majeures éprouvées lors de l’élaboration de mon travail : la délimitation du corpus. Ce livre, reposant sur les principes de la confrontation et de la synthèse, ne pouvait en effet être significatif que s’il s’appuyait sur un volume important, mais aussi homogène et bien défini, de textes. Mon parti a donc été de m’appuyer sur des documents produits par des auteurs qui sont aussi des créateurs de fiction. Sans dénier tout l’intérêt que présenterait une étude à caractère plus historique, je peux affirmer que le choix de documents à visée essentiellement esthétique m’a permis d’analyser un mythe littéraire d’autant plus riche qu’il prend sa source et se déploie en grande partie dans des oeuvres fictives, et laisse donc la part belle à l’interprétation et à la création. Cet aspect esthétique et littéraire des discours analysés permet ainsi de découvrir un XVIIIe siècle au moins autant imaginé et rêvé que dépeint et représenté, et dont l’authenticité importe moins, finalement, que la valeur poétique et compensatoire.
Je n’ai donc pas prétendu analyser l’ensemble des imaginaires que l’époque déploie autour du passé, mais j’ai voulu saisir l’élaboration d’un mythe qui s’appuie sur des réminiscences romanesques et picturales, mêlées de ressentiments idéologiques, pour générer des images parfois contradictoires. Pour n’être pas représentatif de la totalité des écrits du deuxième tiers du XIXe siècle — le projet eût été bien ambitieux —, ce mythe dépasse peut-être bien les limites dans lesquelles François-Emmanuël Boucher semble vouloir le restreindre à la fin de son compte rendu ; le corpus choisi me paraît en effet d’autant plus significatif que, loin de ne représenter qu’une trentaine d’artistes, il est le reflet de tout un discours et de tout un climat qui imprègne non seulement le monde des artistes mais aussi la société dans les années 1830-1860. Même s’il est exact qu’une trentaine d’écrivains surtout se dégagent de cette étude, l’importance de leurs noms peut suffire à montrer que ce phénomène touche une grande partie du paysage littéraire français durant ces trente années. L’ampleur du corpus montre d’autre part que l’imaginaire véhiculé par ces grands noms de la littérature est relayé par de multiples auteurs moins connus qui contribuent à l’imprégnation de ce discours dans la société du temps.
Je partage cependant entièrement le point de vue de François-Emmanuël Boucher lorsqu’il précise qu’« entre 1830 et 1860, lorsqu’il est question du XVIIIe siècle, on ne traite pas seulement d’esthétique rococo ». Même si l’on s’en tient aux auteurs de fiction, force est de remarquer que la Révolution et les philosophes des Lumières occupaient alors bien des esprits, et le mythe du passé se présente comme une superposition d’images, parfois fort éloignées les unes des autres, permettant de rendre au XVIIIe siècle toute sa complexité. Or la première image que les écrivains se font du passé est tout imprégnée de considérations politiques. Loin de ne percevoir le XVIIIe siècle que par son esthétique ou ses manières de vivre, les écrivains l’ont d’abord vu comme le siècle des Lumières et, par là, comme un siècle lourd d’enjeux idéologiques, dangereux, redoutable, voire terrifiant. Ainsi, la partie de mon livre portant sur la peur, voire la haine, que suscite la Révolution chez un bon nombre d’écrivains, s’appuie sur les traces qu’ont laissées les discours de Joseph de Maistre ou de Bonald dans les récits romantiques évoquant le passé proche. Si l’oeuvre des célèbres idéologues n’apparaît, dans les textes analysés, qu’à l’état de traces, ce n’est certes pas que leurs thèses auraient disparu des écrits du XIXe siècle ; là encore, il ne s’agissait pas d’étudier l’influence idéologique du siècle des Lumières sur le siècle qui le suivit — travail considérable et, je n’en doute pas, fort instructif —, mais de s’en tenir à une représentation littéraire et esthétique, suffisamment riche, me semble-t-il, dans ses significations et ses enjeux. Le fait que l’on puisse aussi nettement reconnaître l’influence des discours contre-révolutionnaires sur les romans de Barbey d’Aurevilly, de Pétrus Borel, de Jules Janin ou encore de Balzac, montre cependant bien la force de leur effet dans l’ensemble du XIXe siècle. Le commentaire de François-Emmanuël Boucher me permet alors de préciser, ce qui n’apparaît peut-être pas suffisamment dans mon livre, que cette première image dominante à l’aube du XIXe siècle, tout imprégnée des thèses contre-révolutionnaires, est encore largement présente au cours des années 1830-1860. Si j’ai consacré les deux tiers de mon travail à une représentation plus apaisée, et plus ludique, du passé, c’est que celle-ci me semble moins connue de la critique et permet en particulier de souligner l’émergence, à cette époque, de l’esthétique de la fantaisie dans la littérature française, courant littéraire encore peu ou mal connu aujourd’hui.
Mon propos était ainsi de reconnaître l’existence d’un mythe littéraire qui bénéficie de l’allègement permis par l’éloignement du temps et la fantaisie de la fiction ; une confrontation avec l’image dessinée par les idéologues et les historiens, dont les préoccupations n’étaient par essence pas les mêmes que celles des créateurs de fiction, serait cependant enrichissante et permettrait, ainsi que le souligne François-Emmanuël Boucher, d’étendre la connaissance du discours du XIXe siècle sur le siècle qui le précède. Sans doute trouverions-nous des ressemblances qui dépassent les simples affinités politiques. En s’opposant aux valeurs de la bourgeoisie, les créateurs de fiction veulent surtout affirmer leur essence fondamentalement artistique. Économie, labeur, prudence et pondération ne font pas bon ménage avec les élans de fantaisie et de liberté qui portent la bohème littéraire ; le XVIIIe siècle permet alors l’évasion vers une société de la prodigalité et de la grandeur, festive et élégante, haute en couleur, d’autant plus désirable que certains personnages ou certains objets rappellent encore sa proximité dans le temps. Les affinités ostensiblement affirmées avec le passé traduisent également un rêve aristocratique évident : se réclamer de l’Ancien Régime, c’est prendre ses distances avec une classe dont la préséance n’a pu s’affirmer qu’une fois cette société détruite. Mais au-delà de ces prétentions artistiques, qui relèvent d’une certaine façon du snobisme, le regret du XVIIIe siècle et le dégoût de la bourgeoisie traduisent aussi un rejet de l’utilitarisme et une nostalgie du sacré qui nous renvoient, ici encore, à un penseur comme Joseph de Maistre. Ce dernier a ainsi relevé, comme nos écrivains, et avant eux, le rôle symbolique de l’habit noir dans l’expression à la fois de l’entrée dans la démocratie et de la fin d’une société d’apparat[1]. Bourgeoisie et démocratie, à cette époque, sont fortement liées dans les esprits. L’uniformisation, apportée par le sentiment égalitaire, en bannissant de la société les signes distinctifs des castes et des rangs, a provoqué la disparition de l’exubérance des vêtements et de la symbolique des gestes ; l’utilitaire prend alors le pas sur la représentation solennelle. Ainsi la haine du bourgeois et le constat d’une époque mesquine et dénuée d’idéalisme comportent-ils bien des significations que la confrontation avec d’autres discours nous permettrait certainement de préciser.
Elle nous mènerait à comprendre comment une période s’est construite, peut-être pas précisément sur la haine d’une autre, mais sur un mélange d’acceptation et de rejet de la génération qui l’a précédée. Au déni vital du passé se mêle une forte fascination. Ainsi, le passage du XVIIIe siècle au romantisme, loin de se réduire à une opposition manichéenne parfois pourtant ostensiblement affirmée par des écrivains qui aimeraient ainsi mieux affirmer leur originalité, s’est surtout fait sur le mode d’une intégration sans cesse renouvelée, dans un dialogue mouvementé et fécond que les auteurs ont entretenu avec le passé mais, aussi, avec leur propre époque. Ce qui nous conduit vers un autre paradoxe : alors que le romantisme est d’abord conçu comme synonyme de modernité, le goût des écrivains pour tout ce qui s’éloigne de la bourgeoisie les incite à se tourner vers un passé révolu, à se projeter hors de la vie moderne.
Appendices
Note biographique
Catherine Thomas
Catherine Thomas, agrégée de Lettres modernes et docteur ès Lettres, enseigne à l’université de Bretagne Occidentale (Brest). Le mythe du XVIIIe siècle au XIXe siècle (Paris, Librairie Honoré Champion, 2003) est la publication de sa thèse de doctorat, soutenue en septembre 2001.
Note
-
[1]
« Pour celui qui examine tout, il peut être intéressant d’observer que, de toutes les parures révolutionnaires, les seules qui aient une certaine consistance sont l’écharpe et le panache qui appartiennent à la chevalerie. Elles subsistent, quoique flétries, comme ces arbres de qui la sève nourricière s’est retirée et qui n’ont encore perdu que leur beauté. Le fonctionnaire public, chargé de ces signes déshonorés, ne ressemble pas mal au voleur qui brille sous les habits de l’homme qu’il vient de dépouiller » (Joseph Marie de Maistre, Considérations sur la France, 1980, p. 132).
Référence
- Maistre, Joseph Marie de, Considérations sur la France, Genève, Slatkine, 1980 (éd. de J.-L. Darcel).