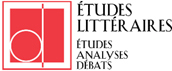Article body
Espace et rhétorique ? Aussitôt, je le concède, une image saugrenue m’est venue à l’esprit, comme un « hiéroglyphe » de la Renaisance ou un emblème à la façon du Père Menestrier. Le corps en serait « Un chameau dans un désert brûlant » et l’âme « Oultre l’autre ». J’imagine la rhétorique comme le cavalier sur son chameau qui, sans l’outre du ventre, n’ira pas outre dans l’espace de tous les espaces. La parole persuasive ne trouve pas en soi son outrepassement, mais dans un « autre » intérieur grâce auquel il peut aller outre à l’extérieur. Une parole sans l’outre vive est condamnée à périr dans le désert brûlant. D’où je parle, c’est de cette outre et du haut de ma chamelle, comme Laurence d’Arabie sur sa belle Wodeiha vers les hauteurs d’Edom et l’escarpement de Petra. La parole consciemment persuasive, qui est l’objet de la rhétorique, ne peut se déployer et marquer son territoire — persuader, s’entendre, se montrer, et faire agir les auditeurs —, que par un déficit secret, l’outre du ventre, la ressource vive de la marche du chameau, vraie monture de la persuasion.
Cette parabole illustre un problème fondamental de la rhétorique, mais qui se trouve comme obscurci par d’autres problèmes, qui paraissent plus glorieux, de l’art rhétorique et de la délibération dans la sphère publique. Ce problème, quel est-il ? Celui du rapport entre la parole, rhétorique, persuasive, publique, la parole que l’on dit si bien « délibérée », comme on parle de geste délibéré, et le lieu où et d’où l’on fait marcher cette parole. Espace et rhétorique ont immédiatement partie liée. La persuasion ne peut se déployer que dans un espace, un espace vif et réel et, par médiation, dans des sites subsidiaires qui mettent en scène ce rapport ou transportent les sujets de la persuasion, vous et moi, loin de leur site naturel, la sphère publique, vers des sites imaginaires – tout cela se nomme fiction évidemment, une fiction qui est littéraire si l’on veut, politique si l’on préfère. La littérature est à mon sens efficace dans cette médiation, sinon elle ne serait pas un objet politique, et même un objet du tout.
Pour une entame, commençons par ce qui est le plus évident. Le rapport de mots avant qu’on puisse le dire comme une relation d’objets entre / espace / et « rhétorique » est perceptible dans la tradition rhétorique. L’/ espace / possède une place dans la parole persuasive. Il occupe simplement un livre presque entier, le second, de la Rhétorique d’Aristote ; son titre de gloire s’appelle la Topique, l’analyse des lieux du raisonnement rhétorique elle-même repiquée sur la cinquième partie de l’Organon, de la Logique, les Topica qui sont une méthode (sur la base des catégories et des analytiques ou modes syllogistiques) qui, je cite, « nous rendra capables de raisonner déductivement, en prenant appui sur des idées admises, sur tous les sujets qui peuvent se présenter, comme aussi, lorsque nous aurons nous-mêmes à répondre d’une affirmation, de ne rien dire qui lui soit contraire[1] ». Mais là n’est pas mon propos, car, hélas, de la topique en rhétorique que Kennedy qualifie justement de « stratégie argumentative[2] » — la rhétorique comme stratège des lieux —, on ne voit plus l’espace, le topos. Mais, pour ajouter un autre regret à cet hélas, la rhétorique aux mains des écoliers, revient souvent, dans la pratique, à n’être qu’une topique, un maniement de trucages argumentatifs, une circulaire ministérielle au demeurant bien intentionnée[3], un jeu de mouvements, ce que les Américains nomment « the right move » ou un « spin » ; c’est-à-dire, pour paraphraser Jacques Brunschwig dans sa préface aux Topiques d’Aristote, l’art de trouver le lieu (topos) par quoi on arrive à cette conclusion toute déjà faite que l’on donne à son auditoire pour lequel, et devant lequel, on mime de faire le chemin logique qui, de lieu en lieu, nous amène, ensemble apparemment, à l’évidence. Topique, stratégie rhétorique du chemin fait à rebours à partir d’un lieu commun — ce lieu métaphorique dans lequel nous partageons un acquiescement — déjà donné, c’est le fameux « message » des communicationnels.
L’espace public de la persuasion est immédiatement un jeu sur un espace figural, qui au fond n’est lui-même que la transcription, dans le langage de la délibération publique, du lieu fondateur de celle-ci, l’agora. Ou pour dire cet effet pervers de la topique, je citerai Barbara Cassin : « Qu’il suffise de suggérer que la rhétorique […] est une machine à domestiquer le temps […] pour le transformer en espace[4]. » Disons cela naïvement : on parle, verba volant, mais on persuade, les mots s’installent, prennent racine. Du flux devient du lieu. Et ce lieu, on le reconstruit en « lieux » rhétoriques.
Qu’est-ce que la topique, cette méthode concernant le lieu public de la parole ?
La rhétorique est, dit Aristote, l’antistrophe de la dialectique ; comme elle, elle est apodictique — on montre devant vous et moi ce qu’il faut démontrer, elle est expositive, démonstrative ; mais elle l’est à sa manière, car elle fait travailler non pas des vérités mais des préjugés, les endoxa, par le biais d’enthymèmes, c’est-à-dire des syllogismes qui ne sont pas faux mais biaisés. Ce sont là des stratégies qui consistent à vous faire venir là où je suis déjà, l’art d’imiter un mouvement logique et d’imiter la logique de ce mouvement. Un enthymème, c’est, dans sa version normée, un syllogisme sur des prémisses probables, lorsque nous interprétons un signe[5], mais c’est aussi — car Aristote ne donne pas une seule définition de la chose —, un syllogisme dont la logique, si elle est moins implacable (pour la logique), possède par contre un implacable effet de persuasion, car nous vivons, sur l’agora, dans la sphère publique de délibération, selon le régime des signes et non pas selon celui du vrai. Cette stratégie des effets, la rhétorique la met au rendement par des enthymèmes pris dans un fond commun. Ce que vous et moi partageons comme évidence — « les politiciens sont inutiles, l’université va mal » —, est notre fond commun qui, en effet, nous permet de débattre entre nous afin de vivre hors violence.
Or, le fameux « lieu commun » de la rhétorique sert comme lieu de reconnaissance entre orateur et auditoire, au long d’un processus qui se nomme, on le sait, l’inventio, première partie de l’art de rhétorique. On va chercher de quoi nourrir une idée, on trouve des choses, on les arrange, on en parle, on vous convainc ou, à tout le moins, on vous « interpelle » pour que « ça vous interroge quelque part » comme on dit. Quelque part en effet. L’enthymème, fabriqué sur le fond commun, opère par des passages obligés, ce que nous partageons comme culture, ce qui se nomme aussi bien « la sphère publique de délibération » pour parler comme Habermas. Cela s’appelle enfin la vie de la cité, la littérature.
La topique rhétorique, c’est ainsi simplement — mais cette simplicité n’est pas facile — l’espace commun dont vous et moi disposons, mais que moi je vais activer et vous écouter et croire activer. Tout le modèle aristotélicien de l’invention et du recours au fond commun qui actionne les lieux communs est celui de potentialité / réalisation, action / passion. La topique n’y échappe évidemment pas. Je ne parle pas pour agir, je parle pour vous faire agir, et cette action se déploiera dans l’espace public. La topique n’est donc pas seulement une sorte de classeur de discours, statique, à une voie, ni simplement un classeur commun, fait de loci, à plusieurs voies, mais un classeur interactif par quoi des endoxa communs sont actionnés en effets de logique afin de produire de l’action qui, du coup, apparaît raisonnable, car commune, de sens commun. Cela, on le voit, c’est la théorie dite libérale de la vie publique, ce que les théoriciens anglo-américains nomment « robust democracy[6] », contre la théorie post-moderne selon quoi l’activité endoxale de la délibération publique est stochastique, aléatoire, impondérable même si elle table toujours sur un fond commun[7].
Dans la version libérale, la parole publique se déploie dans un espace stable ; dans sa version post-moderne, elle s’active dans un temps instable. Le fond commun et sa topique agissent différemment.
Il est intéressant, me semble-t-il, de rappeler maintenant que l’arrimage de l’invention, et de la topique, à une idéologie de la stabilité, du lieu comme lieu dense, pondérable, lieu de reconnaissance, fut la grande affaire du Moyen Âge et d’une certaine Renaissance. Il convient de s’y arrêter un moment afin de mieux cerner le rapport entre inventio et topique. On peut reprendre sous cet angle ce que Frances Yates a décrit dans son Art of Memory. À la Renaissance, et à la suite de la tradition scolastique, des charlatans de la rhétorique ont cru, comme le vénitien Giulio Camillo Delminio dans les années 1530-1540, pouvoir enfermer tout le savoir contenu dans Cicéron, le modèle culturel de la parole publique, dans des casiers et des tiroirs arrangés en amphithéâtre classique, lui-même construit selon un système de chiffres magiques et d’influences astrales (appareil de faux-semblant philosophique et montage, semble-t-il, lucratif pour son inventeur). Qu’importe ce theatro[8]. Par contre, ce qui est d’intérêt pour nous, ressortit à ce que Delminio s’était fabriqué une « topique » en poussant l’analogie des lieux communs jusqu’à construire un véritable théâtre oratoire de lieux communs, mais peuplé de personnages de papier, des diables sous pression prêt à sortir du carton et à prendre la parole sur ceci ou cela, selon le besoin du client, ventriloquie de passages retranscrits à partir des discours, lettres et traités de Cicéron. Il avait poussé la stabilité de sa stratégie inventive topique jusqu’à faire de l’analogie spatiale un espace de parole — un espace total de toute parole. Voulez-vous parler de ceci ? Ouvrez tel tiroir sur le deuxième gradin. Son but reste incertain toutefois. On peut en effet dire qu’il s’agissait là d’une mnémotechnique, un art de mémoire ou de mémorisation qu’il avait apparemment vendu très cher à Paris avant d’aller le colporter dans les États de la Sérénissime. Soit, mais on peut ainsi rattacher ce théâtre à la tradition médiévale, surtout dominicaine, devenue maintenant surexcitée sous l’influence des fantasmagories néo-platoniciennes, des techniques de mémorisation par attribution d’emplacements symboliques aux parties de son discours.
Dans la tradition classique, un discours c’est aussi une salle, un lieu, cette salle-ci où je prends la parole. Pour me souvenir d’un discours, je visualise la salle de mon oratio, je colle mentalement l’exorde sur la statue de droite, et la péroraison sur la porte de gauche, et ainsi de suite. L’espace où je parle est ce que je dis. Et ce que je dis effectue l’espace du fond commun. Cela, car l’inventio rhétorique, faut-il comprendre, durant le Moyen Âge, a partie liée à la memoria, quatrième partie de l’art rhétorique. La mémorisation, l’ars memorativa, resta au demeurant de définition incertaine. Selon Quintilien, mémoriser tel discours revient à ajouter à la charge de donner le discours, l’occasion de se peupler l’esprit de lieux symboliques afin de s’en souvenir[9]. Quintilien donne et reprend qui, du même geste, met les néophytes en garde contre le danger des lieux comme technique de mémorisation. Mais aussi, dans la version du De oratore, la technique spatialisante de l’ars memorativa concerne aussi toute fabrication de discours : à peupler son imagination de figures saillantes et énergiques, on se crée sa salle d’audience à soi afin de pouvoir y puiser, inventer, les techniques et les ressources de l’art, y compris le stock de choses bonnes à dire. Dans une culture orale, le stockage des informations passe par des techniques telles que le classeur de Giulio Camillo Delminio. Ce stockage est d’une telle importance que la memoria recouvre en effet l’inventio : inventer revient à mémoriser ses lieux et à se souvenir des lieux. Dans cette optique, les lieux communs sont effectivement le fond commun.
Or, dans la culture rhétorique du Moyen Âge scholastique de laquelle Giulio Camillo Delminio sort à peine, ces deux tenants sont bien perçus cependant comme la source jumelle de l’art de parler : on rangeait en effet côte à côte la Première rhétorique de Tullius (le De inventione de Cicéron) et la Seconde rhétorique (le Ad Herrenium qu’on attribuait aussi à l’Arpinate). Le Ad Herrenium, brillamment condensé dans un passage du De oratore que Cicéron consacre à la fable de Simonide inventant l’ars memorativa au banquet fatal après avoir trop bien chanté la louange de Castor et Pollux[10], est un véritable manuel de fabrication des loci dans lequel on peut puiser à volonté. Mais cette Seconde rhétorique va l’amble avec le De inventione, la Première rhétorique.
Or, le lien qui s’opère au Moyen Âge, en particulier dans la tradition dominicaine, à la suite de Thomas d’Aquin, entre les deux traités s’articule au catalogue des quatre vertus, autrement cardinales. Prudence, justice, fortitude et tempérance sont en effet, chez Cicéron, simplement des lieux communs, des rouages à fabriquer des enthymèmes, un fond commun moral. Cardinaux points communs. L’ars memorativa prend alors forme rapidement et thomistiquement d’une méthode pour cultiver la prudence, vertu chrétienne qui trouve dans l’exercice de la parole un autre moyen de s’actionner, par le prêche, dans l’auditeur. La rhétorique scolastique, comme plus tard la rhétorique mystagogique des Renaissants (Camillo, Lulle, Bruno), percute donc les loci de la mémoire avec les loci de l’invention, et les loci de l’invention avec une anthropologie morale. Ces versions se font évidemment en mortaise dans le « théâtre » de Camillo, et ces queues d’arronde, invention et mémoire, se sont quasiment soudées l’une dans l’autre, résultant en une anthropologie. La raison de ce télescopage tient au fait que, dans une civilisation essentiellement orale, mémoriser est aussi important que savoir lire et écrire dans une civilisation lettrée. La morale, même religieuse, ne peut échapper à cette règle. Cette assimilation de la topique inventive à la mémorisation, le passage du locus de l’invention au locus de la mémoire, signale donc à quel point / espace / et la rhétorique ont destin commun et destin lié à une interprétation des motifs moraux (traduisons : sociaux, publics, civils) qui permettent à cette construction de passer dans l’espace public de délibération et d’être ce que la rhétorique doit être, un agent de rapports entre citoyens.
Dieu merci, si le livre imprimé fait au XVIIe siècle épargne de l’ars memorativa et des fantasmes symboliques ou mystiques, la ligature entre invention, mémoire et morale restera prégnante. Les Exercices de Loyola, un fruit macéré, et les Caractères de La Bruyère, un fruit tardif, le révèlent. Par exemple, lors du quatrième jour de la deuxième semaine, la fameuse Méditation sur les deux étendards — la bannière du Christ et celle de Satan — procède par « la construction du lieu, de nous représenter un très vaste espace près de Jérusalem […] et d’autre part un espace à Babylone[11] », avec les deux orateurs adversaires dont on se représente[12] la posture, l’entourage et le genre de discours[13]. L’exercice se fait au milieu de la nuit avec une reprise le matin et à la fin de l’après-midi[14]. L’exercice fonctionne admirablement à titre de topique, de stock inventif et de projet moral. De même, il serait utile, je crois, de relire La Bruyère et, en surcroît de son rapport à la casuistique que je suggérai naguère[15] — topique s’il en est —, de considérer cet étrange tableau des moeurs comme une topique qui se dote d’une valeur prudentielle, même si l’on considère, comme je le crois, que La Bruyère est un sceptique qui donne à voir en laissant le jugement en suspens, aux frais de chaque lecteur[16]. Mais la position sceptique ne contrecarre pas la rémanence de la stratégie topique.
Loyola et La Bruyère interviennent dans la sphère publique de délibération, l’un et l’autre dans la mise au point de valeurs éthiques, en utilisant un système qui, en dépit des différences de propos, ligature lieux communs et espace délibératif.
Quel était ce système topique ?
Chez Aristote cependant, avant l’adultération que la mnémotechnique chrétienne et orale fit subir aux lieux communs, et l’ère rationaliste du doute, la « topique » était un art fort. Ou, dit autrement, un art de la parole, un art civique. Qu’est-ce donc que cet art fort et civique ? Il ressortit au troisième des modes de la preuve, à savoir l’administration de la pistis par des techniques relevant du logos. La pistis, c’est à la fois la conviction qu’un auditeur possède, après avoir entendu un orateur, et les matériaux discursifs de la preuve. Ici, avec la topique, il s’agit de trouver ces éléments discursifs qui aident à la construction de son sujet — l’invention. Mais la topique en tant que pistis (et, de fait, la forme forte de la pistis rhétorique) se superpose à la preuve dite par l’èthos[17], faite de l’autorité que l’auditoire reconnaît à l’orateur, et de la capacité de celui-ci à affirmer ce rapport en se mettant à l’écoute du premier (l’accommodatio) ; et à la preuve par le pathos, la charge émotive qui « branche » un discours (l’energeia). La topique comme l’éthique et la pathétique sont des administrations dites « artistiques » — persuader dans les règles de l’art. À ce titre, topique ou logique, éthique, pathétique, servent un but commun : faire de la rhétorique un « art » et pas seulement une « pratique ». La topique se surperpose donc, en les dominant, aux deux autres modes de la pistis : elle est ce qui peut vous convaincre que ce que je dis est « vrai » et donc vous faire agir, car le vrai rhétorique est une dynamis d’action. Est vrai ce qui traduit un mot de l’orateur en un acte de l’auditeur. La rhétorique est toujours civique : son espace est public, même lorsque, lisant un livre, on veut oublier que ce livre, posé sous les yeux, est un acte potentiel. La fiction n’en est jamais une.
Affaire de la topique : comment trouver pour une proposition des « lieux » et traiter un « lieu » par différentes propositions, et puis monter ainsi, c’est le processus d’invention, son discours. Lieux communs, car entre topique, espace et rhétorique, une relation existe, qui passe par le maniement de la persuasion dans la sphère publique et la perception immédiatement ressentie par les sophistes, fondateurs de la rhétorique, venus de Sicile apporter aux Grecs autochtones un savoir trop brillant, trop vif, trop plein de plaisir — celui de parler, devant un public, sur une place publique ou dans un salon, ou à l’ombre des oliviers. La persuasion s’annonce comme parole d’espace. Le pas entre cette prise d’évidence et le montage technique de l’art de parler, la topique, repose sur le sentiment commun aux auditeurs et aux orateurs que pour parler ici, devant vous, je dois me représenter cette parole qui va agir sur vous, vous pousser à agir lorsque ma parole se sera amuïe, qui va vous faire passer en actes, déployés dans le champ du politique ou du public, des mots, de simples mots, des souffles. Je dois donc déjà peupler ma parole de « lieux » et imiter dans ma parole cet espace qui se déploiera. C’est cela la « topique », avant d’être une machine à trouver des arguments ; dire l’espace dans ma parole : « Le lieu est ce sous quoi tombe une multiplicité d’enthymèmes[18]. »
À propos des fins rhétoriques
Mais qu’elle soit un art, un art public, qu’elle incorpore en elle l’espace commun — les enthymèmes, leurs endoxa, bref la place publique — en y situant l’essentiel de sa force, n’est pas sans conséquences. Chez Aristote, un art doit posséder deux finalités.
Je voudrais ici esquisser comment la théorie des fins recèle un impact sur la topique. Un art possède une fin interne ainsi qu’une fin externe. La fin interne de l’art rhétorique est de mettre en oeuvre sa constitution interne, le système de la preuve, essentiellement l’enthymème, bref « les règles de l’art ». La fin externe de la rhétorique relève de l’effet sur l’auditeur, l’effet persuasif. En cela, atteindre la fin externe, persuader tel public par tel discours, ressortit à parfaire sa kinesis — l’acte est complet[19]. Mais atteindre à sa fin interne, mettre en oeuvre les ressources de l’art, illustre par contre l’energeia, lorsque la forme est complète, actualisée. Cinétiquement, un discours va pousser son action (verbale) à être de l’action (politique). Énergétiquement, un discours va pousser sa forme (les lieux communs, les ornements, la syntaxe, le style de diction) jusqu’au bout de soi (mettre en oeuvre ces catégories). La fin externe est du perlocutoire, la fin interne de l’illocutoire. Bref, si l’on peut convaincre par hasard, on ne peut pas argumenter par hasard. La rhétorique n’est pas l’art de rhétorique. L’art de rhétorique, par sa double finalité, est commun à tous, public. Prendre la parole et, à l’emporte-pièce, faire mouche, est un acte unique, non commun même si son effet est public. L’un est vertueux, l’autre ne l’est pas.
De fait, l’art rhétorique comme l’art politique a deux fins ; pour ce dernier, la fin externe c’est que nous vivions (sans nous égorger, la fameuse « sécurité »), mais la fin interne est que nous vivions bien (la fameuse « sécurité sociale »). De même que nous confondons souvent la fin externe du politique avec sa fin interne — problème de la démocratie, celui de la tyrannie est inverse —, de même nous ne voyons pas souvent que persuader doit s’ancrer à une fin interne afin que la raison (logos), l’empathie (pathos) et le respect (èthos) structurent la parole et l’espace publiques. La fin interne fait le lien à l’exercice de la vertu publique. Ôter de la vie politique sa fin interne mène aux abus — un abus, c’est précisément lorsque l’homme politique se sert de l’alibi externe (parler au nom du bien public, de la République, de l’État) pour défalquer de la fin interne (le respect, la raison, la modération) ces vertus mêmes, et ainsi éviter que le politique prenne toute sa forme. En ce sens, Cinna est la tragédie du conflit des fins et son harmonieuse résolution dans la personne d’Auguste : Auguste met Cinna et Maxime face à un choix, celui des fins pour exhiber, en fin de parcours, l’harmonie de ces fins mêmes — maître de soi : effet de fin interne ; de l’univers, de fin externe. À rebours, les Mémoires de Retz sont la passion de la fin externe (la gloriole) au détriment des fins internes (la paix civile). Et ce que dit incessamment Bossuet dans ses grandes oraisons royales, c’est à quel point l’obsession de la fin externe (vivre à la Cour) peut servir les courtisans à cultiver la fin interne (vivre en une « Cour sainte »).
Sommes-nous loin de la chose littéraire ? Pas du tout. La littérature est acte public. Elle entre dans le répertoire des fins internes de la politique, car si cela n’était pas le cas, vous et moi ne serions pas ici, en Sorbonne, et ce bâtiment ne serait pas. Aristote, Poétique, ch. 6 : dans une tragédie, les discours relèvent de la politique et de la rhétorique — ce qui est proprement poétique, c’est la fable (l’intrigue), le caractère (le motif des personnages), la diction et la mélodie. Le spectacle, au dernier rang. Pourquoi ? Parce qu’une tragédie imite non pas des hommes mais une action. La rhétorique, par contre, imite des hommes. Différence fondamentale.
C’est la raison pour laquelle Aristote ne considère pas la métaphore comme « artistique » ou « technique », relevant de l’art rhétorique : dans la Poétique, il la définit seulement comme une « pratique[20] » qui n’est pas objet d’apprentissage. La distinction est cruciale : elle affirme que c’est par la topique qu’un discours achève sa fin interne. Pour quelle raison ? Parce que, ce qui assure cette fin interne de sa validité publique, sa phronesis politique, serait que l’argumentation logique, topique (sur quoi s’arriment éthique et pathétique), est régulière. La métaphore, voyez Boileau sur Longin, est au contraire irrégulière, erratique. Une bonne métaphore, qui achève la fin externe — vous laisser pantois —, fait toujours mouche hors des règles de l’art. Elle rend l’homme public poétique. Son problème est qu’elle reste intransmissible.
Or, pour que vertu il y ait, dans un espace public de délibération, y compris en littérature, il convient qu’il existe une transmission régulée et régulière de la forme. Régulée et régulière. La rhétorique comme la nature engendre du sembable. À quelle fin ? Afin que l’auditeur puisse reproduire l’argument, celui-ci passant d’agent à patient qui lui-même est devenu agent. Des kineseis deviennent des energeiai. La catharsis se loge ici : lorsque l’auditeur se purge, par l’effet de persuasion d’un discours, de ses préventions et qu’il se croit capable d’argumenter à son tour. La vie politique comme la vie tout court ou le désir de lire et d’écrire passent du pareil au même. La persuasion marche quand orateur et auditeur partagent la même energeia. La transmission littéraire aussi. La métaphore bloque la règle. La métaphore vise à plaire. De même, un orateur qui veut deviner ce que pense un auditoire et asservit ainsi à la fin externe la fin interne, est « stochastique », il « tape » juste, peut-être[21]. Deviner n’est pas argumenter. Trouver une métaphore n’est pas être écrivain. Ordre de la règle. Sommes-nous loin de l’espace rhétorique ? Non pas. Voyez, plus évidente, cette citation tirée de la Poétique :
Un spectacle peut bien marcher (psychagonikon) mais être sans art (atechnotaton) et n’avoir rien à voir avec la création littéraire (poietikes). De fait, le potentiel tragique (dynamis) [en paire avec energeia, actualisation] existe en dehors des acteurs et de la représentation. Je le répète, si c’est l’effet spectacle qui est recherché, l’art (technè) du costumier a plus d’autorité (kuriotera) que celui de l’écrivain[22].
Qu’est-ce à dire ? Que le showcasing, comme on dit, peut être plus efficace pour atteindre la fin externe d’une pièce de théâtre, vous toucher, que l’intrigue. Certes, vous êtes là, dans la salle, vous êtes touchés, mais seule la construction « artistique » de celle-ci assure à une tragédie d’achever sa fin interne, sa dynamis qui actualise son potentiel tragique par l’energeia des moyens de l’art, bref la katharsis. Une tradition littéraire fonctionne ainsi.
Sur le lieu commun et l’/ espace / commun
Évidemment, tout cet échafaudage oral et anthropologique s’effondre cependant, pan à pan, au XVIIe siècle sous la triple action du subjectivisme cartésien, du scepticisme libertin, et du nouvel esprit scientifique. Je dois m’y arrêter pour prendre mesure des écarts qui affectent l’espace rhétorique.
Pour Descartes mais aussi les sceptiques, comme La Mothe Le Vayer[23], le lieu commun est le lieu du doute. Le commun du lieu rend le lieu le lieu du doute. Et un tel doute n’affecte pas seulement le savoir pur mais simplement « la vie », même à titre de morale provisoire. Dans la première partie du Discours, l’attaque violente menée par Descartes contre la rhétorique ouvre celle contre les sciences au fil d’une métaphore lancinante, celle de la fondation instable pour un bâtiment « superbe », celle de la fondation solide sur laquelle « on n’avait rien bâti dessus de plus relevé ». Renversement radical de perspective. L’oreille avertie entend la topique, et naturellement en convoquant une critique du savoir « traditionnel », comme disait Bacon avant lui, Descartes ramène ce savoir à un bâtiment, à des bâtiments, à un espace. L’oreille rhétorique y entend une ironie acerbe : c’est avec un appel à la topique que Descartes ruine les Lettres et leur effet voulu de savoir. Les lieux communs sont « de la boue ». Cela, pour le style d’attaque. Voyons le fond. De fait, chez Bacon, le lieu commun est une « idole », selon la fameuse quadripartition du savoir doxal : idole de la tribu, idole du chez soi, idole du marché, idole du théâtre — les lieux communs tenus pour essentiels à notre position dans l’espace public, proviennent de ce que nous croyons être notre rapport au monde, à nous-mêmes, aux autres et aux idées mêmes[24]. Le travail du doute et sa méthode, qu’ils soient cartésien, libertin ou baconien, sont une machine contre le lieu commun. L’inventio cartésienne est ainsi un scandale pour la tradition rhétorique puisque la découverte des lieux (dans l’idiome rhétorique) est conduite par la découverte du cogito, dans un exercice solitaire et qui fait table rase des endoxa. La « table rase » est la réplique au « théâtre des lieux ». Ce qui est mis à terre, rasé sur pied, c’est le fond commun. Les lieux sont annulés.
Dans l’optique libertine et sceptique, le lieu commun fonctionne ironiquement comme la preuve de l’incohérente stabilité des préjugés sociaux, une « diversité », terme normé, qui montre que les lieux communs sont communs ici et que là ils ne le sont pas, donc sans valeur certaine[25]. Qu’il n’existe de commun que l’attirance du commun. Le sage, comme la princesse des romans, ne veut pas le sort du commun. On peut ici évoquer l’analyse de l’historien des sciences Steven Shapin[26]. Il montre comment, pour le nouvel esprit scientifique, l’opinion est l’ennemi au point qu’il convient même, à la Royal Society, d’inventer une nouvelle parole, a-rhétorique, qui ne dise rien comme disait la rhétorique, et, dans la foulée, une stratégie de communication scientifique. La persuasion dans l’espace en constitution de la communauté scientifique, ce sera le rapport de laboratoire et le rapport devant les pairs, les « transactions » et en France, les Mémoires de l’Académie des sciences. Les Transactions se montent contre Aristote. Le rapport de travail contre la topique commune. Ce sera le mécanisme et le respect du « peer review », la civilité des relations entre savants qui permet une bonne circulation des informations, contre l’arrogance oratoire et le recyclage des informations. Cet espace délibératif neuf ne veut rien avoir affaire avec la topique.
Mais ce que je voudrais faire sentir ici, c’est à quel point la notion de sphère publique de délibération, d’espace commun de la parole, si profondément grecque, est l’anathème jeté autant sur la tradition religieuse que sur le nouvel esprit scientifique. Là, l’art de parole n’est pas public, il est un art de clercs, une jouissance d’experts pour fabriquer d’autres experts et, parfois, dans des circonstances extraordinaires, agir sur les fidèles, mais de ces fidèles aucun exercice de la « mild voice of reason ». Ici, l’art de parole est normé dans l’échange scientifique, il est un art d’experts dont les retombées publiques sont littéralement hors de propos. Je prends deux exemples de ces espaces a-rhétoriques et de leur côtoiement de la rhétorique.
Mon premier exemple ressortit à la prédication populaire de la Renaissance. Le cas du franciscain Bernardin de Sienne et sa carrière dans la première moitié de XVe siècle révèlent une stratégie typique du monde oral et de l’espace rhétorique qui s’y déploie. Le XVe siècle est considéré comme l’âge d’or de l’homélitique populaire, par les voix des franciscains et des dominicains[27]. L’espace en est la cité. Le temps en est marqué, le carême et la fin de l’été. La méthode en est « thématique » et suit ce qu’en dit John of Wales dans son De arte praedicatoria. Essentiellement, cet art de la prédication par les nouveaux ordres, qui se sont développés dans une nouvelle écologie de la parole, une culture urbaine, ce serait du Cicéron, mis à part l’usage par exemple du prothème (souvent, chez Bernardin, l’Ave Maria) et sous réserve en outre que la disputatio scolastique ait effectivement transité dans cet ars praedicandi.
Même à accepter cette thèse hamonieuse, et sur laquelle les historiens de notre discipline s’infligent des démentis, un énorme pas existerait entre la visée persuasive cicéronienne — qui agit sur des endoxa, transitoires, logologiques — et la visée édifiante prédicative — qui use du sermon comme d’un pis-aller rhétorique, puisque le Verbe, lui, n’est pas objet de savoir endoxal. Un sermon n’est pas une stratégie de lieux communs, et ne peut l’être ; il se donne comme une proclamation de la vérité. Les eloquia domini se suffisent à eux-mêmes. Le prêche, dans l’espace persuasif public des cités modernes en formation, a trois objets : il est pénitentiel, il exhorte à la réforme du coeur et forme une propédeutique à la réception du sacrement de la confession. Pénitence, édification, confession peuvent être vues comme des lieux communs, mais c’est alors ignorer la spécificité du rapport entre le Verbe, a-doxal, et la persuasion, un moyen, rien d’autre. Permettez-moi ici de sauter à la période moderne et de faire référence au Lineamentum de Jean-Paul II, une instruction aux évêques en préparation au 10e Synode mondial (2000), où le Souverain Pontife souligne que du triplex munus (prêcher, sanctifier, gouverner) en quoi l’évêque redouble la figure du Christ (définition de la Constitution de Vatican II, Lumen Gentium), la proclamation depuis la chaire épiscopale, chaire de la parole, confirme son rôle de perfector — une citation directe de la Summa theologiae [28], une droite ligne thomiste que les ordres destinés à la prédication empruntaient alors sciemment[29].
Or, ce rôle est normé, prophétiquement, dans la proclamation de Dieu dans la vision d’Isaïe : « Appelle a plein gosier, ne te ménage pas, comme la trompette, enfle ta voix, annonce à mon peuple ses révoltes, à la maison de Jacob ses fautes[30]. » Ce lieu commun-là ne se donne pas comme du doxal, mais comme une absolue vérité, qui ne peut être l’objet ni d’une négociation ni d’une mémorisation ni d’un classement. Le chrétien connaît cette voix. Poggio Bracciolini, dans une analyse rhétorique du De avaritia, propose évidemment de lire rhétoriquement les prediche volgari de Bernardin comme une pathétique, une technique oratoire qui élimine le rapport à la topique pour être entièrement effective par l’appel aux passions, soutenu d’un effet éthique, l’incontestable autorité publique du futur saint, elle-même effet d’accommodatio entre le prédicateur et son public (lorsqu’il attaque sorciers, homosexuels et juifs, comme destructeurs de la vie de la cité, de sa socialité heureuse). De cette accommodatio, la marque la plus vive reste la remarquable reportatio du cycle de quarante-cinq sermons donnés à Sienne à la fin de l’été de 1427, transcrits de verbo ad verbum par un fidèle auditeur, tailleur de son état. Seul un effet réussi d’autorité, de preuve éthique, dirait Bracciolini, pouvait conduire à un enregistrement tel. Par contraste, les sermones latini, destinés à ses co-prédicateurs, ainsi que les prediche à valeur catéchétique, suivent, chacun à sa manière, le schéma ratio-auctoritas-exemplum, venu du sermon thématique.
Ce qu’il importe de saisir, ce ne sont pas ces détails, mais le fait que le problème rhétorique, persuasif, qui affronte Bernardin ressortit à s’assurer que l’effet est achevé. Le noeud en est le statut de l’exemplum.
Pourquoi parler ici de l’exemplum ? D’abord qu’est-ce que l’exemple ? Dans les Premiers analytiques, l’exemple appartient à la série des presque-syllogismes (induction, exemple, réduction, objection) que clôt l’enthymème[31]. En logique, il existe un exemple lorsque, je paraphrase Aristote, la majeure est déclarée relever du moyen terme par le recours à un terme qui ressemble au tiers[32]. En théorie moderne de l’argumentation — fond des travaux de Chaïm Perelman, à partir de Rhétorique II, 20-22 surtout — on propose un système de preuves qui regroupe l’exemple, l’illustration et le modèle[33]. En fait, Perelman inverse la division aristotélicienne en deux sortes de paradeigmata, selon laquelle la forme de preuve qui est adaptable à toutes les formes de rhétorique est soit la comparaison ou parabole (qui correspond à l’illustration de Perelman) et la fiction ou logos (qui correspond à l’exemple chez l’auteur de L’empire rhétorique). L’exemple active une régularité imaginaire ; l’illustration, elle, active une régularité acceptée ; le modèle enfin active une caution d’action — Perelman cite justement Bossuet et son sermon Sur la prédication évangélique lorsque le prélat donne le Christ en modèle aux rois.
Mais quel est le fond de la stratégie par l’exemple ? Il est d’un double ressort. D’une part, l’exemple (au sens d’Aristote) se donne à défaut d’enthymèmes[34], lorsque le stock est à sec. D’autre part, l’exemple, selon son placement dans un discours, agit comme une induction (au début d’un discours) ou comme une preuve atechnique, un témoignage (à la fin d’un discours)[35]. Bref, pour revenir à l’espace délibératif, le recours à un exemple — une histoire, un truc, une illustration, s’il peut se réclamer de la filiation à la parabole christique (« Gesù, fontanna d’eloquenzia », dit Bernardin, à Florence, en 1425) — n’en est pas moins une technique qui, dans la bouche des dicitori, articule du matériau profane, bref endoxal. L’exemplum s’ouvre directement sur l’auditoire, il fait appel au témoin, il remplace tel ou tel d’entre nous, ou il nous met en position directe de rapporter le discours à ce que nous vivons. Il est du quasi non artistique : il outrepasse « les règles de l’art ». Convoquer un exemple ou convoquer un témoin, même geste. L’exemplum peut bien être rapporté et sauvé de cette stratégie, dans le genre parabolique au sens novo-testamentaire, mais dans l’espace civique chrétien, il est du profane, du civique, du délibératif, de l’espace social injecté dans l’argumentation.
L’exemple fait entrer le commun du lieu commun dans la prédication sacrée. Il en dérange la certitude. Il agit comme stratégie doxale à propos de comportements sociaux comment se comporter vis-à-vis de l’argent (l’usure), du plaisir (les homosexuels), du refus de Dieu (la dureté de coeur des juifs), de la présence active du Mal (les sorcières). Tous les témoignages affirment combien la prédication de Bernardin de Sienne, exemplaire, s’inscrivait dans un espace civil de délibération, même si son intention n’était pas de l’être. La topique, par l’exemplum, s’affirmait active. Autrement dit, il est difficile de chasser le lieu commun même lorsque le discours se veut hors du commun, hors du doxal, hors d’une stratégie de discussion. Cette forme dénégative de la rhétorique, im-pensable pour la tradition platonico-aristotélicienne comme pour la tradition sophistique, est continûment active — des oraisons funèbres de Bossuet ou des panégyriques de Massillon aux lineamenta du pape Jean-Paul II. Forme dénégative, car elle rejette l’effet de persuasion à partir des endoxa, et avec elle la possibilité d’une topique inventive qui ne soit pas autre que validée par une autorité infaillible. Le fond commun, en d’autres termes, possède cette caractéristique qu’il permet un agôn de discours — tel lieu contre tel lieu.
A-rhétorique anglaise, / espace / civil
La Royal Society offre, dans une culture de l’imprimé et sous une epistémè différente, un autre modèle exactement inverse d’/ espace rhétorique / qui se donne comme entièrement normé par la délibération, contre le lieu commun, contre la topique et contre la pathétique. L’éthique seule reste présente.
Le problème central de la nouvelle science, au XVIIe siècle, n’est pas simple : comment croire ? Comment croire que Galilée a raison ? Comment croire que les expériences de Huet à Caen sont vraies ? Comment croire que les microbes existent ? Comment croire ce qui n’est pas dans les livres ? La réponse est complexe du point de vue de l’histoire des sciences, mais du point de vue de l’histoire de la délibération, elle permet de mieux saisir ce qu’est un espace a-rhétorique. Le problème auquel ont fait face les nouveaux scientifiques, contre l’École, est admirablement posé par John Wilkins dans un texte de 1638 (je traduis) : « Une nouvelle vérité peut sembler absurde et impossible non seulement au peuple mais aussi à ceux qui sont, par ailleurs, des savants ; il s’ensuit que toute nouveauté qui semble contraire à des principes communs, non seulement ne doit pas être rejetée, mais au contraire examinée avec le plus grand soin. » Spratt, dans l’Histoirede la Royal Society (1667), affirme la même chose, que « les effets pernicieux de ce langage superflu se sont étendus aux autres arts et professions »[36]. Mais quoi en fait ? Sinon comment se fabrique de la croyance.
Rhétoriquement, la position est neuve, car c’est contre le lieu commun que se fabrique ici une croyance commune. Évidemment, s’il suffisait de croire que le rapport de laboratoire fabrique à lui seul une croyance commune, la chose serait résolue. Ce n’est évidemment pas le cas. Steven Shapin a bien démonté le système qu’il nomme « décorum épistémologique » qui permet de construire la nouvelle science.
Pour cerner l’ennemi, Bacon nomme le crédit facile dont jouit la science traditionnelle comme relevant d’un savoir “ transitive, concerning the expressing or transferring […] which I will term by the general name of tradition or delivery[37] ”. La tradition donne l’emplacement de la rhétorique dans l’ancien savoir : pour transférer du savoir, il faut — il fallait — un « organe », le langage et l’écriture, une « méthode[38] », et une « illustration[39] ». Or, la marque du savoir traditionnel réside dans la multiplicité des organes (le langage se décline en styles, idiomes, genres), dans la diversité de méthode, et dans la « boutique » rhétorique. Boutique ? Bacon en effet ramène les lieux à ce qu’il nomme les antitheta, “ in resemblance to a shop of pieces unmade up ”, et les formulae, “ [in resemblance to] a shop of things ready made up ”. Bacon résume plus de deux mille ans de réflexion topique en trois courts paragraphes[40]. Il donne congé à cette fausse invention, ayant affirmé auparavant[41] que la fin de la logique est de trouver un argument certain et non pas de coincer l’adversaire (“ to entrap reason ”), que celle de la morale (disons : la psychologie) est de faire en sorte que les émotions servent la raison et ne l’envahissent pas (“ not to invade it ”), et que celle de la rhétorique est de remplir l’imagination pour aider la raison, et non pas pour l’obscurcir (“ The end of rhetoric is to fill the imagination to second reason, and not to oppress it ”). L’ancienne rhétorique appliquée aux productions de l’esprit manque de décorum.
Le mode a-rhétorique de la Royal Society, au coeur du dispositif de la communauté délibérative nouvelle, se démet lui des accrétions stylistiques et langagières, se défait des fausses méthodes et se refuse à la rhétorique — sauf celle que Shapin précisément décrit comme la reconnaisssance de procédures de civilité. La civilité savante n’est pas la politesse française : elle est un moyen du savoir qui permet de valider des recherches. L’/ espace / a-rhétorique de la nouvelle science est ainsi étranger aux lieux communs et à ce qui soutient la topique. Pour Bacon, l’ancien système est purement et simplement une « trappe ». Au lieu des endoxa qui nourrissent la topique scientifique (par exemple, dans Le malade imaginaire, le processus thérapeutique en trois temps appliqué par M. Purgon peut être lu comme un système topique[42]), Bacon et la Royal Society placent la valeur sur ce qu’est un témoignage. Dans ce cadre, la maxime apparemment cynique de Hobbes dans Léviathan, selon laquelle personne ne se dispute à propos des vérités géométriques parce que personne n’a rien à y gagner, est juste tant qu’on n’étend pas ce type de débat sur le vrai aux nouvelles disciplines scientifiques. Dans l’optique expérimentale, pour qu’un fait observé puisse entrer dans la croyance, il faut un observateur autre que celui qui le propose — c’est le fond de certaines propositions de l’Essay Concerning Human Understanding sur le régime de la probabilité, la croyance et le fonctionnement du savoir. Si des règles de décorum animent ce système, selon Shapin, et qu’elles structurent la production de la croyance scientifique, leur source de distinction, pour parler comme Bourdieu, en est effectivement la tradition d’urbanité et de politesse — on fait crédit à celui qui parle comme vous, fond de cette affaire, et cela relève certes de la rhétorique des moeurs —, mais leur agent efficace n’est pas l’art cortegianesque étendu au cercle scientifique. Il est la capacité des agents de ce cercle de sortir du décorum pour accepter ce qui enfreint précisément le système culturel de l’ancienne politesse : l’acceptation de l’expérience. L’espace délibératif par quoi se constitue la communauté scientifique n’est plus celui de la République des Lettres. C’est sur cette articulation qu’intervient Locke.
De prime abord, on sait que Locke, comme Hobbes, réduit la rhétorique à ses effets pathétiques, que certains théoriciens germaniques nomment joliment pathologia (Valentin Thilo, 1647). La topique est éjectée. Mais à s’en tenir à ce point de vue rhéto-centrique (celui de Thomas Conley[43]), on risque de manquer à comprendre comment le fondateur du républicanisme moderne, et par contre coup de la “ rhetorical democracy ” des Pères Fondateurs américains, exécute un tel geste dans l’Essay Concerning Human Understanding (1690).
Son entreprise de discrédit de la rhétorique se redouble d’une entreprise de discrédit de l’espace public de délibération tel qu’il existait alors. Locke, on le sait, rejette le syllogisme comme mécanisme fondamental de raisonnement, en utilisant l’argument sceptique des variations culturelles : un Asiatique ne sait pas ce qu’est un syllogisme, pourtant il peut raisonner juste. Et par rebond, si l’on croit que le syllogisme sert à dépister le faux syllogisme, le “ rhetorical flourish ”, cela n’est valable que pour ceux qui savent ce qu’est une prémisse et ce qu’est une figure de rhétorique : raisonner, c’est au contraire “ [to] see the probable connection ”[44]. L’objet de cette distinction est de ramener l’espace de délibération à un état qu’ailleurs, Locke nomme « rustique », une sorte de perception immédiate du rapport entre les choses, lorsque l’individu délibérant se comporte comme le paysan dans son sillon, en contact avec son écologie, dans laquelle il veut imprimer son action. Mais comment est alors structuré cet espace commun ? Le passage clef se trouve placé juste avant l’analyse du conflit entre raison et foi[45]. Pourquoi ce placement ? Parce que l’objet de l’analyse qui la précède[46] était de tracer dans la sphère publique de délibération, deux zones distinctes (que les cartésiens croyants comme Lamy ne sauraient admettre), l’espace du raisonnement politique et l’espace de la croyance religieuse. La division est impérative car elle permet de mettre en place le droit de regard de la délibération sur ce qui veut lui échapper, car “ if the boundaries be not set between faith and reason, no enthusiasm or extravagancy in religion can be contradicted[47] ”. Cette frontière garantit en somme que l’espace délibératif nouveau puisse fonctionner hors des contraintes extravagantes de la foi. Extra-vagantes, hors de son espace propre. À rebours, comment fonctionne la délibération publique, quel est le régime non syllogistique qui à la fois respecte les variations culturelles et formule des universaux sur l’assentiment et son régime connectif ?
La réponse que formule Locke est simple : « Il faut réfléchir un instant sur les quatre types d’argument dont usent habituellement les hommes, lorsqu’ ils raisonnent les uns avec les autres, pour s’assurer de leur assentiment — ou du moins pour réduire leurs opposants au silence[48]. » Terrible jugement. On donne son assentiment par respect pour la preuve éthique, par respect envers sa propre incapacité de dire mieux, par respect devant une preuve ad hominem[49]. Dans le premier cas, je peux en effet être modeste ; dans le deuxième cas, je peux simplement ne pas savoir mieux ; dans le troisième, je peux effectivement m’être contredit. Cela peut me disposer à entendre — à donner mon assentiment —, mais ce trucage ne me dispose pas à comprendre : car la honte de soi, l’ignorance de soi et l’incohérence en soi ne sont pas des moteurs délibératifs de liberté, et si je parle, c’est pour affirmer que ma parole peut librement entraîner un acte, ne serait-ce que mettre mon bulletin de vote dans une urne[50].
Le test de ce système de délibération publique c’est la Letter Concerning Toleration (1685). En effet, afin de séparer l’Église de la société civile et de fonder en celle-ci une morale publique qui vise au bien commun, il s’agit, pour Locke, de commencer par éliminer les effets oratoires et les “ specious shows of deceitful words[51] ” par quoi s’activent les arguments producteurs d’assentiment, et destructeurs de la délibération. Dans le Second Treatise of Government[52], la fondation du régime de “ commonwealth ” sur le pouvoir législatif fonde en même temps la communauté délibérative sur une nouvelle base dont sont proscrites les stratégies de la topique et leurs déceptions. La civitas lockienne, comme la society de savants de Bacon, est a-rhétorique dans le sens d’une stratégie de lieux communs. La position est éminemment anti-aristotélicienne. Elle est, par une voie détournée, éminemment religieuse : sa plus parfaite expression sera la Déclaration américaine de 1776 qui formulera l’enceinte d’une parole dont les délibérations n’en seront, comme la prédication du Verbe, que l’exploitation — ce qui rend quasiment incompréhensibles aux Européens (à l’exception de L’Osservatore Romano) l’importance vitale de la “ litigation ” comme interprétation de la vie civique aux États-Unis. Autrement dit, pour souder Bacon et Locke, l’espace public délibératif fonctionne ainsi comme l’analogue de l’espace des relations scientifiques : hors topique. On retrouve alors deux préoccupations centrales de la métaphysique lockienne : la question de l’identité personnelle[53], et celle du statut des mots. Le principe d’invariance de la “ consciousness[54] ” qui unifie la “ person ” ne permet pas de donner crédit aux manipulations de la topique. L’espace intérieur, intégral, proposé par Locke — le “ self ” —, rend compte d’un constant retour « expérimental ». Et cet espace s’ouvre sur l’espace extérieur des signes, « la cité, la vie, les autres », un processus par lequel le sujet anticipe le verbal (qui n’est que signe de signe), les relations mises alors en oeuvre dans la communication sociale, ce que Locke nomme dans le Second Treatise, “ civil society ” précisément, étant la résultante de la “ person ”[55]. Comme l’écrit Balibar, « c’est sur cette nouvelle limite […] de l’intérieur mental et de l’extérieur social et verbal que le sujet lockien (ou la « personne ») découvre la possibilité d’observer en lui-même les conditions de la vérité première de ses connaissances […] et celle de travailler à leur progrès[56] ».
Pour nous, cela veut dire que la topique est simplement fausse, une illusion, et que la rhétorique comme moyen de construction de l’espace public est illusoire. Cela veut aussi dire que Locke a étendu le modèle de la communauté expérimentale à la communication sociale en général. La “ civil society ” se construit a-rhétoriquement, dans un espace public formé de personnes et non pas de personae oratoires.
Ma question, en concluant, sera donc celle-ci : sur le socle du XVIIe siècle, est-il possible de penser une histoire des espaces de délibération qui tienne compte des tensions que j’ai brièvement esquissées ici, de l’/ espace rhétorique / comme le lieu de formation du sujet, et qui replace la chose littéraire fermement dans une écologie de la persuasion civile ?
Appendices
Note biographique
Philippe-Joseph Salazar
Philippe-Joseph Salazar enseigne la rhétorique à la Distinguished Chair in Humane Letters, université de Cape Town, et au Collège international de philosophie, Paris. Il est le président de l’Association for Rhetoric and Communication en Afrique du Sud. Il a publié, entre autres, des études sur la “ queer rhetoric ” (dans Thomas O. Sloane (éd.), Encyclopedia of Rhetoric, Oxford, Oxford University Press, 2001), la philosophie de la rhétorique (Entames rhétoriques, Paris, Collège international de philosophie, vol. LVI, 2001 ; La divine sceptique. Éthique et rhétorique, Tübingen, Gunter Narr Verlag, 2000 ; avec Marc Fumaroli et Emmanuel Bury (éds.), Le loisir lettré à l’âge classique, Genève, Librairie Droz, 1996), la rhétorique politique (Afrique du Sud. La révolution fraternelle, Paris, Hermann, 1998 ; An African Athens. The Rhetorical Shaping of Democracy in South Africa, Londres, Erlbaum, sous presses ; “ Nelson Mandela ou l’éthique oratoire ”, dans François Cornilliat et Richard Lockwood (éds.), Ethos et pathos. Le statut du sujet rhétorique, Paris, Librairie Honoré Champion, 2000), la rhétorique et l’oralité (Le culte de la voix au XVIIe siècle, Paris, Librairie Honoré Champion, 1995), et l’éloquence religieuse (éditeur d’Afrique du Sud. Institution de la parole, Paris, Presses universitaires de France, 1997). À paraître : Christus Orator. The Rhetorical Papacy and the Making of World Affairs et Le grand serment, Paris, Éditions du Seuil (L’ordre philosophique).
Notes
-
[1]
Aristote, Topiques, 1967, I, 100a. Cet essai est en partie le résultat d’une recherche sur le fonctionnement de l’autonomie intellectuelle au XVIIe siècle, conduite grâce à une subvention de la National Research Foundation d’Afrique du Sud (International Science Liaison).
-
[2]
George Alexander Kennedy, On Rhetoric : a Theory of Civic Discourse, 1991, p. 320.
-
[3]
Un débat eut lieu en 2000, dans les pages à Rebonds de Libération, faisant subir au Ministère, coupable d’avoir proposé, en septembre 1999, d’introduire la rhétorique en classes du secondaire, une philippique de la part de ceux que je nomme les Jansénistes de la Laïcité, lesquels accusent le premier d’ajouter au capital culturel des nantis l’arme de la rhétorique — le blâme et la censure sans morale. Hélène Merlin, dans un article brillamment mené, plaide pour cette thèse perversement pascalienne et, pour dire bref, platonicienne. Le Ministère est accusé d’être gorgianesque quand il n’est qu’aristotélicien.
-
[4]
Barbara Cassin, L’effet sophistique, 1995, p. 235.
-
[5]
Aristote, Premiers analytiques, L. II, ch. 27.
-
[6]
Ainsi Benjamin Barber, Strong Democracy : Participatory Politics for a New Age, 1984.
-
[7]
Voir Robert L. Ivie, “ Democratic Deliberation in a Rhetorical Republic ”, 1998.
-
[8]
Giulio Camillo Delminio, L’idée du théâtre, 2001.
-
[9]
Quintilien, Institution oratoire, L. XI, ch. 2.
-
[10]
Cicéron, De l’orateur, L. II, ch. 86.
-
[11]
Ignace de Loyola, Exercices spirituels, n° 138.
-
[12]
Ibid., 3e prélude.
-
[13]
Ibid., n° 139-146.
-
[14]
Ibid., n° 148.
-
[15]
Voir Philippe-Joseph Salazar, « “ Je le déclare nettement. ” La Bruyère orateur », 1991.
-
[16]
Voir Philippe-Joseph Salazar, « Scepticisme et sophistique chez La Bruyère et La Mothe Le Vayer », 1997.
-
[17]
Voir François Cornilliat et Richard Lockwood (éds.), Éthos et pathos, 2000.
-
[18]
Aristote, Rhétorique, 1991, L. I, ch. 2, 21 et L. II, ch. 26, 1. Il existe ainsi des lieux généraux, des lieux propres au judiciaire, des lieux mieux adaptés à l’épidictique, des lieux plus politiques, délibératifs. Mais ce sont là des détails de l’ars rhetorica. Chez Aristote, pour monter des enthymèmes et — donner la conclusion (ce que je vous dis qui est) — pour faire semblant d’en trouver les prémisses, afin que mon discours, au fil des endoxa vous paraisse agissant, il existe ainsi vingt-huit topoi (ibid., L. II, ch. 23) et neuf topoi fallacieux (ibid., L. II, ch. 24), qui s’ajoutent aux idia (et non pas topoi) spécifiques au genre politique (délibératif) (ibid., L. I, ch. 4). Dans les Topiques, L. I, ch. 14, Aristote distingue trois classes de propositions : éthiques, physiques, logiques. Ici, pour la rhétorique, l’éthique s’identifie au politique, bref au maniement des endoxa qui sont d’utilité publique. Les idia politiques (ibid., L. I, ch. 4-8) sont des trucs du genre « Mes chers compatriotes », les idia éthiques des resucées sur le bonheur, dans le démonstratif, (ibid., L. I, ch. 9), il s’agit de blâmer ou de louer, (ibid., L. I, ch. 10-11), et dans le judiciaire, il s’agit de savoir comment identifier un criminel.
-
[19]
Voir Aristote, Métaphysique, L. IX sur les deux types d’energeiai, kineseis et energeia).
-
[20]
Aristote, Poétique, op. cit., ch. 22.
-
[21]
Aristote, Rhétorique, op. cit., L. II, ch. 21, 15.
-
[22]
Aristote, Poétique, op. cit., ch. 6, 16-20.
-
[23]
Voir Philippe-Joseph Salazar, « La Divine Sceptique ». Éthique et rhétorique au XVIIe siècle, 2000.
-
[24]
Francis Bacon, Novum organum, 1952, p. 40-44.
-
[25]
Philippe-Joseph Salazar, « La Divine Sceptique », op. cit., ch. 1 et 2.
-
[26]
Steven Shapin, A Social History of Truth, 1994.
-
[27]
Franco Mormando, The Preacher’s Demons. Bernandino of Siena and the Social Underworld of Early Renaissance, 1999.
-
[28]
Saint Thomas d’Aquin, Summa theologiae, 1941, III, question 65, a2 et 2a-2ae, question 185, a1.
-
[29]
Voir Philippe-Joseph Salazar, “ The Rhetorical Papacy ”, en préparation.
-
[30]
Isaie, 58, 1, dans La Bible, traduction oecuménique, 1997.
-
[31]
Aristote, Premiers analytiques, op. cit, L. II, ch. 22-27.
-
[32]
Exemple : A est mauvais, B est faire la guerre contre ses voisins, C Athènes contre Thèbes, D Thèbes contre Phocée. Si on veut démontrer que se battre contre Thèbes est A (mauvais), il faut admettre que B est A ; on recours alors à l’exemple, par similarité, que D est A ; donc puisque B est A et se battre contre Thèbes est B, faire B est A. Dans cet exemple, B appartient à C et D, et A à D, mais que A relève de B est seulement prouvé par D.
-
[33]
Chaïm Perelman, L’empire rhétorique, 1997, p. 119-126.
-
[34]
Aristote, Rhétorique, op. cit., L. II, ch. 20, 9.
-
[35]
Id.
-
[36]
Les citations sont tirées de Steven Shapin, A Social History of Truth, op. cit., p. 199.
-
[37]
Francis Bacon, Advancement of Learning, 1952, vol. II, p. 16.
-
[38]
Ibid., vol. II, p. 17.
-
[39]
Ibid., vol. II, p. 18.
-
[40]
Id.
-
[41]
Id.
-
[42]
Patrick Dandrey, Molière et la maladie imaginaire, 1998, vol. II, p. 340-344.
-
[43]
Thomas M. Conley, Rhetoric in the European Tradition, 1994.
-
[44]
John Locke, An Essay Concerning Human Understanding, 1952, L. IV, ch. 17, § 4.
-
[45]
Ibid., L. IV, ch. 17, § 19.
-
[46]
Ibid., L. IV, ch. 18.
-
[47]
Ibid., L. IV, ch. 18, § 12.
-
[48]
Ibid., L. IV, ch. 18, § 19.
-
[49]
C’est-à-dire un argument par lequel mon adversaire retourne contre moi mon propre raisonnement, est paradoxalement « mon orateur ».
-
[50]
John Locke, An Essay Concerning Human Understanding, op. cit., L. IV, ch. 17, § 20-22.
-
[51]
John Locke, A Letter Concerning Toleration, 1993, p. 425.
-
[52]
John Locke, Second Treatise of Government, 1993 [1681], p. 1690.
-
[53]
John Locke, An Essay Concerning Human Understanding, op. cit., L. I, ch. 3, § 4 et L. II, ch. 27, § 9. Voir l’édition d’Étienne Balibar de John Locke, Identité et différence, 1998.
-
[54]
John Locke, An Essay Concerning Human Understanding, op. cit., L. II, ch. 27, § 10.
-
[55]
John Locke, Second Treatise of Government, op. cit., ch. 7, « Of Political Power on Civil Society ».
-
[56]
Étienne Balibar, « Introduction », dans John Locke, Identité et différence, op. cit., p. 92-93.
Références
- Aristote, Rhetoric, Oxford, Oxford University Press, 1991 (éd. de G. A. Kennedy).
- — — —, Topiques, Paris, Société d’Édition « Les Belles Lettres », 1967, 2 vol. (éd. de J. Brunschwig).
- Bacon, Francis, Advancement of Learning, Chicago, The University of Chicago Press, 1952, 2 vol.
- — — —, Novum organum, Chicago, The University of Chicago Press, 1952.
- Barber, Benjamin, Strong Democracy : Participatory Politics for a New Age, Berkeley, University of California Press, 1984.
- Cassin, Barbara, L’effet sophistique, Paris, Gallimard, 1995.
- Conley, Thomas M., Rhetoric in the European Tradition, Chicago, The University of Chicago Press, 1994 [1990].
- Cornilliat, François et Richard Lockwood (éds.), Éthos et pathos, Paris, Librairie Honoré Champion, 2000.
- Dandrey, Patrick, Molière et la maladie imaginaire, Paris, Éditons Klincksieck, 2 vol., 1998.
- Delminio, Giulio Camillo, L’idée du théâtre, Paris, Allia, 2001.
- Garver, Eugene, Aristotle’s Rhetoric, Chicago, The University of Chicago Press, 1994.
- Ignace de Loyola, Exercices spirituels (texte définitif, 1548), Paris, Éditions du Seuil (Points / Sagesse), 1982 (éd. de J.-C. Guy).
- Ivie, Robert L., “ Democratic Deliberation in a Rhetorical Republic ”, Quarterly Journal of Speech, vol. LXXIV, n° 4 (1998), p. 491-530.
- La Bible, traduction oecuménique, Paris, Éditions du Cerf — Société biblique française, 1997.
- Locke, John, A Letter Concerning Toleration, dans Political Writings, Londres, Penguin, 1993 (éd. de D. Wootton).
- — — —, An Essay Concerning Human Understanding, Chicago, The University of Chicago Press, 1952 (éd. d’A. Campbell Fraser).
- — — —, Identité et différence, Paris, Éditions du Seuil (Essais), 1998 (éd. d’É. Balibar).
- — — —, Second Treatise of Government, dans Political Writings, Londres, Penguin, 1993 (éd. de D. Wootton).
- Mormando, Franco, The Preacher’s Demons. Bernardino of Siena and the Social Underworld ofEarly Renaissance, Chicago, The University of Chicago Press, 1999.
- Perelman, Chaïm, L’empire rhétorique, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 1997 [1977].
- Quintilien, Institution oratoire, Paris, Société d’édition « Les Belles Lettres », 1975, 7 vol. (éd. et trad. de J. Cousin).
- Salazar, Philippe-Joseph, « “ Je le déclare nettement ”. La Bruyère orateur », L’infini, n° 35 (1991), p. 105-116.
- — — —, « La Divine Sceptique ». Éthique et rhétorique au XVIIe siècle, Tübingen, Gunter Narr Verlag (Études littéraires françaises), 2000.
- — — —, « Scepticisme et sophistique chez La Bruyère et La Mothe Le Vayer », dans Benedetta Papàsogli et al. (éds.), Il prisma dei moralisti, Rome, Salerno Editore, 1997, p. 397-406.
- — — —, « Christus orator. The Rhetorical Papacy », Journal for the Study of Religion, vol. XV, n° 1 (2002), sous presses.
- Shapin, Steven, A Social History of Truth, Chicago, University of Chicago Press, 1994.
- Thomas d’Aquin, Summa theologiae, Montréal, Université de Montréal, 1941 (éd. du Collège dominicain d’Ottawa).