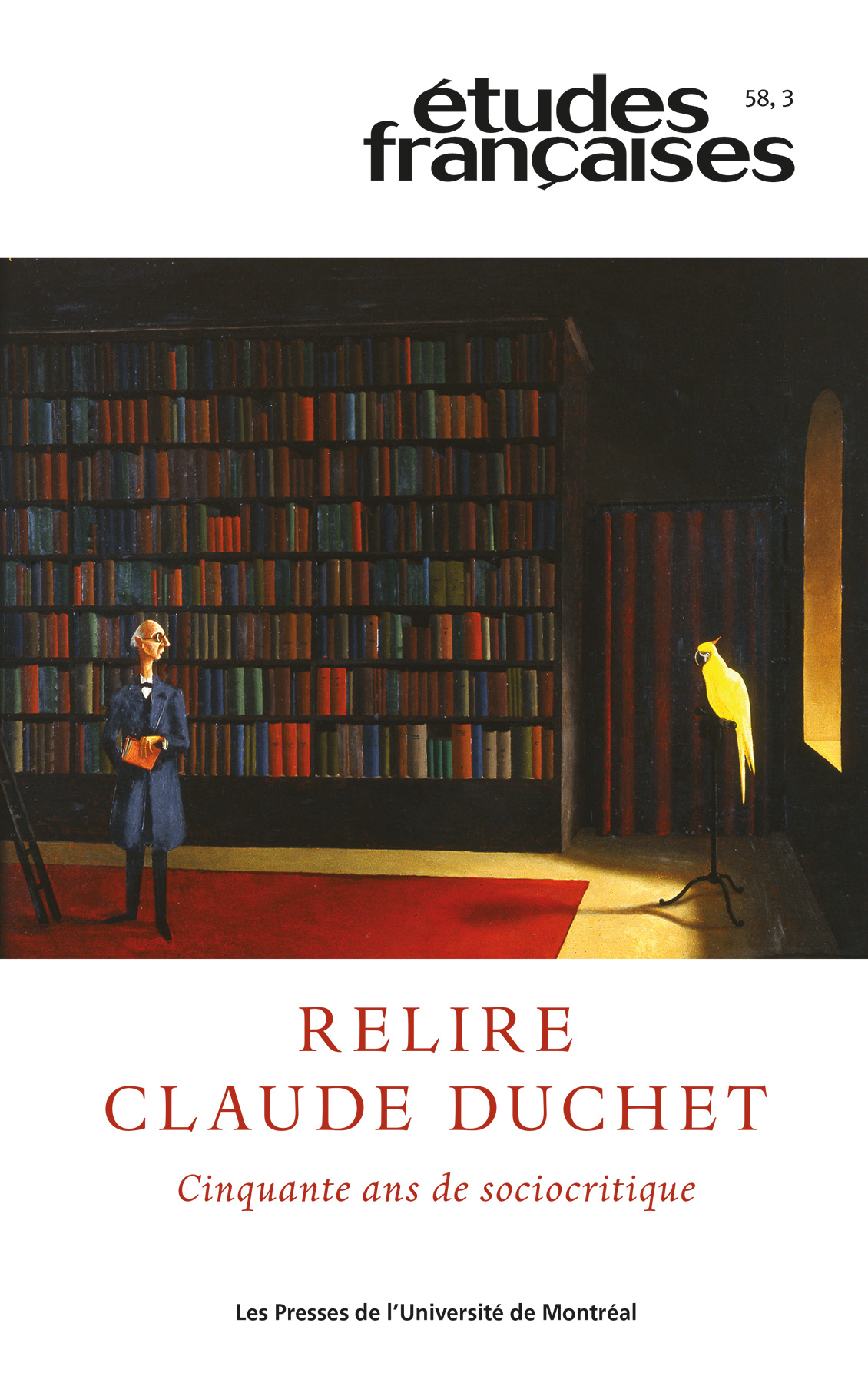Abstracts
Résumé
L’article réfléchit à une définition opératoire de la notion d’historicité pour la sociocritique à partir d’un exemple concret : Vanina Vanini (1829), première nouvelle publiée par Stendhal. Il part des réticences de Claude Duchet, qui semble presque substituer à la notion d’historicité celle de cotexte, soit l’envisager comme une question de « représentations ». Nous suggérons qu’on gagne toutefois à ne pas réduire cette notion à un « problème de représentations ». L’argument se développe en trois temps. Nous montrons d’abord que l’historicité passe par le tissage des référents et des références, autrement dit la manière dont le texte présente sa situation historique : Vanina Vanini est lu cotextuellement comme un texte affichant un fort effet d’actualité tout en étant travaillé de références parfaitement inactuelles (La princesse de Clèves). L’historicisation du récit par cotextualisation découvre des temporalités multiples, non synchrones. Nous élargissons ensuite la notion d’historicité à une prise en compte de la manière dont le texte prend non seulement place mais sens dans l’Histoire, par l’articulation de son discours propre (sa « valeur » au sens sociocritique) aux enjeux historiques de son moment d’émergence : Vanina Vanini, texte du blocage historique, montre un Stendhal sceptique sur les chances d’évolution libérale, à court terme, de l’Italie. Nous suggérons enfin la nécessaire prise en compte des supports matériels de l’oeuvre comme composante essentielle de son historicité. À partir d’une macro-génétique de l’oeuvre stendhalienne, nous étudions les effets de sens induits par les supports et dispositifs médiatiques et éditoriaux de la nouvelle.
Abstract
This article offers reflections on an operational definition of the notion of historicity for sociocriticism, based on a concrete example: Vanina Vanini (1829), the first short story published by Stendhal. It starts from the reticence of Claude Duchet, who seems almost to substitute for the notion of historicity that of cotext, hence, to envisage it as a question of “representation.” We suggest that it is better to avoid reducing this notion to a “problem of representation.” The argument develops in three stages. First, we demonstrate that historicity comes from the interweaving of referents and references, in other words, the way the text presents its historical situation: Vanina Vanini is read cotextually as a text displaying a strong sense of contemporaneity, while in fact being wrought from references that are not contemporary at all (La princesse de Clèves). The historicization of the narrative by cotextualization uncovers multiple asynchronous timeframes. We then broaden the notion of historicity to consider the way the text not only takes its place but also its meaning from History, by articulating its own discourse (its “value” in sociocritical terms) according to the historical stakes of its moment of emergence: Vanina Vanini, a text about a historical blockage, shows Stendhal’s scepticism about the chances of a liberal evolution in Italy in the near future. Finally, we suggest the necessity of taking into account the physical medium of the published work as an essential component of its historicity. Taking a macro-genetic approach to the Stendhalian work, we study the effects of meaning induced by the medium as well as the media-based and editorial devices of the short story.
Article body
Pour la sociocritique, l’historicité est à la fois une évidence et un angle mort. Évidence parce que pour elle tout texte est situé, porte sa date, prend sens relativement à son moment, qu’il le veuille ou non, qu’il le revendique ou au contraire le dénie. Mais aussi angle mort en raison même de cette évidence, qui fait que la notion n’a pas été totalement théorisée. Deux indices en témoignent. Le lexique « Socius »[1] ne compte pas d’entrée « historicité » et, surtout, dans les « Nouveaux entretiens sur la sociocritique », Claude Duchet n’emploie la notion qu’avec réticence, lui substituant presque celle de « cotexte » : « Pour l’historicité, j’attendais la réponse des historiens. Je croyais que ça équivalait à la notion de cotexte. […] L’historicité d’un phénomène, c’est ce qu’il faut lire en même temps avec, le fait qu’il n’est pas seul, isolé, qu’il était le produit d’un moment dont il fallait tenir tous les paramètres[2]. » On aura reconnu la reprise presque textuelle de la définition du cotexte[3]. Les notions de cotexte et de sociogramme ont pris la place de celle d’historicité. Cela situe l’historicité ainsi entendue dans ce qui a trait aux représentations, car cotexte et sociogramme sont des outils d’appréhension et d’organisation des représentations[4]. Claude Duchet le dit en toutes lettres dans ces mêmes entretiens : « L’historicité est un problème de représentations[5]. » Or il me semble que, si l’on veut faire de l’historicité un outil opératoire pour la sociocritique, on gagne à ne pas la réduire aux seules représentations. C’est ce que je voudrais suggérer ici. La question se pose d’autant plus si l’on suit la suggestion de Patrick Maurus de voir dans l’histoire même de la sociocritique sur ces cinquante dernières années « le passage [d’une] première topique (socialité) à [une] seconde (historicité)[6] ».
On réfléchira à partir d’un exemple concret : celui de Vanina Vanini, qui a cette particularité d’être la première nouvelle publiée par Stendhal, en 1829[7]. Tout l’enjeu est de savoir si l’historicité se réduit à une simple historicisation. La nouvelle, on s’en souvient, voit la jeune princesse romaine Vanina Vanini tomber amoureuse d’un carbonaro échappé des prisons papales : Missirilli, qui a trouvé refuge au palais Vanini. L’amour naît instantanément entre ce jeune homme de mérite et l’éruptive Vanina, qui en vient à soutenir les entreprises carbonaristes dirigées par Missirilli. Lorsque celui-ci refuse le mariage que lui propose Vanina, elle comprend que l’amour de la patrie prime chez lui sur tout autre amour. Elle dénonce alors la « vente » (le groupe de carbonari) au cardinal-légat : Missirilli se livre à la police pour ne pas être soupçonné de trahison par ses camarades. Vanina fait jouer ses relations pour libérer son amant, qu’elle rencontre une dernière fois dans la chapelle de la prison. Blessée par l’accueil glacial que lui réserve Missirilli, plus que jamais habité par son engagement politique, elle lui révèle sa trahison. Furieux et horrifié, Missirilli rejette inexorablement celle qu’il considère désormais comme un monstre. Vanina, par dépit, épouse don Livio Savelli, fade et médiocre prince romain, antithèse parfaite de l’héroïque carbonaro.
Temps du référent, temps des références
Un premier mode de rapport au temps, d’inscription dans l’histoire, passe par les deux premiers paliers de la triade sociocritique « information / indice / valeur »[8], autrement dit par le jeu du référent et des références[9], soit encore la manière dont le texte présente sa situation historique. En l’occurrence, Vanina Vanini s’affiche expressément comme un texte du contemporain, repose sur un effet d’actualité immédiate. Le titre complet, Vanina Vanini, ou particularités sur la dernière vente de carbonari découverte dans les États du pape[10], ainsi que la phrase d’ouverture, qui littéralement prend date (« C’était un soir du printemps de 182* » ; VV, 247), indiquent que le texte enregistre directement l’actualité de son moment d’énonciation. La nouvelle revendique donc l’Histoire comme l’un des cadres d’intelligibilité du récit. « Dernière » dans le titre s’entend comme un déictique désignant la découverte de la vente comme la plus récente en date relativement au présent de l’énonciation. Le présent est le temps auquel s’écrit la clausule qui cite en outre un « journal », dont Vanina Vanini se fait ainsi l’écho direct : « Vanina resta anéantie. Elle revint à Rome ; et le journal annonce qu’elle vient d’épouser le prince don Livio Savelli » (VV, 269). Comme à la fin de Madame Bovary, l’énoncé rejoint l’énonciation pour signifier leur essentielle contemporanéité. Ces éléments correspondent on ne peut mieux à la définition du genre de la nouvelle qui, étymologiquement, se rapporte à ce qui est nouveau, aux « dernières nouvelles » au sens quasi journalistique de l’expression. Michel Crouzet a montré que le titre reprend (parodie ?) ceux de la tradition des récits tragiques laissant attendre des révélations, des faits inédits à propos d’affaires connues et médiatisées[11].
Vanina Vanini est le contraire d’un hapax. L’effet d’actualité de la nouvelle tient non seulement aux jeux de datation, mais aussi au fait que le référent carbonari, donc conspiration, est un thème à la mode en 1829. La nouvelle se lit avec un cotexte proliférant. Le Rouge et le Noir, composé au même moment, évoque dans le célèbre épisode de la « Note secrète » une conspiration ultra, cette fois, et non plus libérale : il reprend l’idée dont bruissent les journaux de l’année 1829 d’une « camarilla » secrète oeuvrant en sous-main pour radicaliser un gouvernement Polignac déjà passablement réactionnaire[12]. Plus largement, la conspiration est une des topiques de la littérature de la Restauration et l’un des éléments clés de son imaginaire social, comme l’ont montré Jean-Noël Tardy et Gilles Malandain[13] : qu’on songe, parmi d’autres exemples, à Cinq-Mars ou une conjuration sous Louis XIII d’Alfred de Vigny (1826) ou aux Soirées de Neuilly. Esquisses dramatiques et historiques d’Adolphe Dittmer et Hygin-Auguste Cavé (1827-1828) dans lesquelles on trouve un Malet ou une conspiration sous l’Empire et Une conspiration de province ; sans oublier qu’on réédite en 1820, 1821, 1824 et 1829 les Conjurations de César Vichard de Saint-Réal. Charles Nodier écrit pour sa part en 1830 : « [I]l n’y a rien de plus extraordinaire et de plus digne d’attention dans l’histoire de l’esprit humain, que l’idéal psychologique d’un conspirateur complet[14]. »
Dans Vanina Vanini la thématisation de la prison, la scénographie du nocturne et du secret, le jeu récurrent des travestissements (Missirilli en jeune femme, Vanina en jeune homme), la fréquence des objets (argent et armes notamment), plus grande qu’habituellement chez Stendhal, sont autant de manières de déplier le topos et de le traduire poétiquement, et, pour tout dire, sur un mode assez mélodramatique. Elles seraient toutes susceptibles d’éclairages cotextuels immédiats dans la littérature et le discours social du temps. Les détails du procès des carbonari sont ainsi directement empruntés au Constitutionnel des 12 et 28 octobre 1829[15]. Les références du récit, plus encore que son référent, l’inscrivent dans un moment parfaitement identifiable dont, littéralement, il porte la trace. On tient là une première historicisation du récit qui repose sur deux éléments convergents : l’ancrage revendiqué du récit comme de son énonciation dans une chronologie historique jouant fortement d’un effet de contemporanéité ; une densité cotextuelle qui inscrit la nouvelle dans l’air du temps et implique pour le lecteur de 1829 un immédiat sentiment de reconnaissance.
Le cotexte de la nouvelle se déplace toutefois, ou s’enrichit, si l’on considère que son incipit est travaillé par une tout autre référence, implicite, mais bien active et, cette fois, parfaitement inactuelle : La princesse de Clèves, que l’ouverture de Vanina Vanini réécrit avec des échos textuels presque littéraux. La scène inaugurale du bal se tient dans un palais embelli de « [t]out ce que les arts de l’Italie, tout ce que le luxe de Paris et de Londres peuvent produire de plus magnifique », peuplé de « beautés blondes […] de la noble Angleterre » et des « plus belles femmes de Rome », entourées de « princes » comparés à des « rois », au point que tous sont « frappés de la magnificence de ce bal » (VV, 247). Ces « belles femmes », courtisées par des « Anglais fort beaux et fort nobles », comme par le prince Savelli, « le jeune homme le plus brillant de Rome » (VV, 248), semblent un pastiche de Mme de Lafayette affirmant : « Jamais Cour n’a eu tant de belles personnes et d’hommes admirablement bien faits, et il semblait que la nature eût pris plaisir à placer ce qu’elle donne de plus beau dans les plus grandes Princesses, et dans les plus grands Princes[16]. » La co-occurrence « magnifique » / « magnificence » à quelques lignes de distance (VV, 247) fait signe vers l’incipit célébrissime de La princesse de Clèves, ici délocalisé à Rome : « La magnificence et la galanterie n’ont jamais paru en France avec tant d’éclat, que dans les dernières années du règne de Henri second[17]. » Ajoutons que l’entrée de Vanina est littéralement une apparition. La jeune princesse se détache de la foule ; son « éclat » la fait proclamer « la reine du bal » que « tous les regards suivirent » (VV, 247). Nouvel écho, cette fois à l’entrée de la princesse de Clèves ainsi décrite : « Il parut alors une beauté à la Cour, qui attira les yeux de tout le monde, et l’on doit croire que c’était une beauté parfaite, puisqu’elle donna de l’admiration dans un lieu où l’on était si accoutumé à voir de belles personnes[18]. »
La référence-révérence à un roman que Stendhal s’est déjà donné pour modèle dans Armance[19] et qu’il qualifie de « trop anciennement à la mode[20] » joue à contretemps. Lire Vanina Vanini depuis et avec La princesse de Clèves, c’est penser la nouvelle dans un régime référenciel à la mémoire beaucoup plus longue que celui des allusions à l’actualité carbonariste et conspirationniste de la Restauration, et inscrire la nouvelle fondée, on l’a vu, sur un effet d’actualité immédiate, dans une tradition romanesque au long cours qu’inaugure Mme de Lafayette. La référence tire la nouvelle en arrière, la déboîte d’une chronologie de l’actuel ou, plus exactement, creuse une profondeur littéraire et mémorielle que n’impliquait pas le cotexte plus immédiat de la nouvelle.
L’historicisation du récit par cotextualisation découvre ainsi d’emblée des temporalités non synchrones, aux scansions et aux rythmes multiples et potentiellement conflictuels. Autrement dit, Vanina Vanini est tout aussi inactuelle qu’actuelle, elle dit la mode avec des modèles démodés ou, pour le dire avec une formule d’Isabelle Tournier, elle « a des contemporaines diverses[21] ». À s’en tenir là, toutefois, on limiterait l’historicité à une simple historicisation (par reconstitution des référents et des références du texte) et l’on conclurait que l’historicité équivaudrait à la notion de cotexte.
Historicité et valeur : le temps de la textualisation
Une première manière d’élargir la définition de l’historicité consiste à tenir compte non seulement de la manière dont un texte prend place dans l’histoire (ce qu’on vient en partie d’envisager), mais aussi prend sens dans l’histoire, c’est-à-dire envisager comment, à partir du référent et des références qu’il mobilise, il produit un discours particulier sur cette histoire. C’est articuler la notion d’historicité à celle de « valeur » au sens sociocritique, celui d’une singularité systématique[22]. C’est toujours rester au plan des représentations mais en mettant l’accent sur une position historique non au sens de simple situation, mais de prise de position, prise de parti, plus ou moins explicite – soit envisager le texte relativement à ce que Michèle Riot-Sarcey appelle le « processus de fabrique de l’histoire dans l’expérience conflictuelle des interprétations d’où émerge le sens commun[23] » d’un moment donné. Autrement dit, assumer la sociocritique comme herméneutique, donner son sens fort au « critique » de « sociocritique » et concevoir l’oeuvre comme lieu d’un travail des valeurs, s’il est vrai, comme Balzac le dit, que faire oeuvre revient à prendre « une décision quelconque sur les choses humaines[24] ». Pour quelle « décision » la nouvelle Vanina Vanini témoigne-t-elle ?
Cette interrogation est d’autant plus légitime que la nouvelle se donne un propos directement politique avec la mise en scène de la conspiration des carbonari. Lire la nouvelle sous cet angle, consiste à penser le discours stendhalien sur l’évolution politique du « xixe siècle » et les chances d’une révolution libérale, invite à apprécier les effets idéologiques de la fiction dans un moment où l’effervescence libérale saisit l’Europe, depuis les mouvements insurrectionnels de 1820-1821 en Espagne, à Naples, dans le Piémont, jusqu’à l’insurrection des « décabristes » en Russie en 1825, en passant par les tentatives de la charbonnerie française avec notamment l’affaire des quatre sergents de La Rochelle et leur procès en 1822[25]. Stendhal y est tout particulièrement attentif et ne cesse d’évoquer ces diverses insurrections, lui, le libéral qui, en 1821, dut quitter précipitamment Milan où il était surveillé par la police autrichienne parce que suspect de fréquentations carbonaristes.
Ce régime propre de la fiction, que j’appellerai le temps de la textualisation, conduit dans Vanina Vanini à une pensée pessimiste de l’Histoire. Cette dernière traduit les interrogations d’un Stendhal qui, en 1829, semble avoir perdu espoir en une révolution possible[26]. Trois éléments majeurs le suggèrent.
D’abord la construction même d’un héros « fort peu héros », pour reprendre la formule de La chartreuse de Parme[27]. De fait, Missirilli n’est présenté que comme un personnage empêché et hésitant. Il incarne les aléas d’un héroïsme inabouti. Je n’en donnerai qu’un indice. Du fort Saint-Ange dont il s’échappe à la prison de San Leo à laquelle il est promis en passant par celle de Città Castellana, mais aussi la chambre du palais Vanini dans laquelle il se réfugie, le parcours de Missirilli n’est qu’un chemin de croix carcéral, et Vanina Vanini pourrait être sous-titré « D’une prison l’autre ». Missirilli est essentiellement un être de l’inaction, de l’immobilité. On ne le voit que blessé et enfermé, toujours entravé, jusqu’à ce portrait saisissant qui le peint « emmailloté » de « chaînes froides et pointues » (VV, 267) : l’espace de la prison ne cesse de se resserrer autour de lui. Et, outre sa dévirilisation au début du récit par son travestissement en femme, Missirilli reste un peu trop proche du type du brigand – par le côté très romanesque de la nouvelle : évasions, coups de pistolet, déguisements, etc. – pour être crédible en véritable héros de l’engagement, en figure possible d’un nouveau choix politique. Il est l’illustration fictionnelle de ce jugement porté dans Souvenirs d’égotisme : « [J]e n’ai jamais rien connu de plus poétique et de plus absurde que le libéral italien ou carbonaro qui, de 1821 à 1830, remplissait les salons libéraux de Paris[28]. » Le personnage, comme celui d’Altamira dans Le Rouge et le Noir qui en est un nouvel avatar[29], est renvoyé à une immaturité politique, à ce que Giono nommera dans Angelo, qui peint aussi les milieux carbonaristes, une « politique romanesque[30] », soit le contraire d’une politique.
Ensuite, deuxième élément marquant du temps de la textualisation, la logique récursive de la nouvelle. Malgré l’impression d’un récit tendu, qui semble aller de l’avant, avoir un allant lié aux effets de vitesse stendhalienne, Vanina Vanini est en réalité un texte de la répétition, voire du surplace[31]. Son titre le suggère : le personnage éponyme frappe par la paronymie du prénom et du nom, comme si la nouvelle s’écrivait à l’enseigne d’un bégaiement inaugural. L’explicit conduit à la même conclusion. Qu’y voit-on en effet ? Vanina épouser le parfait mais insignifiant prince Livio Savelli. Ce faisant, elle réalise très exactement le voeu de son père, exposé au début de la nouvelle. Et l’on s’avise alors que son prénom, Vanina, n’est guère que la duplication du patronyme, du nom du père, Vanini. Le récit se clôt sur un mariage, qui est le contraire d’une fin de conte de fées. Vanina rentre dans le rang. Elle épouse bien in fine celui à qui elle était depuis le début destinée, et se conforme ainsi à la loi du père, figurant une norme sociale prégnante bien difficile à faire évoluer. Celle qui rêvait de gloire et d’aventures extraordinaires fait bien la une des journaux, non pas à la rubrique des faits divers passionnels ou des actions d’éclat, mais tout simplement à celle de la chronique mondaine, des avis de mariage d’une société de bon ton. Bien sûr, ce sort est parfaitement tragique : Vanina a délibérément consenti à ce mariage qui ressemble à une forme adoucie de suicide. Cette fin n’ouvre aucun horizon, et douche tous les espoirs d’une libération quelconque, personnelle comme collective. Au point que l’adjectif « dernière » dans le sous-titre (Particularités sur la dernière vente de carbonari) s’entend alors non plus comme un déictique désignant une série ouverte appelée à se compléter – la dernière en date, avant celle qui viendra la remplacer –, mais plutôt au sens d’ultime, soit d’une série définitivement close.
Enfin, cette histoire politique de carbonarisme est donnée à lire depuis un cadre psychologique qui privilégie une logique essentialiste de lois atemporelles de l’amour et contribue à déshistoriciser le propos. La référence implicite à La princesse de Clèves, parangon du roman d’analyse psychologique, le laissait déjà entendre. Mais une référence, explicite, elle, au De l’amour que Stendhal publie en 1822, le confirme. La fiction reprend les catégories analytiques mises en place dans le traité en évoquant par exemple « les scrupules de l’amour-passion » (VV, 253) éprouvés par Missirilli, l’amour-passion étant, on s’en souvient, l’une des quatre formes d’amour définies dans le premier chapitre de De l’amour. De même, tout le rapport des personnages au carbonarisme, à l’engagement pour la patrie, est conçu sur le mode psychologique de l’attachement amoureux, donc de la jalousie qu’il peut susciter, quand Missirilli voit dans la patrie sa maîtresse, là où Vanina en fait sa rivale, dont elle se venge cruellement. La progression narrative de la nouvelle obéit bien plus à cette logique psychologique qu’à une causalité de type politique.
Ces éléments figuratifs et structurels font de Vanina Vanini le contraire d’un texte du progrès. Ils traduisent ainsi le scepticisme de Stendhal envers le carbonarisme en 1829 et les possibilités d’évolution libérale des sociétés européennes après les congrès de Vienne et de Vérone. Si cette évolution est assurément souhaitable pour Stendhal, elle se fera sur un temps long ; c’est ce que suggère Vanina Vanini[32], et ce que redira, d’une autre manière, la lettre du 28 avril 1831 au comte Sébastiani : « Les Romains, que je connais depuis vingt ans, sont loin d’être mûrs pour une charte et pour l’ordre légal[33]. »
Le temps spécifique de la textualisation, prenant appui sur un référent et des références politiques, conduit paradoxalement à repousser le politique dans un horizon lointain pour faire de Vanina Vanini un texte du blocage historique. Cette pensée de l’Histoire, produite par le texte et dérivant d’un diagnostic aigu et conscient de la décennie qui vient de s’écouler, est une dimension essentielle de son historicité.
Le temps de l’oeuvre : historicité et support
Une dernière composante de l’historicité, qui n’apparaît pas dans l’analyse menée jusqu’ici, est celle qui est impliquée par les supports matériels de l’oeuvre. Elle a été, il faut le reconnaître, moins travaillée par la sociocritique[34], en tout cas moins que celle qui touche aux représentations. Elle induit pourtant une temporalité et des scansions spécifiques. Si le dialogue de la sociocritique avec la génétique s’est tôt instauré[35] – sans surprise car toutes deux s’intéressent à la mise en texte comme processus –, la prise en compte des logiques matérielles et médiatiques du support est restée en retrait, et assurée plutôt par des historiens du livre et de la lecture, tel Roger Chartier, qui n’a jamais directement dialogué avec la sociocritique et, du côté des littéraires, par des chercheurs qui sont à la fois très proches de et dans un écart revendiqué avec la sociocritique de Claude Duchet – précisément parce qu’elle privilégie les représentations et les idéologèmes. Nous pensons à Alain Vaillant qui, parti d’une approche bibliométrique, développe une poétique historique sensible aux logiques médiatiques et institutionnelles[36], ou à Marie-Ève Thérenty dont les travaux s’orientent spécifiquement vers une poétique historique du support et de l’énonciation éditoriale[37]. Or, si l’un des présupposés fondateurs de la sociocritique est que le texte est dans l’Histoire et de l’Histoire, on voit mal comment la prise en compte de l’historicité du texte pourrait faire abstraction des conditions matérielles de composition, de publication et de réception de l’objet livre (ou manuscrit), si l’on rappelle avec Roger Chartier que « les formes qui […] donnent à lire, à entendre ou à voir [les textes] participent, elles aussi, à la construction de leur signification[38] ».
C’est ce que je désignerai ici de la formule volontairement ambiguë de temps de l’oeuvre, entendant par oeuvre les réalisations matérielles diverses d’un texte dans son devenir éditorial et par « le temps de l’oeuvre » la manière dont ces réalisations matérielles s’inscrivent dans et sont conditionnées par des effets de champ (littéraire) qui ont des rythmes propres. Dans le cas de Vanina Vanini, l’enquête génétique tourne court, dans la mesure où l’on ne dispose pas du manuscrit. On peut néanmoins apprécier sa place dans une macro-génétique de l’oeuvre stendhalienne. La nouvelle est composée en 1829, en même temps que Le Rouge et le Noir, et conçue, semble-t-il, comme un travail préparatoire à la seconde partie du roman. Stendhal confiera en effet plus tard : « J’ai fait quelques plans de romans, par exemple Vanina ; mais faire un plan me glace[39]. » « Plan » : la critique a souvent noté les parallèles manifestes de Vanina Vanini à Le Rouge et le Noir. Pour les questions qui nous occupent, la nouvelle fait donc sens aussi relativement au roman, dans le moment d’invention du roman, ce que perdent ou minimisent toutes les éditions séparées de Vanina Vanini comme son inclusion problématique dans le volume (apocryphe) des Chroniques italiennes. Seule l’édition des Oeuvres romanesques complètes dans la « Bibliothèque de la Pléiade »[40] permet d’apprécier cette temporalité propre, macro-génétique, en ce qu’elle se fonde sur un principe de strict classement chronologique des oeuvres de fiction. Lue dans ce support éditorial, Vanina Vanini apparaît comme un jalon décisif dans le rapport de Stendhal à la fiction. Elle a valeur doublement inaugurale : première nouvelle / premier essai d’une nouvelle oeuvre, romanesque, à venir.
Cette valeur est confirmée si l’on observe le support matériel premier de la nouvelle. Elle est publiée dans la Revue de Paris le 13 décembre 1829. Ce sera sa seule modalité d’existence éditoriale anthume. Vanina Vanini fonctionne alors comme « billet d’entrée », pour reprendre une formule chère à son auteur, de Stendhal dans une revue toute jeune, fondée par Véron en avril 1829, marquée à gauche, soutien actif et lieu de diffusion majeur d’une littérature « romantique » qui, depuis le mitan des années 1820, tente de passer de la théorie à la pratique, et qui influe directement sur le cadastre des genres en favorisant l’essor de la nouvelle, adaptée par son format bref à ce support médiatique. Intervient un effet évident de groupe[41] qui se structure pour conquérir une visibilité dans le champ littéraire : dans ce tome IX de la Revue de Paris, Stendhal voisine ainsi avec Delécluze, Sainte-Beuve, Théodore Leclercq, Delatouche, Mérimée, auteurs avec lesquels il est par ailleurs en contact régulier au moins depuis 1825, notamment par le biais des soirées, libérales, du grenier de Delécluze. Vanina Vanini prend alors sens dans une stratégie de conquête de l’espace médiatique par le romantisme libéral sur une temporalité à la fois resserrée (celle de l’année 1829 avec la fondation d’un nouvel organe de presse) et à moyen terme (la décennie 1820 de « bataille » romantique).
À cette stratégie de structuration de groupe répond une stratégie individuelle, qui consiste pour Stendhal à trouver sa place et sa posture dans le groupe. En un mot, à se faire une signature. Vanina Vanini en est un jalon marquant, inaugural. La nouvelle est signée « Stendhal ». Le pseudonyme n’est certes pas nouveau. Mais « M. de Stendhal » a signé jusque-là des oeuvres non fictionnelles, essais ou pamphlets : Rome, Naples et Florence en 1817 (1817), Racine et Shakespeare (1823), Vie de Rossini (1824), Promenades dans Rome (1829)[42]. Et la mystification du premier roman, Armance (1827), qu’il s’agissait de faire passer pour un roman de Mme de Duras, empêchait de le signer « Stendhal ». Seul l’« Avant-propos » y est signé de ce nom : « Stendhal » s’y présentant non comme auteur, mais comme simple correcteur du roman. Avec la signature de Vanina Vanini, on voit très nettement la stratégie : il s’agit pour Stendhal d’investir le champ de la fiction, tout en capitalisant sur son image de marque de spécialiste ès choses italiennes, construite au fil de la décennie avec Rome, Naples et Florence, la Vie de Rossini et Promenades dans Rome. Il s’agit aussi d’investir un genre (la nouvelle) et un support (la revue) nouveaux qu’il n’a pas pratiqués jusqu’alors sous cette forme et dont il perçoit la mode mais aussi le potentiel[43]. Cette réorientation de la posture ou de la place dans le champ se confirme immédiatement avec la publication en quelques mois d’une série d’autres nouvelles dans la Revue de Paris, sur le même modèle de l’histoire passionnelle à coloration étrangère : Le coffre et le revenant, aventure espagnole (9 mai 1830), puis Le philtre, imité de l’italien de Silvia Valaperta (6 juin 1830), avant la publication de Le Rouge et le Noir fin 1830. Vanina Vanini marque donc la première pierre d’une stratégie que viendra bientôt casser net le départ pour l’Italie à la fin de 1830, qui éloigne Stendhal des cercles du romantisme libéral parisien et de ses organes médiatiques. Ce bref moment (fin 1829-fin 1830) qui vient cristalliser et réorienter une stratégie de conquête médiatique, construite progressivement sur la décennie, est une des dimensions centrales de l’historicité de Vanina Vanini envisagée depuis les logiques de champ.
Voilà précisément ce qu’efface l’inclusion de Vanina Vanini dans le recueil apocryphe et posthume des Chroniques italiennes, édité-inventé en 1855 par Romain Colomb chez Michel Lévy. Depuis, le titre s’est institutionnalisé comme l’insertion de Vanina Vanini, qui n’a guère eu d’existence éditoriale en dehors des éditions successives des Chroniques italiennes. Cette (re)configuration éditoriale a des conséquences immédiates sur l’historicité de l’oeuvre. Dans un tel environnement, Vanina Vanini se trouve totalement désancrée du moment 1829 et au contraire assimilée à des « chroniques » qui s’offrent expressément comme des traductions de chroniques judiciaires anciennes, de la fin du xvie siècle, dont le propos n’est plus politique mais plutôt moral selon le modèle de l’histoire tragique. La nouvelle se trouve comme tirée vers l’arrière, vers l’autrefois, et signifie dans une temporalité longue de confrontation des époques (des temps anciens énergiques présentés comme contre-épreuve d’un xixe siècle émollient). Dans ce cadre, ses contemporains ne sont plus les nouvelles de Mérimée, les essais de Sainte-Beuve ou les proverbes de Théodore Leclercq, comme dans la Revue de Paris, mais des manuscrits anciens anonymes délibérément ramenés à leur ancienneté, à leur in-actualité. La focale temporelle change du tout au tout et montre combien l’historicité de Vanina Vanini, à faire intervenir les supports de la nouvelle, son énonciation éditoriale, est chose mouvante, à multiples étages.
Que conclure ? Que l’historicité telle qu’on l’a envisagée est le contraire d’une historicisation uniforme et unidimensionnelle, du recensement de ce que j’appellerai le passif historique du texte. Elle agit sur le plan des représentations mais aussi des supports matériels et médiatiques de l’oeuvre. Elle est dans le croisement de focales et d’échelles diverses qui ont leur mémoire propre et des régimes de temporalité différents : l’historicité de Vanina Vanini conjugue le temps long de références littéraires qui la formatent (La princesse de Clèves, les histoires tragiques) à un temps court de l’actualité politique et médiatique, celui d’un carbonarisme symptôme des enjeux historiques d’un xixe siècle conçu comme temps de la crise, de l’évolution difficile d’un libéralisme qui peine à naître, et à une temporalité de moyen terme, celle d’une macro-génétique de l’oeuvre stendhalienne elle-même travaillée de rythmes multiples (l’année 1829 comme point de cristallisation et d’accélération d’une logique médiatique qui n’a de sens que rapportée à une échelle temporelle plus large, celle de l’usage d’une signature sur un peu plus d’une décennie, que vient reconfigurer encore l’histoire éditoriale ultérieure de la nouvelle). En l’espèce, dans le jeu conflictuel de ces régimes de temporalité, Vanina Vanini apparaît comme une oeuvre du paradoxe ou au moins de la tension : elle témoigne d’un fort effet d’actualité qui la ramène à sa date, 1829, et en même temps d’un aussi fort effet d’in-actualité, de désancrage de cette date qui la fait signifier à de tout autres échelles – une décennie, un siècle, une confrontation des siècles. L’historicité se construit alors non comme une simple identification-consignation des différents régimes de temporalité, mais dans l’interprétation de leur confrontation.
On dira donc, avec Claude Duchet, que « l’historicité est un processus, pas un état[44] », une dynamique, pas un donné. Par hypothèse et pour récapituler, on proposera la définition suivante, qu’on espère opératoire pour une sociocritique passée à sa seconde « topique », celle de l’historicité : l’historicité désigne la manière dont l’oeuvre prend place, sens et corps dans l’Histoire. Elle n’est pas une simple historicisation et n’est pas réductible au cotexte. Elle est une résultante, c’est-à-dire le résultat de l’activité conjuguée et éventuellement contradictoire de plusieurs facteurs. Ces facteurs sont les différentes manières par lesquelles l’oeuvre négocie son rapport à la temporalité, à la référence et à la matérialité.
Appendices
Note biographique
Professeur de littérature française du xixe siècle à l’Université Rennes 2 et membre du Centre d’études des langues et littératures anciennes et modernes (CELLAM). Ses travaux, inscrits dans le champ de la sociocritique, portent sur Stendhal, Mérimée et plus largement la fiction romantique envisagée dans ses rapports à l’Histoire. Il est l’auteur de L’Écriture de l’Histoire chez Mérimée. L’archive et l’« archè » (Classiques Garnier, 2022), a édité Stendhal (De l’amour, Flammarion, « GF », 2014 ; Lucien Leuwen, 2007, et Féder, 2014, dans les Oeuvres romanesques complètes de la « Bibliothèque de la Pléiade »). Il dirige la « Série Stendhal » publiée aux Classiques Garnier.
Notes
-
[1]
Voir ressources-socius.info/index.php/lexique (page consultée le 31 décembre 2022).
-
[2]
Claude Duchet et Patrick Maurus, Un cheminement vagabond. Nouveaux entretiens sur la sociocritique, Paris, Champion, « Poétiques et esthétiques xxe-xxie siècle », 2011, p. 151 (je souligne).
-
[3]
Le cotexte est « tout ce qui, en fait, s’écrit avec le texte mais sans être nécessairement textualisé, tout ce qui est lu avec le texte sans être pourtant concrétisé, sans être littéralement exprimé » (Claude Duchet, « Sociocritique et génétique. Entretien avec Anne Herschberg-Pierrot et Jacques Neefs », Genesis, no 6, 1994, p. 117 col. 2).
-
[4]
Sur le sociogramme, voir Claude Duchet et Patrick Maurus, op. cit., p. 47-60, 124-162 ; Régine Robin, « Pour une socio-poétique de l’imaginaire social », dans Jacques Neefs et Marie-Claire Ropars (dir.), La politique du texte. Enjeux sociocritiques pour Claude Duchet, Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires de Lille, « Problématiques », 1992, p. 104-112 ; Pierre Popovic, « La sociocritique. Définition, histoire, concepts, voies d’avenir », Pratiques, nos 151-152 (« Anthropologies de la littérature »), décembre 2011, p. 18-19.
-
[5]
Claude Duchet et Patrick Maurus, op. cit., p. 150.
-
[6]
Ibid., p. 11.
-
[7]
Si l’on excepte Souvenirs d’un gentilhomme italien, dont l’authenticité fait largement débat.
-
[8]
Sur cette triade, voir Claude Duchet et Patrick Maurus, op. cit., p. 26-27 et Régine Robin, loc. cit., p. 112-117.
-
[9]
Sur ce binôme, voir Claude Duchet et Patrick Maurus, op. cit., p. 84-85 et 128-129.
-
[10]
Stendhal, Vanina Vanini, dans Oeuvres romanesques complètes, publié par Yves Ansel et Philippe Berthier, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », t. I, 2005. Désormais abrégé VV suivi du numéro de la page. – Le sous-titre, de l’aveu même de Stendhal sur son exemplaire personnel, a été « ajouté par le Libraire », Louis-Désiré Véron, directeur de la Revue de Paris (VV, 930, var. a de la p. 245).
-
[11]
Voir Michel Crouzet, « Stendhal et le récit tragique », dans Rosa Ghigo Bezzola (dir.), Stendhal Europeo, Paris / Bari, Nizet / Schena, « Biblioteca della ricerca. Cultura straniera », 1996, p. 107-162.
-
[12]
Voir Kosei Kurisu, Modernité du roman stendhalien. Aux sources d’une oeuvre singulière, Paris, SEDES, 2001 (chapitre I : « La “Note secrète” du Rouge », p. 13-32).
-
[13]
Jean-Noël Tardy, L’âge des ombres. Complots, conspirations et sociétés secrètes au xixe siècle, Paris, Les Belles Lettres, 2015 ; Gilles Malandain, L’introuvable complot. Attentat, enquête et rumeur dans la France de la Restauration, Paris, éd. de l’École des hautes études en sciences sociales, « En temps & lieux », 2011.
-
[14]
Charles Nodier, « Souvenirs de l’Empire. Portraits. Premier article. Le général Malet. Le colonel Oudet », Revue de Paris, t. XIII, 1re livraison, 4 avril 1830, p. 25-26.
-
[15]
Voir Henri-François Imbert, Les métamorphoses de la liberté ou Stendhal devant la Restauration et le Risorgimento, Paris, Corti, 1967, p. 452 et 617-618.
-
[16]
Mme de Lafayette, La princesse de Clèves (1678), dans Oeuvres complètes, publié par Camille Esmein-Sarrazin, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2014, p. 332.
-
[17]
Ibid., p. 331.
-
[18]
Ibid., p. 337.
-
[19]
« Tous le [Armance] disent mauvais […]. / Seule excuse of the author : what should they say of the Princess of Clèves ? […] Il [Armance] me semble délicat comme La P[rince]sse de Clèves » (Oeuvres romanesques complètes, op. cit., t. I, p. 892, note a de la p. 83).
-
[20]
Note sur l’exemplaire Bucci d’Armance (ibid., p. 905, note l de la p. 130). À propos d’Armance, affiché pourtant comme roman de l’actualité immédiate – voir le sous-titre : Quelques scènes d’un salon de Paris en 1827 – Stendhal note que « la mode les empêche [les lecteurs] de comprendre ce Roman qui n’a de ressemblance qu’avec des ouvrages trop anciennement à la mode, tels que la Princesse de Clèves, les romans de Mme de Tencin, etc. » (Ibid.)
-
[21]
Dans Claude Duchet et Patrick Maurus, op. cit., p. 151.
-
[22]
C’est-à-dire qui fait système à l’échelle de l’oeuvre et signe par là sa spécificité. Voir aussi, ci-dessus note 8, les références à la triade sociocritique « information / indice / valeur ».
-
[23]
Michèle Riot-Sarcey, Le procès de la liberté. Une histoire souterraine du xixe siècle en France, Paris, la Découverte, 2016, p. 301 ; voir aussi « Temps et histoire en débat. “Tout s’oublie” et “rien ne passe” », Revue d’histoire du xixe siècle, no 25 (« Le temps et les historiens »), 2002, p. 7-13. Dans le même ordre d’idées, Pierre Laforgue note que l’historicité implique un « enjeu historique » sans quoi la temporalité reste le « degré zéro de l’historicité » (Le roi est mort. Fictions du politique au temps du romantisme [1814-1836], Paris, Classiques Garnier, « Études romantiques et dix-neuviémistes », 2019, p. 285 et 283).
-
[24]
Honoré de Balzac, « Avant-propos » à La comédie humaine, dans La comédie humaine, publié sous la dir. de Pierre-Georges Castex, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », t. I, 1976, p. 12.
-
[25]
Voir Jacques-Oliver Boudon, Les quatre sergents de La Rochelle. Le dernier crime de la monarchie, Paris, Passés Composés, 2021.
-
[26]
Il sera d’ailleurs surpris par la révolution de 1830, qu’il n’avait pas anticipée.
-
[27]
« Notre héros était fort peu héros en ce moment », La chartreuse de Parme (I, iii), dans Oeuvres romanesques complètes, publié par Yves Ansel, Philippe Berthier, Xavier Bourdenet et Serge Linkès, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », t. III, 2014, p. 180.
-
[28]
Stendhal, Souvenirs d’égotisme, dans Oeuvres intimes, publié par Victor Del Litto, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », t. II, 1982, p. 490.
-
[29]
Voir Xavier Bourdenet, « Saillance du personnage secondaire. Altamira ou le personnage-écho », Revue Stendhal, no 1 (« Présences du personnage »), 2020, p. 129-154.
-
[30]
Jean Giono, Angelo, dans Oeuvres romanesques complètes, publié par Robert Ricatte avec la collaboration de Pierre Citron et Henri Godard, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », t. IV, 1977, p. 3.
-
[31]
Voir Christopher W. Thompson, « Vanina Vanini ou la répétition tragique », L’Année Stendhal, no 4, novembre 2000, p. 29-36.
-
[32]
Voir Henri-François Imbert, op. cit., p. 457.
-
[33]
Stendhal, Correspondance, publié par Henri Martineau et Victor Del Litto, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », t. II, 1967, p. 285 (cité par Henri-François Imbert, op. cit., p. 457).
-
[34]
Malgré de notables exceptions : voir notamment, en s’en tenant au cas de Balzac, les travaux d’Isabelle Tournier ou de Stéphane Vachon sur l’histoire de l’édition balzacienne, ou La fabrique de « La comédie humaine » de Pierre Laforgue (Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, « Annales littéraires de l’Universitaires de Franche-Comté », 2013).
-
[35]
Voir Claude Duchet, « Sociocritique et génétique », loc. cit. ; Henri Mitterand, « Critique génétique et sociocritique. Entretien avec Pierre-Marc de Biasi et Anne Herschberg-Pierrot », Genesis, no 30, 2010, p. 59-63.
-
[36]
Voir, entre autres, « De la sociocritique à la poétique historique », Texte. Revue de critique et de théorie littéraire, nos 45-46 (« Carrefours de la sociocritique »), 2009, p. 81-98.
-
[37]
Voir, entre autres, « Poétique historique du support et énonciation éditoriale : la case feuilleton au xixe siècle », Communications & langages, no 166, décembre 2010, p. 3-19.
-
[38]
Roger Chartier, Au bord de la falaise. L’histoire entre certitudes et inquiétude, Paris, Albin Michel, « Bibliothèque Albin Michel de l’histoire », 1998, p. 270 (voir en particulier le chapitre « Histoire et littérature », p. 269-287).
-
[39]
Stendhal, lettre à Honoré de Balzac, 17-28 octobre 1840, Correspondance, op. cit., t. III, 1968, p. 398.
-
[40]
Op. cit. (note 10).
-
[41]
Voir Guillaume Bridet et Laurence Giavarini (dir.), « La fonction-groupe », COnTEXTES, no 31, 2021 (disponible en ligne, doi : 10.4000/contextes.10303).
-
[42]
Mais pas De l’amour (anonyme) ni les toutes premières oeuvres, Vies de Mozart, Haydn et Métastase et Histoire de la peinture en Italie (respectivement signées « Louis-Alexandre-César Bombet » et « M. B. A. A. »).
-
[43]
Stendhal a une intense activité journalistique dans la décennie 1820 mais jamais pour des textes de fiction. Sur ce tournant stratégique de 1829-1830, voir David Bryant, « Stendhal et la tentation de la littérature facile. Être lu en 1830 », Stendhal Club, no 107, 15 avril 1985, p. 264-275.
-
[44]
Claude Duchet et Patrick Maurus, op. cit., p. 151.