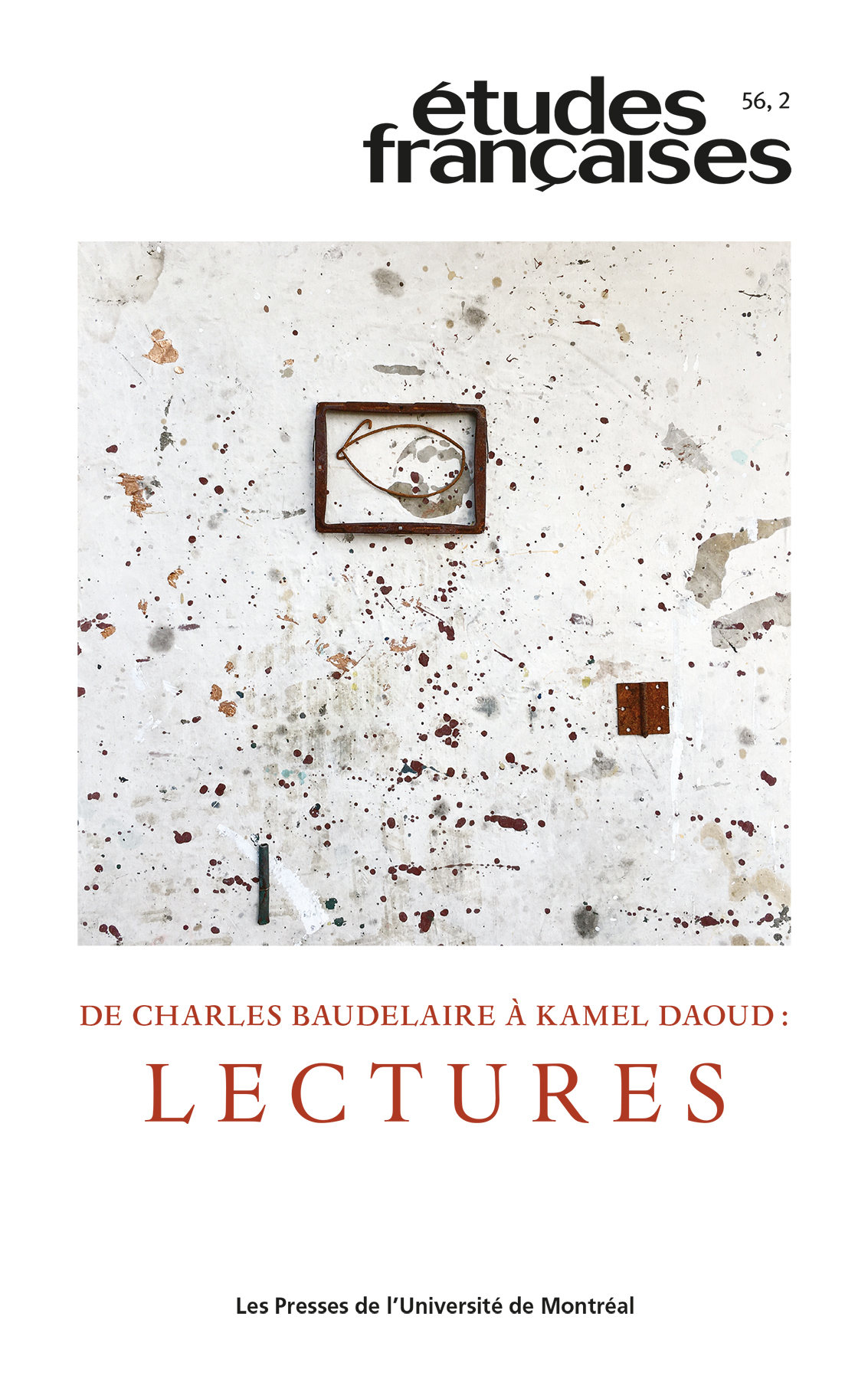Abstracts
Résumé
Le fragment de La Belgique déshabillée que Baudelaire a placé sous la rubrique « Épilogue » et qu’on retrouve, dans l’édition d’André Guyaux (« Folio », 1986), au septième feuillet de la section « Feuillets détachés », témoigne d’un exceptionnel effort d’esthétisation. On s’étonne qu’il ait suscité peu d’attention critique, d’autant plus qu’il culmine en une projection imaginaire d’une extrême violence. Le poète s’y met en scène dans l’anticipation fébrile du choléra, en se délectant à l’avance des ravages que ce « fléau divin » devrait infliger aux Belges. Nous nous proposons ici de caractériser l’élément discursif qui représente – à l’échelle de toute La Belgique déshabillée aussi bien que dans ce projet d’épilogue – le plus puissant inducteur de la violence baudelairienne, à savoir la référence au choléra. Hautement pathétique, cette référence est aussi hautement révélatrice. D’une part, en brandissant le fléau du choléra et en posant au prophète de malheur, le Baudelaire de Belgique offre à la postérité le portrait sans doute le plus expressif du poète « de la fin » qu’il est fatalement devenu et qu’il a stratégiquement choisi de devenir dans les années 1860, un poète tout à la fois résigné et résolu à puiser dans la haine un principe nouveau de création. D’autre part, évoquant cette destruction de masse, il reconduit de manière imaginative la dénonciation de la société libérale qu’il associe à la Belgique. C’est contre cette réalité historique, politique et plus largement idéologique, qu’il déchaîne le plus manifestement sa colère. S’il recourt au choléra dans son épilogue, s’il isole ce motif de l’imaginaire social pour l’intégrer dans son discours, c’est d’abord pour opposer l’atroce marche de ce fléau à celle, aussi terrible à ses yeux, du progrès et de la civilisation.
Abstract
The fragment of La Belgique déshabillée, that Baudelaire placed under the heading “Épilogue” and reproduced in André Guyaux’s edition (“Folio,” 1986) on the seventh folio of the section “Feuillets détachés,” demonstrate an exceptional effort of aestheticization. One wonders why it has elicited so little critical attention, even more since it culminates into an imaginary projection of extreme violence. There, the poet stages himself in the feverish anticipation of the cholera, enjoying in advance the devastation that the “divine scourge” should inflict upon the Belgians. Our goal is to characterize the discursive element that represents – at the level of La Belgique déshabillée in its entirety and in the epilogue project – the most powerful inductor of the Baudelairian violence, that is, the reference to cholera. Highly pathetic, this reference is also highly revealing. On the one hand, brandishing the scourge of cholera and posing as a doomsayer, the Baudelaire of Belgium offers to posterity what is perhaps the most expressive portrait of the “latter day” poet whom he fatally became and strategically chose to become in the 1860s, a poet resigned and determined to draw in hatred a new principle of creation. On the other hand, evoking this mass destruction, he reiterates in an imaginative manner the denunciation of the liberal society which he associates with Belgium. It is primarily against this historical, political, and, more broadly, ideological reality that he most manifestly unleashes his anger. The recourse to cholera in his epilogue, isolating this motif from the social imagination to integrate it to his discourse, opposes the dreadful march of this scourge to that, no less terrible in his view, of progress and civilization.
Article body
L’esprit prophétique est naturel à l’homme et ne cessera de s’agiter dans le monde.
Joseph de Maistre[1]
Quant à moi qui sens quelquefois en moi le ridicule d’un prophète […].
Charles Baudelaire[2]
Discours de Belgique et discours de la fin
Avec ses quelque quatre cents feuillets de notes souvent lourdement redondantes, et son stock également volumineux de coupures de journal, le fort et foisonnant dossier préparatoire du « livre satyrique sur la Belgique[3] » auquel Baudelaire aura consacré passablement d’attention dans les dix premiers mois de son séjour à Bruxelles – en l’assimilant, il est vrai, à presque autant de formes que de titres différents[4] – reflète une tentative littéraire manifestement inaboutie. Pour autant, cette ébauche d’oeuvre, qu’on s’accorde de nos jours à désigner sous la formule La Belgique déshabillée[5], n’en présente pas moins quelques développements relativement élaborés sur les plans esthétique et argumentatif.
L’un d’eux paraît même singulièrement achevé : celui que Baudelaire a placé sous la rubrique « Épilogue » et qu’on retrouve aujourd’hui, dans l’édition d’André Guyaux, au septième feuillet de la section « Feuillets détachés »[6]. Le peu d’intérêt critique que ce passage a suscité[7] est d’autant plus étonnant qu’il donne lieu à une projection imaginaire d’une violence sensationnelle, rarement égalée chez Baudelaire. Le poète s’y met en scène dans l’attente fébrile du choléra, en se délectant à l’avance des ravages que ce « fléau divin » devrait causer chez les Belges :
Pauvre Belgique.
ÉPILOGUE
Aujourd’hui Lundi, 28 août 1865, par une soirée chaude et humide, j’ai erré à travers les méandres d’une Kermesse de rues, et dans les rues du Coin du Diable, du Rempart des moines, de Notre-Dame du Sommeil, des Six Jetons, et de plusieurs autres, j’ai surpris suspendus en l’air, avec une joie vive, de fréquents symptômes de choléra. L’ai-je assez invoqué, ce monstre adoré ? Ai-je étudié assez attentivement les signes précurseurs de sa venue ? Comme il se fait attendre, l’horrible bien-aimé, cet Attila impartial, ce fléau divin qui ne choisit pas ses victimes ? Ai-je assez supplié le Seigneur Mon Dieu de l’attirer au plus vite sur les bords puants de la Senne ? Et comme je jouirai enfin en contemplant la grimace de l’agonie de ce hideux peuple embrassé par les replis de son Styx-contrefaçon, de son ruisseau-Briarée qui charrie encore plus d’excréments que l’atmosphère au-dessus ne nourrit de mouches ! – Je jouirai, dis-je, des terreurs et des tortures de la race aux cheveux jaunes, nankin et au teint lilas !
Une jolie observation : après de nombreux écussons dédiés à l’union, à l’amitié, à la fidélité, à la constitution, à la Vierge Marie, j’en ai trouvé un dédié : à la Police.
Est-ce la policy anglaise ?
Peuple inepte, dans ses joies et dans ses voeux !
Lire un livre sur l’architecture des Jésuites, et un livre sur le rôle politique et éducateur des Jésuites en Flandre. –
Guides pour Malines, Bruxelles, Namur, Liège, Gand[8].
Là où la très grande majorité des segments textuels de La Belgique déshabillée donnent l’impression d’avoir été « interrompu[s] avant qu[’un] geste proprement littéraire[9] » ait pu affiner et transformer la matière brute de leur contenu – extraite par larges couches, comme on sait, du fond de préjugés de l’époque[10] –, cet épilogue reflète un indéniable travail d’esthétisation.
En témoigne d’abord, de manière frappante, son caractère doublement et comme entéléchiquement final : à savoir le fait que cette brève prose à contenu apocalyptique soit explicitement assignée, dans l’économie d’une oeuvre qui reste par ailleurs tout hypothétique, à une fonction épilogale, donc clausulaire.
Le couplage de ces deux « fins » suffirait à désigner ce passage comme l’un des plus surdéterminés, sur le plan esthétique, de La Belgique déshabillée. Mais le tour fortement rhétorique que lui imprime Baudelaire ajoute encore à son relief esthétique. De fait, son épilogue ne saurait être réduit à un simple « mot de la fin ». Il s’articule certes autour d’un mot – et quel mot ! celui, porteur de formidables affects et de menaces terriblement actuelles, alors, de « choléra » –, mais la complexité de sa structure et la densité de son style invitent plus largement à y reconnaître un authentique « discours de la fin »[11]. On s’étonne en effet de rencontrer dans une plage de texte aussi limitée et dans le cadre d’un avant-texte aussi rudimentaire un développement à ce point riche et ouvragé. Entre anecdote réaliste et affabulation mythique, pronostic hygiéniste et projection fantasmatique, invocation religieuse et malédiction prophétique, caricature grotesque et détraction satirique, la vision apocalyptique qui s’y fait jour parvient à une fusion de modalités et de tonalités génériques singulièrement variées (même à l’aune de la typologie hétéroclite des Petits poèmes en prose, dont on pourrait d’ailleurs imaginer qu’elle inaugure un modèle nouveau et limite, en porte-à-faux avec le genre lui aussi tardif et polymorphe de la « fusée » ou de la note baudelairienne). Sur le plan stylistique, l’investissement dont cette vision fait l’objet n’est pas moins important : on est saisi en particulier par l’emphatique et dramatique développement de l’allégorie, qui porte rapidement la catachrèse attendue de la « marche du choléra » à la hauteur d’une « venue » divine, et qui fait culminer l’évocation apocalyptique dans l’image brève mais énergique (puisqu’il s’agit bien là d’une amorce d’energeia) de « la grimace de l’agonie de ce hideux peuple embrassé par les replis de son Styx-contrefaçon, de son ruisseau-Briarée » ; de même, on est déstabilisé par l’alternance et la compénétration quelque peu tournoyantes des différents régimes modaux et temporels, qui ont pour effet, plutôt que d’aligner classiquement le présent de l’énonciation sur l’eschatologie lointaine du prophétisme traditionnel ou sur l’antériorité profonde de l’introspection lyrique, de l’accentuer et, dirait-on, de le redistribuer équivoquement entre les bornes d’un passé et d’un futur à la fois proches et irréels, fantasmatiques. Un tel degré d’élaboration stylistique et structurelle, s’il induit à la vision de Baudelaire une vivacité caractéristique, peut sans doute être mis au compte du phénomène d’« intensification sémiotique[12] » auquel donnent lieu les discours de la fin, dans leur mélange habituel de frénésie analytique et de désarroi plus ou moins panique.
On se souvient que Baudelaire qualifiait une autre de ses « prophéties » – celle, la plus célèbre, qui prédisait que « le monde va finir » (Fusées, OC I, 665) – de « hors-d’oeuvre » (OC I, 667). Il empruntait alors au vocabulaire des architectes, qui désignent par ce mot « une pièce en saillie, qui ne fait pas partie de l’ordonnance générale[13] » de la construction. Notre épilogue tombe-t-il aussi sous cette qualification ? On peut en douter, car s’il se détache nettement, par son fini, des autres fragments de La Belgique déshabillée, il s’inscrit thématiquement en parfaite continuité avec eux. Plus encore, son statut clausulaire semble le destiner en priorité à une fonction de récapitulation, plutôt qu’à une fonction d’ouverture et, donc, d’innovation. Tout au moins peut-on lui prêter la bivalence du fragment romantique, « ruine » valant non seulement pour elle-même, comme on sait, mais pour l’édifice symbolique disparu ou irréalisé qu’elle aurait le pouvoir d’évoquer[14].
Ce que l’épilogue résume, c’est d’abord, bien sûr, le discours antibelge qui ressort de presque tous les feuillets de La Belgique déshabillée. Discours agressivement amer en même temps que « fortement tourné au bouffon » à travers lequel, comme tout donne à le penser, Baudelaire se sera ingénié à trouver la voie d’un renouveau esthétique[15]. C’est plus précisément la violence de ce discours maximaliste et paradoxaliste que l’épilogue concentre et répercute avec fulgurance.
Nous nous proposons ici de caractériser l’élément discursif qui représente – à l’échelle de toute La Belgique déshabillée aussi bien qu’à celle de ce projet d’épilogue – le plus puissant inducteur de la violence baudelairienne, à savoir la référence au choléra. Hautement pathétique, cette référence est aussi hautement révélatrice. On peut même dire que c’est en brandissant le fléau du choléra que le Baudelaire de Belgique parvient véritablement à « dater [s]a colère » (Fusées, OC I, 667) ; qu’il réussit, même dans le cadre d’un texte resté à l’état de projet, à pleinement extérioriser et officialiser la colère qui lui tient désormais lieu d’inspiration, en ces mauvais jours qu’il n’ignore pas être ses derniers. De fait, en posant en prophète de malheur, Baudelaire offre à la postérité le portrait sans doute le plus expressif du poète « de la fin » qu’il est fatalement devenu et qu’il a choisi stratégiquement de devenir dans les années 1860, un poète tout à la fois résigné et résolu à puiser dans la haine un principe nouveau de création. Peut-être même la référence au « choléra » (à l’instigation des déterminations conscientes et inconscientes si suggestives de son étymologie, qui rapporte les affections du cholérique et celles du colérique à un même dérèglement bilieux [latin cholera > grec χολέρα]) vient-elle signaler dans le discours de cet ultime Baudelaire le passage du spleen à un autre régime humoral et créatif : celui, précisément, de la colère, régime d’une agressivité qui serait dirigée non plus d’abord vers le Moi mais vers l’Autre[16].
Libre à l’analyste ou au psychanalyste, par une sorte de retour à l’envoyeur, de considérer cette colère comme l’expression médiatisée d’une violence qui ne serait jamais, en première ou en dernière instance, qu’une haine de soi. La vision c(h)olérique de Baudelaire, sous cet angle, n’en paraît que plus représentative des discours apocalyptiques et des imaginaires de la fin – tant il est vrai qu’« imaginer l’apocalypse est façon de se venger à l’avance de sa propre mort[17] ». Mais on se gardera de diminuer l’importance « objective » des cibles déclarées du satirique et du pamphlétaire. Le Belge, ici, n’est pas que le reflet du Moi baudelairien : il est aussi, il reste nécessairement l’hypostase de la « bêtise moderne », l’exemplaire produit – la copie parfaite – de cette société libérale qui a fait du progrès sa nouvelle religion. C’est contre cette réalité historique, politique et plus largement idéologique, que Baudelaire déchaîne le plus manifestement sa colère. Et, comme il s’agira de le montrer de manière plus précise, s’il recourt au choléra dans son épilogue, s’il isole ce motif de l’imaginaire social et le repique dans son discours, c’est d’abord pour opposer l’épouvantable marche de ce fléau à celle, qui n’est pas moins terrible à ses yeux, du progrès et de la civilisation.
Le choléra : une histoire en marche
Venu d’Inde, le choléra (ou « choléra morbus », selon l’appellation historique) conquiert l’Occident au xixe siècle. S’il ne s’installe pas en Europe, il y sévit en une série de quatre ou cinq « bouffées pandémiques[18] » qui, rapprochées dans le temps, tiendront dans un état d’alerte presque continu les populations, les gouvernements et les autorités scientifiques au cours du siècle.
Lorsqu’il frappe le territoire français pour la première fois en 1832, le choléra fait cent mille victimes. Il revient en force moins de dix ans plus tard, à l’occasion de ce qui sera l’attaque épidémique (1841-1854) « la plus meurtrière » que la France ait connue au xixe siècle, avec un bilan de « cent cinquante mille » décès[19]. Sa réapparition, de 1863 à 1875, n’est pas aussi funeste en France qu’elle le sera en Belgique, où il se répand avec une violence inédite et où il cause, en 1866, quarante-trois mille quatre cents morts[20].
C’est au seuil de cette invasion pandémique, tout juste après en avoir reconnu, dit-il, les « fréquents symptômes » dans les rues de Bruxelles, que Baudelaire prend la plume pour formuler son sinistre pronostic. « Aujourd’hui Lundi, 28 août 1865 » : la référence précise à la date de l’énonciation – fait rare et révélateur chez ce preneur de notes habituellement peu soucieux de marques calendaires[21] – charge d’emblée sa prédiction d’une gravité angoissante, en ancrant l’actualité et la positivité du fléau dans l’espace intime de son quotidien. Remarquons que, par cette référence temporelle, Baudelaire se place bel et bien, en tant qu’énonciateur, dans une dimension d’antériorité, et donc dans une posture de prédiction, par rapport à l’événement : en effet, à la date du 28 août 1865, le choléra n’a pas encore touché la Belgique ; il ne franchira la frontière belge que bien plus tard, au printemps 1866, et ne fera sa première victime bruxelloise qu’à la fin du mois de mai[22]. Est-ce à dire que Baudelaire, prophète de malheur, aurait vu juste ? Si, sur le plan philologique, rien ne laisse croire qu’il a antidaté sa « prédiction » de façon à en assurer frauduleusement l’exactitude, on peut supposer qu’il l’a formulée au jour qu’il indique en extrapolant à partir de l’évolution contemporaine de l’épidémie ailleurs en Europe, notamment en France, telle que la presse et la rumeur publique s’en faisaient l’écho. L’opération paraît toute simple, mais, en réalité, à une époque où les principes de contagion du choléra sont encore inconnus, se livrer à de telles projections constitue un exercice passablement conjectural, presque aussi divinatoire que rationnel. Aussi peut-on penser qu’au jeu des pronostics catastrophistes, en cette fin d’été 1865, Baudelaire a eu la main heureuse…
Avant la révolution pasteurienne et surtout la découverte du vibrion cholérique en 1883 par Robert Koch, l’infection a le champ libre. Échappant à l’analyse, elle alimente tout autant les mythologies populaires que les spéculations médicales et les initiatives prophylactiques. On craint cette « peur bleue » comme on craignait naguère la peste. Pour la conjurer, on la personnifie, fût-ce sous des traits effroyables, comme en témoigne abondamment la production littéraire[23] et picturale[24] du xixe siècle.
Un aspect de cet être imaginaire semble avoir tout particulièrement fasciné et troublé les esprits, qu’il importe d’emblée de souligner puisqu’il magnétise aussi l’évocation de Baudelaire : sa marche mystérieuse. En effet, se propageant d’une manière apparemment irrationnelle – à travers les continents, les pays mais aussi les agglomérations urbaines, où il donne parfois l’impression de contourner certains quartiers et de fondre sur certains autres –, le choléra s’impose rapidement et durablement sous la figure d’un marcheur erratique, engagé dans une sorte de « fantastique et macabre randonnée[25] ». C’est ainsi qu’il apparaît dans Le Juif errant d’Eugène Sue, qui sait tirer de son approche des effets notoirement dramatiques : « Ce voyageur, mystérieux comme la mort, lent comme l’éternité, implacable comme le destin, terrible comme la main de Dieu… c’était… le choléra ! ![26] »
Toutes les manoeuvres de cet ennemi insidieux, tous les mouvements de ce « géant invisible », pour faire allusion à un autre de ses célèbres avatars littéraires[27], n’échappent cependant pas à l’observation. Ainsi, on se rend vite compte que le fléau accable en priorité les villes et, dans les villes, les quartiers populaires : pas plus sans doute que le commun des mortels, la science hygiéniste n’a de difficulté à constater que la pauvreté constitue le « milieu pathogène par excellence[28] » de l’infection – même si elle rechignera à expliquer cette pauvreté par des facteurs socioéconomiques, préférant longtemps alléguer des causes morales, fustiger les moeurs déréglées ou le tempérament taré du peuple[29].
C’est dire qu’en situant les « signes précurseurs » de l’épidémie dans le quartier, alors populaire, voire misérable par endroits, du vieux Bruxelles (« j’ai erré à travers les méandres d’une Kermesse de rues, et dans les rues du Coin du Diable, du Rempart des moines, de Notre-Dame du Sommeil, des Six Jetons, et de plusieurs autres »), Baudelaire adopte une perspective réaliste ; il inscrit sa prédiction dans un cadre propice à la propagation de l’infection : si les noms de rues qu’il cite (et choisit à dessein, selon toute vraisemblance, comme le suggère leur soulignement) sont bien faits pour instiller à son propos une atmosphère mystérieusement fantastique, à la fois maléfique et somnambulique, ils reflètent aussi un aspect objectivement exact, en regard de l’histoire et de l’épidémiologie, de sa « vision » du choléra.
Évidemment, l’intérêt premier de cette vision n’est pas d’ordre documentaire. Il réside plutôt dans la manière dont Baudelaire y fait intervenir le choléra, y fait jouer à son profit les sèmes et les thèmes qui s’attachent à ce motif dans l’imaginaire social, pour le transformer en une « chose » pour ainsi dire sienne, baudelairienne, c’est-à-dire congruente avec son désir et son discours[30].
La principale marque de son appropriation est de mettre en jeu deux représentations générales de l’épidémie qui ont en commun de l’assimiler à un Mal d’envergure mythique, mais qui ont aussi la particularité de lui conférer certains traits historiques non seulement différents, mais, à bien des égards, contrastants : là où la première de ces représentations associe le choléra à une puissance ou une résurgence à caractère prémoderne, la seconde désigne en lui une sorte de création ou de dégénération à caractère moderne. Le discours de Baudelaire ne disjoint ni ne hiérarchise ces deux figurations ; il les garde plutôt en tension. Pour quoi ? Selon toute apparence, comme il s’agit de le vérifier, pour capitaliser sur le potentiel critique et expressif accru d’une énonciation / dénonciation à plusieurs entrées.
Un fléau démocratique
La première de ces représentations s’impose à la lecture avec le plus d’évidence, car elle exploite les traits du choléra qui sont les plus prégnants dans l’imaginaire social.
C’est elle qui actualise le réseau d’associations qui posent le choléra comme une manifestation à la fois transcendante et lointainement historique, comme un spectre fait d’images et de croyances universelles mais emblématiquement prémodernes. Dans le contexte du xixe siècle, ce « fléau […] médiéval[31] » – ou, pour mieux dire, d’aspect « tou[t] moyenâgeu[x][32] » – est d’autant plus effrayant qu’il apparaît sur le fond philosophiquement « éclairé » et métaphysiquement pacifié de l’optimisme bourgeois triomphant. En infligeant un cruel démenti à la croyance selon laquelle la société européenne n’offrirait que des avantages sous le rapport de l’hygiène publique, il contredit l’idée de progrès qui s’attache à l’histoire des nations policées[33]. Il s’introduit dans le présent à la façon d’un dérangeant rappel, venu d’un autre âge, revenu d’un Moyen Âge éternel. La frayeur qu’il induit est perceptible jusque dans le langage naturaliste et l’humanisme confiant d’un positiviste comme Émile Littré : « Paris, sous un ciel depuis longtemps si bénin, avait oublié ces temps lugubres où la peste désolait son enceinte ; et, fiers de notre civilisation, nous songions peu à ces assauts redoutables que la nature livre, d’intervalle en intervalle, aux races humaines[34]. »
Les implications religieuses et théologiques de cette représentation du choléra sont particulièrement claires ; elles ne diffèrent pas de celles des autres « pestes » qui ont scandé l’histoire depuis toujours ; elles font en priorité du choléra, on l’aura compris, l’expression de la vengeance divine, la main du Dieu punisseur. Le clergé du xixe siècle ne manquera d’ailleurs pas de corréler les manifestations répétées de cette Ira Dei aux errements spirituels de la France postrévolutionnaire[35].
Ce « fléau divin » devient dans l’épilogue, conformément à la rhétorique superlative qui informe tout le discours de La Belgique déshabillée, une arme de destruction massive. On ne s’étonnera guère que Baudelaire en confie le maniement au Dieu chrétien, au « Seigneur [S]on Dieu » : après tout, sa conception du christianisme, dont on a pu dire avec raison qu’elle ignore la rédemption, implique une divinité non seulement attachée au respect strict de la Loi mais engagée, même sadiquement par moments, dans l’administration des peines et, comme telle, aussi susceptible que « le Démon » de se prévaloir de l’« appareil sanglant de la Destruction » (« La Destruction », dans Les Fleurs du Mal, OC I, 111). Au demeurant, la divinité dont procède ici le choléra n’est pas exclusivement chrétienne ; elle symbolise de manière plus générale une puissance transcendante. Deux des expressions sous lesquelles elle est invoquée, « Monstre adoré » et « Attila impartial », concourent même à lui donner des traits païens : la première, en rappelant l’image du veau d’or ; la seconde, celle du barbare. Le texte de Baudelaire, sur ce point encore, recycle des composantes affectives et sémantiques assez bien sédimentées dans l’imaginaire social du choléra. Composantes pagano-barbares qui relèvent bel et bien de sa représentation à caractère prémoderne et moyenâgeux, dès lors qu’elles contribuent elles aussi à le rapprocher d’une sorte de mal venu de l’étranger pour « envahir » et détruire l’ordre de la civilisation et, incidemment, propre à remuer de vieilles angoisses obsidionales. François Delaporte constate ainsi que les « réminiscences de l’épidémie qu’on appelait par antonomase Guerre de Dieu réveillaient d’autres peurs[36] », et notoirement celle des hordes barbares, si bien qu’on était souvent conduit à redouter, comme en témoigne un observateur au début des années 1830, que le « fléau, semblable à l’invasion des Barbares du Moyen Âge, ne vienne décimer les peuples, désorganiser la société, anéantir le commerce, et faire reculer la civilisation[37] ».
La seconde représentation du choléra que donne à lire l’épilogue est plus déterminante que la première pour la compréhension de la « vision » et du discours belge de Baudelaire, dans la mesure où elle résulte d’une appropriation plus originale, qu’on peut à bon droit qualifier de subversive.
Là aussi, le choléra figure une menace qui risque d’emporter la société tout entière ; là aussi, sa marche entrave celle du progrès, représente une contremarche[38]. Seulement, il n’apparaît plus comme un mal étranger à la civilisation, de provenance extratemporelle et extraterritoriale : il semble au contraire en dériver, être immanent, plutôt que transcendant, par rapport à elle. En un mot, suivant cette représentation, le choléra semble lui aussi moderne. C’est ce que suggère Baudelaire lorsqu’il l’évoque sous les traits non seulement d’un « Attila », mais aussi d’un « Attila impartial » (nous soulignons), puis tout juste après, non seulement sous ceux d’un « fléau divin », mais encore, par une glose quelque peu lourde et comme intentionnellement insistante, de « ce fléau divin qui ne choisit pas ses victimes » (nous soulignons). Ces éléments de prédication jouent sur deux registres : d’un côté – c’est leur sens obvie –, ils disent le terrible esprit de justice d’une épidémie qui, sévissant de façon aveugle, serait en principe universellement cruelle ; de l’autre – et c’est par là qu’ils introduisent une note nouvelle et discordante par rapport aux conceptions traditionnelles de l’épidémie –, ils dotent le choléra d’un esprit pour ainsi dire égalitaire, non discriminatoire, qui, entrant directement en correspondance avec l’identité de la société décrite et condamnée dans La Belgique déshabillée, et partout ailleurs chez le dernier Baudelaire, en fait une manifestation exemplairement, monstrueusement, démocratique, aussi bien dire moderne.
Une telle caractérisation est éminemment ironique. Certes, en lui-même, le fait de prêter au choléra des traits qui connotent une certaine modernité ne l’est pas. Beaucoup de contemporains de Baudelaire ne manqueront d’ailleurs pas de le faire, en soulignant par exemple comment cette épidémie – encore nouvelle pour l’Europe, où elle ne s’affirme qu’au xixe siècle, rappelons-le – a pu progresser à la faveur des développements techniques impulsés par la Révolution industrielle. Dans leur discours, « l’expansion » rapide « du chemin de fer dans les années 1850 », suivie peu de temps après de « la généralisation du bateau à vapeur » dans le commerce maritime, constitue le facteur de modernité ou de modernisation du choléra le plus décisif [39]. Les représentations de ce type, qui concourent à accorder le choléra au temps présent, à sa vitesse expansionniste, s’ajoutent à celles qui tendent au contraire à en faire un mal prémoderne ; les unes et les autres interagissent pour composer dynamiquement, dans l’imaginaire social, l’idée générale du choléra, avec son poids obligé de contradictions et son potentiel intrinsèque de frictions. Il n’y a pas là ironie, intention subversive, mais tension et opposition – « sociogrammatiques[40] », dirait Claude Duchet – normales, structurelles.
En revanche, la modernisation du choléra sous l’espèce d’un « Attila impartial » relève bien de l’ironie. L’esprit « démocratique » qu’affiche la personnification de Baudelaire entre trop violemment en contradiction avec la réalité historique, dément trop précisément les faits pour ne pas répondre à une intention subversive. Car, on ne le sait que trop bien, loin d’être « impartial », le choléra est une épidémie dont les ravages sont particulièrement marqués socialement. S’il est un mal qui « choisit » ses « victimes », s’il est un « fléau » dont les plateaux sont déséquilibrés, c’est bien lui ! On estime même que sa manifestation de 1866, celle dont Baudelaire prétend déceler les prodromes, a été « probablement la plus discriminatoire [des épidémies] par son exacerbation des inégalités face à la maladie et à la mort[41] ». Si ses causes et les modalités de sa contagion sont restées longtemps mystérieuses, ses « préférences » en matière de victimes devaient, quant à elles, apparaître clairement à la population ; on ne pouvait ignorer qu’il se portait par prédilection sur les quartiers les plus peuplés et les plus insalubres des grandes villes, donc qu’il décimait surtout les pauvres. Aux yeux et dans le langage des classes dirigeantes, ces pauvres s’assimilent d’abord et avant tout à « ce petit peuple sans profession, sans domicile et toujours à l’affût d’un mauvais coup, voire d’une émeute », à cette cohorte de vagabonds, de chiffonniers, de mendiants et de journaliers « qui échappe sans cesse à la surveillance de la police[42] ». Comme on pouvait s’y attendre, une partie au moins de ces mêmes classes dirigeantes, bourgeoises, à travers le discours hygiéniste, ne se contentera bientôt plus d’imputer le fléau à l’immoralité des miséreux (en posant cette immoralité comme la cause de leur misère, et non l’inverse), et verra en lui une occasion somme toute opportune de purger la société de ces dangereux « sous-habitants ». C’est ainsi que le choléra se révélera en fin de compte avoir des vertus : reconnu comme moyen d’épuration eugénique et politique (comme le sera, cinq ans après la rédaction de l’épilogue, le gigantesque coup de balai réactionnaire que constituera la répression de la Commune), il devient « rien de moins qu’un auxiliaire de la police ; il assur[e] la protection des biens et des personnes[43] ».
On mesure toute la distance, ironique, qui sépare l’épilogue de ce discours. Décidément, le temps est loin où, élève au Collège royal de Lyon, Baudelaire pouvait se demander si le choléra viendrait « purger la ville[44] » et où il semblait, lui aussi, en accord avec le discours bourgeois, souhaiter une réponse « épidémique » à la question sociale. En 1865, c’est à la société tout entière – cette société hygiéniste et, plus largement, progressiste, telle qu’il l’hypostasie dans la Belgique – que son désir étend « démocratiquement » le traitement purgatif du choléra. Ce faisant, en esprit et en effigie, Baudelaire peut goûter à l’intense « jouissance » (« Et comme je jouirai […] – Je jouirai, dis-je […] ») de retourner le mal cholérique contre ceux-là mêmes qui ont l’infamie, lorsqu’il décime les masses populaires, de lui reconnaître des propriétés civilisatrices.
Nul élan révolutionnaire et encore moins d’enthousiasme humanitaire dans ce coup frappé, en imagination, contre la civilisation bourgeoise. Nul désir sous-jacent, non plus, de voir advenir ce qui serait une authentique démocratie. Le Baudelaire de La Belgique déshabillée reste profondément et virulemment antidémocrate[45]. Il l’est pour plusieurs raisons, mais surtout parce que la démocratie – même bridée par des mécanismes autocratiques, comme elle l’est dans la France du Second Empire, ou bien par un suffrage censitaire, comme elle l’est encore plus dans la monarchie constitutionnelle de Léopold Ier – représente pour lui, comme pour tous les autres de ses confrères « antimodernes », la tyrannie du Nombre, c’est-à-dire la négation de tout ce à quoi peut aspirer un individu supérieur comme lui, aristocrate sinon de naissance du moins d’essence. Au-delà des représentations et des discours particuliers qu’il brocarde de manière directe ou indirecte, au-delà des cibles de premier et de deuxième plan qu’il assigne à ses attaques satiriques, c’est contre cette société moderne poussant à l’uniformisation des caractères, travaillant à la médiocratisation générale des êtres, c’est contre cette « marée montante de la démocratie, qui envahit tout et qui nivelle tout, noie jour à jour ces derniers représentants de l’orgueil humain[46] » que sont à ses yeux les dandies et les artistes véritables – que Baudelaire déchaîne le fléau de sa colère. Voilà ce qu’il combat d’abord en Belgique, dans l’étrange « guerre à la répétition[47] » qu’il y mène.
Considérée de ce point de vue général et fondamental, sa représentation moderne du choléra a l’ironie non seulement de se conformer à la société qu’elle critique, mais plus radicalement encore d’en proposer l’expression pour ainsi dire paroxysmique, ultime : l’oeuvre d’extermination à laquelle s’associe ici le choléra donne en effet la nette impression de venir parachever dans une apocalypse totale, à l’échelle nationale, l’entreprise d’uniformisation et de nivellement des différences que Baudelaire ne cesse de maudire dans la démocratie. Comme si cette destruction de masse n’était que le plus spectaculaire phénomène de masse que puisse engendrer la société libérale, dans sa propension typique au conformisme[48].
Une Senne visionnaire
Pour spectaculaire qu’il soit, insistons-y, le choléra « moderne » de Baudelaire n’est pas cet Autre réapparu d’une contrée fantasmatiquement ancienne et éloignée, ainsi que le suggérait la première représentation que nous avons mise au jour. Il est plutôt un autre, un semblable : il figure le double du Belge-civilisé et, plus exactement, sa part monstrueuse et cachée, refoulée. Incidemment, s’il faut en citer un avatar dans la littérature décadente, là où l’imaginaire social semble avoir fixé le plus clairement les traits de sa fantasmatique générale, on pensera cette fois, non pas au « géant invisible » imaginé par Bram Stoker, mais au monstrueux M. Hyde de Stevenson.
Chez Baudelaire, comme chez d’autres, une telle créature moderne a la caractéristique d’émerger du sein de la civilisation pour se retourner contre elle. Là est son véritable intérêt dramatique et symbolique. La scène qui constitue le point névralgique et proprement apocalyptique de l’épilogue, le coeur à la fois vivant et agonique de la vision de Baudelaire, suggère un tel retournement. On se souvient – et le rapprochement homophonique in absentia le rappelle[49] – que cette scène correspond à l’évocation de la Senne :
Et comme je jouirai enfin en contemplant la grimace de l’agonie de ce hideux peuple embrassé par les replis de son Styx-contrefaçon, de son ruisseau-Briarée qui charrie encore plus d’excréments que l’atmosphère au-dessus ne nourrit de mouches !
La Senne revient à plusieurs reprises dans La Belgique déshabillée[50] et, plus souvent encore, proportionnellement, dans les Amoenitates Belgicae[51]. Sa présence, ici, n’est pas inusitée : elle fait écho à l’opinion de l’époque qui accusait ses eaux malpropres de favoriser l’incubation et la contagion du choléra. De façon plus générale, la Senne intervient sous la plume de Baudelaire, et suivant la tendance qui l’amène à assimiler la Belgique au seul Bruxelles, comme une illustration emblématique de la nation belge. En elle coulerait en quelque sorte la « belgitude », dans ce qu’elle a de plus corrompu et de plus répugnant. Le second terme de la métaphore composée « Styx-contrefaçon » se rapporte ainsi directement au principal trait, ou tare, devant décrire cette identité, au jugement non seulement de Baudelaire mais de beaucoup de ses compatriotes : on sait en effet que c’est la contrefaçon des livres – à laquelle le pays doit l’aspect le moins honorable de sa notoriété commerciale et politique – qui constitue la matrice de la majeure partie des préjugés antibelges ayant cours au xixe siècle, et ce, longtemps après qu’elle fut résorbée au début du Second Empire[52]. C’est donc elle qui vaut aux Belges de figurer aux yeux de leurs voisins français, qui trouvent négativement à se rengorger de cette image, des êtres dépourvus d’authenticité, poussés par une sorte de fatalité naturelle à tout copier. Ce mimétisme généralisé expliquerait virtuellement tous les aspects de l’identité individuelle et collective des Belges, y compris leur histoire politique (la révolution de Septembre ne serait qu’une répétition dégradée des Journées de Juillet) et leur environnement naturel (la Senne, on l’a déjà compris, figurerait le terne reflet de la Seine[53])…
Baudelaire, qui joue à plein de ces stéréotypes et les exagère avec une insistance et une outrance souvent choquantes, les renforce un peu plus, dans la présente phrase, à travers l’expression « ruisseau-Briarée » : expression qui adjoint, elle aussi, une référence classique à un élément réaliste, même très réaliste, et qui, par ce biais, redit dans le langage de la mythologie et de la tétralogie (« Briarée » renvoie au dieu archaïque à mille bras traditionnellement associé à l’idée de multiplicité[54]) l’absence d’individualité des Belges, le défaut d’être propre qui en fait également, de manière plus fréquente et plus classique, dans le discours de La Belgique déshabillée, des « singes en tout » (OC II, 846). En outre, l’expression actualise l’autre grand champ sémantique – celui de l’excrémentiel – que Baudelaire associe à la Senne : là où « Briarée » éveille par paronomase certains relents de « diarrhée » – relents d’autant plus sensibles que le principal symptôme du choléra est l’écoulement diarrhéique –, « ruisseau », pris en son sens urbain, traduit sur un mode presque poli cette rivière qui ne serait « guère qu’un excrément / Qui coule » (Amoenitates Belgicae, OC II, 968 ; et qui coulerait notamment dans le faro belge, « bière deux fois bue » à forte « saveur citoyenne », OC II, 970…).
C’est ainsi, chargée de toutes sortes d’alluvions anciennes et modernes, et transformée en une forme de serpent de mer – « monstre tout gonflé de haine et de crachats » (« À une madone », dans Les Fleurs du Mal, OC I, 58[55]), comme on en trouve d’autres chez Baudelaire pour dire la mort et le désir –, que la Senne de l’épilogue en vient à se retourner contre les Belges et à les « embrasser » dans ses « replis ». L’image de cet « embrassement » scelle laconiquement – et comme « laocooniquement[56] » – la parfaite adéquation symbolique du choléra-châtiment et du Belge-coupable. Mais, acte de reconnaissance, elle authentifie aussi l’identité fondamentale du choléra et de ses victimes ; elle rend explicite leur communauté de nature ou, pour mieux dire, leur commune appartenance à l’ordre de la souillure[57].
Tel est bien le sens fondamental de cette monstration apocalyptique : faire émerger le Mal, à travers l’évocation emphatique de la maladie, comme la vérité cachée des Belges ; rappeler, par une figuration particulièrement scabreuse, que chez eux la souillure tient lieu de nature.
Chez eux comme chez tout homme, conclut-on. Le renvoi allégorique semble aller de soi, et la vérité cachée du Belge se confondre sans grand mystère avec cette « perversité primordiale de l’homme » (« Notes nouvelles sur Edgar Poe », OC II, 323) que Baudelaire, par ailleurs dans son oeuvre et conformément aux déterminations les plus pessimistes de son christianisme, présente en effet comme « la grande vérité oubliée » (OC II, 323). Si on ne se trompe pas en voyant dans le « hideux peuple » des Belges le reflet de l’humanité corrompue par le péché originel, « marqu[ée] pour le mal » (OC II, 323), que suppose la « religion » baudelairienne, il ne faut toutefois pas oublier que leur déchéance ne traduit pas seulement, ni d’abord, une réalité universelle (ou cette « réité[58] » chère à Joseph de Maistre). Leur déchéance revêt en effet une acuité historique bien distincte, une actualité qui la désigne en priorité comme un fait de civilisation et, plus précisément, comme un trait de l’époque, de ce xixe siècle héritier des Lumières, acquis à l’idéologie du progrès et, par suite, « infatué de lui-même » (OC II, 322). Ce n’est pas un hasard : dans la philosophie de l’histoire de Baudelaire, le progrès, en niant le mal dont est entaché l’homme, aurait pour effet de l’aggraver ; il représente d’abord le discours négateur ou dénégateur de la souillure originelle, le masque auquel recourt plus ou moins consciemment l’homme civilisé pour cacher sa laideur et qui, en fait, ne le rend que plus affreux.
Le discours de La Belgique déshabillée s’inscrit dans le droit fil des diatribes contre le progrès qui agitent polémiquement les essais sur Poe et sur Gautier ou bien le compte rendu de l’Exposition universelle de 1855[59]. Baudelaire destine même expressément son « livre satyrique sur la Belgique » à « la raillerie de tout ce qu’on appelle progrès » (et, sans doute subsidiairement, à « la démonstration du gouvernement de Dieu », Corr. II, 611). À Bruxelles, il a vite fait de se persuader que « [l]a croyance au progrès est une doctrine de paresseux, une doctrine de Belges » (Mon coeur mis à nu, OC I, 681[60]). Pour lui, personne plus que le Belge, parmi les représentants des « races amoindries » (OC II, 580), ne semble avoir aussi clairement abdiqué sa volonté individuelle au nom des chimères suscitées par la foi collective en la perfectibilité humaine. Personne, non plus, ne semble montrer autant de zèle dans le déni du péché originel. Les nombreuses « observations » de La Belgique déshabillée relativement à la propreté belge – le « mensonge » de la propreté belge (OC II, 833) – gravitent autour de cette idée : dans le registre d’une hygiène prosaïquement domestique, mais où les catégories du pur et de l’impur n’en retrouvent pas moins leur sens anthropologique élémentaire, Baudelaire s’amuse à corréler la compulsion des Belges à laver infatigablement les « choses » (« parquets, rideaux, poêles, façades, lieux d’aisance », OC II, 869) et leur négligence non moins remarquable en matière d’hygiène corporelle, négligence qui laisserait deviner leur saleté d’« âme » (OC II, 869). Ainsi, en tendant le miroir caricaturalement grossissant du cas belge, croit-il refléter l’état de la civilisation contemporaine tout entière : état d’une humanité moderne qui, derrière ses hautes prétentions au progrès, cache un fond plus barbare que la barbarie ancienne (Amoenitates Belgicae, OC II, 967).
Quelle serait donc la « vraie civilisation » ? À cette question, qu’il effleure dans l’un des feuillets de Mon coeur mis à nu, Baudelaire ne répond pas clairement[61]. La Belgique déshabillée n’offre pas non plus matière à précision. Et l’éclat de vérité que réfléchit négativement la Senne visionnaire de son épilogue n’est pas de nature à éclairer une conception du passé ou un projet d’avenir d’ordre collectif, même mythique, même utopique.
L’individualisme forcené de Baudelaire semble d’emblée incompatible avec de telles projections. En revanche, comme il nous reste à en juger, en guise de conclusion, c’est en vertu de ce même individualisme, qui tend consciemment ou non à mobiliser toutes les ressources d’individuation à l’oeuvre dans l’écriture, qu’un fragment de texte comme l’épilogue s’avère également révélateur sur le plan subjectif.
Quid enim nisi vota supersunt ?[62]
Sous l’aspect ironiquement moderne où nous l’avons examiné, le choléra de l’épilogue apparaît comme un mal parfaitement assorti à la Belgique-civilisation. Il représente, lui aussi, une puissance de négation de la singularité. Comme tel, il s’impose également comme l’expression hyperbolique de tout ce qui contrarie le désir du Baudelaire « de la fin », de tout ce qui frustre et avive cruellement, en ce moment de son existence plus qu’en aucun autre, son désir de distinction, de différenciation.
Il est d’autant plus important de reconnaître le rôle agissant qui revient à ce désir qu’il semble, dans l’économie textuelle du feuillet, faire pression au-delà du premier paragraphe et motiver, en leur fond, tout ou partie des considérations « touristiques » distribuées dans la série de courts alinéas. Il semble par là même indiquer entre les deux segments génériquement distincts de l’ensemble – segment poético-narratif d’une part et segment notationnel d’autre part – le lien d’une certaine unité, le fil d’une continuité qu’on peut à certains égards juger contradictoire mais qu’on aurait sans doute tort d’attribuer au seul hasard[63].
Relisons les trois premiers alinéas du second segment :
Une jolie observation : après de nombreux écussons dédiés à l’union, à l’amitié, à la fidélité, à la constitution, à la Vierge Marie, j’en ai trouvé un dédié : à la Police.
Est-ce la policy anglaise ?
Peuple inepte, dans ses joies et dans ses voeux !
Au regard amusé, et ici encore affûté par l’ironie, de Baudelaire, les « écussons » qu’arborent les édifices belges apparaissent d’abord comme des artefacts des aspirations belges. Ou, plutôt, comme des preuves de l’absence d’aspirations véritables – véritablement individuelles – chez les Belges. Ce que ses inscriptions dédicatoires lui révèlent, avant toute chose, c’est l’inaptitude de ce peuple à désirer, son « ineptie » « dans ses joies » et plus encore, semble-t-il, « dans ses voeux » (nous soulignons). En les transcrivant moqueusement, Baudelaire se donne donc l’occasion de reprendre et d’aggraver un motif de détractation dont il use souvent dans les notes de La Belgique déshabillée. À travers elles, il peut dénoncer une nouvelle fois le défaut congénital de volonté qu’il impute aux Belges et qui en fait à ses yeux un peuple incurablement mou, un peuple de « moutons » et de « mollusque[s] », ou bien encore un « peuple automate » (OC II, 824, 844, 947) et gouverné par un roi idoine, faisant figure d’« Automate en hôtel / Garni » (Amoenitates Belgicae, OC II, 971).
Cette absence de volonté individuelle, cette carence de désir propre, est représentative de ce que Roger Kempf considère comme l’identité « contredandy[64] » des Belges baudelairiens. La référence au dandy – qui donne corps à l’idéal moderne de la distinction artiste, comme on sait, et qui incarne plus précisément chez Baudelaire un modèle de volonté[65], vertu cardinale s’il en est de son éthique et de son esthétique – se recommande d’autant plus à l’attention qu’elle est, en l’occurrence, appelée de manière assez explicite par la question relative à la dédicace « À la Police » (« Est-ce la policy anglaise ? »). Question ostensiblement rhétorique, même antiphrastique, tant il paraît évident que l’évocation de ce peuple censément incapable de fixer ses souhaits et ses dévotions sur autre chose que sur des entités morales ou politiques présentées comme banalement fraternitaires (l’« union », l’« amitié », la « fidélité », la « constitution ») interdit de lui attribuer cette sorte d’intelligence courtoise, mettant en avant l’autonomie individuelle plutôt que l’esprit d’obéissance, qu’on associe traditionnellement à la « policy anglaise », et qu’on peut en effet rapprocher de l’urbanité dandy.
Les quelques notes inspirées par les écussons belges, on le constate, ne semblent pas s’inscrire tout à fait par hasard à la suite de la vision du choléra : en thématisant l’idée d’une certaine capacité ou incapacité à désirer, elles communiquent avec le registre votif et le régime optatif dans lesquels s’énonce le développement visionnaire du premier paragraphe, en tant qu’il constitue aussi et d’abord une invocation, un souhait, une prière ; du coup, elles mettent en relief, par un vif contraste, tout ce que le sujet baudelairien est capable, lui, de souhaiter, de vouloir, de désirer, tout ce qu’il est en mesure, lui, de projeter et de faire advenir imaginairement. En d’autres mots, l’« ineptie » des Belges en matière de voeux vient accuser en négatif la suprématie de Baudelaire dans l’ordre du vouloir, son extraordinaire et inégalable, dirait-on, puissance de volition. Comme si le désir de distinction du poète poussait ici à une distinction dans les désirs, à une hiérarchisation des potentiels de désir. De fait, la disparité de force et d’inspiration entre Baudelaire et les Belges, entre le dandy et les « contredandies », ne saurait apparaître plus clairement qu’à travers le contraste de celui qui appelle le choléra sur toute une nation, traite d’égal à égal avec Thanatos, et de ceux qui, dans un repli pieux et complaisant, adressent leurs voeux à la société du progrès, prient pour le monde « comme il va ».
Aussi bien, s’il n’est pas certain que la prophétie de l’épilogue révèle quelque don de double vue, et si elle incite à croire que l’auteur de La Belgique déshabillée a épuisé presque toutes les ressources lyriques de sa muse malade – jusqu’à faire penser au « prophète le plus désolé depuis les prophètes d’Israël », ainsi que le suggérait Proust[66] –, la vision qu’elle inspire n’en constitue pas moins une terrible protestation de vie.
Appendices
Note biographique
Patrick Thériault est professeur agrégé de littérature française à l’Université de Toronto. Ses recherches portent principalement sur la modernité poétique et l’histoire des idées au xixe siècle. Entre autres travaux, il a publié Le (dé)montage impie de la Fiction : la révélation moderne de Mallarmé (Champion, 2010) ; codirigé avec Jean-Jacques Hamm : Composer avec la mort de Dieu. Littérature et athéisme au xixe siècle (P. de l’U. Laval / Hermann, 2014) ; et dirigé : Une littérature « comme incantatoire ». Aspects et échos de l’incantation en littérature (xixe - xxie siècle) (Presses françaises de l’Université de Toronto, 2018).
Notes
-
[1]
Oeuvres, suivies d’un Dictionnaire Joseph de Maistre, publiées par Pierre Glaudes, Paris, Laffont, « Bouquins », 2007, p. 764.
-
[2]
Fusées, dans Oeuvres complètes, publiées par Claude Pichois, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2 vol., 1975 et 1976 ; t. I, p. 667. Sauf indication contraire, toutes nos références à l’oeuvre de Baudelaire se rapportent à cette édition désormais abrégée OC suivi des numéros du tome et de la page.
-
[3]
Baudelaire, Correspondance, publiée par Claude Pichois et Jean Ziegler, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2 vol., 1973 ; t. II, p. 417. Toutes nos références à la correspondance de Baudelaire se rapportent à cette édition désormais abrégée Corr. suivi des numéros du tome et de la page.
-
[4]
Voir André Guyaux, « Pauvre France et La Belgique déshabillée », dans Claudine Gothot-Mersch et Claude Pichois (dir.), Mélanges de littérature en hommage à Albert Kies, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, « Collection générale », 1985, p. 75-85.
-
[5]
Il s’agit du dernier titre envisagé par Baudelaire dans sa correspondance (fin 1865-début 1866). Voir la présentation par André Guyaux de Fusées. Mon coeur mis à nu. La Belgique déshabillée suivi de Amoenitates Belgicae, Paris, Gallimard, « Folio classique », 1986, p. 58-61.
-
[6]
Ibid., p. 316 (pour le texte) et p. 724-725 (pour la notice éditoriale). Notons que, dans le groupement des notes et la division par chapitres de La Belgique déshabillée, Baudelaire emploie à plusieurs reprises le terme « épilogue » en guise de titre ou de composante titulaire (OC II, 953, 955, 956, 957).
-
[7]
Voir Giovanna Angeli, Le prove e i testi. Letture francesi, Pise, Pacini, « Saggi Critici », 1975, p. 137-141 (cité par André Guyaux, op. cit., p. 725-726, note 1 de la p. 316) ; et Jérôme Solal, « Une histoire belge : Baudelaire et la guerre à (la) répétition », dans Marie-Catherine Huet-Brichard et Helmut Meter (dir.), La polémique contre la modernité. Antimodernes et réactionnaires, Paris, Classiques Garnier, « Rencontres », 2011, p. 85-86.
-
[8]
Nous citons l’épilogue dans l’édition d’André Guyaux (op. cit., p. 316), plutôt que OC II, 956. André Guyaux a choisi d’en restituer la troisième partie (les deux derniers alinéas), que Claude Pichois avait intégrée au chapitre XXV (OC II, 943). Nous estimons que le choix de cette restitution est préférable, pour des raisons qui devraient apparaître en conclusion.
-
[9]
Jérôme David, « Baudelaire à Bruxelles. Style de la flânerie et individuation esthétique », dans Laurent Jenny (dir.), Le style en acte. Vers une pragmatique du style, Genève, MétisPresses, « Voltiges », 2011, p. 88.
-
[10]
Voir Claude Pichois, L’image de la Belgique dans les lettres françaises de 1830 à 1870, Paris, Nizet, 1957 ; et Gustave Charlier, Passages, Bruxelles, La Renaissance du livre, 1947, p. 178-180.
-
[11]
Voir Bertrand Gervais, Logiques de l’imaginaire, t. III : L’imaginaire de la fin, Montréal, Le Quartanier, « Erres Essais », 2009 ; et l’ouvrage récent de Jean-Paul Engélibert, Fabuler la fin du monde. La puissance critique des fictions d’apocalypse, Paris, La Découverte, « L’horizon des possibles », 2019. Nous employons les expressions « imaginaire de la fin » et « discours de la fin » de manière équivalente.
-
[12]
Bertrand Gervais, op. cit., p. 41, 64-67.
-
[13]
Émile Littré, cité par Claude Millet, « Charles Baudelaire, la fin du monde et nous », Écrire l’histoire, no 15, 2015, p. 205.
-
[14]
Voir Philippe Lacoue-Labarthe et Jean-Luc Nancy, avec la collaboration d’Anne-Marie Lang, L’absolu littéraire. Théorie de la littérature du romantisme allemand, Paris, Seuil, « Poétique », 1978, p. 63. Remarquons que la portée synthétique de l’épilogue est telle qu’elle couvre presque tout l’empan thématique des matières de La Belgique déshabillée. Matières qui comprennent aussi, en marge des considérations sur les moeurs politiques et sociologiques belges, des observations sur les « villes d’art » de Belgique. Les quelques notations sur les « écussons », l’« architecture jésuite » et les « guides » – qui suivent immédiatement le premier et principal paragraphe de l’épilogue et qui, quoi qu’elles suggèrent en première lecture, le prolongent à certains égards – se rapportent à cette composante « touristique » de La Belgique déshabillée. Elles reflètent par là même ce qu’on peut considérer comme le versant heureux ou lumineux de l’expérience belge de Baudelaire, versant où se découvre l’émerveillement du « touriste » parisien face à l’art décoratif et architectural de certaines églises « jésuites », notamment, et où quelque chose de la « “primitive passion” » du poète pour les « images » trouve ainsi à « transperce[r] la misanthropie » (André Guyaux, « Le tourisme de Baudelaire en Belgique », dans Marc Quaghebeur et Nicole Savy [dir.], France-Belgique, 1848-1914. Affinités-ambiguïtés, Bruxelles, Labor, « Archives du futur », 1997, p. 250). Ainsi considéré, l’épilogue ne reproduit pas seulement la composition thématique de La Belgique déshabillée ; en sa double articulation « apocalyptique » (dysphorique) et « renaissante » (euphorique), il semble se conformer de manière plus générale et fondamentale à la nature paradoxale des discours de la fin, un type de discours qui, comme le note Frank Kermode, ne se limitent pas en général à annoncer ou évoquer des scènes d’anéantissement, mais formulent aussi des promesses, indiquent l’horizon d’une certaine régénérescence (The Sense of an Ending. Studies in the Theory of Fiction, Oxford, Oxford University Press, 2000 [1967], p. 9). Point de meilleure illustration que l’essai (dont la verve pamphlétaire, d’ailleurs, semble beaucoup devoir à l’héritage baudelairien) Une lueur d’espoir publié par Marc-Édouard Nabe dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001 (Monaco, Éditions du Rocher, 2001). – Nous reviendrons, en conclusion, sur certains aspects de l’unité et de la continuité de l’épilogue.
-
[15]
Baudelaire, lettre à Julien Lemer du 3 février 1865 (Corr. II, 443). On remarquera que la double visée accusatrice et bouffonne de ce discours est parfaitement exprimée, on pourrait même dire légendée, dans l’épilogue, dans la référence à « la grimace de l’agonie de ce hideux peuple ». Si la grimace fait signe, ici comme ailleurs en modernité, vers le grotesque, le fait qu’elle vienne qualifier, en plus, au second degré, des figures posées en elles-mêmes comme « hideuses » accentue sa portée caricaturale et donne à penser, par un suggestif raccourci, l’hypercaricaturalité du Baudelaire de Belgique. Voir notre article « Outrance et outrage poétiques chez le dernier Baudelaire : les Amoenitates Belgicae et le poème-caricature », Les Lettres romanes, vol. 73, nos 3-4, 2019, p. 437-458.
-
[16]
Nous développons actuellement l’hypothèse de ce passage dans le cadre d’un projet d’essai consacré à « Baudelaire et la “Muse des derniers jours” ».
-
[17]
Jean-Pierre Vidal, « “Moi seule en être cause…”. Le sujet exacerbé et son désir d’apocalypse », Protée, vol. 27, no 3 (« L’imaginaire de la fin », Anne Élaine Cliche et Bertrand Gervais [dir.]), hiver 1999-2000, p. 45. – Saint Augustin n’est pas loin d’exprimer la même idée, lorsqu’il évoque « les terreurs de la Fin comme une figure de la mort personnelle » (Frank Kermode, op. cit., p. 25 et 186, nous traduisons).
-
[18]
Patrice Bourdelais, cité par Thierry Eggerickx et Michel Poulain, « Le choléra, cet autre fléau social du xixe siècle. L’épidémie de 1866 en Belgique et l’exacerbation des inégalités face à la mort », dans Historiens et populations. Liber amicorum Étienne Hélin, contributions rassemblées par la Société belge de démographie, Louvain-la-Neuve, Academia, 1991, p. 203. D’un historien à l’autre, on constate des différences dans le découpage et le sous-découpage chronologiques des épidémies, donc dans leur nombre.
-
[19]
Thibaut Weitzel, Le fléau invisible. La dernière épidémie de choléra en France, Paris, Vendémiaire, « Chroniques », 2011, p. 14.
-
[20]
Thierry Eggericks et Michel Poulain, loc. cit., p. 204.
-
[21]
Toute déterminée qu’elle soit sur le plan rhétorique, par sa fonction phatique, cette formule ne semble pas moins embrayer sur l’« autre scène » de l’énonciation baudelairienne. D’autant qu’elle en répète d’autres. À la suite de Giovanna Angeli (op. cit., p. 140-141), André Guyaux (op. cit., p. 726, note 1 de la p. 316) la rapproche de celle de « L’Examen de minuit » (publié en février 1863) : « Aujourd’hui, date fatidique, / Vendredi, treize, nous avons, / […] » (Les Fleurs du Mal, OC I, 144), et surtout de celle du feuillet 86 de Fusées : « […] aujourd’hui 23 janvier 1862, j’ai subi un singulier avertissement, j’ai senti passer sur moi le vent de l’aile de l’imbécillité » (OC I, 668). Cette dernière occurrence est d’autant plus signifiante qu’elle introduit une notation qui, comme l’épilogue, renvoie à une maladie et procède d’un régime prédictif, à titre d’« avertissement ». Entre le choléra dont Baudelaire guette et souhaite le déclenchement, et la syphilis dont il attend, dans les années mille huit cent soixante, la « venue » en quelque sorte décisive (ainsi écrit-il à sa mère en février 1866 : « “[A]h çà ! raisonnons ! Si c’est l’apoplexie ou la paralysie qui vient, que ferai-je et comment mettrai-je ordre à mes affaires ?” », Corr. II, 595), il est difficile de ne pas entrevoir des jeux de déplacement et de réinvestissement d’affects (frustration, colère, honte…), impliquant l’identification, tout autant que l’opposition, bien sûr, du sujet baudelairien au Belge contaminé.
-
[22]
Thierry Eggericks et Michel Poulain, loc. cit., p. 212-213.
-
[23]
Voir René Garguilo, « Mythologie du choléra », dans Max Milner (dir.), Pathologie et littérature, Saint-Denis, Presses universitaires de Vincennes, « L’imaginaire du texte », 1989, p. 149-165.
-
[24]
Voir Annick Opinel, « Du choléra morbus et de ses représentations dans la peinture française du xixe siècle », Histoire de l’art. Bulletin d’information de l’Institut national d’histoire de l’art, no 46, juin 2000, p. 67-76, et Patrice Bourdelais et Jean-Yves Raulot, Une peur bleue. Histoire du choléra en France. 1832-1854, Paris, Payot, « Médecine et sociétés », 1987, p. 245-248.
-
[25]
Jean Lucas-Dubreton, La grande peur de 1832. (Le choléra et l’émeute), Paris, Gallimard, « NRF », 1932, p. 24.
-
[26]
Le Juif errant, Paris, Laffont, « Bouquins », 1983, p. 116 (cité par René Garguilo, loc. cit., p. 152). – Parution en feuilletons dans Le Constitutionnel du 25 juin 1844 au 26 août 1845.
-
[27]
La formule sert de titre à la traduction française de la nouvelle de Bram Stoker The Invisible Giant (1881).
-
[28]
Thierry Eggericks et Michel Poulain, loc. cit., p. 216.
-
[29]
Les classes supérieures, bien sûr, ne sont pas complètement épargnées : un grand bourgeois comme Manet, pour rappeler un cas qui émouvra Baudelaire, doit lui aussi, à l’automne 1865, « pay[er s]on tribut à l’épidémie régnante »… il est vrai sans y laisser la vie (lettre d’Édouard Manet à Baudelaire du 25 octobre 1865, dans Études baudelairiennes, t. IV-V [« Lettres à Charles Baudelaire »], 1973, p. 237). La forte réaction de Baudelaire au témoignage du peintre atteint par la maladie mérite d’être citée : « Mon cher ami, / Les premières lignes de votre lettre m’ont donné le frisson. Il n’y a pas dix personnes en France, – non certes, il n’y en a pas dix, – au sujet desquelles j’en pourrais dire autant » (Corr. II, 538).
-
[30]
Notons à ce titre que la référence au choléra se rencontre aussi, hors des écrits belges, en deux points de l’oeuvre baudelairienne : dans « Quelques caricaturistes français », en lien avec la description d’un dessin de Daumier représentant la désolation du Paris frappé par le fléau (OC II, 554) ; et dans l’un des reliquats du Spleen de Paris où le poète mentionne une gravure d’Alfred Rethel, Der Tod als Erwürger, qui illustre la « Première apparition du Choléra à un bal masqué à Paris, 1831 » (OC I, 374).
-
[31]
François Delaporte, Le savoir de la maladie. Essai sur le choléra de 1832 à Paris, Paris, Presses universitaires de France, « Bibliothèque d’histoire des sciences », 1990, p. 37.
-
[32]
Jean Lucas-Dubreton, op. cit., p. 25.
-
[33]
François Delaporte, op. cit., p. 75-77.
-
[34]
Cité par François Delaporte, ibid., p. 37.
-
[35]
Ibid., p. 47.
-
[36]
Ibid., p. 80.
-
[37]
Alexandre Moreau de Jonnès, cité par François Delaporte, ibid. Notons que Baudelaire recourt à la figure d’Attila ailleurs dans La Belgique déshabillée, pour signifier aussi une forme de destruction des Belges : après avoir exprimé son opposition au projet d’annexion de la Belgique par la France, il prend un malin plaisir à préciser qu’il ne serait toutefois pas « ennemi d’une invasion et d’une razzia, à la manière antique, à la manière d’Attila » (OC II, 919). Dans le contexte de l’épilogue, la valeur expressive du personnage d’Attila est accrue par le fait qu’il souligne le caractère oriental du choléra – épidémie originaire de l’Inde (ou de la Chine) et continûment imputable, dans l’imaginaire européen, à l’Asie. C’est ce même sème oriental qui revient dans la prédication la « race aux cheveux jaunes, nankin ». Qualifiant le Belge aussi bien que le choléra, il manifeste leur nature pareillement barbare, étrangère.
-
[38]
Pour un exemple (s’il en est besoin) d’allégorisation de l’idée de progrès sous le motif de la marche, on peut citer Hugo, dans Les Misérables (V, I, 20) : « Le progrès marche ; il fait le grand voyage humain et terrestre vers le céleste et le divin ; il a ses haltes où il rallie le troupeau attardé ; il a ses stations où il médite, en présence de quelque Chanaan splendide dévoilant tout à coup son horizon ; il a ses nuits où il dort ; et c’est une des poignantes anxiétés du penseur de voir l’ombre sur l’âme humaine, et de tâter dans les ténèbres, sans pouvoir le réveiller, le progrès endormi » (cité par André Guyaux, « Préface » à Fusées. Mon coeur mis à nu et autres fragments posthumes, Paris, Gallimard, « Folio classique », 2016, p. 20 ; nous ne citerons ce volume qu’une seule autre fois, voir note 61).
-
[39]
Thibaut Weitzel, op. cit., p. 15. Patrice Bourdelais et Jean-Yves Raulot observent en ce sens : « Pendant des siècles et jusqu’au cours de la première moitié du xixe siècle, le choléra a progressé au pas de l’homme ou du cheval, au rythme des caravanes ou des voiliers. […] / En janvier 1849, et pour la première fois, c’est le chemin de fer nouvellement créé qui, entre Douai et Le Havre, achemine la troupe et le choléra. En 1854, les propagations principales de la contagion suivent à nouveau très nettement les voies de chemin de fer à peine ouvertes, ou même en construction » (op. cit., p. 50).
-
[40]
Si elle reste sujette à caution et mobilise une contextualisation méthodologique que l’on peut juger onéreuse, et dont nous préférons nous dispenser, la notion de sociogramme a l’avantage de mettre en valeur la conflictualité inhérente à la conceptualisation des phénomènes justiciables de l’imaginaire social. On se rappellera que Claude Duchet la définit comme « un ensemble flou, instable, conflictuel de représentations partielles en interaction les unes avec les autres, centré autour d’un noyau lui-même conflictuel » (cité par Maxime Prévost, « “Rien ne blesse, ni mes idées, ni mes sentiments là-dedans” : Pierre-Jules Hetzel et le sociogramme du progrès chez Jules Verne », COnTEXTES, no 21, 2018, note 6 ; disponible en ligne, doi : 10.4000/contextes.6583). Soulignons, du point de vue de l’histoire des idées autant que de notre analyse, que l’idée de progrès paraît à ce titre exemplaire : elle s’impose non seulement comme « le grand paradigme spéculatif issu des Lumières, paradigme qui a dynamisé toute la modernité intellectuelle », mais également comme une construction conceptuelle intrinsèquement conflictuelle, ayant été « contesté[e] depuis toujours par les Cassandre de la “décadence” » et ayant « éclaté très vite en plusieurs avatars contradictoires » (Marc Angenot, cité par Maxime Prévost, ibid., § 25).
-
[41]
Thierry Eggericks et Michel Poulain, loc. cit., p. 205.
-
[42]
François Delaporte, op. cit., p. 48.
-
[43]
Ibid., p. 87. Dans le rapport qu’il publie en 1832, le célèbre docteur Villermé ne se fait ainsi aucun scrupule d’affirmer que « le choléra en sévissant principalement sur les vagabonds, les gens sans aveu, sans moyens d’existence, toujours prêts à violer les lois de la société, [avait] dû au moins épurer celle-ci » (cité par Patrice Bourdelais et Jean-Yves Raulot, op. cit., p. 238). Fait intéressant, pris en ce sens, pour signifier « l’élimination des membres jugés indésirables dans une société », le mot « épuration » dériverait de la littérature médicale autour de la première vague de choléra (François Delaporte, op. cit., p. 40).
-
[44]
Lettre à Alphonse Baudelaire, fin août ou début septembre 1835 [?], Corr. I, 34. Le discours du Père que reproduit Baudelaire coïncide très exactement avec celui de son beau-père : le lieutenant-colonel Aupick avait été appelé à Lyon le 25 novembre 1831 par Louis-Philippe pour réprimer la première révolte des canuts. Son action jugée efficace lui vaudra d’être nommé tout juste après chef d’état-major.
-
[45]
Sur Baudelaire politique, voir Richard D. E. Burton, Baudelaire and The Second Republic. Writing and Revolution, Oxford, Clarendon Press, 1991.
-
[46]
Le peintre de la vie moderne, OC II, 712.
-
[47]
Jérôme Solal, loc. cit., p. 75-91. Voir aussi Richard D. E. Burton, « Baudelaire, Belgians, Jews », Essays in French Literature, nos 35-36, 1998-1999, p. 69-112.
-
[48]
Envisagée sous cet angle, l’apocalypse de Baudelaire n’est pas sans rappeler celle que Poe évoque, en des termes également prophétiques, dans Colloque entre Monos et Una [The Colloquy of Monos and Una] (Edgar Poe. Contes, essais, poèmes, publié par Claude Richard, Paris, Laffont, « Bouquins », 1989, p. 563-571). On notera aussi, en passant, en évoquant Poe, que l’exploitation du thème du choléra fait, elle, penser au Masque de la mort rouge [The Masque of the Red Death] (ibid., p. 593-597), une autre des Nouvelles histoires extraordinaires (1857).
-
[49]
Baudelaire en fait un jeu de mots dans la deuxième strophe d’« Une eau salutaire » : « “Voyez – dit ce Belge badin / Qui n’est certes pas un ondin – / La contrefaçon de la Seine.” / – “Oui – lui dis-je – une Seine obscène !” » (Amoenitates Belgicae, OC II, 968).
-
[50]
Voir OC II, 869 et passim.
-
[51]
Voir « Une eau salutaire » (OC II, 968), « La nymphe de la Senne » (OC II, 969-970) et « Opinion de M. Hetzel sur le faro » (OC II, 970).
-
[52]
Voir Claude Pichois, L’image de la Belgique dans les lettres françaises de 1830 à 1870, op. cit., p. 45. – On connaît le cri du coeur de Balzac : « La Belgique a ma fortune » (Lettres à madame Hanska, Paris, Laffont, « Bouquins », 1990, t. I, p. 627 ; 22 décembre 1842), qui pourrait résumer le ressentiment de bon nombre d’écrivains français victimes de la contrefaçon belge. On rappellera aussi, pour sa valeur exemplaire, le combat que Balzac a lui-même livré pour endiguer ce fléau, que ce soit en qualité de président de la Société des gens de lettres, en tant que rédacteur ou co-rédacteur du Mémoire sur la situation actuelle de la contrefaçon des livres français en Belgique… (1841) ou bien en tant que préfacier (voir notamment la « Préface » à Un grand homme de province à Paris, 1839).
-
[53]
Baudelaire résume sa conception des moeurs du Belge en un passage particulièrement lapidaire de l’« Argument » de La Belgique déshabillée : « Ne sortons pas pour le juger, de certaines idées : Singerie, Contrefaçon, Conformité, Impuissance haineuse, – et nous pourrons classer tous les faits sous ces différents titres » (OC II, 844).
-
[54]
Cette référence au « centumgeminus Briareus » de la mythologie, qu’Énée croise lors de sa descente aux enfers (Virgile, Énéide, VI, v. 287), communique thématiquement avec celle du Styx.
-
[55]
Sur la symbolique du serpent chez Baudelaire, voir Patrick Labarthe, Baudelaire et la tradition de l’allégorie, Genève, Droz, « Titre courant », 2015 [1999], p. 689-694.
-
[56]
Impression d’ailleurs renforcée par l’étymologie : « Laocoon » (Λαοκόων) signifiant « celui qui comprend le peuple ».
-
[57]
Notons que l’identité du Belge et du choléra est posée en termes plus explicites encore dans « À propos d’un importun qui se disait son ami ». Voici les deux dernières strophes de cette pièce des Épaves (dont le sujet est esquissé dans un feuillet de La Belgique déshabillée, OC II, 857) : « Ce monstre se nomme Bastogne ; / Il fuyait devant le fléau. / Moi, je fuirai jusqu’en Gascogne, / Ou j’irai me jeter à l’eau, // Si dans ce Paris, qu’il redoute, / Quand chacun sera retourné, / Je trouve encore sur ma route / Ce fléau, natif de Tournai » (OC I, 176-177).
-
[58]
Voir Daniel Vouga, Baudelaire et Joseph de Maistre, Paris, Corti, 1957, p. 45.
-
[59]
Rappelons la plus célèbre d’entre elles : « Ce fanal obscur, invention du philosophisme actuel, breveté sans garantie de la Nature ou de la Divinité, cette lanterne moderne jette des ténèbres sur tous les objets de la connaissance ; la liberté s’évanouit, le châtiment disparaît. Qui veut y voir clair dans l’histoire doit avant tout éteindre ce fanal perfide. Cette idée grotesque, qui a fleuri sur le terrain pourri de la fatuité moderne, a déchargé chacun de son devoir, délivré toute âme de sa responsabilité, dégagé la volonté de tous les liens que lui imposait l’amour du beau : et les races amoindries, si cette navrante folie dure longtemps, s’endormiront sur l’oreiller de la fatalité dans le sommeil radoteur de la décrépitude. Cette infatuation est le diagnostic d’une décadence déjà trop visible » (« Exposition universelle, 1855, Beaux-Arts », OC II, 580).
-
[60]
Il précise dans un autre feuillet : « La Belgique est plus remplie que tout autre pays de gens qui croient que J[ésus-]C[hrist] était un grand homme, que la Nature n’enseigne rien que de bon, que la morale universelle a précédé les dogmes dans toutes les religions, que l’homme peut tout et que la vapeur, le chemin de fer et l’éclairage au gaz prouvent l’éternel progrès de l’humanité » (OC II, 895-896). Dans l’édition d’André Guyaux, on lit : « […] que l’homme peut tout, même créer une langue et que la vapeur, le chemin de fer […] » (op. cit., p. 221).
-
[61]
Il s’agit du feuillet 58 : « Théorie de la vraie civilisation. / Elle n’est pas dans le gaz, ni dans la vapeur, ni dans les tables tournantes, elle est dans la diminution des traces du péché originel » (OC I, 697). Voir le commentaire d’André Guyaux dans les notes de Fusées. Mon coeur mis à nu et autres fragments posthumes, op. cit., p. 396-398, note 3 de la p. 107.
-
[62]
Ovide, Tristes, texte établi et traduit par Jacques André, Paris, Les Belles Lettres, « Collection des universités de France », 1968, p. 7 (« puisque seuls les voeux me restent »).
-
[63]
André Guyaux commente l’unité des deux segments en ces termes : « La contradiction – on dirait presque la frivolité de Baudelaire – consiste à parler de “l’architecture des Jésuites”, qu’il aime tant, au bas du même feuillet. Est-ce là une raison supplémentaire de ne pas couper en deux l’unité fortuite et paradoxale d’un même feuillet ? » (op. cit., p. 726, note 2 de la p. 316).
-
[64]
Voir Roger Kempf, « Du Belge comme contredandy », dans Dandies. Baudelaire et Cie, Paris, Seuil, « Pierres vives », 1977, p. 103-118.
-
[65]
Voir, entre autres, le feuillet 5 de Mon coeur mis à nu, où ce modèle apparaît en négatif de la dénonciation de la femme comme créature subordonnée aux besoins naturels (OC I, 677).
-
[66]
Lettre à André Beaunier, vers le 15 octobre 1913, citée par André Guyaux, op. cit., p. 11.