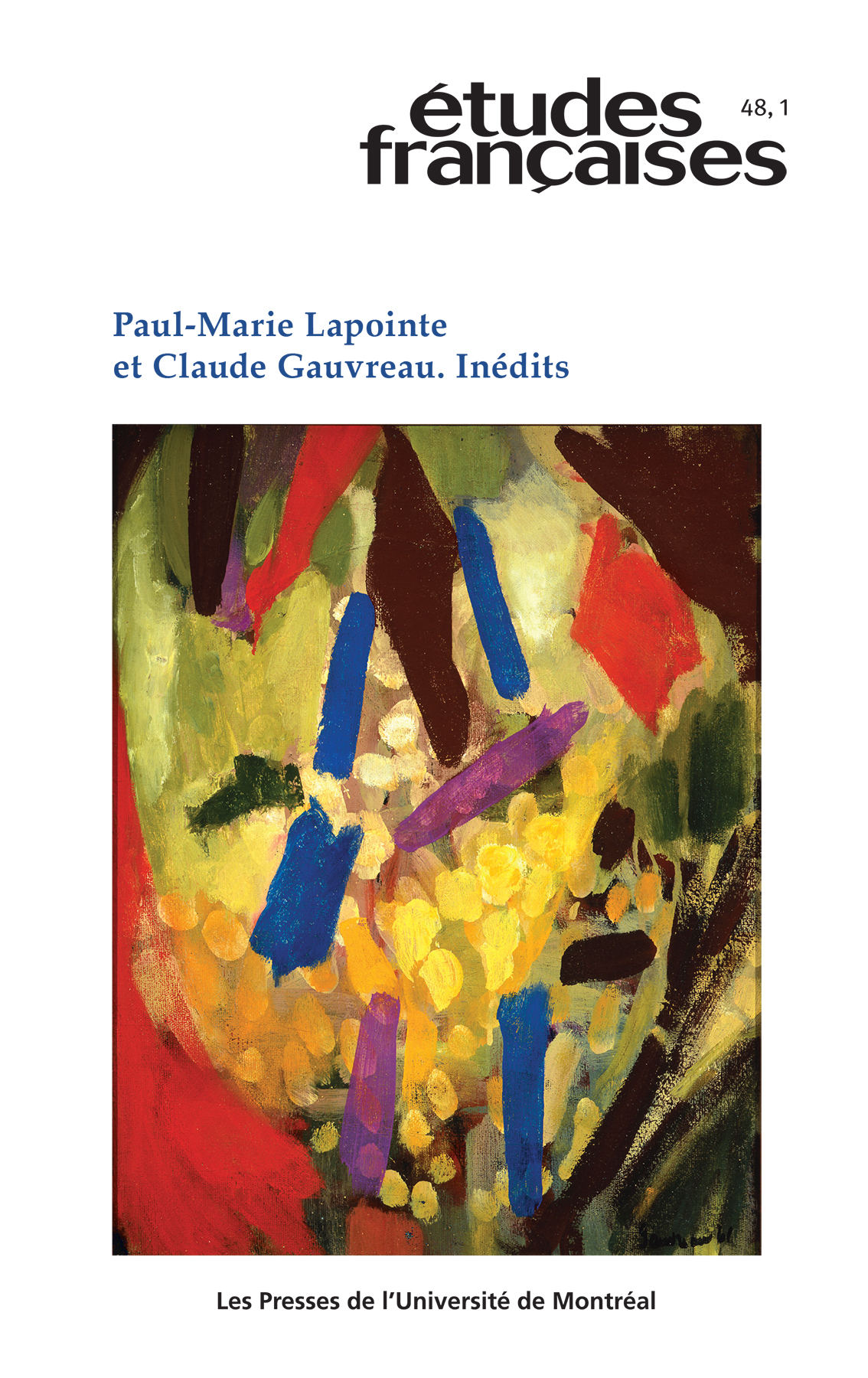Cette livraison de la revue Études françaises, placée sous le signe de l’inédit, rend hommage à deux figures majeures de la littérature québécoise, Paul-Marie Lapointe et Claude Gauvreau. De Paul-Marie Lapointe, Gaston Miron a déjà déclaré qu’il était « notre plus grand poète », propos rappelé en ces pages par Pierre Nepveu, qui souligne la vive admiration que l’auteur de L’homme rapaillé vouait au poète originaire de Saint-Félicien. Poète de tout premier plan et dramaturge prolifique, Claude Gauvreau n’est certes pas en reste, lui dont la langue exploréenne résonne puissamment encore aujourd’hui sur les plus grandes scènes québécoises. L’histoire de ces deux écrivains fut, on le sait, particulièrement liée durant les mois qui précédèrent la parution, en 1948, du Vierge incendié de Lapointe aux éditions Mithra-Mythe. Cherchant un éditeur, Paul-Marie Lapointe, à la suggestion de Robert Blair, qui avait eu Gauvreau comme condisciple au collège Sainte-Marie, se rendit chez le poète automatiste accompagné de Blair et Jean Lefébure, et lui confia son manuscrit : « Après le départ des trois, je me mis à lire ces courts poèmes ; et, plus je lisais, plus j’étais impressionné. Je parlai de ce texte à plusieurs personnes, dont Maurice Perron ; et c’est ainsi que Le vierge incendié fut édité par Mithra-Mythe. » Pierre Gauvreau assura la préparation du recueil et illustra la couverture d’un dessin érotique inspiré du Surmâle de Jarry. Après Refus global, il s’agissait, pour la maison d’édition dirigée par Maurice Perron, du second appel radical à la liberté posé en cette année charnière. Un triste concours de circonstances a voulu que Pierre Gauvreau et Paul-Marie Lapointe nous quittent à quelques mois d’intervalle, ce qui a rendu à nos yeux la réalisation du présent numéro d’autant plus nécessaire et urgente. En publiant les « Petits poèmes animaux » de Paul-Marie Lapointe et l’édition critique de la lettre adressée le 7 janvier 1961 par Claude Gauvreau à André Breton, la revue Études françaises renoue avec une tradition critique déjà ancienne, qui consiste à mettre à la disposition de ses lecteurs des textes d’écrivains inédits ou difficiles d’accès, conférant du coup à ces écrits une actualité et, pour certains, une intelligibilité neuve. En ce qui concerne les inédits de Paul-Marie Lapointe, la suite de poèmes que nous publions ici sous le titre « Petits poèmes animaux » appartient à un projet des années 1975-1976 resté inachevé et qui figure parmi les travaux poétiques que l’écrivain avait choisi de garder auprès de lui même après la cession de ses archives personnelles. Issus d’une entreprise menée en collaboration avec son fils Frédéric, ces poèmes-images sont pour certains d’entre eux le fruit de la rencontre, sous la forme d’un collage, d’un dessin d’enfant et d’un poème. S’est ainsi instauré, entre l’image et le texte, un dialogue complice, où le jeu et l’humour occupent une grande place. C’est au foisonnement du monde de Paul-Marie Lapointe et à sa faune bigarrée, « monde surpeuplé, fourmillant, pléthorique » que Pierre Nepveu convie ici le lecteur. Dans sa lecture où l’ontologie occupe une place centrale — car « la poésie de Lapointe, écrit Nepveu, a l’aptitude à être, plus qu’aucune autre, totalement présente à elle-même à chaque instant » —, celui-ci examine les spécificités de la vision cosmologique qui soutient les deux grands récits privilégiés par Lapointe, l’économie politique et l’économie naturelle, et qui préfigure le grand récit hégémonique de l’écologie. Pénétrée des couleurs archaïques et mythologiques tout en restant pourtant profondément ancrée dans le monde contemporain, parasitée par les figures du pouvoir, la poésie de Lapointe trouve en effet toute sa force dans sa capacité à …
Présentation[Record]
- Gilles Lapointe
Online publication: Oct. 24, 2012
A document of the journal Études françaises
Volume 48, Number 1, 2012, p. 5–10
Paul-Marie Lapointe et Claude Gauvreau. Inédits
Tous droits réservés © Les Presses de l’Université de Montréal, 2012