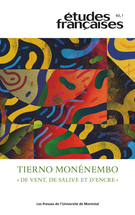
Volume 47, Number 3, 2011 Publics et publications dans les éloges collectifs de femmes à la fin du Moyen Âge et sous l’Ancien Régime Guest-edited by Renée-Claude Breitenstein
Table of contents (10 articles)
-
Présentation. Publics et publications dans les éloges collectifs de femmes à la fin du Moyen Âge et sous l’Ancien Régime
-
De « l’onneur et louenge des femmes » : les dédicaces épistolaires du Débat sur le Roman de la Rose et la réinvention d’un débat littéraire en éloge de femmes
Deborah Mcgrady
pp. 11–27
AbstractFR:
Au début du xve siècle, Christine de Pizan participe à un débat déjà en cours sur l’importance littéraire de Jean de Meun. Si les lettres qu’elle adresse à ses adversaires se plaisent à souligner que cet auteur ne mérite aucun éloge, les versions textuelles de ce débat produites entre 1402-1403 redéfinissent dans son ensemble l’enjeu du débat. En effet, Christine affirme dans les versions qu’elle a supervisées que ses interventions dans le débat n’étaient motivées que par son intention d’oeuvrer pour « l’onneur et louenge des femmes ». Aussi en appelle-t-elle au public pour la soutenir dans cette entreprise. Cet article s’appuie sur les travaux de Pierre Bourdieu concernant la formation et la mise en oeuvre des codes culturels ou des « goûts » afin d’examiner la manière dont Christine a formulé son argument en remodelant les critères d’évaluation de la littérature vernaculaire. Il s’agira d’abord d’analyser le mécanisme de l’échange entre l’auteure et ses adversaires avant de s’intéresser à la mise en oeuvre textuelle de ce débat épistolaire en portant un intérêt particulier à l’addition des deux dédicaces qui introduisent le Débat. Cette approche nous permettra de comprendre les différents axes poursuivis par Christine afin de former non seulement une communauté qui lira le débat comme un appel à la défense des femmes, mais qui répondra par un appel aux futurs éloges collectifs, tels que le Livre de la Cité des dames qui sera terminé par l’auteure trois ans plus tard.
EN:
At the outset of the 15th century, Christine de Pizan joined in an ongoing debate on the literary importance of Jean de Meun. While letters addressed to her opponents are dismissive of this author, according her scant praise, the textual versions of this debate produced between 1402 and 1403 set forth its essential issues. In fact, in the version she supervised Christine claims to have entered the debate solely to work for “l’onneur et louenge des femmes” and she calls on her public to support her in this endeavor. This article draws on Pierre Bourdieu’s work on the formation and implementation of cultural codes or “tastes” to examine how Christine formulated her argument by reinventing the criteria used to assess vernacular literature. Examining first the exchange mechanism between the author and her adversaries, this study then turns to the textual mise en oeuvre of the epistolary debate with particular focus on the addition of two dedications introducing the Débat. This approach shows us the various strategies adopted by Christine to marshal a community that will read the debate as a defence of women and also generate a market for future texts in praise of women, such as the Livre de la Cité des dames that Christine would complete three years later.
-
Dédicaces à Anne de Bretagne : éloges d’une reine
Cynthia J. Brown
pp. 29–54
AbstractFR:
Dans cet article, j’examine les nombreuses dédicaces offertes à Anne de Bretagne à la fin du xve et au début du xvie siècle. Le corpus des 22 dédicaces qui sert de base à cette étude nous donne un aperçu de la nature des oeuvres dans sa bibliothèque, la motivation des auteurs qui lui ont présenté leurs livres, l’image de la reine qu’ils y ont construite, et la culture livresque de l’époque. C’est grâce en partie aux hommes écrivains engagés par Anne de Bretagne, ou attirés par la possibilité de son mécénat, que la littérature à la louange et à la défense des femmes a été promue à la cour de France, ainsi qu’auprès d’un public plus large, puisque leur stratégie consistait à portraire la reine sous un jour très positif et à faire des choix littéraires qu’elle préférait, y compris des oeuvres au sujet des femmes et leurs vertus. La plupart de ces auteurs de dédicaces s’adressaient à Anne de Bretagne sous forme manuscrite. Lorsque ces dédicaces à la reine de France précédaient des textes imprimés, elles visaient un autre public. Pour le libraire ou l’imprimeur, il s’agissait d’attirer des acheteurs bourgeois en soulignant l’association directe entre l’auteur et Anne de Bretagne. Dans l’Appendice I, je fournis une liste des 21 oeuvres contenant les 22 dédicaces adressées à Anne de Bretagne. Dans l’Appendice II, j’édite sept des dédicaces qui n’ont jamais été publiées, tirées des oeuvres suivantes : Robert du Herlin, L’Acort des mesdisans et bien disans ; Alberto Cattaneo, [Histoire des rois de France, en latin] ; Pierre Le Baud, Le liure des Cronicques des roys, ducs et princes de Bretaigne ; Antoine Dufour, Les epîtres de saint Jérôme ; Germain de Brie, Chordigerae nauis conflagratio ; Pierre Choque, L’incendie de la Cordelière ; Maximien, La Vie de Sainte Anne.
EN:
In this article, I examine the many dedications addressed to Anne of Brittany in the late 15th and early 16th centuries. The 22 dedications that form the corpus of this study offer scholars insight into the nature of the books in her library, the motivations of the authors who gave her these works, the image of the queen so depicted, and the book culture of the time. Thanks in part to the male writers seeking and receiving the patronage of Anne of Brittany, a substantial body of literature praising and defending women emerged at the French court and in the public at large, all strategically favourable to the queen and highlighting themes that would please her, including the subject of female virtues. Most of these authors addressed Anne of Brittany in manuscript form. A different public was targeted when the printed works included dedications to the queen, with printers and booksellers wooing a middle class market by playing up the author’s direct association with Anne of Brittany. Appendix I provides a list of the 21 works that contain the 22 dedications addressed to Anne of Brittany. Appendix II includes edited versions of the dedications never before published, which appear in the following works: Robert du Herlin, L’Acort des mesdisans et bien disans; Alberto Cattaneo, [Histoire des rois de France, en latin]; Pierre Le Baud, Le liure des cronicques des roys, ducs et princes de Bretaigne; Antoine Dufour, Les epîtres de saint Jérôme; Germain de Brie, Chordigerae nauis conflagratio; Pierre Choque, L’incendie de la Cordelière; Maximien, La Vie de Sainte Anne.
-
« Des circuits de pouvoir » : un modèle pour la relecture des rapports poète-mécène dans les apologies du sexe féminin de la fin du Moyen Âge
Helen J. Swift
pp. 55–69
AbstractFR:
Cet article a pour but de renouveler notre appréciation des rapports entre poète et mécène au moyen de trois études de cas de textes écrits à la louange des dames entre 1440 et 1534 : Le Champion des dames de Martin Le Franc, dédié à un homme (Philippe le Bon), La Nef des dames vertueuses de Symphorien Champier et Le Palais des nobles Dames de Jehan Du Pré, tous les deux destinés à des femmes (Anne de France et Marguerite de Navarre respectivement). Cette contribution s’intéresse en particulier au rôle que joue l’acte de publication (ou de re-publication) dans l’élaboration de ces rapports sur le plan idéologique aussi bien que matériel. On pourrait s’attendre à des rapports des plus simples dans un corpus où, semblerait-il, on n’a qu’à louer la ou les dames — adopter la rhétorique « pro-féminine » et se proclamer des plus sincères — afin de s’assurer le mécénat. Mais il arrive que les rapports ne se tissent pas de cette manière. En me servant du modèle sociologique des « circuits de pouvoir » proposé par Stewart R. Clegg dans Frameworks of Power (Londres, Sage, 1989), j’essayerai de formuler dans des termes plus précis la circulation du pouvoir dans les rapports poète-mécène dans les apologies du sexe féminin de la fin du Moyen Âge. L’article interrogera la flexibilité et l’espace de négociation issus de cet axe de communication à titre de stratégies potentielles, et, du côté négatif, les risques de résistance — autant de facteurs qui nous permettront d’identifier avec plus de nuance les enjeux de l’acte de publication et le rôle qu’y jouent ses acteurs principaux.
EN:
This article gives us a new perspective on poet-patron relations through three case studies of texts written in praise of women between 1440 and 1534: Martin Le Franc’s Le Champion des dames, dedicated to a man (Philip the Good), and La Nef des dames vertueuses and Le Palais des nobles Dames by Symphorien Champier and Jehan Du Pré, both directed at women (Anne of France and Margaret of Navarre). This contribution examines the act of publishing (or indeed re-publishing), exploring how the poet-patron relationship proceeds both materially and ideologically. One might expect a straightforward relationship in a corpus where proclamations of pro-feminine rhetoric seemingly suffice to win patronage. But clearly things did not happen so simply. Using the sociological model of “circuits of power” presented by Stewart R. Clegg in Frameworks of Power (London, Sage, 1989), I shall attempt to formulate more precisely the circulation of power in poet-patron relations in late-Medieval defences of women. This article examines the strategic possibilities of flexibility and negotiation opened up by this axis of communication, and, on the negative side, the risk of resistance—all factors which more subtly enunciate the stakes at play in the act of publishing and the roles of its principal agents.
-
Les xylographies du Palais des nobles Dames (Lyon, 1534) : un renfort pour « la querelle des honnestes femmes »
Brenda Dunn-Lardeau
pp. 71–90
AbstractFR:
Livret de 5 667 vers adressé à Marguerite de Navarre, Le Palais des nobles Dames de l’auteur Jehan Du Pré relate le songe historique au cours duquel Noblesse féminine invite Du Pré à la suivre dans les treize loci d’un palais où les femmes de tous les temps et de tous les lieux sont regroupées selon les exploits ou les qualités qui les ont immortalisées. Dans le contexte de la seconde Querelle des femmes, Du Pré montre leurs contributions à l’histoire, à la culture et à la société, reconnaît aux femmes les qualités traditionnelles de beauté, de chasteté, de fidélité et de tempérance, souligne leurs rôles dans la maternité, la guerre et la recherche de la paix, fait l’éloge de leurs capacités intellectuelles, physiques et sportives, et revalorise la vieille femme.
Cet article propose une typologie des xylographies. Celles-ci, exécutées expressément pour le Palais, illustrent des personnages stéréotypés sans respect des lois de la perspective, dans le style archaïque lyonnais, mais avec des bordures de la Renaissance italienne. Liant le texte à des xylographies inspirées d’allégories médiévales, de l’Antiquité païenne et chrétienne, et de scènes contemporaines, Du Pré, qui s’est par ailleurs lui-même mis en scène, capte ainsi l’attention d’un public de lecteurs autant que de spectateurs cultivés.
Texte et images ont des fonctions distinctes. Pourtant, le graveur, en faisant une lecture attentive du texte qu’il suit de près, ou dont il conserve généralement l’esprit lorsque le format de la vignette l’amène à supprimer quelques détails, apporte un renfort à la cause de Noblesse féminine défendue par Du Pré. Cependant, si les xylographies montrent ainsi les femmes régnant sur l’Histoire, la Géographie et les vertus morales, seul le texte, avec force arguments et exempla, donne la mesure de la situation de Noblesse féminine, fragilisée par la Querelle des femmes.
EN:
In this pro-feminine pamphlet comprising 5667 verses dedicated to Marguerite de Navarre, the author Jehan Du Pré recounts the dream in which Feminine Nobility invites him to follow her through a palace where women from every era and place congregate in thirteen thematic loci corresponding to the deeds and qualities responsible for their eternal fame. Within the context of the second Querelle des femmes, Du Pré shows women’s contributions to history, culture and society and recognizes the traditional qualities of beauty, chastity, fidelity, and temperance in the female elite. Du Pré emphasizes the specificity of their maternal role, as well as their occasional or exceptional role in war, and their quest for peace. Additionally, he praises their capacities in the arenas of sport and intellectual life and, reasserts the value of elderly women.
This article attempts to classify the woodcuts created especially for this book in the archaic style, common in Lyons, though with borders typical of the Italian Renaissance. The characters are stereotypical and outside the laws of perspective. By linking the text to woodcuts inspired by Medieval allegories, pagan and Christian Antiquity, and contemporary scenes, Du Pré (himself depicted in a woodcut) captures the attention of cultivated viewers and readers alike.
Text and images have distinct functions, yet the illustrator serves the spirit of the text and succeeds in bolstering the feminist cause championed by Du Pré even when details of the woodcuts are omitted to fit size constraints. But while the woodcuts show women reigning over History, Geography and moral virtues, it is the text itself, replete with arguments and exempla, that proves the measure of Feminine Nobility, nuanced by the Querelle des femmes.
-
Traduction, transferts culturels et construction des publics dans deux éloges collectifs de femmes de la première moitié du XVIe siècle
Renée-Claude Breitenstein
pp. 91–107
AbstractFR:
Cet article s’intéresse à la construction des publics dans deux éloges collectifs de femmes traduits du traité latin De nobilitate et praecellentia foeminei sexus d’Henri Corneille Agrippa : Le Jardin de foelicite avec la louenge & haultesse du sexe feminin en ryme françoyse, divisee par chapitres […] (1541) de François Habert et Le Fort inexpugnable de l’honneur du sexe féminin (1555) de François de Billon. Le passage d’une langue à une autre et celui d’une forme littéraire à une autre sont des facteurs de poids dans la réorientation du texte source vers de nouveaux lecteurs et lectrices ; ils enclenchent un important travail d’adaptation, tant discursif que matériel. Le premier objectif de cet article est de mesurer les modalités d’inscription, les fonctions et les enjeux de ces transferts linguistique et culturel, afin d’en apprécier l’influence dans la construction des publics. Le deuxième objectif consiste à identifier les stratégies de publication de l’auteur, lesquelles comprennent aussi bien l’opération de construction d’un nouveau public par le texte que ce que ce texte, et les livres dans lesquels celui-ci se cristallise, mettent en vedette. Au-delà des objectifs encomiastiques de célébration des femmes énoncés dans les paratextes, l’éloge abrite des finalités dissimulées, qui constituent autant d’appels à l’adhésion par des lectorats différents et indiquent des publics secondaires implicites. Les configurations identifiées — juxtaposition et superposition — fournissent la base d’une réflexion méthodologique plus large sur les publics et la publication dans les éloges collectifs de femmes du xvie siècle.
EN:
This article examines the construction of publics in two collections in praise of women translated from the Latin treatise De nobilitate et praecellentia foeminei sexus by Henri Corneille Agrippa: François Habert’s Jardin de foelicite avec la louenge & haultesse du sexe feminin en ryme françoyse, divisee par chapitres […] (1541) and François de Billon’s Fort inexpugnable de l’honneur du sexe féminin (1555). Changes in language and literary form are crucial in reshaping the original text for new readers, male and female, involving major discursive and material reworking. The primary goal here is to assess the modes, functions, and interplays of these linguistic and cultural transfers, and their influence on the construction of publics. The second goal is to identify the author’s publication strategies aimed at attracting new publics via the text and also the substance of the text, and its materialization in books. Besides the encomiastic objective of celebrating women illuminated in the paratexts, such praise hides other objectives like the thrust for different readerships, and hence secondary publics. Such devices as juxtaposition and superposition provide a methodological foundation and configuration to explore the publics and publications in sixteenth-century collections in praise of women.
-
La construction du public lecteur dans le Recueil des dames de Brantôme et les dédicataires, Marguerite de Valois et François d’Alençon
Claude La Charité
pp. 109–126
AbstractFR:
Réparti en deux volumes, que les éditeurs du xviie siècle intituleront respectivement « les dames illustres » et « les dames galantes », le Recueil des dames de Brantôme cherche à rejoindre des lectorats apparemment fort différents d’un volume à l’autre. Cette apparente disparité est à l’image du choix des dédicataires, le premier volume étant dédié à la soeur de Henri III, Marguerite de Valois (1553-1615), le second à son frère, François d’Alençon (1555-1584), héritier présomptif du trône jusqu’à sa mort prématurée. L’écart apparent entre les deux volets est si grand que la majorité des éditeurs modernes furent tentés de gommer cette différence, en ne retenant qu’une seule partie, celle des dames galantes. L’intérêt de l’oeuvre tient pourtant à ce qu’elle n’exclut pas que les dames illustres soient aussi galantes, le recueil nous donnant à voir les mêmes femmes, côté cour et côté alcôve. Ce qui expliquerait l’apparente disparité générique (au sens de gender) des publics lecteurs, les « dames illustres » s’adressant aux lectrices et étant destinées à leur servir de modèles, les « dames galantes » s’adressant à leurs amants dans une sorte d’Art d’aimer mis au goût du jour. Cet article s’attache d’abord à voir comment les éditions jusqu’à tout récemment ont rompu l’unité du Recueil des dames et passé sous silence les stratégies de construction du lectorat par la suppression partielle ou totale des dédicataires choisis par Brantôme. Il met ensuite en évidence la figure idéale de lecteur suggérée par les dédicataires respectifs des deux volumes et avance enfin que le meilleur lecteur, à l’image de la dame de l’escadron volant imaginé par l’auteur, est d’abord la personne qui, homme ou femme, lit successivement les deux parties du recueil et les met en relation.
EN:
In two volumes designated by 17th-century publishers as “the illustrious ladies” and “the gallant ladies,” Brantôme’s Recueil des dames targeted a diverse readership with these two very different volumes, and their disparate dedicatees. The first volume is dedicated to the sister of Henri III, Marguerite de Valois (1553-1615), and the second to his brother, François d’Alençon (1555-1584), heir to the throne until his untimely death. The marked disparity between the two parts is such that most modern publishers are tempted to mute this difference by retaining one aspect only, that of the gallant ladies. The work’s interest, however, lies in depicting the illustrious ladies as gallant too, showing the same women at court and in the boudoir. This would explain the apparent gender disparity within the reading public, with the “illustrious ladies” geared to female readers and intended to serve as their models, and the “gallant ladies” intended for their lovers in a sort of modernized Art of Love. This article first explores how editions have, until very recently, betrayed the unity of the Recueil des dames and ignored readers’ construction strategies by either partially or totally suppressing Brantôme’s chosen dedicatees. It then highlights the ideal reader envisioned by the respective dedicatees of the two volumes, concluding that the best reader, personified by the author’s imagined “flying squadron” lady, is she or he who successively reads and relates the two parts of the recueil.
-
« La gloire de nostre sexe » : savantes et lectrices dans Les dames illustres (1665) de Jacquette Guillaume
Jean-Philippe Beaulieu
pp. 127–142
AbstractFR:
Parmi les recueils de femmes illustres publiés au xviie siècle, l’ample ouvrage de Jacquette Guillaume intitulé Les dames illustres où par bonnes et fortes raisons, il se prouve, que le sexe feminin surpasse en toute sorte de genres le sexe masculin (Paris, Thomas Jolly, 1665) se singularise par la façon dont il s’attache à démontrer le savoir féminin en attribuant de longs discours érudits à des contemporaines, principalement françaises, désignées de manière allusive (« Mademoiselle **** »), avec qui l’auteure semble entretenir des liens de familiarité. Ces « portraits parlants », qui prouvent la réalité d’un savoir féminin représenté par des femmes qui ne se sont pas encore distinguées sur la scène publique, indiquent qu’être illustre n’implique donc pas une notoriété préalable, mais simplement des dispositions que le texte de Guillaume a pour fonction de rendre publiques. Par l’usage systématique de la citation directe ou indirecte, le texte donne existence à un cercle virtuel mais étendu de femmes savantes, dont Élisabeth d’Orléans, la dédicataire, serait la marraine et l’auteure, la porte-parole. Contrastant avec son attitude négative à l’égard des hommes, les efforts que déploie Guillaume pour mettre en valeur une communauté hypothétique de femmes suggèrent que les Dames illustres visent principalement un public féminin que l’on invite à suivre les exemples fournis par l’ouvrage. En tant qu’aperçu — en grande partie fictif — d’un savoir qui embrasse des disciplines comme la théologie et la géographie, généralement étrangères à l’expérience féminine, le livre de Guillaume serait tendu vers les lectrices tel un miroir qui réfléchit tout à la fois les qualités de l’auteure, de la dédicataire et des diverses savantes, pour faire la preuve irréfutable que le savoir féminin représente désormais un fait avéré.
EN:
The voluminous tome entitled Les dames illustres où par bonnes et fortes raisons, il se prouve, que le sexe feminin surpasse en toute sorte de genres le sexe masculin published by Jacquette Guillaume in 1665 (Paris, Thomas Jolly) stands out among 17th-century collections devoted to famous women. Guillaume’s emphasis on women’s knowledge is truly unusual, especially the way she attributes extensive learned discourses to contemporary French women whose identity, evidently known to her, remains concealed. These “talking portraits” bespeak a feminine knowledge possessed by women yet unknown and suggest that fame is not necessarily a prerequisite for inclusion here: learning can be found among very different women, be they illustrious or anonymous. Systematically using citation strategies, the author develops a virtual coterie of scholarly women, with the dedicatee, Élisabeth d’Orléans, as matriarch and herself as spokesperson. In contrast to her antagonistic attitude towards men, Guillaume’s impetus to stage this fictitious community suggests a book intended for a female public, with the “dames illustres” as inspirational examples and mentors in such areas as theology and geography, fields seldom associated with women in 17th-century France. Thus does Guillaume’s book serve as a mirror set before female readers to reflect the qualities of the author, the dedicatee and the learned women, and to implicitly prove the existence of a feminine culture of considerable abundance and quality.
Exercices de lecture
-
Une défaillance du miroir à la rescousse du sujet durassien
Marie-Andrée Morache
pp. 145–163
AbstractFR:
L’élément central de cette lecture de l’oeuvre de Marguerite Duras est l’analyse d’une scène de La vie tranquille où la narratrice ne se reconnaît pas dans le reflet de sa personne que lui renvoie un miroir. Nous voyons dans cette scène une destitution du moi par la mise à distance de l’image de soi qui fut investie sous le regard de la mère (Lacan). Par un travail laborieux qui s’étend sur toute la seconde partie du livre, l’énonciation désamorce l’identification principale, fusionnelle et mortifère, au profit d’une multiplicité d’identifications. Elle instaure ainsi une nouvelle structure identitaire dont les possibilités semblent presque illimitées : le soi tend vers une altérité intérieure qui lui permettrait de demeurer en perpétuelle réélaboration. Ce passage d’une instance à l’autre, de « ma personne » aux « elles », est vécu par le personnage comme une mort, une mort à soi qui doit être distinguée du voeu de mort, de la haine et du dégoût de soi que l’on retrouve chez plusieurs héroïnes de Duras. La distinction opérée dans cette analyse pose La vie tranquille à part des autres premiers romans (Les impudents et Un barrage contre le Pacifique) et fait ressortir un point commun que ce livre relativement peu connu entretient avec le grand succès de Duras : L’amant. Plutôt que d’aborder L’amant comme une reprise d’Un barrage contre le Pacifique, notre lecture souligne quelques-uns des nombreux aspects par lesquels le livre de 1984 reprend un travail abordé en 1944 dans La vie tranquille.
EN:
This interpretation of Marguerite Duras’s work consists mainly of an analysis of a scene from La vie tranquille, in which the narrator does not recognize herself while observing her reflection in a mirror. We see in that sequence the discharge of the Self through a detachment from a self-image essentially imposed by the mother (Lacan). The entire second part becomes an effort to neutralize the dominant identity that had merged with the dead brother, and instead favour multiple identities. The text then introduces a new structure of identity with almost unlimited potential: the Self strives toward an “otherness within” that invites constant renewal. This profound change, noticeable in the book by the transition from “me” (ma personne) to “them” (elles), is experienced by the protagonist as a form of death, a suppression of the Self which must be distinguished from a death wish, from the self-loathing experienced by several other female characters imagined by Duras. This distinction sets La vie tranquille apart from Duras’s other early novels (Les impudents and Un barrage contre le Pacifique) and brings out a distinctive characteristic found both in this little-known book and the famous L’amant. Rather than perceiving L’amant as a rehash of Un barrage contre le Pacifique, we considered L’amant in continuity with La vie tranquille, underlining some of the many ways in which the 1984 novel resumes the process broached in the 1944 La vie tranquille.
-
Olivier Adam, Arnaud Cathrine : la tentation de l’autobiographie
Anne Strasser
pp. 165–182
AbstractFR:
En septembre 2005, le Magazine littéraire choisit de faire la recension conjointe de deux romans, Falaises d’Olivier Adam et Sweet home d’Arnaud Cathrine. Les affinités entre ces deux romans sont frappantes. Au-delà de leur argument commun — le suicide de la mère — leur forme est significative : ils sont écrits à la manière d’une autobiographie, soit un récit d’événements fictifs, qui possède la plupart des caractéristiques de l’autobiographie. Les choix énonciatifs et narratifs (récit rétrospectif à la première personne articulé autour de la quête d’un sens), tout comme les thèmes privilégiés — l’enfance, la mort, le deuil — posent la geste autobiographique. Des narrateurs écrivains, double des auteurs, parachèvent cette ressemblance en permettant une réflexion sur l’écriture et le travail de deuil, mais aussi de filiation qu’elle constitue. Ainsi, à l’exception de l’identité entre l’auteur, le narrateur et le personnage, tout concourt à mimer la démarche autobiographique.
Il ne s’agit pas ici de se lancer dans une réflexion sur les genres, pour savoir si nous avons affaire à des romans, à des romans autobiographiques ou à des autofictions — ces concepts nous serviront plutôt à définir ce que ces romans ne sont pas —, mais de montrer comment le genre autobiographique contamine le roman, ce qui peut constituer une caractéristique de la littérature française contemporaine. De la même manière qu’en mettant en scène la perte, la réparation, la filiation, ces récits rejoignent des questionnements qui habitent la société contemporaine.
EN:
In September 2005, the Magazine littéraire chose to simultaneously review two novels in tandem, Falaises by Olivier Adam and Sweet home by Arnaud Cathrine. It is striking how similar these two novels are. Besides their common motif—the mother’s suicide—they share a particular form: both are written as if they are autobiographies, i.e., a fictive narrative having the general qualities of an autobiography. Thus, the enunciative and narrative choices (retrospective narrative with the “I” pronoun based on the quest for meaning), as well as the salient themes—childhood, death, grief—begin like an autobiography. The writers-narrators, representing the authors’ double, complete the similarity, spurring a reflection on writing and on the grieving process and the exploration of filiation that writing involves. Hence, apart from the identity of the author, narrator and character, the components converge to mimic the autobiographical process.
We do not wish to fuel the debate on genres, to determine whether we are dealing with novels, autobiographical novels or autofictions (concepts that will rather help us to clarify what these novels are not), but instead wish to show how the autobiographical genre contaminates novels, which may be a characteristic of contemporary French literature. Equally, as when expressing loss, healing, filiation, these stories convey some of the questionings of contemporary society.



