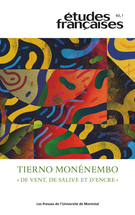
Volume 45, Number 2, 2009 L’échelle des valeurs au xviie siècle : le commensurable et l’incommensurable Guest-edited by Craig Moyes
Table of contents (9 articles)
-
Présentation
-
La mesure de la pastorale
Thomas Pavel
pp. 13–24
AbstractFR:
Le roman pastoral des xvie et xvii e siècles raconte le destin d’êtres humains qui, oscillant entre la constance et la faiblesse, passent du dévouement au caprice et de l’inconstance à la fidélité. Bien que l’amour entraîne ces personnages vers la source du Bien, du Vrai et de l’Un, ils demeurent en proie aux troubles intérieurs et aux perturbations engendrés par le désir. La tension entre l’imperfection humaine et l’élan vers l’idéal se reflète dans l’alternance, typique pour le roman pastoral, de la narration en prose et du transport poétique. Or, en dépit de la coexistence de ces grandeurs incommensurables, des oeuvres comme l’Ameto de Boccace, l’Arcadie de Sannazaro, La Diane de Montemayor, Galatée de Cervantès, l’Arcadie de Sir Philip Sydney et L’Astrée d’Honoré d’Urfé dégagent une remarquable impression de mesure et d’équilibre, qui réunit la force de l’idéal aux impulsions les plus intimes de l’âme humaine. Cet équilibre est perceptible dans tous les ingrédients du roman pastoral : le cadre idyllique, l’intrigue, la psychologie morale et l’élégance du style. Située dans une Arcadie primitive qui ignore les conflits, la pastorale inclut également des épisodes appartenant au monde des rivalités sociales. Elle ne se contente pas d’une seule histoire, mais incorpore une gamme de situations où l’amour est confronté à la Fortune, à la duplicité du coeur humain et, enfin, à l’énigme de l’union entre corps et âme. Concernant la psychologie, la pastorale ne s’attarde pas aux replis du coeur humain mais peint des âmes que l’élan amoureux emporte au-delà des circonstances amères et boueuses de leur vie. Enfin, l’alternance de la prose et des passages en vers participe elle aussi à cette mesure sans doute fragile, à cet équilibre souvent instable, en soulignant à sa manière l’incommensurabilité de la faiblesse humaine avec le Beau et le Bien qui l’attirent.
EN:
In Renaissance pastoral novels, characters oscillate between weakness and constancy, caprice and resolve, fickleness and perfect loyalty. Although True Love inevitably leads these characters towards the invisible source of the Good, pastoral heroes are nevertheless prey to the turmoil and distraction engendered by earthly passions. This clash between the contradictory nature of human frailty and the neo-platonic desire for an ideal unity is further mirrored by the mix of prose and poetry, a typical stylistic feature of the genre. In spite of the tension between these elements, a strong impression of equilibrium emerges from works like Boccaccio’s Ameto, Sannazaro’s Arcadia, Montemayor’s Diana, Cervantes’ Galatea, Sir Philip Sidney’s Old Arcadia and Honoré d’Urfé’s Astrea. An elusive, yet durable balance unites the movement towards the Ideal and the innermost contradictions of the soul. This balance is perceptible at various levels : the idyllic setting, the plot, the moral psychology and graceful discourse of the characters. Set in Arcadia, a legendary land assumed to be free of greed and discord, all pastoral novels include episodes which take place beyond Arcadia’s borders in the familiar world of wealth, social rank, rivalry and conflict. In addition to the dignified love story (or stories) narrated by the main plot, pastoral novels always stage a variety of situations depicting clashes between love and Fortune, the duplicity of the human heart, and the enigmatic links between body and soul. Yet these novels rarely linger on the inner struggles of the soul ; instead, they highlight True Love’s extraordinary capacity to carry it away, far beyond the often murky and bitter circumstances of its daily existence. Finally, the blend of prose and poetry reinforces the pastoral’s equilibrium and its inner measure, calling attention, in its own way, to the incommensurability between human imperfection and the irresistible attraction of the Ideal.
-
Juste(s) titre(s) : l’économie liminaire du Roman bourgeois
Craig Moyes
pp. 25–45
AbstractFR:
Le roman bourgeois est en général considéré comme une oeuvre plus ou moins bâclée, un burlesque de deuxième ordre, racheté seulement, çà et là, par les quelques touches de description « réaliste » qu’il recèle. Nous croyons toutefois que lire ce roman selon une grille de lecture héritée du xix e siècle serait passer à côté du véritable intérêt du livre. Au lieu de considérer l’apparent désordre du récit — les historiettes détachées, les bribes de listes, la structure boîteuse, l’absence de personnage principal, la méchanceté grincheuse envers Charles Sorel, la terminaison arbitraire —, comme une tare qu’il faut condamner (ou excuser), cet article veut suggérer qu’il s’agit d’une décision stratégique de la part de Furetière dans une tentative globale de représenter une nouvelle commensurabilité esthétique qui serait propre à la bourgeoisie. C’est par le livre, objet à la fois commercial et esthétique, par un jeu polysémique autour du titre et enfin par une réflexion sur l’échange même que Furetière arrive à négocier quelques-unes des incommensurablités qui traversent la société du xviie siècle.
EN:
Le roman bourgeois is usually seen as a more or less failed work, a second-order burlesque, redeemed only by the touches of incipient realism which shine through its disarticulated narrative. But to read this work through an interpretive framework provided by the nineteenth-century novel would be to miss much of its real value. Instead of considering its apparent lack of structure as a fault to be condemned or excused, this article takes these vices as virtues, reading the novel less as an attempt by Furetière to represent the “reality” of the bourgeoisie than to question the epistemological and social bases of its own representation. It is through the book, taken both as a commercial good and an aesthetic object, the title, understood principally as a polysemic signifier, and finally through a reflection on the exchange itself that Furetière is able to negotiate a number of incommensurabilites characteristic of French seventeenth-century society.
-
Le texte comme don public
Hélène Merlin-Kajman
pp. 47–67
AbstractFR:
Il est devenu commun d’interpréter les épîtres dédicatoires, et plus généralement les textes d’éloge des grands, à la lumière des relations clientélaires qui subordonnent les écrivains à leurs « patrons » : même l’échange mécénique est interprété comme un échange où les deux protagonistes engagent un intérêt socioéconomique qui réduit la liberté de parole de l’écrivain. La littérature est, dans cette perspective, définie comme un bien sans valeur publique particulière, mobilisé dans des rapports de force et des stratégies sociales. On se propose ici de relire la relation de l’écrivain à son mécène, et, au-delà, à son public, à la lumière de la distinction opérée par les anthropologues entre objet marchand, objet de don et objet sacré.
EN:
Dedicatory epistles and panegyrics have generally been interpreted in terms of the socio-economic interest of the writer who, in subordinating himself to a powerful patron, gives up a measure of his artistic freedom in exchange for financial gain or social advancement. From this point of view, literature has no particular public value : it becomes merely a means to an end, a good to be exchanged within a restricted network of social relations. In order to broaden this reductively narrow understanding of literary patronage as simple exchange, this article will reconsider it first theoretically, in light of the anthropological distinction between good, gift and sacred object, and second socially, as a more complex relationship between the writer, the grandee and the public.
-
Valeurs de vérité et formes publiques d’énonciation chez le « Secrétaire de Port-Royal » : l’impasse heureuse des Provinciales
Éric Méchoulan
pp. 69–81
AbstractFR:
À partir de la controverse entre jansénistes et jésuites, et en particulier des Lettres provinciales, cet article cherche à comprendre le rapport entre vérité, formes de publication, institutions autorisantes et sujet d’énonciation où se négocient les calculs du commensurable et de l’incommensurable.
EN:
Taking as its starting point the controversy between Jansenists and Jesuits (especially in Pascal’s Lettres provinciales), this article addresses the relationship between truth, forms of publication, institutional authority and the subject of enunciation, asking how this relationship negotiates the calculus of the commensurable and the incommensurable.
-
La mesure du ciel : la correspondance de Chapelain et Huygens
Frédérique Aït-Touati
pp. 83–97
AbstractFR:
Au xvii e siècle, les débats cosmologiques ont donné lieu à une vaste production textuelle dont l’un des enjeux est la crédibilité. Comment convaincre de ce que l’on ne peut voir ou atteindre, et comment prendre la mesure de l’incommensurable ? C’est avec les outils du monde que les astronomes tentent de convaincre leurs contemporains de la validité de leur conception du monde. En ce sens, les textes cosmologiques sont le laboratoire de nouvelles stratégies de construction de la crédibilité et d’expérimentation des outils disponibles. C’est dans cette perspective qu’est abordée dans cet article la correspondance entre Christiaan Huygens, mathématicien et astronome, et le poète Jean Chapelain, l’un des principaux théoriciens du vraisemblable en poétique. On se propose ici de suivre les stratégies — sociales, mondaines, rhétoriques, diplomatiques ou génériques — déployées par Christiaan Huygens au cours de la « querelle de l’anneau » de 1658 qui préluda à la publication l’année suivante du Systema Saturnium , et durant laquelle Chapelain joua un rôle actif au côté du jeune astronome. L’étrangeté de l’anneau de Saturne, tel que Huygens en conçoit le modèle, entraîne un usage de la notion de vraisemblable qui tend à sa profonde redéfinition. Outre le vraisemblable aristotélicien, doxique, que l’on peut reconnaître dans les premiers moments de la querelle, l’étude de la correspondance montre que la notion joue chez Chapelain un rôle véritablement heuristique lorsque, en réponse à ceux qui objectaient à Huygens que l’existence d’un tel anneau serait contraire à la gravité, il propose de le voir comme composé d’une « multitude de lunes », hypothèse qui anticipe des observations astronomiques bien ultérieures, et qui apparaît motivée, chez lui, par l’exigence de la vraisemblance comme ordre et congruence maximale des phénomènes. Ainsi l’astronome et le poète se retrouvent-ils sur un même terrain d’entente entre esthétique et épistémologie, entre vraisemblable et probable : le postulat commun d’une harmonie du monde aboutit à la mise en oeuvre, dans l’imitation fictive et dans la redescription du cosmos par l’hypothèse, d’une même poïétique consistant à créer des « machines vraisemblables ».
EN:
Seventeenth-century cosmological texts were in many ways vast textual laboratories for the establishment of scientific credibility. The problem is how to validate theories whose objects one can neither see nor reach ? How, in other words, to measure what seems by its nature to be incommensurable ? This article is devoted to a detailed account of the development of Christiaan Huygens’ dual career as courtier and scientist, specifically through a reading of his correspondence with the writer Jean Chapelain, in order to make sense of the discrepancy between the theoretical incommensurability of his astronomical problems and the need for making these commensurate with the rhetorical and poetic strategies then available. The article explores the function of epistolary relations in court philosophical circles of the period using the Chapelain-Huygens letters as case, as well as the strategies—social, worldly, rhetorical, or poetic—that Christiaan Huygens developed during the debate over Saturn’s ring in 1658, which took place the year before the publishing of Huygens’s Systema Saturnium and during which Chapelain played a crucial role as adviser and protector of the young astronomer. The correspondence shows an analogous relationship between the concepts of harmony and vraisemblance, or verisimilitude, in the unlikely fields of astronomy on the one hand and of poetics on the other. The singularity of Saturn’s ring led Huygens to a changed use of the Aristotelian concept of verisimilitude, where it becomes not only an evaluative tool for measuring the poetic and known world, but a new way to think about the incommensurability of a singular and previously unknown astronomical object.
-
« Un si prodigieux amas de bienfaits tourné en poison » : félonie et démesure dans les Mémoires de Saint-Simon
Frédéric Charbonneau
pp. 99–111
AbstractFR:
Fidèle à la tradition des Mémoires aristocratiques, le duc de Saint-Simon se montre dans son oeuvre attentif aux créances comme aux dettes de la monarchie, à la balance des bienfaits et du service qui définit dans un monde ordonné les rapports du souverain et de ses grands vassaux. Du cardinal de Bouillon, dont il est question dans ces pages, le mémorialiste condamne avec énergie les intrigues et la trahison ; et il trouve une source à ses félonies dans une récompense accordée jadis par Henri IV à l’aïeul du cardinal, fait prince souverain de Sedan. Aux yeux de Saint-Simon, cette transaction est inouïe. Une telle « princerie » crée des monstres : des souverains régnicoles ; et de cette impossibilité ontologique découle la félonie, un prince souverain ne pouvant demeurer simple et loyal sujet du Roi. Les crimes du cardinal sont ainsi commis en vertu d’un nom et d’un titre que la sanction royale consistera à éradiquer. Or la stratégie de Saint-Simon est tout autre : faute de pouvoir lui-même abolir le rang de prince étranger et réduire les Bouillons à leur rang de pairie, Saint-Simon a sans relâche écrit des centaines, voire des milliers de pages en faveur de cette abolition, convoquant les ressources de la critique la mieux informée en matière de titulature afin d’accomplir son oeuvre de justice et de vérité, et de rendre à chacun scrupuleusement son dû.
EN:
True to the tradition of aristocratic Memoirs, the Duke of Saint Simon’s work is attentive to the debts owed to the monarchy as they are to those owed by it, to the balance of favours rendered and services due which in an ordered world define the relationships of the sovereign and his principle vassals. The Cardinal of Bouillon, who will be the focus of the following pages, is vigorously condemned by Saint Simon for his intrigues and for his treason ; the memorialist finds a source of his disloyalty to lie in a reward formerly accorded by Henri IV to the Cardinal’s grandfather, making him the sovereign prince of Sedan. In the eyes of Saint Simon, this transaction is unprecedented. Such a princeship creates monsters : regnicole sovereigns ; and from this ontological impossibility disloyalty ensues, a sovereign prince not being able to remain a mere or loyal subject of the King. The crimes of the Cardinal are thus committed in accordance with a name and a title that royal sanction will consist in eradicating. The strategy of Saint Simon is however quite different : unable to abolish the rank of foreign prince himself and reduce the Bouillons to their rank in the peerage, Saint Simon unceasingly wrote hundreds, even thousands of pages in favour of this abolition, using as his resource the most informed writings in titular matters to accomplish his work of justice and of truth, and to scrupulously give unto each his due.
Exercices de lecture
-
Une colonisation linguistique ? Les Mémoires de l’Amérique septentrionale de Lahontan
Ursula Haskins Gonthier
pp. 115–129
AbstractFR:
Cet article est une invitation à redécouvrir les Mémoires de l’Amérique septentrionale (1703) du baron de Lahontan. Ce portrait ethno-géographique du Canada colonial se révèle être un témoignage rare du transfert des langues et des cultures entre l’Europe et le Nouveau Monde au Siècle des lumières. En étudiant en particulier la dernière partie des Mémoires , le « Petit Dictionnaire de la langue des Sauvages », nous proposons d’analyser de près les réflexions linguistiques de Lahontan afin de mieux comprendre le rôle joué par les langues indigènes dans les échanges interculturels entre Français et Amérindiens, ainsi que dans les processus de la colonisation. La vision des langues indigènes épousée par Lahontan s’avère différer radicalement de celle propagée par les missionnaires jésuites qui, à des fins évangélisantes, poursuivaient des recherches sur les langues amérindiennes depuis le début du dix-septième siècle. Ceci n’est pas étonnant : célèbre iconoclaste et précurseur des philosophes, Lahontan est principalement connu comme étant le créateur d’Adario, archétype du « bon sauvage » et protagoniste des Dialogues curieux entre l’Auteur et un Sauvage de bon sens qui a voyagé (1703), qui prend la défense de la culture amérindienne pour critiquer les abus de la civilisation occidentale, notamment en matière de religion. Cependant, quoique fortement hostile à la colonisation religieuse des missionnaires, Lahontan ne s’oppose pas pour autant à l’occupation française du Canada : son « Petit Dictionnaire » montre qu’il envisage même la maîtrise des langues indigènes comme un moyen de maîtriser et le pays et ses habitants.
EN:
This article seeks to shed new light on the Mémoires de l’Amérique septentrionale (1703), by the Baron de Lahontan, better known as the author of the polemical Dialogues in which Amerindian chief Adario condemns the European colonisation of the New World. The Mémoires, an ethno-geographic description of colonial Canada, provide invaluable evidence of the transfer of languages and cultures between Europe and the New World in the early Enlightenment. Taking as its primary focus the “Petit Dictionnaire de la langue des Sauvages” included as an appendix to the Mémoires, this article examines Lahontan’s reflections on the languages spoken by the inhabitants of “la Nouvelle-France.” This leads to an exploration of the role of language as a medium of cultural exchange between French and Native Canadians, and, more widely, as an element in the process of colonisation. Importantly, Lahontan’s theories regarding native languages will be shown to differ radically from those propagated by the Jesuit missionaries, who had piloted the linguistic study of Amerindian languages in the seventeenth century. This is hardly surprising, given Lahontan’s well-known anticlerical and heterodox views. However, despite his evident hostility to the religious colonisation of Canada by Jesuit missionaries, Lahontan is no opponent of colonialism, and seeks through his work to further the exploitation of the country by the secular authorities. Indeed, this detailed study of his “Petit Dictionnaire” reveals that its author considers the command of Amerindian languages to be a means of taking command of “la Nouvelle France,” and of its native inhabitants.
-
L’écriture « extime » de Gérard Wajcman : blancs, notes et intertextes dans L’interdit
Fransiska Louwagie
pp. 131–150
AbstractFR:
Le présent article propose une analyse de L’interdit, roman (Wajcman, 1985), une oeuvre qui se compose presque exclusivement de notes de bas de page, le corps du texte étant « absent ». Si l’oeuvre semble, d’après ce qu’indique son sous-titre, conclure un pacte romanesque, force est cependant de constater qu’elle participe également d’une écriture autofictionnelle et testimoniale, centrée sur la mémoire de la Shoah. L’interprétation de ce projet littéraire se fait en trois étapes. Dans un premier temps, nous examinerons les fonctions esthétique et phatique des notes : une lecture linéaire et circulaire de celles-ci nous permettra de déceler les grands traits de la trajectoire du protagoniste. Troisièmement, l’analyse des citations intertextuelles (notamment celles tirées de Proust, de Dante et de Flaubert) nous conduira à approfondir les isotopies sémantiques des notes, ce qui confirme que l’apparente dissémination de sens dans L’interdit ne constitue qu’une impression de surface. Finalement, nous montrerons comment L’interdit réalise le projet testimonial que Wajcman définit dans ses ouvrages consacrés à la Shoah et à l’histoire de l’art (L’objet du siècle et Fenêtre,Chroniques du regard et de l’intime ). De fait, appartenant lui-même à la deuxième génération de survivants juifs du génocide, l’auteur se construit dans son « roman » une position testimoniale qu’il fonde sur les concepts lacaniens du sujet décentré, de l’objet (a) et de « l’extime ».
EN:
The present article offers an analysis of L’interdit, roman (Wajcman, 1985), a literary work almost exclusively composed of footnotes, the text itself being “absent.” Although the subtitle identifies L’interdit as a “novel,” the text also indicates a close affinity with autofiction and with Holocaust testimony. The literary analysis follows three stages. We will first concentrate on the aesthetic and phatic functions of the footnotes : a linear and circular interpretation of the latter will allow us to sketch the broad outlines of the protagonist’s history. The analysis of Wajcman’s intertextual quotations (principally those originating from Proust’s, Dante’s and Flaubert’s oeuvre) will subsequently enable us to further elucidate the footnotes’ isotopies, which confirms that the apparent semantic dissemination in L’interdit is only a superficial impression. Finally, we will point out how L’interdit realizes the testimonial project defined in Wajcman’s critical works on the Shoah and on art history (L’objet du siècle and Fenêtre, Chroniques du regard et de l’intime). Wajcman being a member of the second generation of Jewish Holocaust survivors, the “novel” more precisely elaborates a testimonial position relying on Lacanian notions as the decentered subject, the object (a) and the “extime.”



