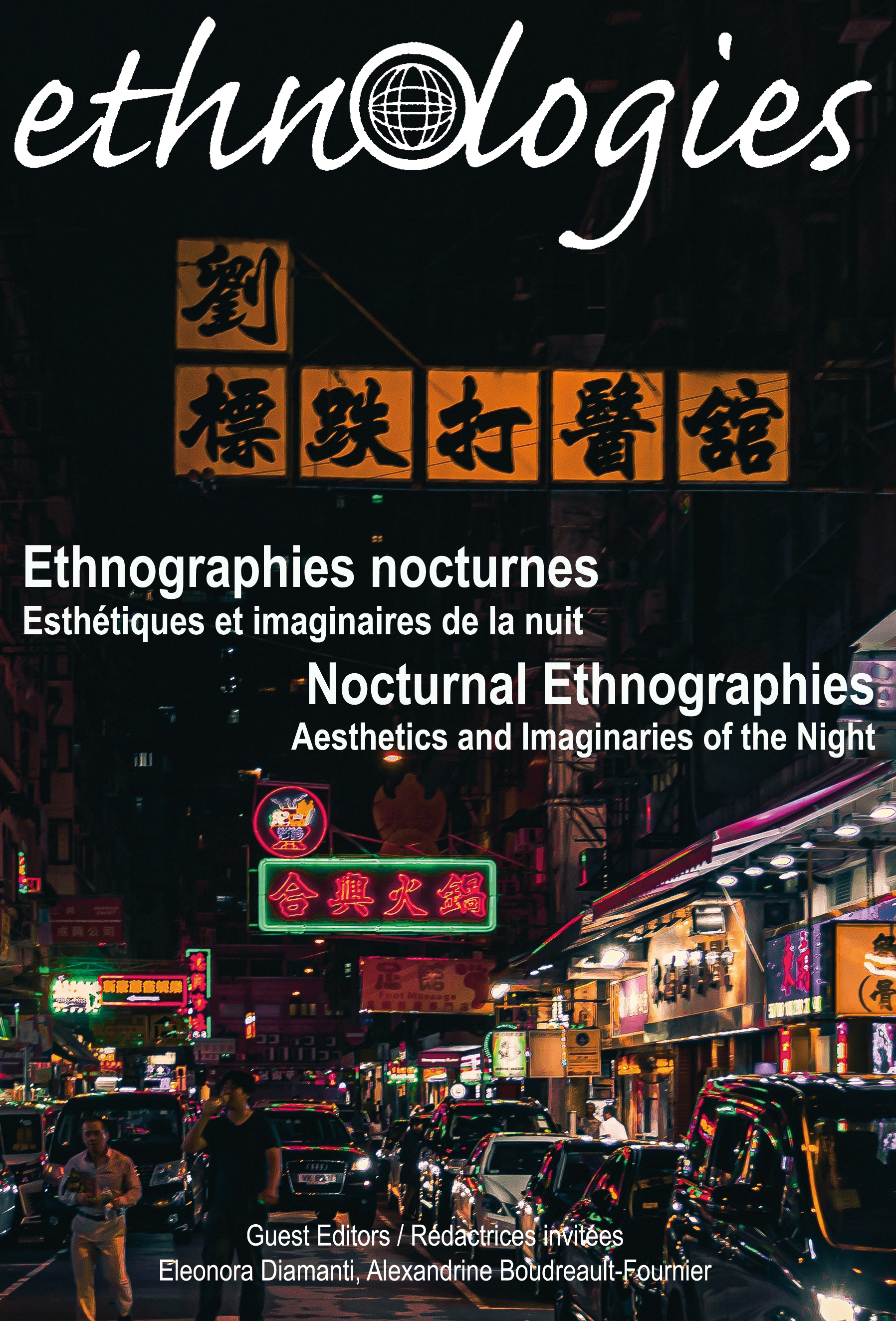Abstracts
Résumé
Six parcs, près de 500 heures d’observation, plus de 60 entrevues, une question: que font les jeunes de 16 à 25 ans, la nuit, à Montréal? Alors qu’elle se place en opposition à la vie civilisée et légitime du jour, la nuit se définit sous deux angles: d’une part comme un moment d’insécurité, de vulnérabilité accentuées pour certain-es, de l’autre comme un moment de liberté et d’explorations festives. Alors que Montréal entame une réflexion sur la gouvernance nocturne et au regard des exemples européens où la nuit est déjà bien investie par un encadrement misant sur la marchandisation de l’hyperactivité nocturne, nos données récoltées à l’été 2020 révèlent une troisième dimension de la nuit; celle où les jeunes vivent des activités nocturnes ordinaires, axées sur l’expérience sensorielle de l’accalmie, la recherche d’intimité (entre soi, en territoire connu) et de liberté (être soi-même, en-dehors des contraintes et exigences diurnes).
Abstract
Six parks, nearly 500 hours of observation, more than 60 interviews, just one question: what do young people aged 16 to 25 do at night in Montreal? While often placed in opposition to the civilized and legitimate life of day, the night is defined from two angles: on the one hand, as a moment of accentuated insecurity and vulnerability for some, on the other hand, as a moment of freedom and festive explorations. As the city of Montreal begins a reflection on nocturnal governance, and in view of European examples where the night is already well invested by a framework focusing on the commodification of nocturnal hyperactivity, our data collected in the summer of 2020 reveals a third dimension of the night: one where young people experience ordinary nocturnal activities, centered on the sensory experience of calm, the search for intimacy (between themselves, in known territory) and freedom (being themselves, outside the diurnal constraints and demands).
Article body
Introduction
La réputation de Montréal, de ses festivals et espaces publics animés de jour comme de nuit n’est plus à faire. Pourtant, les autorités municipales ne se penchent sérieusement sur une politique de la nuit que depuis quelques années. Pour ce faire, Montréal s’inspire notamment des métropoles européennes qui, depuis une vingtaine d’années, misent sur la « nocturnalisation », soit la promotion des pratiques sociales et activités économiques la nuit, cet espace-temps maintenant considéré attractif et productif (Crozat 2020).
La gouvernance nocturne est tout-à-fait justifiée dans un contexte urbain : les sorties nocturnes ne sont plus de l’ordre de l’exceptionnel, et relèvent même de la prescription sociale pour les jeunes (Gauthier 2004; Mouchtouris 2003). Les pratiques noctambules s’accompagnent souvent de représentations sociales ambivalentes de la nuit (transgression, intimité) et de contrastes (centre/périphéries, repos/amusement, iconique/banal). Cependant, les travaux scientifiques sur la nuit restent rares. Nous ne savons pas vraiment ce qu’en font les jeunes ni ce qu’ils et elles veulent en faire. À partir d’un terrain d’une ampleur inédite à Montréal, nous avons cherché à comprendre quelles sont leurs pratiques et expériences de la vie nocturne montréalaise. Leur part ordinaire a retenu toute notre attention.
Renouveler le regard sur la nuit : souligner l’ordinaire de la vie nocturne
Gwiazdzinski, géographe de la nuit, dénonce le manque d’attention accordée à la nuit urbaine : « si l’on connaît et l’on étudie depuis longtemps la ville diurne, on oublie encore souvent sa dimension nocturne. Privée de la moitié de son existence, comme amputée, la ville semble livrée aux seuls poètes et artistes noctambules » (Gwiazdzinski 2005 : 61). En sciences sociales, les recherches qui s’y intéressent concernent surtout les usages de la nuit (Cabantous 2009; Espinasse et al. 2005; Gwiazdzinski 2002; 2005; Paquot 1997), sa dimension poétique (Mouchtouris 2003 : 21), les mobilisations politiques qui lui sont propres (Bertrand 2002; Candela 2017) et son économie politique (Burnett 2011; Galinier et al. 2010).
Pour Montréal spécifiquement, on trouve quelques rapports de recherche sur la dimension festive de la nuit (dont Archambault et al. 2005) et pistes d’intervention parsemées dans des documents sur le transport et la sécurité nocturne[1]. La naissance de l’organisme MTL 24/24 en 2017, la création en 2019 du poste de Commissaire au bruit et à la nuit de la Ville de Montréal et la tenue de l’événement public Montréal au sommet de la nuit, qui a connu sa deuxième édition en juin 2022, témoignent de la mobilisation récente de citoyen-nes, d’entrepreneurs-euses, d’artistes et d’élu-es autour de cet enjeu de vie publique, supportée par la reprise économique post-COVID-19. Sachant qu’il n’existe pas de politiques, de règlements, d’incitatifs ou d’approches spécifiquement dévolus aux 15-25 ans et au nocturne (16h-6h), ni aux espaces de la ville fréquentés par les jeunes à ce moment particulier (Conseil jeunesse de Montréal 2022), notre recherche s’est développée sur ce terrain laissé vacant.
La nuit régulée de la nouvelle ville 24/24
Dans un contexte de compétition entre les grandes métropoles, les autorités locales et les organisations non gouvernementales promeuvent le concept de ville 24/24, parfois comme une fatalité (Buhagiar et Espinasse 2004), parfois comme une évolution inéluctable (Johnston 2002). Avec une focale sur l’économie de la nuit ou l’attractivité nocturne, la ville 24/24 consiste à développer les offres de transports et autres services publics toute la nuit pour s’adapter aux nouveaux usages du temps libre (Johnston 2002). Parallèlement, un pan important de la littérature, à l’intersection des impératifs d’ordre public et des logiques de marketing, s’est concentré sur les politiques nocturnes de régulation (Homan 2019; Seijas et Mirik; Milan 2020), sur les enjeux de surveillance propres à la nuit (Chatterton et Hollands 2002) et sur la « juridicisation de la vie nocturne » (Talbot 2011 : 2). La nouvelle nuit urbaine, qui accentuerait un espace-temps déjà associé à l’excès, au divertissement et à la consommation, exigerait encore plus de surveillance et de normes.
Les sociabilités nocturnes
Si la nuit extraordinaire fait parler d’elle, comment aborder les nuits ordinaires? Chausson (2019) admet que c’est davantage par la régulation des activités des nuits que dans leurs potentialités qu’elles sont perçues : « les nuits ordinaires […] ne profitent pas du même niveau d’acceptation publique ni des mêmes attentions politiques alors que c’est dans l’ordinaire que se cristallisent les véritables enjeux d’animation et d’apaisement de la nuit ». La nuit, « trou noir de l’action publique locale » (Chausson 2019 : 449), mériterait une prise en compte plus globale de ses enjeux spécifiques en réunissant notamment des projets d’animation et de détente, généralement opposés, et en formulant une politique spécifique au même titre que celle qui encadre les projets diurnes.
En effet, dans la représentation de la nuit comme « un temps de compensation, de récréation […] un temps de convivialité, de rencontres, de sensualité, de fêtes, de transgression » (Mouchtouris 2003 : 16), ce qu’on retient, c’est l’excès, la transgression, au détriment de la sociabilité, sous-jacente de ces activités. La nuit et ses formes de sociabilité marqueraient une transition vers l’âge adulte (Chausson 2019) : composition et recomposition des liens sociaux, déplacements et développements des compétences de mobilité; l’espace nocturne favoriserait les échanges.
Les écrits concernant les potentialités de la nuit pour parvenir à être soi, ou devenir adulte, se concentrent généralement sur les lieux de divertissements nocturnes et les espaces de consommation (Desjeux et al. 1999). Mais les sociabilités nocturnes ne se jouent pas exclusivement dans ces seuls cadres. Pour les jeunes, l’espace public — surtout la nuit — représente un territoire de libertés où il est possible de se retrouver quand les parents dorment (Mouchtouris 2003). Leur expérience est souvent associée à des expérimentations, surtout dans les grandes villes, perçues comme des lieux initiatiques « par excellence » (Gauthier 2004 : 34). Chez les adolescentes par exemple, l’espace public est un support à la création de liens sociaux, hors du regard et du contrôle parental, à distance de l’assignation genrée à la sphère privée (Cossette et Boucher 2021; Lloyd et al. 2008; Skelton 2000). En France, les jeunes de cité désertent les lieux de divertissement nocturnes coûteux (bars, boîtes de nuit, salles de spectacles, etc.) pour investir des espaces moins attendus comme les cages d’escalier, les caves et autres lieux (Mouchtouris 2003).
Que font les jeunes la nuit, quand ils et elles ne vont pas dans les clubs, ne fréquentent pas les bars, ou les lieux destinés à une jeunesse perçue comme transgressive, hyper mobile et avide de découvertes? Comment se déploie la régulation des transgressions ordinaires? Ces questions couvrent plusieurs pistes à explorer, d’autant plus prometteuses que les chercheurs-euses se sont jusqu’ici concentré-es sur les nuits événementielles, les nuits dansantes et souvent chargées d’ivresse. À travers l’étude des pratiques et expériences de jeunes montréalais-es que nous avons suivi-es dans certains parcs de la ville, nous revenons sur la façon dont la nuit mobilise leurs sens et module leur expression de soi, leurs relations aux autres et leurs liens aux espaces.
Méthodologie
Notre méthodologie emprunte à l’ethnographie et à l’anthropologie de la communication, qui rendent compte avec sensibilité et rigueur des pratiques et interactions quotidiennes et ordinaires dans l’espace public (Goffman 1973; Joseph 1981; Low 2000; Winkin 2001). Elle se décline en plusieurs outils qui ont permis une collecte de données très riche et multisite.
Nous appuyant sur les méthodes originales développées par Boucher (2012; 2017), inspirées entre autres des travaux de Day (2011), Golicnik et Ward Thompson (2010), Unt et Bell (2014), nous avons mobilisé l’observation et les entretiens semi-dirigés, individuels et en groupes. La réalisation d’une recension méthodologique des travaux en sciences sociales consacrés à la vie nocturne a par ailleurs permis de valider l’efficacité de l’utilisation de méthodes mixtes. Si la majorité de ces études utilisent les questionnaires et les entrevues, nous avons fait le choix de mobiliser également l’observation participante puisqu’elle révèle la subtilité, la temporalité et l’ancrage spatial des pratiques, mais aussi l’indicible (Conseil jeunesse de Montréal 2022).
Entre le 12 juillet et le 9 octobre 2020, près de 470 heures d’observation ont été réalisées dans six parcs de Montréal, la nuit, de 16h (heure qui signale généralement la fin de l’horaire de travail et d’étude, et le début du temps libre) à 3h du matin (heure de fermeture des établissements nocturnes), selon un horaire réparti de manière équilibrée entre les soirs de semaine et de fin de semaine. Durant les périodes d’observation de deux heures chacune, deux techniques ont été utilisées : la cartographie des comportements (Boucher 2012; 2017; Golicnik et Ward Thompson 2010; Lofland 1998; Marcus and Francis 1997; Unt et Bell 2014) et le suivi des interactions, aussi appelé « pistage » (Boucher 2012; 2017; Hall 2003; Winkin 2001). La cartographie des comportements consiste à localiser sur un plan du site, au début et à la fin de chaque période d’observation, tous-tes les usagers-ères, leurs activités (comme parler, manger, ou lire) et leurs caractéristiques sociodémographiques présumées (leurs genre, âge et appartenance ethnoculturelle). Entre-temps, les observateurs-trices choisissent au hasard un-e jeune ou un groupe de jeunes dont ils et elles notent minutieusement les comportements, les interactions intra et extragroupe, tout comme le mobilier et les installations utilisées, par périodes de 10 minutes. Cette description détaillée des événements est accompagnée de croquis qui permettent de représenter la scène observée tout en préservant l’anonymat des personnes; une méthode nommée Humpty Dumpty (Boucher 2012; 2017). Au total, 9 355 usagers-ères ont été cartographié-es dans les parcs de notre enquête, dont un peu plus du tiers ont été identifié-es comme appartenant à la tranche d’âge des 15 à 25 ans.
Figure 1
Parcs observés et arrondissements de résidence des jeunes interrogé-es
De juillet 2020 à mars 2021, des entretiens semi-dirigés individuels et en groupes ont été menés avec 64 jeunes âgé-es de 16 à 25 ans, recruté-es sur une base volontaire, surtout via les réseaux sociaux et par effet boule de neige. La technique d’échantillonnage préconisée ne permettait pas d’assurer une représentativité de l’échantillon, mais la composition de celui-ci s’est avérée relativement diversifiée tant au niveau du genre, de l’âge, de l’appartenance ethnoculturelle que du quartier de résidence des participant-es. De surcroît, de mars à août 2021, 11 entretiens ont été conduits auprès d’intervenant-es municipaux-ales, communautaires et universitaires.
Notons que nos observations, limitées à une sélection de parcs, excluent les espaces publics que sont les places, les rues et les ruelles, et se sont déroulées hors de la saison hivernale[2]. Nous avons compensé cette limite par des invitations, lors des entrevues, à élargir la couverture spatio-temporelle des activités décrites[3]. Précisons également que les observations ont été réalisées dans le contexte de la pandémie de COVID-19, alors que les espaces publics extérieurs étaient les seuls lieux de rassemblement accessibles[4]. Il a été possible d’en tirer un avantage : constater la pression sur les installations (notamment sanitaires), le mobilier et l’espace, mettre en lumière le besoin de faire ses activités normales la nuit, et la pertinence des espaces publics pour ce faire.
Chiller et autres banalités
Les observations dans les parcs révèlent la prévalence d’activités que l’on peut qualifier d’ordinaires, pratiquées par les jeunes usagers-ères. Ordinaire est, dans ce texte, associé à plusieurs autres manières de décrire les activités observées comme invisibles, banales, habituelles. Notre analyse des scènes observées intègre une évaluation des situations et des contextes qui les encadrent. Par exemple, au parc Lalancette (arrondissement Mercier–Hochelaga–Maisonneuve), sur 433 jeunes de 15 à 25 ans cartographié-es en pleine action, 358 étaient assis-es, 263 discutaient, 159 buvaient de l’alcool. Moins nombreux-euses étaient celles et ceux qui mangeaient (n=41), écoutaient de la musique sur haut-parleur (n=33), accompagnaient un ou des chiens (n=25), jouaient au ballon, à la pétanque ou autre (n=20), fumaient (n=19), utilisaient leur cellulaire ou une tablette (n=9), ou lisaient (n=3). Un portrait semblable a été dressé dans les autres parcs. Notons que la plupart de ces activités se font simultanément, l’une à la suite de l’autre, ou en alternance. Comprises dans les termes des jeunes rencontré-es en entrevue, ces activités composent, parmi d’autres, un ensemble de pratiques que le terme chiller, non dépréciatif et choisi ici pour son efficacité lexicale, englobe.
Chiller signifie, au plus simple, être assis-es et discuter entre ami-es. Terme francophone dérivé de l’anglais “to chill out”, se détendre, il est majoritairement employé au Québec[5]. Certains dictionnaires participatifs ou alternatifs en donnent une définition sommaire, dont la dimension principale serait de ne rien faire : « Flâner, ne rien faire de pertinent, en compagnie de ses amis » (La Parlure 2019). Ou encore :
[...] chiller est un anglicisme essentiellement utilisé au Québec et signifiant “prendre du bon temps, ne rien faire et se détendre”. Exemple : La bande de jeunes gens se retrouvait tous les samedis et se rendait sur la plage ou dans le centre-ville pour chiller et oublier les cours.
L’internaute 2021
Chiller s’est révélé une pratique dominante durant les entretiens avec les jeunes, peu importe leur âge, leur genre ou leur quartier de résidence. Nous avons noté 92 apparitions de variantes du terme chiller. Les jeunes l’utilisent comme tel, à l’infinitif (n=38), mais aussi conjugué (je chille, on chille) (n=21) et sous forme de nom, pour nommer l’événement en soi, le(s) chilling(s) (n=17) :
[On choisit nos parcs] plus en fonction d’où est-ce qu’on est le mieux pour chiller et en fonction de là où on vit tous.
Léo, adolescent blanc, 17 ans, arr. Le Plateau-Mont-Royal[6]
On met un petit drap à terre et tout le monde a sa bouteille de vin, on met une petite musique, pis on chille.
Marc, homme noir, 25 ans, arr. Saint-Léonard
Ce que je fais le plus le soir et la nuit quand je suis en congé, c’est d’aller au parc avec mes ami-es. […] Que ce soit pour un chilling […] ou même pour des fêtes ou des dates.
Karen, femme blanche, 24 ans, arr. Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
Les portraits types des jeunes noctambules déduits de nos observations dans les parcs font émerger une catégorie dominante, celle des chilleurs-euses, soit les jeunes dont l’activité principale est le chilling. Durant les entrevues, les chilleurs-euses se sont également révélé-es être une catégorie de jeunes dont la caractéristique principale est qu’ils et elles chillent souvent. Ce sont les ami-es qu’on contacte spécialement quand on veut chiller : « j’ai mon bassin de personnes plus chilleuses », nous mentionnait Karen (femme blanche, 24 ans, arr. Mercier–Hochelaga–Maisonneuve).
Finalement, être chill est également une expression utilisée par les jeunes pour qualifier un lieu ou une personne particulièrement relaxe, et parfois pour décrire une personne qui est (ou non) respectueuse, ou d’agréable compagnie (n=16) :
Parfois c’est arrivé que le barman soit moins chill, mais c’est vraiment pas arrivé souvent.
Manon, femme blanche, 23 ans, arr. Rosemont–La Petite-Patrie
Les résultats d’observation comme les entrevues montrent que chiller, et tout ce que le terme implique, est l’activité nocturne principale des jeunes montréalais-es. Activité banale et routinière, quotidienne dans beaucoup de cas, elle s’adapte à une multiplicité de lieux : les parcs, les logements privés, les bars, et même les stationnements. Les services et installations nécessaires à sa pratique nocturne dans l’espace public, d’une durée parfois prolongée, n’ont rien d’extraordinaire : espaces gazonnés, tables et bancs, éclairage stratégique, installations sanitaires, poubelles, wifi et transports en commun accessibles. S’il est possible de chiller de jour ou dans des cadres restrictifs (comme à l’école, entre deux cours), cette activité prend tout son sens hors du temps de la productivité conventionnelle (études, travail) et des obligations (familiales, communautaires), dans un environnement qui se veut agréable et confortable, hors des logements parfois trop petits, surpeuplés, et où le bruit inhérent au chilling entraîne des réprobations.
Chiller s’apparente ainsi à une disposition générale, d’un groupe ou d’une personne seule, plutôt qu’à une activité précise : il s’agit avant tout de se rassembler (ou de s’installer seul-e) dans un espace propice, sans objectif défini au préalable, dans un état d’esprit ouvert à la spontanéité. Chiller peut être l’occasion de discuter, de passer du temps entre ami-es, en mangeant, en jouant, tout en offrant une fenêtre à la transition vers des activités plus mouvementées, comme une sortie culturelle, festive, ou sportive.
Les qualités de l’ordinaire nocturne
Le terme chiller s’emploie de manière fluide et évolutive, dans des contextes constituant autant d’écosystèmes locaux, tissés de normes et de pratiques qui leurs sont propres (parcs, quartiers), par une diversité d’usagers-ères. Son utilisation, plutôt que de signifier l’absence d’activité, renvoie à une multitude de situations et de pratiques, dont il est possible de faire émerger certaines qualités transversales : l’improductivité, la magie, l’intimité et la liberté. Ces dernières éclairent les caractéristiques des activités ordinaires recherchées et pratiquées par les jeunes. Sans nier la recherche du sensationnel et du spectaculaire associée à certaines pratiques juvéniles nocturnes, nous explorons ici (et tentons de rendre justice à) la part ordinaire des nuits montréalaises.
Une dimension improductive de la nuit
Chiller se caractérise par sa dimension improductive[7], en opposition avec le monde du travail ou des études, souvent associé à la vie diurne et à l’âge adulte. La nuit, qualifiée comme un temps libre, en dehors de ces activités productives, offre ainsi un cadre opportun pour chiller. Pratiqué dans l’espace public, et donc à portée de vue et d’ouïe d’autrui, chiller peut par ailleurs faire l’objet de sanctions. S’agissant d’une pratique statique, parfois bruyante et susceptible de se prolonger sur plusieurs heures, chiller échappe aux représentations hégémoniques des normes d’occupation de l’espace public, construit comme un espace de mobilité dans lequel « les personnes passent pour rejoindre les deux espaces de sécurité que sont le domicile et le travail » (Bellot et al. 2015 : 21), et de plus en plus comme un espace de consommation (semblable aux bars, restaurants et boîtes de nuit).
Les « jeunes qui traînent » effraient, en focalisant sur eux les menaces de la rue. Ils occupent ostensiblement les carrefours, les places publiques, sans raison précise. Leur présence sans raison dans le passage n’est pas légitime et déjà illégale. Il n’est pas étonnant dans ces conditions que l’opinion publique les associe à toute forme d’effraction, de dépassement de l’interdit. Cette construction d’une “géographie de l’exclusion” s’inscrit alors dans une dynamique sociale et spatiale qui va alimenter les stratégies d’intervention en matière d’ordre public.
Bellot et al. 2015 : 22
Considéré (à tort ?[8]) comme un synonyme de « chiller », le terme « flâner » renvoie par ailleurs, au Québec, à une pratique sanctionnée par différents règlements municipaux, ayant trait à l’occupation de l’espace public et commercial, ainsi qu’au Canada, par l’article 175-1 du Code criminel : « Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas : […] flâne dans un endroit public et, de quelque façon, gêne des personnes qui s’y trouvent » (Code criminel du Canada 1985).
Les jeunes qui chillent peuvent ainsi faire l’objet d’une stigmatisation relative à leurs modes d’occupation, considérés illégitimes, mais pourtant légaux, de l’espace public. Les conseillers-ères en développement communautaire du Service de police de la Ville de Montréal rencontré-es en entrevue déploraient la discrimination sociale et l’importante criminalisation des jeunes assis-es et calmes dans les parcs la nuit par les citoyen-nes méfiant-es.
En outre, nos résultats montrent que les événements ou pratiques considérées transgressives ou relevant de l’incivilité mineure qui se pratiquent pendant un chilling la nuit – fumer, boire de l’alcool, uriner dans les buissons (par choix ou par contrainte), s’enlacer ou s’embrasser sous le regard des autres – sont effectivement récurrentes, mais que contrairement aux représentations associées à la présence des jeunes la nuit dans l’espace public, à l’exception de quelques regards réprobateurs, ils sont acceptés ou du moins tolérés par les usagers-ères des parcs étudiés. À chaque parc ses normes implicites, qui sont définies par les usagers-ères et le voisinage, révélant une régulation interne modulable elle-même en fonction des sous-secteurs des parcs, ou de l’heure.
En dernier lieu, ajoutons que si les jeunes ne sont peut-être pas les seul-es à chiller (les aîné-es, par exemple, constituent une autre catégorie susceptible d’occuper des espaces publics et privés de façon statique, prolongée et improductive), le terme semble leur être exclusif. On présume qu’en grandissant, les jeunes devenu-es adultes auraient plutôt tendance à désigner et à organiser leurs activités de façon plus précise et cadrée (voire plus légitimes) : « souper avec des ami-es », « lire au parc », « se retrouver entre ami-es », etc. Les sanctions conséquentes au fait d’occuper l’espace selon le triptyque « statique-prolongé-improductif » varient selon les catégories d’usagers-ères de l’espace public dont il est question. Par exemple, et contrairement aux aîné-es, les personnes en situation d’itinérance et les personnes racisées font l’objet de certains préjugés communs à ceux rattachés aux jeunes (désordre, incivilité) (Campbell et Eid 2009; Casséus 2016). L’occupation statique et prolongée de l’espace public par les femmes et les adolescentes est quant à elle plus souvent sanctionnée par du harcèlement et des violences à caractère sexuel (Alessandrin et al. 2017; Cossette et Boucher sous presse; Lieber 2002; Maurin 2017).
Une dimension magique de la nuit
La nuit est aussi propice à l’exploration sensorielle. La poétique de la nuit est une expérience qui n’échappe pas aux jeunes : plusieurs ont abordé spontanément la dimension sensible de cet espace-temps et ont témoigné de leur appréciation de l’esthétique toute particulière de la nuit, dont l’ambiance visuelle, sonore et haptique serait empreinte de magie :
Quand je marche, c’est plutôt la beauté, voir les arbres, les étoiles, d’une autre manière. […] Et le vélo, le soir, c’est magnifique avec un écouteur, tu fais de la vitesse. Il y a du plaisir et quelque chose de fantastique.
Yasmine, adolescente arabe, 17 ans, arr. Saint-Léonard
Ça m’amène un peu un sentiment de témoigner de quelque chose que je suis pas censée voir, j’ai l’impression de vivre alors que tout le reste du monde est endormi; j’adore observer la ville la nuit. […] il fait froid l’hiver, tu te promènes et personne n’a [marché] sur la neige encore. Ça me donne l’impression d’être privilégiée d’avoir ce moment-là et d’avoir une ville super silencieuse.
Éléonore, personne queer blanche, 22 ans, arr. Rosemont–La Petite-Patrie
Il y a des [lieux] qui sont moins visibles et qui donnent envie d’aller voir, comme une ruelle sombre jolie, ou parce que c’est une rue cool. Ou au contraire, on roule sur la nuit […] et il y a des choses qui ressortent du fait qu’elles sont lumineuses. […] ça change la perception de l’espace en visitant le jour et la nuit […]. Même chose pour le bruit ou le son, ça peut être l’autobus ou des gens qu’on entend en attrapant des bribes de conversations qu’on comprend pas, la toile sonore est différente.
Benoît, homme blanc, 24 ans, arr. Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
Les jeunes affirment que le calme de la nuit et la raréfaction de ses passagers-ères permettent de mieux profiter de l’atmosphère particulière qui en ressort. La « lenteur » de la nuit offre ainsi la possibilité de s’attarder, de prendre le temps d’observer plus attentivement les choses, mais aussi de s’observer soi-même avec plus d’acuité. Son caractère méditatif favorise les pauses en soi, hors du rythme diurne accéléré. Parce qu’elle sollicite les cinq sens, la nuit est décrite simultanément comme une invitation à l’introspection et à la création :
C’est une autre atmosphère, il y a quelque chose qui est vraiment particulier la nuit, le fait que tu sois un peu tout seul réveillé, dans ta bulle. Quand je travaille de la musique avec mon ami […] c’est toujours le soir qu’on se voit. […]. Le jour c’est le fun[9] aussi, mais on dirait que c’est plus pragmatique, c’est moins dans les feels[10].
Mat, homme blanc, 21 ans, arr. Lachine
Ces incursions nocturnes sous le règne du sensible illustrent encore une fois la dimension la plus valorisée par les jeunes, soit une expérience vécue de manière non explicite, intimement, sans artifice. Si le sens commun donné à l’expérience de la nuit par les jeunes est empreint de qualificatifs festifs et transgressifs, les jeunes montréalais-es valorisent tout autant les expériences banales de la nuit : les bars, clubs et salles de spectacles (surtout) restent effectivement des espaces de divertissement privilégiés à l’occasion, mais ce sont davantage les moments ordinaires, de partage et de longues discussions, qui sont priorisés. Beaucoup décrivent une « bonne soirée » comme un moment de partage simple avec leurs proches, en territoire connu : chez soi, chez des ami-es, dans un parc de quartier.
Une dimension intime de la nuit
La sobriété, le calme et la dimension banale de chiller appellent à l’intimité, avec soi ou avec d’autres. En majorité, les jeunes disent profiter de la nuit avec des personnes qu’ils et elles connaissent déjà, plutôt qu’en compagnie d’inconnu-es, dans des lieux propices aux discussions et aux échanges : certains secteurs de parcs, bars peu bruyants, chez les un-es et les autres. À l’effervescence et à l’éphémère, ils et elles préfèrent la richesse et la profondeur des longs moments partagés en petits comités, peu compatibles avec les rythmes diurnes. La nuit étant perçue comme un temps non productif et associée à un moment de détente, les jeunes trouvent une part de confort à éviter l’effort de la rencontre. La nuit permet donc de consolider des relations déjà existantes, plutôt que d’en créer de nouvelles :
C’est rare que j’allais dans des places comme des clubs ou des places plus de danse ou de gros party là, c’était moins ça qui m’attirait. C’était plus sortir prendre une bonne bière pour parler avec des ami-es, puis plus le temps avançait et plus j’aimais ça sortir avec moins de gens à la fois. T’sais, si on sort et pis on est juste trois ensemble, j’étais plus à l’aise de pouvoir parler […] longtemps, en profondeur avec les gens.
Luc, homme blanc, 24 ans, arr. Rosemont–La Petite-Patrie
Les activités que je préfère c’est être avec des gens que j’aime, cercle d’ami-es, pas trop de gens. Pour moi, inviter des ami-es à la maison, cinq-six, avec mon copain, il invite ses ami-es aussi, on s’achète des bouteilles, de la pizza et on joue à des jeux de société, on regarde la télé un peu.
Emmy, femme asiatique, 19 ans, arr. Montréal-Nord
Circonscrire son territoire d’activité relève également de stratégies explicitement mises en place par les jeunes participant-es à nos entrevues, qui soulignent régulièrement les enjeux de sécurité liés à leurs pratiques nocturnes :
On dirait que, savoir que je suis dans mon quartier, je suis en sécurité, car je connais toutes les rues, toutes les ruelles, je sais où aller, je sais où la police passe. J’essaie d’être le moins possible loin de chez moi parce que ça crée une insécurité […]. Je veux dire, je suis une minorité visible, des fois il peut y avoir des gens qui peuvent croire que tu es quelqu’un ou comme “qu’est-ce que tu fais ici ?”, il m’a été demandé souvent dans des quartiers différents, par exemple le quartier Saint-Henri à Montréal, “qu’est-ce que vous faites là, vous êtes qui, vous êtes de quelle couleur ?” […] C’est pour ça que j’aime être dans mon coin, parce que les gens me connaissent, je connais des gens.
Marc, homme noir, 25 ans, arr. Saint-Léonard
Chausson souligne à ce propos la manière dont, entre les individus noctambules, « les différences sociales restent superficielles et cachent une homogénéité qui sécurise la relation à l’autre et permet l’expression de la liberté » (2019 : 142). Cet entre soi ou cette « communauté émotionnelle » (Desjeux et al. 1999) s’inscrit par ailleurs dans l’espace urbain, comme en témoigne l’exemple fourni par Deleuil, à propos des communautés homosexuelles dont les établissements nocturnes « sont plus ou moins regroupés au sein d’un même quartier et permettent une “certaine clandestinité [qui] protège contre les regards et les agissements crétins” » (Deleuil dans Chausson 2019 : 143).
Ce besoin de tranquillité et d’intimité se traduit parfois par une critique de l’offre culturelle nocturne, essentiellement centrée sur la consommation. Certain-es jeunes, prônant l’authenticité et l’accessibilité, considèrent que les bars, clubs et autres institutions nocturnes ne répondent pas à leurs besoins, et dénoncent une forme de capitalisme nocturne qui ne leur correspond pas :
Je fréquente les milieux queer et féministes […], des concerts de solidarité […], des milieux alternatifs; comme je ne vais pas dépenser un sou dans les bars de la rue, je ne connais même pas leurs noms, genre les trucs huppés où y’a plein de lumières, t’as l’impression t’es à Time Square […] ça ne m’intéresse pas du tout. […] on s’entend qu’on est compris dans le capitalisme et […] ça me pue au nez […] d’aller dépenser dans de gros trucs. Je fais des soirées en famille dans des endroits qui sont un peu plus intimes.
Éléonore, personne queer blanche, 22 ans, arr. Rosemont–La Petite-Patrie
Les plus jeunes, notamment, ne trouvent pas toujours leur place dans la nuit mainstream, qui est perçue comme étant réservée aux consommateurs-trices et aux extraverti-es, et qui offre peu de lieux de rassemblement pour les personnes mineures :
À l’époque où j’avais 16-17 ans, je trouvais ça vraiment très contraignant d’avoir aucun lieu de rassemblement intérieur autre que, mettons le sous-sol à quelqu’un. Une patinoire par exemple, même à mon âge, j’aimerais ça sortir sans forcément boire et faire autre chose. […] Je trouve que les seules [places] qui restent ouvertes longtemps, c’est le classique : les bars et clubs. Puis c’est pas pour tout le monde. C’est comme si la nuit était réservée aux extraverti-es qui vont sortir, mais les introverti-es veulent peut-être aller à la librairie à 2h du matin.
Pami, femme blanche, 20 ans, arr. Villeray-Saint-Michel-Parc-extension
Je pense que c’est trop tourné vers l’alcool, l’alcool et encore l’alcool.
Cindy, femme noire, 20 ans, arr. Montréal-Nord
Durant la jeunesse, les liens sociaux se recomposent et l’importance des relations familiales laisse place à d’autres formes de sociabilité. C’est ce que les jeunes expérimentent la nuit, par le renforcement des amitiés et des liens avec la communauté, qu’elle soit identitaire ou territoriale, en dehors des cadres diurnes. Dans le même ordre d’idée, en France, Mouchtouris (2003) a montré que durant leur temps libre, les jeunes s’approprient certains lieux aux frontières de l’espace public et de l’espace privé (les cages d’escalier, par exemple), qui favorisent la sociabilité et l’appartenance au sein d’un groupe. Ce sont des nuits que Mouchtouris qualifie comme étant confidentielles. Toutefois, alors que Chausson (2019 : 141) parle d’une « illusion de profondeur dans la relation à autrui » qui garderait une superficialité nécessaire au « charme relationnel » de la nuit, les jeunes avec qui nous avons discuté insistent sur l’authenticité des amitiés et des conversations entretenues durant leurs activités nocturnes :
Moi et mes ami-es, on aime ça avoir notre intimité, où on peut décider de parler de basket, on peut faire des “freestyles” en mettant des musiques, on peut décider [d’avoir des] discussions un peu osées sur certains sujets.
Marc, homme noir, 25 ans, arr. Saint-Léonard
Ces dimensions intimes de la nuit — l’entre soi et les espaces connus — assurent ainsi une forme de confort et de sécurité bienvenue, permettant à la fois de s’exprimer plus librement, de se sentir plus en contrôle de son environnement et globalement de son expérience nocturne. Cette tendance à l’immobilité nuance d’abord les thèses sur la jeunesse festive, qui cherche avant tout à explorer les différents territoires de la ville. En miroir, elle renforce celle que nous formulons sur ces nuits ordinaires, investies avant tout par la recherche d’intimité et de plaisir avec des personnes, et dans des lieux, que l’on connaît déjà.
Une dimension libre de la nuit
Durant le jour, la visibilité est associée à la surveillance et au contrôle (formel et informel), mais l’obscurité de la nuit permet à l’inverse un laisser-aller et un sentiment de liberté : moins facilement vu-es et reconnu-es dans l’ombre, les jeunes décrivent un allègement de la pression des exigences sociales. Ne pas risquer de croiser ses parents ou ses voisin-es sont des facteurs de tranquillité liés au parc, que l’on choisira plus ou moins distant du domicile et du lieu de vie sociale diurne : « à l’inverse du jour où les emplois du temps sont contraints par les impératifs du quotidien, les individus placent la notion de choix au coeur de leurs discours » (Chausson 2019 : 225). Ce sentiment libérateur se traduit, d’une part, en opposition à la productivité et d’autre part, en termes d’expression de soi. D’abord, l’obscurité de la nuit offre une liberté en contraste avec les lumières du jour, qui appellent à la productivité et au mouvement :
[La nuit procure] une espèce de liberté [par rapport à] un regard sur la vie très normé : boulot, travail, dodo.
Vanessa, femme noire, 24 ans, arr. Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
Je trouve que dans la lumière tout le monde est en mode production […] et travail, et tout ça. Et quand il fait noir, c’est plus comme un mode relaxe, plus libre.
Ella, femme blanche, 22 ans, arr. Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
La majorité des êtres humains dans notre société, on fonctionne dans la journée, ce qui fait en sorte qu’on a des règles, des moeurs, etc. La nuit, c’est comme la nuit est pour nous, on a fini de faire toutes les actions, toutes les exigences, les critères, de travailler, donc la nuit c’est ton moment si tu veux retourner chez toi, prendre ta bière, écouter ton émission, dialoguer avec tes enfants ou tes ami-es.
Marc, homme noir, 25 ans, arr. Saint-Léonard
Dans l’ombre, les jeunes disent se sentir plus libres de s’exprimer, à la fois verbalement, artistiquement ou en lien avec la sexualité et le genre. L’obscurité offre une brèche qui encourage les jeunes noctambules à dévoiler des facettes de leur identité dissimulées le jour :
Je préfère discuter la nuit, je trouve qu’on est plus à l’aise, on est moins surveillé, on te reconnaît moins la nuit, donc c’est un peu le moment où tu peux dire ce que tu veux, il y a personne qui va te reconnaître demain.
Sony, homme arabe, 23 ans, arr. Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
Je trouve que la journée j’ai quand même un rôle un peu social, que je dois répondre à certaines exigences, alors que la nuit, ou dans ce cadre fictif, je peux m’habiller comme je veux, je peux même, tout ce qui est relié à l’identité de genre et sexuelle, genre justement ce que je recherchais dans les soirées LGBT, c’est […] d’être full[11] moi-même.
Maxime, personne non-binaire blanche, 25 ans, arr. Le Sud-Ouest
Je fais du graffiti […], en tant que personne queer on n’a pas tant d’espace pour s’exprimer alors je trouve que c’est un moyen d’expression incroyable, s’inscrire littéralement dans l’espace public, sur les murs et tout.
Éléonore, personne queer blanche, 22 ans, arr. Rosemont–La Petite-Patrie
Le soir quand on sort […] tu peux être toi, tu peux être plus osé, autant pour une femme que pour un homme, porter des vêtements […] que tu ne pourrais pas porter en général à ton travail ou à l’école.
Marc, homme noir, 25 ans, arr. Saint-Léonard
Les jeunes font aussi le récit de nuits où le sentiment de liberté favorise la création et l’exploration : écriture, musique, arts visuels ou promenades urbaines.
Q : Quand tu penses à la nuit, quelle représentation en as-tu ?
R : Exploration. […] je me sens plus libre d’aller plus loin. En tant qu’artiste c’est plus la nuit que je vais créer. Sans temps, sans stress.
Vanessa, femme noire, 24 ans, arr. Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
Je dirais les moments où je suis la plus créative c’est le soir, ça me vient plus facilement, y’a moins de contraintes, je suis plus libre dans mon écriture.
Claire, femme blanche, 24 ans, arr. Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
Je me sens plus créatif le soir […], j’ai plus le goût de travailler ou de créer des choses, donc c’est souvent là que je prends des notes dans un cahier […]. Je vois personne dehors, je vois plus de lumière dehors, aucun bruit autour. C’est calme, ça me permet d’être très focus[12] sur ce que j’ai à faire.
Luc, homme blanc, 24 ans, arr. Rosemont–La Petite-Patrie
Finalement, ces quatre dimensions de la nuit ordinaire — l’improductivité, la magie, l’intimité, la liberté — se nourrissent mutuellement. Comme le décrit Bianchini (1995 : 124), la nuit banale constituerait « un temps libre pour l’épanouissement personnel… le temps de l’amitié, de l’amour, de la conversation… plus libre que le jour des contraintes, conventions et persécutions sociales [13]», dont l’appropriation constitue une forme de « contre-pouvoir » au jour (Chausson 2017 : 18). Bien que certain-es valorisent l’exploration urbaine lors de promenades nocturnes, c’est généralement dans l’intimité, chez soi ou dans son quartier, avec ses proches, que les jeunes disposent de ces moments hors des injonctions à la productivité et à la performance d’une identité contraignante.
Conclusion
Historiquement, l’analyse des pratiques juvéniles dans l’espace public se consacre surtout aux potentielles criminalités, aux transgressions, ou aux expressions identitaires, artistiques, créatives et ludiques. L’étude de la nuit, quant à elle, se préoccupe surtout des enjeux de sécurité et de surveillance, ou bien des dimensions de la fête et de la consommation. Au-delà de ces terrains attendus, notre enquête permet de découvrir les manières dont les jeunes montréalais-es s’approprient la nuit, et révèle leurs pratiques ordinaires. Chiller s’impose ainsi comme une activité dominante et englobante, dans la quiétude de la nuit : autorisant l’improductivité, elle invite à l’intimité (avec soi, entre-nous, en territoire connu), à la liberté (être soi-même, dégagé-e des contraintes et exigences du rythme de vie et des contextes sociaux diurnes) et à la découverte sensorielle de la ville nocturne, à laquelle est conférée un caractère magique (raréfaction des usagers-ères, silence, obscurité dissimulatrice et lumières révélatrices). Ainsi, s’attarder sur l’ordinaire des nuits urbaines montréalaises offre un regard nécessaire et renouvelé sur ses usages et ses jeunes usagers-ères, pour qui devient primordiale la valorisation des pratiques banales et la disponibilité d’espaces propices pour chiller.
Appendices
Remerciements
Cette recherche a été réalisée dans le cadre du projet Tryspaces, financé par le Conseil des sciences humaines du Canada (895-2017-1019). Certaines des données présentées dans cet article ont initialement été publiées en 2022 dans l’Avis « Montréal nocturne : perspective jeunesse sur l’utilisation des espaces publics » du Conseil jeunesse de Montréal, réalisé en collaboration avec l’organisme R.Es.P.I.R.E. Merci à Magalie Carrier-Girard, Léa Chrétiennot, Camille Fuentes et Quentin Guatieri pour leur contribution à ce projet de recherche.
Notes
-
[1]
Voir par exemple l’Avis sur la mobilité des jeunes montréalais-es de 17 à 30 ans du Conseil jeunesse de Montréal (2019).
-
[2]
Au Québec, l’hiver modifie considérablement les possibilités en termes d’activités, de lieux et de durée pour les rassemblements extérieurs.
-
[3]
Durant les entrevues, les jeunes ont résumé leurs pratiques hivernales au fait qu’ils et elles ne sortent pas, ou rarement, dans l’espace public de manière prolongée et statique. Ils et elles privilégient des activités similaires, mais à la maison, dans les voitures ou dans des établissements locatifs privés. Nous avons donc choisi d’exclure la période hivernale de l’analyse des résultats subséquente.
-
[4]
Malgré le règlement en vigueur à l’été 2020, plusieurs rassemblements de plus de 10 personnes ont été observés.
-
[5]
Les jeunes français-es lui préfèrent l’expression « se poser ».
-
[6]
Nous utilisons des pseudonymes. La manière de nommer le genre et l’appartenance ethnoculturelle des participant-es aux entrevues a été choisie par les personnes elles-mêmes. Nous employons les termes « adolescent » ou « adolescente » pour les personnes mineures (moins de 18 ans).
-
[7]
Par contraste avec les activités productives conventionnelles. Chiller peut être vue comme une activité productive alternative, car les jeunes font quelque chose. Chiller est une pratique normée, pratiquée massivement et tangible, même nécessaire et utile au développement social et affectif des jeunes.
-
[8]
Bien que le terme puisse légalement les désigner, et que certain-es jeunes emploient « chiller » comme un euphémisme pour englober des pratiques effectivement transgressives (comme la consommation d’alcool ou de substances illicites dans l’espace public), notons qu’aucun-e des participant-es à nos entrevues n’utilise « flâner » pour définir ses propres activités.
-
[9]
Signifie « amusant ».
-
[10]
Signifie « émotions ».
-
[11]
Signifie « complètement ».
-
[12]
Signifie « concentré ».
-
[13]
Notre traduction de « a time which is free for one’s own personal development… the time of friendship, of love, of conversation… freer than the daytime from social constraints, conventions and persecutions ».
Bibliographie
- Alessandrin, Arnaud, Johanna Dagorn et Laetitia Cesar-Franquet, 2017, « La nuit, tous les déplacements des femmes sont gris ». CAMBO : Cahiers de la Métropole Bordelaise 12 : 54–55.
- Archambault, Michel, Pascale Daigle, Hélène Huard, Sylvain Lefebvre et Olivier Filiatrault, 2005, Analyse de l’environnement externe (benchmarking) des expériences étrangères dans le domaine des festivals et événements. Montréal, Chaire du Tourisme, ESG UQAM.
- Bellot, Céline, Isabelle Raffestin, Marie-Noële Royer et Véronique Noël, 2005, Judiciarisation et criminalisation des populations itinérantes à Montréal. Montréal, Secrétariat National des Sans-abri. En ligne : https://www.homelesshub.ca/sites/default/files/3eti2wov.pdf
- Bertrand, Romain, 2002, Indonésie : la démocratie invisible. Violence, magie et politique à Java. Paris, Karthala.
- Bianchini, Ranco, 1995, « Night cultures, night economies ». Planning Practice and Research 10 (2) : 121–126.
- Boucher, Nathalie, 2012, « Vies et morts des espaces publics à Los Angeles : Fragmentation et interactions urbaines ». Montréal, Institut national de la recherche scientifique – Centre Urbanisation Culture Société.
- Boucher, Nathalie, 2017, « The People in Los Angeles Public Spaces Are Not Dead : Micro-Sociability in the Square, Plazas, and Parks of the Modern Global City ». Dans Jenny Banh et Melissa King (dir.) Anthropology of Los Angeles : City, Image, and Politics. 45–72. Lanham, Lexington Books.
- Buhagiar, Peggy et Catherine Espinasse, 2004, Les passagers de la nuit : vie nocturne des jeunes. Paris, L’Harmattan.
- Burnett, Jon, 2011, « UK: racial violence and the night-time economy ». Race & Class 53 (1) : 100–106.
- Cabantous, Alain, 2009, Histoire de la nuit : XVIIe-XVIIIe siècle. Paris, Fayard.
- Campbell, Christine et Paul Eid, 2009, La judiciarisation des personnes itinérantes au Québec : un profilage social. Montréal, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec. En ligne : https://cdpdj.qc.ca/storage/app/media/publications/itinerance_avis.pdf
- Candela, 2017, « Pour une sociologie politique de la nuit ». Cultures & Conflits 105-106 (printemps/été) : 7–27.
- Casséus, Thierry, 2016, Entre contestation et résignation : L’expérience de profilage racial de jeunes racisés ayant reçu des constats d’infraction dans le cadre du contrôle de l’occupation de l’espace public montréalais. Mémoire de maîtrise en travail social, Université de Montréal.
- Chatterton, Paul et Robert Hollands, 2002, « Theorising urban playscapes: producing, regulating and consuming youthful nightlife city spaces ». Urban studies 39 (1) : 95–116.
- Chausson, Nicolas, 2017, « Vers un urbanisme de la nuit. Une première lecture des nuits de la métropole lyonnaise à travers le concept de qualité de vie ». Dans Laurent Matthey, Simon Gaberell et Raphaël Pieroni (dir.), Planifier la nuit ? Quand les politiques d’aménagement s’emparent des enjeux culturels et festifs nocturnes : 15–22. Genève, R-EMU.
- Chausson, Nicolas, 2019, Penser la “métropole nocturne” : entre tensions, risques et opportunités : une première approche des nuits de la métropole lyonnaise à travers le concept de qualité de vie. Thèse de doctorat, Géographie, Université Grenoble Alpes.
- Code criminel, 1985, Lois et règlements du Canada. Ch. C-46, Partie V : Infractions d’ordre sexuel, actes contraires aux bonnes moeurs, inconduite, article 175-1, Troubler la paix, etc., alinéa c). En ligne : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/page-40.html#h-115408
- Conseil jeunesse de Montréal, 2022, « Montréal nocturne : perspective jeunesse sur l’utilisation des espaces publics ». Montréal, Conseil jeunesse de Montréal. En ligne : http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/cons_jeunesse_fr/media/documents/avis_montreal_nocturne.pdf
- Cossette, Sarah-Maude et Nathalie Boucher, 2021, « Les adolescentes, tacticiennes de l’espace public. Usages engagés et expériences transgressives des adolescentes dans les parcs de Pointe-aux-Trembles (Montréal) ». Revue canadienne de recherche urbaine 30 (2) : 109–123.
- Crozat, Dominique, 2020, SmartNights — Argumentaire du projet. SmartNights : pour des nuits urbaines durables et inclusives. En ligne : https://smartnights.hypotheses.org/159
- Day, Kristen, 2011, « Feminist approach to urban design ». Dans Tridib Banerjee and Anastasia Loukaitou-Sideris (dir.), Companion to urban design : 150–161. Londres, Routledge.
- Deleuil, Jean-Michel, 1993, Lyon la nuit, espaces, pratiques, représentations. Thèse de doctorat, Géographie, aménagement et urbanisme, Université Lumière – Lyon 2.
- Desjeux, Dominique, Magdalena Jarvin et Sophie Taponier, 1999, Regards anthropologiques sur les bars de nuit. Espaces et sociabilités. Paris, L’Harmattan, coll. Dossiers sciences humaines et sociales.
- Espinasse, Catherine, Luc Gwiazdzinski et Edith Heurgon, 2005, La nuit en question(s). La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube.
- Galinier, Jacques et al., 2010, « Anthropology of night: cross-disciplinary investigations ». Current Anthropology 51(6) : 819–836.
- Gauthier, Madeleine, 2004, « La ville fait-elle encore rêver les jeunes ? ». Dans Pierre-W. Boudreault et Michel Parazelli (dir.), L’imaginaire urbain et les jeunes. La ville comme espace d’expériences identitaires et créatrices : 29–43. Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec.
- Goffman, Erving, 1973, La mise en scène de la vie quotidienne II. Les relations en public. France, Éditions de Minuit.
- Golicnik, Barbara et Catharine Ward Thompson, 2010, « Emerging relationships between design and use of urban park spaces ». Landscape and Urban Planning 94 (1) : 38–53.
- Gwiazdzinski, Luc, 2002, « Les temps de la ville : nouveaux conflits, nouvelles frontières ». Anthropos. Villes et frontières : 195–212. En ligne : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00700791/file/Les_temps_de_la_ville_nouveaux_conflits_nouvelles_frontiA_res.pdf
- Gwiazdzinski, Luc, 2005, La nuit, dernière frontière de la ville. La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube.
- Hall, Edward T., 2003, « Proxemics ». Dans Setha M. Low et Denis Lawrence-Zuniga (dir.), The Anthropology of Space and Place : Locating Culture : 51–73. Oxford, Blackwell Publishers.
- Homan, Shane, 2019, « ‘Lockout’ laws or ‘rock out’ laws? Governing Sydney’s night-time economy and implications for the music city ». International Journal of Cultural Policy 25 (4) : 500–514.
- Johnston, Jennifer Lee, 2002, Open 24 hours: a case study of Vancouver and the twenty-four hour city concept. Mémoire de maîtrise, Planification urbaine, University of British Columbia.
- Joseph, Isaac, 1981, « Éléments pour une analyse de l’expérience de la vie publique ». Espaces et Sociétés 36 : 57–76.
- La parlure, s.d., « Chiller ». Dans Le dictionnaire collaboratif du français parlé. En ligne : https://www.laparlure.com/terme/chiller
- Lieber, Marylène, 2002, « Le sentiment d’insécurité des femmes dans l’espace public : une entrave à la citoyenneté ? ». Nouvelles Questions Féministes 21: 41–56.
- L’internaute. s.d. « Chiller ». Dans Dictionnaire français. En ligne : https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/chiller
- Lloyd, Kathleen, Josephine Burden et Jackie Kiewa, 2008, « Young girls and urban parks: planning for transition through adolescence ». Journal of Park and Recreation Administration 26 : 21–38.
- Lofland, Lyn H., 1998, The Public Realm. Exploring the City’s Quintessential Social Territory. New York, Aldine de Gruyter.
- Lovatt, Andy et Justin O’Connor, 1995, « Cities and the Night-time Economy ». Planning Practice & Research 10 (2) : 127–134.
- Low, Setha M., 2000, On the Plaza : The Politics of Public Space and Culture. Austin, University of Texas Press.
- Marcus, Clare Cooper et Carolyne Francis (dir.), 1998, People Places. Design Guidelines for Urban Open Spaces. New York, John Wiley & Sons.
- Maurin, Marine, 2017, « Femmes sans abri : vivre la ville la nuit. Représentations et pratiques ». Les Annales de la recherche urbaine 112 : 138–149.
- Mouchtouris, Antigone, 2003, Les jeunes de la nuit : représentations sociales des conduites nocturnes. Paris, L’Harmattan.
- New York Nightlife Association, 2004, The $9 Billion economic impact of the nightlife industry on New York city: a study of spending by bar lounges and clubs/music venues and their attendees. New York, New York Nightlife Association. En ligne: http://rhiweb.org/resource/economic/nyc.pdf
- Oloukoï, Chrystel, 2016, « Nuits, objets de peurs et de désirs à Maboneng (Johannesburg, Afrique du Sud) ». Sociétés politiques comparées 38 (janvier-avril), en ligne : http://www.fasopo.org/sites/default/files/charivaria2_n38.pdf.
- Paquot, Thierry, 1997, « Le sentiment de la nuit urbaine aux XIXe et XXe siècles ». French Literature Series 24 : 1–32.
- Seijas, Andreina et Mirik Milan Gelders, 2020, « Governing the Night-time City: The Rise of Night Mayors as a New Form of Urban Governance after Dark ». Urban Studies 58 (2) : 316–334.
- Skelton, Tracey, 2000, « Nothing to do, nowhere to go? Teenage girls and public space in the Rhondda Valleys, South Wales ». Dans Sarah Halloway et Gill Valentine (dir.), Children’s Geographies : Playing, Living, Learning : 69–85. London, Routledge.
- Talbot, Daborah, 2011, « The Juridification of Nightlife and Alternative Culture: Two UK Case Studies ». International Journal of Cultural Policy 17 (1) : 81–93.
- Unt, Anna-Liisa and Simon Bell, 2014, « The Impact of Small-scale Design Interventions on the Behaviour Patterns of the Users of an Urban Wasteland ». Urban Forestry & Urban Greening 13 (1) : 121–135.
- Winkin, Yves, 2001, Anthropologie de la communication. De la théorie au terrain. Paris, Éditions du Seuil.
List of figures
Figure 1
Parcs observés et arrondissements de résidence des jeunes interrogé-es