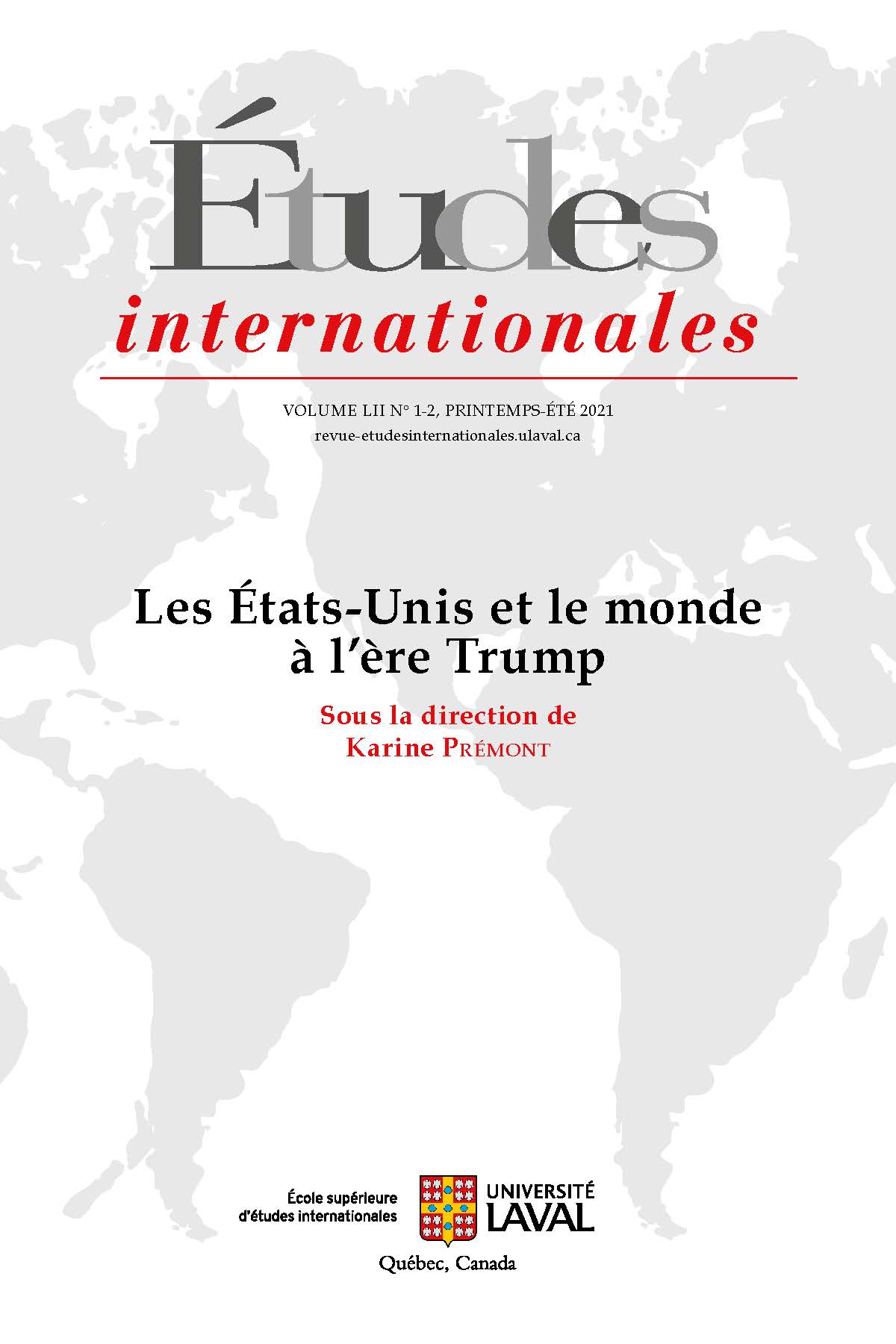Abstracts
Résumé
Cet essai présente une réflexion sur la manière dont le Canada peut renforcer sa politique étrangère. Afin de se différencier des grandes puissances et de déployer une politique étrangère stratégique, le Canada doit d’abord approfondir et mettre en oeuvre sa politique étrangère féministe. Une politique féministe force une réflexion stratégique d’ensemble. Cette politique est plus inclusive et démocratique, car elle met notamment l’accent sur l’accès et la participation de la société civile dans le système international. Si elle est mise en oeuvre de manière rigoureuse, elle présente une occasion de consolider la cohérence entre l’implémentation de politiques liées aux enjeux féministes au Canada et ceux à l’étranger. Une politique féministe doit nécessairement être enracinée dans le terrain et répondre aux besoins des communautés ; elle doit donc être soutenue par une présence accrue des diplomates canadiens à l’étranger et une empreinte diplomatique robuste.
Mots clés:
- Affaires étrangères,
- stratégie,
- Canada,
- politique étrangère féministe,
- empreinte diplomatique
Abstract
This essay presents some strategic considerations on how Canada can strengthen its foreign policy. To differentiate itself from great powers and deploy a strategic foreign policy, Canada must deepen and implement its feminist foreign policy. A feminist foreign policy is a forcing mechanism for the undertaking of a holistic strategic review. Such a policy is more inclusive and democratic in nature as it emphasizes civil society access and participation in the international system. If this policy is implemented in a rigorous manner, it presents an opportunity to consolidate the coherence between Canada’s intervention on feminist issues at home and abroad. A feminist approach in foreign affairs must be rooted in the field and target the needs of communities ; thus it must be supported by a greater presence of Canadian diplomats abroad and a robust diplomatic footprint.
Keywords:
- Foreign affairs,
- Strategy,
- Canada,
- Feminist foreign policy,
- Diplomatic footprint
Article body
Introduction
L’arrivée au pouvoir du Parti libéral de Justin Trudeau en 2015 a causé un émoi incontestable au sein de la communauté des multilatéralistes canadiens. Au cours de la décennie précédente, durant laquelle Stephen Harper était premier ministre de 2004 à 2015, trois grands moments ont marqué au fer rouge la conscience collective des individus qui oeuvraient dans le secteur humanitaire et dans les organisations internationales.
Le premier choc a eu lieu en 2010. En effet, pour la première fois de son histoire, le Canada a subi une défaite lors de sa course pour obtenir un siège au Conseil de Sécurité de l’onu. Les défaites du Canada lors de ses tentatives d’obtention d’un siège au Conseil de Sécurité, y compris en 2020, ne sont pas nécessairement synonymes d’un déclin de son influence mondiale. Cela dit, ce moment a été tout de même perçu comme une première atteinte à l’identité multilatéraliste du Canada. Le deuxième coup eut lieu en décembre 2011, lorsque le ministre de l’Environnement de l’époque, Peter Kent, annonça le retrait du Canada de l’accord de Kyoto. Finalement, le coup de grâce eut lieu en 2013, au moment de la fusion de l’Agence canadienne de développement international (acdi) au reste du ministère des Affaires étrangères, renommé à ce moment-là ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement[1]. Ce fusionnement a été perçu comme un abandon de la mission apolitique vouée au développement international. Cette décennie a aussi été parsemée d’autres moments qui, bien que moins marquants, ont terni la réputation multilatéraliste du Canada aux yeux des observateurs au Canada et à l’étranger. On pense entre autres à l’annonce de John Baird en novembre 2011, alors ministre des Affaires étrangères, qui a expliqué qu’à la suite de l’accession des Palestiniens à l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (unesco), le Canada ne fournirait plus de paiements excédentaires à ses contributions statutaires pour soutenir l’organisation qui faisait face à un grand manque budgétaire. On peut penser également au boycott du sommet du Commonwealth au Sri Lanka.
C’est dans ce contexte que les libéraux ont fait campagne en 2015, promettant un retour du Canada sur la scène internationale. L’échiquier mondial a gagné en complexité depuis. La montée de Daesh en Irak et en Syrie, la nécessité de renégocier l’aléna sous Trump ainsi que l’escalade de vives tensions avec la Chine (également héritage de l’ère Trump) ont marqué l’engagement canadien au cours de ces années. Il faut aussi souligner que Justin Trudeau n’est pas le seul à avoir déclaré, lors son élection, le retour du Canada dans le monde. Les Premiers ministres Martin et Harper avaient fait la même promesse lors de leur arrivée au pouvoir (Chapnick 2021). Ce slogan revient de manière cyclique et est populaire également à l’extérieur du Canada. Joe Biden a fait la même déclaration après avoir remporté l’élection américaine en 2020. Plutôt que d’évaluer si le Canada a réellement fait un retour sur la scène internationale, une réflexion s’impose sur le rôle que doit jouer le Canada sur la scène internationale et sur les manières de renforcer sa politique étrangère. À ce titre, deux grands champs d’action sont analysés. Deux aires d’intervention auxquelles les diplomates et les ministres présents et futurs doivent réfléchir afin de mobiliser le potentiel canadien en matière de politique étrangère. Tout d’abord, le Canada doit approfondir et mettre en oeuvre sa politique étrangère féministe. Une politique féministe permet de faire un examen d’envergure de la politique étrangère canadienne dans son ensemble, un examen qui est souvent exigé par les chercheurs et experts dans ce domaine, bien que rarement dans le contexte du féminisme (Juneau 2020 ; Paris 2019). Également, cet essai avance que le Canada doit accroître sa présence sur la scène internationale, c’est-à-dire étendre son empreinte diplomatique physique et humaine à l’étranger. Il s’agit d’une condition pour la mise en oeuvre d’une politique étrangère féministe, puisqu’une telle approche requiert une localisation des politiques et des programmes et une définition des priorités canadiennes sur le terrain.
Cet essai se concentre donc sur ces deux thèmes qui découlent l’un de l’autre. La mise en oeuvre d’une politique étrangère féministe présente un potentiel de contribution stratégique et idéologique du Canada sur la scène internationale, alors que l’expansion de l’empreinte diplomatique consiste en un moyen pratique et logistique de définir, de déployer et d’assurer l’influence de cette politique féministe canadienne. La discussion des moyens pratiques nécessaires au déploiement de cette politique s’impose, car faire connaître des valeurs et des idées et tenter de persuader autrui de leur plus-value n’est pas suffisant en politique étrangère ; il faut avoir la capacité et les moyens de les disséminer et de les mettre en oeuvre (Welsh 2004 : 183).
À travers ces réflexions, un argument principal s’impose : le Canada doit être beaucoup plus impliqué et visible sur la scène internationale et se différencier à travers une stratégie féministe ancrée dans le travail diplomatique de terrain. Cette implication ne signifie pas nécessairement un retour aux champs d’action historiques du Canada, tels que le déploiement de troupes canadiennes au sein des missions de maintien de la paix, le développement d’instruments légaux ou encore une quête incessante pour un siège au Conseil de sécurité. La politique étrangère canadienne doit s’émanciper de cette nostalgie et faire son deuil de sa position prépondérante d’après-guerre, alors que l’Europe était absorbée par sa reconstruction. En effet, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le Canada a joué un rôle disproportionné à l’échelle mondiale compte tenu de son poids économique, démographique et militaire. Cette tendance à garder le regard fixé sur le rétroviseur est citée comme une cause de l’érosion de l’influence canadienne (Gotlieb 1991). En renforçant l’aspect féministe de sa politique étrangère, le Canada a le potentiel de créer un changement de paradigme en affaires internationales. Une approche féministe en relations internationales rend visibles les structures patriarcales qui définissent la diplomatie et mène à une remise en question de tous les processus en affaires étrangères afin de les rendre plus inclusifs (Enloe 2014). En approfondissant son empreinte diplomatique, le Canada peut s’assurer que sa politique féministe réponde réellement aux besoins locaux, et contribuer à l’analyse nuancée de contextes politiques, à la prévention de conflits, et à la mise en oeuvre de programmes innovants et de travail durable au sein des communautés.
I – Renforcer la politique étrangère féministe du Canada
Il peut être tentant de dire que le Canada n’a rien accompli de stratégique ou encore de notoire entre 2015 et 2021 à l’étranger, et que la promesse d’un retour du Canada sur la scène internationale n’était qu’une série de mots lancés en campagne électorale. Des auteurs tels que Jocelyn Coulon (2018, 2021) ont fait ce constat. Selon moi, le fil conducteur indéniable de changements ayant marqué la politique étrangère du Canada depuis 2015 a plutôt été son identité féministe. Trois éléments principaux ont contribué à cette nouvelle identité canadienne : le lancement de la Politique d’aide internationale féministe du Canada en 2017, le renouvellement du Plan national d’action du Canada consacré aux femmes, à la paix et à la sécurité mandaté par le Conseil de Sécurité des Nations unies (onu) en 2017, ainsi que la nomination d’une ambassadrice du Canada pour les femmes, la paix, et la sécurité, Jacqueline O’Neill. Enfin, notons que l’ancien ministre des Affaires étrangères François-Philippe Champagne a promis de publier un document détaillant la Politique étrangère féministe du Canada. Cette promesse fut réitérée par son successeur aux affaires étrangères, Marc Garneau. Cette promesse n’était toujours pas concrétisée au moment de la publication de cet article.
La politique étrangère féministe canadienne en est encore à ses débuts. Elle semble par moments relever davantage de l’aspiration ou encore de l’ambition plutôt que d’un plan d’action établi. Il faut donc la définir et la renforcer pour des raisons précises. En théorie, une politique étrangère féministe présente une occasion de faire un examen complet de la politique étrangère du Canada et de repenser autant le financement de l’aide au développement international que la stratégie de ressources humaines du service diplomatique. Si l’exercice est sérieux, on peut remettre en question des pratiques désuètes et proposer de nouvelles approches. Cette politique présente également une occasion de démocratiser la politique étrangère du Canada et, de façon plus générale, le système international. Enfin, un engagement féministe doit par défaut forcer une cohérence entre les pratiques nationales d’un gouvernement et ses politiques à l’international. Cette politique peut pousser le Canada à faire preuve de transparence et d’humilité à l’étranger. Si la politique étrangère féministe continue d’être évoquée comme identité canadienne en affaires étrangères, il faut que des engagements précis soient pris. Une des grandes faiblesses de cette politique est qu’elle est inconnue ou mal comprise par le grand public. Il faut mieux la définir, la mettre systématiquement en oeuvre et clairement communiquer son impact. Par ailleurs, certains experts et activistes révèlent derrière des portes closes que davantage d’actions concrètes et de financement doivent être déployés pour les convaincre du niveau de sérieux du gouvernement envers cette politique. D’autres critiques qualifient cette politique de discours vertueux qui n’a rien à voir avec les vraies questions de paix et sécurité – ces derniers ne seront peut-être jamais convaincus. Pour certains, le malaise n’est pas l’idée d’une politique étrangère féministe, mais bien l’idée du féminisme tout court. Consciemment ou inconsciemment, ces critiques ne croient pas nécessairement en l’égalité des genres et ne voient pas le lien entre ces inégalités et les enjeux de paix et de sécurité.
A – Un exercice de réflexion stratégique
Certains experts se plaignent aussi que le Canada n’ait pas fait d’examen d’envergure de sa politique étrangère depuis l’ère de Paul Martin. Ils demandent un livre blanc qui puisse être rendu public, critiqué, évalué, et qui sera utilisé par différents acteurs pour pousser le Canada à respecter ses propres objectifs. Ces exercices peuvent être pernicieux car, souvent, afin de préserver une marge de manoeuvre politique et diplomatique, les documents qui en ressortent peuvent être si généraux qu’ils ne sont pas particulièrement utiles. Ou encore, à l’opposé, s’ils sont rédigés par rapport à une relation bilatérale en particulier, ils peuvent enraciner un pays dans une approche « de faucon », car le contexte politique tendu fait en sorte que le document peut se transformer en une liste de représailles potentielles en réponse aux actions du pays visé. C’est la tournure que pourrait prendre par exemple un énoncé sur la Chine dans le contexte canadien actuel. Un document sur la politique étrangère féministe peut encourager une réflexion de fond puisqu’il s’agit aussi d’un exercice de remise en question des relations de pouvoir en politique étrangère, et tout peut être réévalué à travers le prisme du genre[2].
Pour le Canada, mettre de l’avant une orientation telle que le féminisme en affaires étrangères est aussi en phase avec ses grands legs historiques. Ces legs ont typiquement été stratégiques et idéologiques plutôt que spécifiques et éphémères. Le Canada s’est effectivement démarqué en repensant le fonctionnement de certains outils du multilatéralisme afin de faire avancer l’ordre international fondé sur des règles, incluant la Responsabilité de protéger (r2p), la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel (le Traité d’Ottawa) ou encore la création de la Cour pénale internationale. L’élaboration d’une politique étrangère féministe n’est pas une invention canadienne : c’est la Suède qui en fut à l’avant-garde avec la publication d’un livre blanc en 2014. En revanche, le Canada a contribué à étoffer et populariser le concept. L’idée d’une politique étrangère féministe n’est pas une intervention unique qui est déployée à un moment historique clé ; il s’agit plutôt d’un moyen de reconsidérer le multilatéralisme et la diplomatie. C’est justement pourquoi ce travail doit être mieux communiqué et approfondi, car il prend du temps à être mis en oeuvre.
B – Une démocratisation des relations internationales
La politique étrangère féministe présente un potentiel de changement de paradigme en affaires étrangères. Si le féminisme vise à atteindre l’égalité des genres, à éradiquer la marginalisation systémique de tous ceux qui souffrent de discriminations, dont les femmes, ce processus requiert une remise en question fondamentale des relations et des dynamiques de pouvoir qui limitent les possibilités pour ces groupes marginalisés. Une politique étrangère féministe ne s’arrête pas à la priorisation de financements qui soutiennent les initiatives de développement et les interventions humanitaires pour répondre aux besoins des femmes et des filles. Une telle politique ne devrait connaître aucune limite en termes de remise en question des structures de pouvoir établi, et ce à différents niveaux de gouvernance. Elle peut dicter un renversement des hiérarchies obsolètes au sein du ministère des Affaires étrangères et soutenir la transformation nécessaire pour que les femmes et les minorités soient mieux représentées et promues à juste titre. Elle peut aussi amener une refonte du fonctionnement des organisations internationales et des grandes rencontres diplomatiques.
Si cette politique peut présenter un tel potentiel, en réalité le Canada n’a jamais clairement exprimé ses intentions dans le cadre de son approche féministe. En effet, le flou définitionnel entourant la politique étrangère féministe canadienne affaiblit sa crédibilité. La portée de cette politique doit être expliquée, et c’est pourquoi la société civile a demandé un énoncé clair sur son contenu ; mais très concrètement, le gouvernement canadien doit définir ce en quoi consiste le terme « féministe ». Bien qu’un potentiel de réforme complète des affaires étrangères existe à travers le féminisme, la société civile s’inquiète que ce dernier ne soit pas saisi. En ce qui a trait à un pilier existant de cette approche, la Politique d’aide internationale féministe du Canada, de nombreuses expertes ont trouvé que la Politique n’était pas assez radicale. La critique principale découlant de cette perspective est que l’énoncé ne stipule pas un démantèlement des inégalités, ou une remise en question des causes des inégalités, mais prône plutôt la croissance économique à tout prix (Groupe de travail sur la politique étrangère féministe 2021 : 7). Sans définition ou plan, l’inquiétude que le terme féminisme soit coopté et blanchi de ses élans radicaux et émancipatoires perdurera (Thomson 2020 : 425).
Ainsi, si une politique étrangère féministe est définie de manière transformatrice, on peut se demander si les rencontres internationales lors desquelles les participants sont sélectionnés en fonction de leur contribution au pib mondial, comme c’est le cas au sein du Groupe des sept (g7), sont la meilleure configuration de joueurs pour coordonner les affaires internationales ? Ou encore, est-il normal, pour des chefs d’États et ministres, de participer à des rencontres sur des enjeux internationaux lors lesquelles des représentants des communautés en question ne sont pas invités ? Pourquoi les organisations de la société civile, en première ligne du combat pour la démocratie et les droits de la personne, ne sont-elles que rarement invitées à prendre la parole durant les grandes rencontres internationales ? À travers ce prisme, repenser qui est assis à une table de négociations pour la prise de décisions devient inévitable, ainsi que remettre en question la suprématie du pib comme facteur décisif dictant la coordination de la majorité des grands forums diplomatiques (g7, g20, ocde). Cette approche est non seulement peu inclusive, mais elle est aussi inefficace. Le Canada a invité des représentantes de la société civile à de récentes rencontres internationales, dont à ces trois forums qui ont eu lieu en 2018 : le g7 à Charlevoix, la première réunion de femmes ministres des Affaires étrangères à Montréal, et la réunion des ministres des Affaires étrangères sur la sécurité et la stabilité dans la péninsule coréenne à Vancouver. Ces premières expériences d’inclusion de la société civile doivent être reproduites et devenir la norme. Ainsi que l’a soutenu Enloe, « une approche d’investigation féministe met en lumière un assortiment remarquable des types de pouvoir nécessaires pour que le complexe système politique international fonctionne ainsi qu’il le fait actuellement » (2014 : 352)[3]. Une perspective féministe en relations internationales mène donc à une remise en question de tout ce qui est tenu pour acquis en relations internationales : les dynamiques d’alliance entre les gouvernements, de compétition, de conflits. Surtout, cette perspective permet d’examiner quels individus sont considérés comme interlocuteurs légitimes en diplomatie.
C – L’intégration des considérations nationales au coeur d’une politique étrangère féministe
Au lendemain de la découverte de sépultures non identifiées d’enfants décédés dans les pensionnats autochtones gérés par l’Église et le gouvernement fédéral, et au moment où le Canada commence finalement à affronter son passé colonial et ses politiques discriminatoires qui perdurent, la politique étrangère et la responsabilité du gouvernement canadien à l’intérieur de ses frontières ne peuvent être dissociées l’une de l’autre. Les réalités du passé colonial du Canada, de l’oppression historique et contemporaine des peuples autochtones, doivent faire partie de sa politique étrangère. Le Canada s’est longtemps présenté comme une puissance sans passé colonial ou impérial, donc de qui on n’avait pas à se méfier. Comme l’a noté Smith (2013 : 27), « la colonisation intérieure reste de la colonisation, mais elle est stratégiquement oubliée lorsque nous faisons la promotion de nos valeurs à l’international »[4]. Une politique étrangère féministe peut ainsi pousser le Canada à agir en toute humilité et transparence face aux réalités de sa propre histoire. C’est un potentiel qui existe au coeur d’une telle politique, mais qui n’est pas encore saisi. Un moment diplomatique récent démontre que cette transparence est possible. Lors de son premier discours à l’Assemblée générale de l’onu en 2016, Justin Trudeau ne s’est pas concentré strictement sur ce que le Canada doit faire à l’étranger. Il a aussi évoqué plusieurs sombres chapitres de l’histoire du Canada, comme l’internement de Canadiens d’origine ukrainienne, japonaise ou italienne pendant les guerres mondiales ; le refus d’accueillir les réfugiés juifs et punjabis ; ainsi que la discrimination des peuples autochtones qui continue aujourd’hui (Bureau du Premier ministre 2016). Trois ans plus tard, lors de rencontres au sujet de la campagne canadienne pour l’obtention d’un siège au Conseil de Sécurité, les diplomates se remémoraient ce discours en ma présence. Il est plutôt rare que les chefs d’État se prononcent avec transparence sur les injustices et violations des droits de la personne dans leur pays lors de ces grands discours. L’honnêteté de ces paroles a marqué la communauté diplomatique onusienne.
Au cours de son histoire, le Canada s’est prononcé et a agi sur plusieurs enjeux internationaux par choix et sans y être forcé. On pense par exemple à la crise migratoire au Moyen-Orient ou encore à la famine dans la Corne de l’Afrique ou au Yémen. La décision d’accueillir plus de 50 000 réfugiés syriens à partir de 2015 était un choix politique, plutôt qu’une réalité inévitable. Ce luxe décisionnel n’existait pas pour le Liban, la Turquie ou même l’Allemagne. Mais ce choix n’existe pas pour les actions relatives aux droits des femmes. En effet, la violence faite aux femmes, surtout aux femmes autochtones, est encore si répandue au Canada qu’il n’y a pas de flou décisionnel : le Canada a une responsabilité d’agir et un devoir moral sur ces enjeux. Le Canada doit être encore plus décisif dans ses actions féministes à l’étranger et au Canada. Le Canada doit renouveler son Plan d’action sur les femmes, la paix et la sécurité en 2022 puisque le précédent arrive à échéance en 2021. Le prochain plan doit ainsi inclure des actions concrètes nationales à la suite des recommandations de l’Enquête nationale sur les filles et les femmes autochtones disparues et assassinées (2019) et du Rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada (2015). Un nouveau plan sur la Résolution 1325 doit aussi être imbriqué au coeur de cette plus large stratégie de politique étrangère féministe.
Lier les engagements nationaux aux stratégies internationales est aussi une manière de décoloniser la politique étrangère. Les plans d’action nationaux sur les Femmes, la paix et la sécurité présentent une occasion de souder ces deux types d’engagements[5]. Cependant, à chaque fois qu’un pays développe son plan d’action sur la Résolution 1325, les attentes envers les pays du Sud, comparativement aux États occidentaux, sont complètement différentes. Par exemple, l’Afrique du Sud détaille dans son plan d’action ses engagements en termes d’inclusion du genre et de la diversité dans la résolution de conflits et la sécurité à l’intérieur de ses frontières ainsi qu’à travers certaines initiatives internationales, tandis que le Canada ou le Royaume-Uni prennent en général des engagements exclusivement liés à leur politique de sécurité internationale ou d’aide au développement sans remettre en question les inégalités et l’oppression qui a lieu à l’intérieur de leurs frontières. L’aspect le plus exigeant de la mise en oeuvre d’une véritable politique étrangère féministe est en effet d’assurer la cohérence entre les politiques internes et externes.
Au Canada, le travail de réconciliation qu’il reste à faire pour reconnaître les crimes contre les femmes et les filles autochtones et le génocide des peuples autochtones est considérable et doit nécessairement inclure le fait de rendre des comptes à ces communautés. Les politiques à mettre en oeuvre, comme tous les aspects d’une stratégie qui se veut féministe, doivent émerger des communautés visées. Pour le Groupe de travail sur la politique étrangère féministe qui regroupe des représentantes de la société civile, le manque d’action et d’engagements sur le plan national, entre autres envers les femmes autochtones, jumelé aux déclarations de déploiement d’une politique étrangère féministe par le Canada, dénote un profond manque de cohérence (2021). Il est toujours difficile d’assurer la collaboration entre les Affaires étrangères, les Relations Couronne-Autochtones et les Services aux Autochtones Canada. Ces ministères n’ont pas pour habitude de collaborer. Assurer cette coopération systématique est l’un des plus grands défis que présente une politique étrangère féministe exhaustive. Or, c’est la seule façon pour le Canada de se positionner comme un acteur crédible sur la scène internationale, sans se laisser tenter par les doubles discours aux tonalités postcoloniales.
II – Faire pousser l’érable dans de nouveaux climats
La politique étrangère féministe émerge sans contredit de la mobilisation de la société civile qui, depuis des années, demande que le Canada déploie une stratégie féministe en consultation avec les communautés qu’il vise à soutenir. Ce travail exige une présence sur le terrain et un dialogue continu avec différentes communautés. Pour déployer une véritable politique étrangère féministe, cette politique doit être enracinée dans l’expertise, le vécu et le savoir institutionnel des gender policy entrepreneurs (True 2003 ; Tiessen 2019) et des mouvements locaux pour les droits des femmes. La définition des politiques et des programmes doit donc être ancrée dans le terrain, plutôt que centralisée à tout prix à Ottawa.
Cependant, à très grande échelle, l’économie mondiale tend vers la direction opposée, c’est-à-dire vers la numérisation et la distance par rapport au terrain. La pandémie a aussi accéléré le télétravail et a forcé presque toutes les industries à trouver des façons de fonctionner sans avoir à voyager. Si, pour certaines industries, cela a forcé une transformation de pratiques désuètes, cette distance des communautés et la coupure du contact humain ont mis à l’épreuve la diplomatie. Il s’agit peut-être d’un des rares milieux où le contact humain reste impératif. La présence sur le terrain des ambassadeurs et des diplomates est un multiplicateur d’influence et un déterminant de la capacité d’analyse des réalités locales d’un pays. Avant de démontrer la nécessité d’une diplomatie de terrain et d’énumérer les raisons pour lesquelles le Canada doit étendre son empreinte diplomatique, quelques constats quant aux missions canadiennes à l’étranger doivent être survolés. Enfin, une courte réflexion sur les implications budgétaires d’une telle stratégie s’impose.
A – Constats sur la présence canadienne à l’étranger
Les pays dont l’empreinte diplomatique est en croissance ne sont généralement pas des pays du g7, mais plutôt des superpuissances émergentes comme la Chine, l’Inde ou encore la Turquie. Le désintérêt ou la baisse d’investissements des pays du g7 en diplomatie se produit parallèlement à une croissance des dépenses militaires. On semble parfois vouloir substituer la présence et les interventions militaires au travail diplomatique – un phénomène aussi observé par Copeland (2014). Le Canada a des ambassades officielles dans 95 pays en 2021 ; la majorité des ambassadeurs de ces 95 pays sont aussi accrédités dans plusieurs autres pays. C’est donc dans moins de la moitié des pays du monde que le Canada est représenté de manière conséquente[6]. Le Canada favorise une présence diplomatique dans les pays qui sont des puissances mondiales, des pays francophones, et en troisième lieu des membres du Commonwealth (Webster 2001). Selon les données du Lowy Institute australien (2019), c’est la Chine qui est le pays le mieux représenté dans le monde, dérobant aux États-Unis la première place qu’ils détenaient jusqu’en 2019[7]. Le Canada arriverait au 18e rang mondial en termes de représentation à l’étranger. À titre comparatif, la Turquie décrocherait le sixième rang mondial, résultat de son ambitieuse expansion diplomatique au cours de la dernière décennie. Le Canada ne doit pas nécessairement tenter de reproduire les stratégies diplomatiques chinoises ou turques ; cela dit, il semble clair que les superpuissances émergentes ont bien compris que la représentation physique peut se traduire en influence géopolitique, et ce, aux dépens des pays occidentaux comme le Canada. Évidemment, l’ouverture de nouvelles ambassades présente un coût financier élevé ; mais leur mise en oeuvre est relativement facile.
Il y a des régions en particulier où le Canada est presque invisible. On pense entre autres à l’Afrique de l’Est et à la Corne de l’Afrique, où le Haut-Commissaire basé au Kenya est également responsable de représenter le Canada au Rwanda, au Burundi, en Ouganda et en Somalie. Entre 2005 et 2013, l’empreinte canadienne est passée d’ambassades dans 45 % des pays en Afrique à 37 % (Zillo 2013). John Schram, ancien ambassadeur canadien en Éthiopie, accrédité également au Soudan et en Érythrée et qui fut également ambassadeur au Zimbabwe et accrédité de manière simultanée en Angola et au Botswana, a affirmé qu’il était impossible de bien faire son travail d’ambassadeur en étant basé à l’extérieur du pays en question. D’après lui, ces ambassadeurs accrédités depuis un pays voisin ont également très peu d’influence dans les pays où ils n’ont pas d’ambassade (cité dans Zillo 2013). De surcroît, le recul de la présence canadienne dans plusieurs régions du monde a aussi été accentué par la fusion de l’acdi avec les Affaires étrangères. Cela a mené à une baisse du nombre de programmes de développement et de programmes humanitaires déployés directement par le Canada. En effet, la majeure partie de l’enveloppe d’aide au développement canadien à l’étranger est maintenant déboursée par l’intermédiaire d’organisations multilatérales. Le financement par les organisations multilatérales peut sembler préférable dans certains cas, mais cela se fait aux dépens de la visibilité de la contribution du Canada.
B – L’importance du contact humain en diplomatie
Tout diplomate onusien reconnaîtra que les négociations les plus critiques qui se déroulent à l’onu n’ont pas lieu à l’assemblée générale ou même en comité, mais bien dans les corridors de l’onu et dans les cafés et les restaurants de Midtown à New York. Cela peut sembler une équation élémentaire, mais si le Canada veut faire entendre sa voix dans les grands débats d’affaires internationales et faire connaître sa politique féministe, il doit devenir un acteur incontournable sur le terrain, dans les corridors des institutions locales et internationales, et dans les rues à la rencontre de la population. L’empreinte diplomatique canadienne a été nettement réduite par le programme de réduction de la dette (2006-2015) et plusieurs ambassades ont été fermées. De nouvelles ambassades, représentations et bureaux doivent être ouverts pour accroître l’influence canadienne à l’étranger.
La pandémie a montré que la confiance est difficile à instaurer en virtuel. Lors des vidéoconférences, il est impossible de savoir qui est ajouté de manière silencieuse pour prendre des notes. Les connexions sont généralement peu sécurisées et peuvent être interceptées. Les grandes rencontres internationales en virtuel sont devenues pires que les rencontres diplomatiques qui étaient reconnues pour être les plus pénibles par leur lenteur, la vacuité de leurs débats et leur manque d’engagements concrets. Le monde virtuel diplomatique manque de profondeur. Afin de combler ce manque lors de moments critiques, tels que la campagne canadienne pour obtenir un siège au Conseil de Sécurité en 2020, des centaines d’appels ont été faits, souvent à répétition, pour finalement approfondir des relations. On peut se demander s’il aurait été possible de renégocier l’aléna dans le contexte de la pandémie. Ce type de négociations existentielles ne peuvent pas se tenir par vidéoconférence. Les diplomates expérimentés savent lire les émotions de leur interlocuteur, charmer, comprendre, montrer leur force et tendre la main. Rien de cela n’est possible à travers un écran. La pandémie a créé un laboratoire qui a démontré l’importance de la diplomatie en personne et l’importance de convaincre le public canadien d’investir dans la représentation diplomatique physique dans le monde.
C – La nécessité de nouvelles allocations budgétaires pour la diplomatie
Évidemment, afin de multiplier les drapeaux canadiens partout dans le monde, il faut que le Canada décide d’allouer de nouveaux financements à la diplomatie. Cette transition n’est pas possible à travers les enveloppes budgétaires existantes. Il est très difficile d’avoir une vision globale et exhaustive des fluctuations des budgets en affaires étrangères du Canada étant donné les différentes catégories de financements qui existent à travers le Conseil du Trésor. Les annonces budgétaires donnent aussi rarement tous les détails sur la durée des programmes et les variations des budgets permanents et temporaires. Des dépenses ont aussi lieu à l’extérieur des paramètres du budget annuel. Prenant en considération l’imperfection des chiffres publiés, selon rapports annuels sur les opérations d’Affaires mondiales Canada (2021), le Canada aura dépensé 7,2 milliards de dollars en 2019-2020, et un milliard de ce budget aura été dépensé pour soutenir la présence diplomatique du Canada à l’étranger (sans compter les programmes). La majeure partie des dépenses sont allouées aux programmes d’aide au développement. Par ailleurs, à la suite des coupures fondamentales qui ont marqué la décennie du programme de réduction de la dette, il y a eu un certain rattrapage en termes d’effectifs. Lors de ce programme de réduction de la dette, la priorité a été donnée à la réduction d’autres dépenses opérationnelles avant la suppression de postes, comme la vente de bâtiments canadiens pour reloger des ambassades dans des immeubles de bureaux dans certains pays. Dans certains cas, il s’agit d’un rideau de fumée comptable : en récoltant un revenu par la vente de bâtiments à l’étranger, on peut annoncer des chiffres avantageux. Cela dit, le gouvernement est aux prises avec de nouvelles dépenses récurrentes à cause des loyers à payer. Selon les rapports annuels sur les opérations d’Affaires mondiales Canada (2016, 2020), le département des Affaires étrangères aurait créé près de 1270 postes (équivalent à temps plein total) en cinq ans, ce qui représente une augmentation de 12 % au total. Il y a eu certaines augmentations budgétaires, circonscrites à des programmes spécifiques pour des durées limitées, comme pour la mise en oeuvre du Traité sur le commerce des armes, des nouvelles sanctions Magnitsky ou de stratégies limitées dans le temps comme la stratégie en Irak, en Syrie et dans les pays voisins. Cela dit, sauf quelques postes ajoutés au sein des ambassades en Chine et à la centrale à Ottawa lors du budget de 2017, peu de choses ont été mises en place sur le plan budgétaire qui puissent transformer l’empreinte diplomatique canadienne. L’instabilité des effectifs et les cycles répétés d’expansion et de coupures drastiques ont affaibli ce ministère depuis plusieurs décennies (Essex, Stokes et Yusibov 2019). De manière générale, les dépenses actuelles dans toutes les sphères des affaires étrangères ne sont pas suffisantes pour soutenir le renouveau du leadership canadien sur la scène internationale (Paris 2018).
Deux grands mouvements poussent les gouvernements à augmenter leurs budgets en affaires internationales : d’une part le mouvement surtout encadré au sein de l’onu pour que les pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économique (ocde) atteignent un niveau d’aide au développement qui représente 0,7 % du pib national, et de l’autre l’engagement des membres de l’otan de maintenir leurs dépenses militaires à 2 % de leur pib. Ces objectifs de dépenses peuvent être critiqués et remis en question ; toutefois on peut se demander pourquoi on ne parle jamais d’investissements en diplomatie. Pourquoi de telles dépenses sont-elles si rarement débattues malgré leur importance pour la prévention et la résolution de conflits ?
Les raisons politiques de ce manque de financement sont évidentes : les budgets pour la diplomatie et les affaires étrangères sont difficiles à justifier. La diplomatie est enviée par les jeunes diplômées en science politique et relations internationales pour la même raison qu’elle peut paraître une cause politique peu populaire : elle est perçue comme étant difficile d’accès, mystérieuse et même élitiste, discrétionnaire et pompeuse. En réalité, c’est un outil politique extraordinaire, mais elle souffre fondamentalement d’un problème d’image, de transparence et de communication publique. L’octroi de financement pour la diplomatie est encore plus difficile, car les choix budgétaires sont généralement perçus comme un compromis entre les dépenses en affaires étrangères d’une part, et les programmes sociaux au Canada de l’autre.
D – Quel type d’expansion diplomatique ?
La diplomatie canadienne doit être en mode croissance, mais pas de n’importe quelle façon. En effet, même si la présence des diplomates sur le terrain est importante, Cornut (2015) a démontré que les ambassades ayant le plus de personnel ne produisaient pas nécessairement les meilleures analyses. Comme l’a soutenu Daryl Copeland (2014), le travail des diplomates doit être davantage ancré dans la diplomatie publique, le rapprochement avec la société civile et l’expérimentation. Les modèles de missions dans de nouvelles localités doivent nécessairement varier. Dans certains cas, comme à Londres, la Canada House sur Trafalgar Square permet d’attirer des personnalités publiques et politiques. Il s’agit d’un lieu culturel, social et politique au coeur de Londres qu’il faut préserver. Cependant, le Canada n’a pas nécessairement besoin de bâtiments majestueux tels que la Canada House au coeur de la capitale de tous les pays du monde. Des formules plus minimalistes et flexibles peuvent être adoptées. Dans certains cas, les diplomates peuvent être semi-nomades et revenir à leur bureau seulement si c’est nécessaire. Cette flexibilité peut leur permettre de cultiver des contacts non seulement avec les autorités officielles, mais aussi avec l’opposition politique, les journalistes, les intellectuels et les leaders de la société civile et des mouvements sociaux. Dans l’étude que Cornut (2015) a réalisée au sujet du travail diplomatique du Canada en Égypte, les diplomates interagissaient en général avec des hommes âgés de 60 à 80 ans qui occupaient des postes importants dans le gouvernement ou dans le secteur privé. Cette dynamique n’est certainement pas spécifique à l’Égypte ; il faut poursuivre cet examen des interlocuteurs des diplomates canadiens pour s’assurer que l’expansion diplomatique serve réellement à la mise en oeuvre d’une politique féministe. Les diplomates doivent être formés en fonction de ces objectifs. Il faut également accroître la représentation canadienne au sein d’organisations multilatérales et d’organismes régionaux en faisant campagne pour avoir accès à des sièges d’observateurs ou être invités à certaines rencontres, y compris au sein de l’Union africaine, de la Ligue arabe ou encore du Sommet de l’Asie orientale.
La diplomatie est aussi un service et c’est peut-être à travers cet argument qu’elle peut regagner la sympathie du public canadien. Il s’agit de fournir des services aux Canadiens partout dans le monde et de défendre leurs intérêts. On a souvent conscience de l’importance des communautés culturelles au Canada, mais on fait moins souvent allusion à la diaspora canadienne à l’étranger. Le Canada a pourtant une des plus grandes diasporas – 8 % de sa population, ou près de 3 millions (Statistiques Canada 2014). Lorsqu’il s’agit de rapatrier d’urgence près de 62 000 Canadiens comme ce fut le cas pendant les premiers mois de la pandémie de la covid-19 en 2020, on saisit le risque énorme que peut représenter la fermeture d’ambassades ou la sous-traitance des services consulaires à nos alliés.
La campagne canadienne pour obtenir un siège au Conseil de Sécurité de l’onu en 2020 a démontré sans contredit l’importance de la diplomatie de terrain. Même si le Canada n’a pas obtenu de siège, cette campagne a imposé une réflexion collective au sein de la diplomatie canadienne. Diplomates et politiciens se sont assis avec des représentants de presque tous les pays, de la France jusqu’au Tuvalu en passant par l’Ouzbékistan. Ils ont écouté leurs interlocuteurs leur parler de leur vision du Canada. Souvent, leurs homologues se désolaient de l’absence canadienne, chez eux et au sein des organisations multilatérales. Il faut ainsi garder la flamme de la course vivante, rester à l’écoute et être plus visibles et proactifs. Car lorsque les crises existentielles internationales éclatent, que ce soit une pandémie ou la crise climatique, aucun pays ne peut s’en sortir seul, ou encore en s’en tenant seulement à des rencontres au sein de l’otan, du g7 ou du g20. Un réel engagement multilatéral devient nécessaire, avec tous, d’égal à égal.
Conclusion
Le travail stratégique en affaires étrangères est un labeur de longue haleine. Malheureusement, dans un climat de replis sur soi qui caractérise la crise sanitaire de la covid et la période lente et incertaine de sortie de pandémie qui s’ensuit, la politique étrangère risque de continuer d’être définie par les joutes partisanes et parlementaires. Les remaniements à répétition rendent aussi le travail d’examen d’envergure difficile. De 2006 à 2021, le Canada a eu onze ministres des Affaires étrangères sous Harper et Trudeau, donc sans compter la ministre actuelle, chaque ministre était en poste en moyenne un an et demi, mais en réalité leur temps moyen avec toutes les autorités ministérielles et parlementaires était encore plus court en raison des périodes d’élections. Pour avoir de l’influence sur la scène internationale, il faut être présent, mais il faut aussi apprendre à connaître ses interlocuteurs, développer des stratégies, connaître les nuances de ses dossiers qui sont généralement complexes. Cet incessant jeu de la chaise musicale aux Affaires étrangères nuit à la capacité du pays de développer une vision durable. Depuis les trente dernières années, les ministres qui furent en poste le plus longtemps sont Joe Clarke (1984-1991) qui fut de manière simultanée ministre de la Justice sous Brian Mulroney, et Lloyd Axworthy (1996-2000) sous Jean Chrétien. Ces ministres ont marqué l’histoire des relations internationales de maintes façons et on leur a donné la chance de s’épanouir dans ce rôle, ce qui est un facteur essentiel de leur impact.
Pour conclure, la politique étrangère féministe ne peut pas être perçue comme étant partisane ou associée strictement au Parti libéral, car cela voudrait dire que son avenir est en danger. Elle doit devenir symbole d’identité canadienne afin de survivre aux élections, aux remaniements, aux genres et partis politiques des politiciens et politiciennes à la tête du ministère. En fait, l’émergence de cette politique n’était pas à l’origine un projet partisan. Elle est le résultat du travail de la société civile. Ainsi que l’a écrit Chapnick, « la politique étrangère féministe du Canada était celle du Canada avant d’être celle de Justin Trudeau »[8] (2019 : 204). Des données sur l’impact d’une telle politique féministe existent, sur les résultats qui découlent de l’inclusion des femmes dans la résolution de conflits, dans l’économie et les accords de libre-échange. Mais une telle politique doit être poursuivie, car c’est une question de droits de la personne de promouvoir l’égalité des genres et de mettre fin aux discriminations, et pas seulement si cela a un effet positif sur le pib par exemple. Elle doit être pleinement déployée, car cette politique force une réflexion stratégique, parce qu’elle rend par défaut le travail diplomatique plus démocratique, inclusif et accessible. Finalement, à travers le travail féministe, on peut arriver à davantage de cohérence entre le travail à l’international et à l’intérieur des frontières canadiennes. La collecte de données est nécessaire afin de faire le suivi sur sa mise en oeuvre et les résultats sur le terrain, mais les données quantitatives ne sont pas la justification première de sa nécessité ; les droits de la personne le sont. La politique étrangère féministe doit être clairement définie pour pouvoir être évaluée. En ce moment, il est encore difficile de déterminer si le potentiel de transformation radicale dont elle est porteuse est réellement saisi. En ce qui a trait à la présence diplomatique, une offensive d’ouverture de missions devrait être lancée. Le rapprochement du terrain est essentiel à la mise en oeuvre d’une politique féministe. Le féminisme tel que défini à Ottawa ne peut pas répondre aux besoins des communautés à travers le monde. Par ailleurs, les fermetures d’ambassades et le retrait de diplomates comme stratégie punitive bilatérale devraient être évités à tout prix. De telles mesures peuvent sembler alléchantes politiquement sur le moment, mais c’est en général la diaspora canadienne qui en subit les conséquences.
Appendices
Remerciements
L’auteure aimerait remercier Audrey-Ann Lavallée-Bélanger pour ses commentaires ainsi que le Cérium et les organisateurs du Forum St-Laurent sur la sécurité internationale.
Note biographique
Laurence Deschamps-Laporte
Professeure invitée, Département de science politique, Université de Montréal. Chercheure invitée au Centre d’études et de recherches internationales (Cérium), Université de Montréal. De 2016 à 2020 elle était employée politique à Affaires Mondiales Canada.
Notes
-
[1]
Je continue d’utiliser le terme « ministère des Affaires étrangères » dans cet essai pour faire référence au ministère dans son ensemble, même si ce n’est pas le terme officiel, par souci de simplicité et puisque le titre du ministre n’a jamais changé. Le ministère dans son ensemble se nomme depuis 2015 Affaires mondiales Canada.
-
[2]
Si le sexe fait référence à une définition biologique des identités, le genre fait plutôt référence à la construction socioculturelle des rôles, des identités et des rapports. Ainsi, en prenant une perspective selon laquelle le genre est inculqué socialement et culturellement, si on repense la politique étrangère à travers les forces qui déterminent ces rôles, ces identités et ces rapports, on se questionne nécessairement sur la dynamique des inégalités, des marginalisations et des processus de paix et de conflits. Cela peut ainsi engendrer un examen innovant sur la façon dont la politique étrangère pourrait se réaliser différemment.
-
[3]
Texte original : « A feminist investigatory approach exposes a remarkable assortment of the kinds of power it takes to make the complex international political system work the way it currently does ».
-
[4]
Texte original : « Internal colonization is still colonization, but it is strategically forgotten when we promote our values internationally ».
-
[5]
C’est pour donner suite à la Résolution du Conseil de sécurité 1889 (2009) sur les mesures pour assurer le suivi sur la Résolution 1325 que l’ancien Secrétaire général de l’onu, Ban Ki-Moon, a demandé aux pays membres de développer des Plans d’action nationaux qui précisent leur contribution à l’inclusion des femmes dans toutes les sphères de la sécurité et de la résolution de conflits.
-
[6]
Toutes ces données ont été compilées par l’auteure en août 2021 à partir de communiqués de presse du gouvernement du Canada et autres données publiques sur ses ambassades. Une synthèse officielle ne semble pas être disponible sur Internet.
-
[7]
Lors des vérifications de l’auteure à travers l’étude des nominations cycliques d’ambassadeurs et de leur accréditation, les données du Lowy Institute diffèrent parfois légèrement (parfois d’une représentation seulement), mais s’en rapprochent. Les années des données étant différentes, le Lowy Institute d’Australie semble être la seule référence pour les données diplomatiques comparatives au niveau mondial et leur ordre comparatif est plutôt fiable.
-
[8]
Texte original : « Canada’s feminist foreign policy was Canada’s before it was Justin Trudeau’s ».
Références
- Affaires mondiales Canada, 2021, Rapport sur les résultats ministériels 2019-2020, Gouvernement du Canada, consulté sur Internet (https://www.international.gc.ca/gac-amc/publications/plans/drr-rrm/drr-rrm_1920.aspx?lang=fra) le 10 août 2021.
- Affaires mondiales Canada, 2016, Rapport ministériel sur le rendement de 2014-2015, Gouvernement du Canada, consulté sur Internet (https://www.international.gc.ca/gac-amc/publications/plans/dpr-rmr/dpr-rmr_1415.aspx?lang=fra) le 10 août 2021.
- Bureau du Premier Ministre du Canada, 2016, Allocution du premier ministre Justin Trudeau à la 71e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, consulté sur Internet (https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/discours/2016/09/20/allocution-du-premier-ministre-justin-trudeau-la-71e-session-de) le 11 septembre 2021.
- Chapnick Adam, 2019, « The Origins of Canada’s Feminist Foreign Policy », International Journal, vol. 74, no 2 : 191-205.
- Chapnick Adam, 12 août 2021, « The “Canada Is Back” Humbug », The Dorchester Review. Consulté sur Internet (https://www.dorchesterreview.ca/blogs/news/the-canada-is-back-humbug) le 17 août 2021.
- Coulon Jocelyn, 2018, Un selfie avec Justin Trudeau, Montréal, Québec-Amériques.
- Coulon Jocelyn, 2021, Le Canada à la recherche d’une identité internationale, Montréal, Presses de l’Université de Montréal.
- Copeland Daryl, 2013, « A Foreign Ministry for the 21st Century? Canada Needs More dfait, and the World Needs More Diplomacy », Canadian Foreign Policy Journal, vol. 19, no 1 : 110-114.
- Copeland Daryl, 2014, « Humanity’s best hope : Increasing diplomatic capacity in ten (uneasy) steps », Canada Global Affairs Institute, consulté sur Internet (https://www.cgai.ca/humanitys_best_hope) le 19 août 2021.
- Cornut Jérémie, 2015, « To Be a Diplomat Abroad : Diplomatic Practice at Embassies », Cooperation and Conflict, vol. 50, no 3 : 385-401.
- Enloe Cynthia, 2014, Bananas, Beaches and Bases : Making Feminist Sense of International Politics, Berkeley, University of California Press.
- Essex Jamey, Lauren Stokes et Ilkin Yusibov, 2019, « Geographies of Diplomatic Labor: Institutional Culture, State Work, and Canada’s Foreign Service », Political Geography, no 72 : 10-19.
- Gotlieb Allan, 1991, I’ll Be with You in a Minute, Mr. Ambassador: The Education of a Canadian Diplomat in Washington, Toronto et Buffalo, University of Toronto Press.
- Groupe de travail sur la politique étrangère féministe, 2021, Courage et ambition. Recommandations pour la politique étrangère féministe du Canada, consulté sur Internet (https://live-amnesty.pantheonsite.io/sites/default/files/FFP%20Brave%20Bold%20FR.pdf) le 13 septembre 2021.
- Juneau Thomas, 2020, « Opinion : Canada Will Pay the Price for Neglecting Our Foreign Policy », The Globe and Mail, 7 juin, consulté sur Internet (https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-canada-will-pay-the-price-for-neglecting-our-foreign-policy/) le 12 août 2021.
- Lowy Institute, 2019, Global Diplomacy Index, consulté sur Internet (https://globaldiplomacyindex.lowyinstitute.org/country_rank.html) le 17 août 2021.
- Paris Roland, 2018, « The Promise and Perils of Justin Trudeau’s Foreign Policy », dans Norman Hillmer et Philippe Lagasse (dir.), Justin Trudeau and Canadian Foreign Policy : Canada and International Affairs, New York, Palgrave Macmillan : 310 pages.
- Paris Roland, 2019. « Opinion: With Tectonic International Shifts, Our Foreign Affairs Strategy Shouldn’t Be an Afterthought. » The Globe and Mail, 6 octobre, consulté sur Internet (https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-with-tectonic-international-shifts-our-foreign-affairs-strategy/) le 19 août 2021.
- Smith Heather Ann, 2013, « Disrupting Internationalism and Finding Others », dans Claire Turenne Sjolander et Heather Ann Smith (dir.), Canada in the World: Internationalism in Canadian Foreign Policy, Oxford, Oxford University Press : 283 pages.
- Statistiques Canada, 2014, Canadians Abroad, consulté sur Internet (https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-008-x/2008001/article/10517-eng.htmhtml) le 10 septembre 2021.
- Swann Emma et Rebecca Tiessen, 2018, « Canada’s Feminist Foreign Policy Promises : An Ambitious Agenda for Gender Equality, Human Rights, Peace, and Security », dans Norman Hillmer et Philippe Lagasse (dir.), Justin Trudeau and Canadian Foreign Policy : Canada and International Affairs, New York, Palgrave Macmillan : 310 pages.
- Tiessen Rebecca, 2019, What’s New about Canada’s Feminist International Assistance Policy and Why “More of the Same” Matters, The University of Calgary School of Public Policy Publications/Institut canadien des Affaires mondiales, consulté sur Internet (https://www.cgai.ca/whats_new_about_canadas_feminist_international_assistance_policy_the_problem_and_possibilities_of_more_of_the_same) le 17 août 2021.
- Thomson Jennifer, 2020, « What’s Feminist about Feminist Foreign Policy? Sweden’s and Canada’s Foreign Policy Agendas », International Studies Perspectives, vol. 21, no 4 : 424-437.
- True Jacqui, 2003, « Mainstreaming Gender in Global Public Policy », International Feminist Journal of Politics, vol. 5, no 3 : 368-396.
- Webster Craig, 2001, « The Placement of Canada’s Embassies Driven by Realpolitik or the Domestic Political Debate? » Peace Research, vol. 33, no 1 : 125-133.
- Welsh Jennifer, 2005, At home in the world: Canada’s global vision for the 21st century, Toronto, Harper Perennial.
- Zillo Michelle, 2003, « Dwindling Canadian diplomatic presence in Africa a concern: experts », iPolitics, 26 février, consulté sur Internet (https://ipolitics.ca/2013/02/26/dwindling-canadian-diplomatic-presence-in-africa-a-concern-experts/) le 13 août 2021.