Abstracts
Résumé
À Québec, des comités citoyens réagissent dès la fin des années 1960 aux opérations de rénovation urbaine qui transforment les quartiers populaires de la Basse-Ville. Ces comités s’opposent d’abord aux grands projets d’autoroutes urbaines qui menacent l’accessibilité au logement, et ils visent à protéger l’identité populaire des quartiers. Avec le temps, leurs revendications s’étendent à la réfection des rues et à l’aménagement urbain en général. À partir de 2014, avec un projet pilote, la Ville de Québec expérimente de nouvelles façons d’aborder les réfections de rues, avec l’objectif d’évaluer la pertinence d’une démarche participative et intégrée. Dans cet article, nous défendons l’hypothèse qu’une série de revendications citoyennes, formulées de manière de plus en plus « experte », a pu favoriser l’émergence de cette pratique d’expérimentation municipale.
Mots-clés :
- Expérimentation,
- participation,
- planification urbaine,
- rues,
- infrastructures
Abstract
In Quebec City, at the end of the 1960s, citizen committees reacted to urban renovation operations in the blue collar neighborhoods of Lower Town. These committees first fought large-scale urban highway projects that threatened housing accessibility and wanted to protect the working-class identity of their neighborhoods. Over time, they broaden their concerns to the way streets are renovated and to urban planning more generally. Beginning in 2014, with a pilot project, Quebec City started to experiment with new ways to address street renovations, in order to evaluate the relevance of a participative and integrated approach. This paper suggests that citizen claims, formulated with more and more “expertise’’, may have supported the emergence of this practice of municipal experimentation.
Keywords:
- Experimentation,
- participation,
- urban planning,
- streets,
- infrastructure
Resumen
En la ciudad de Quebec, desde fines de la década de los 60, los comités de ciudadanos reaccionaron ante las acciones urbanas para remozar los barrios populares de la Basse-Ville. En primer lugar, los comités se oponen a los proyectos importantes de auto-rutas urbanas que amenazan la accesibilidad a la vivienda. Aspiran proteger la identidad popular de esos barrios. Con el tiempo, sus reivindicaciones se amplían hacia la reparación de las calles y hacia la planificación urbana en general. A partir de 2014, gracias a un proyecto piloto, la Ciudad de Quebec ensaya nuevas maneras de tratar la reparación de calles para evaluar la pertinencia de un modo de gestión participativo e integrado. En este artículo, defendemos la hipótesis según la cual, la serie de reivindicaciones ciudadanas, formuladas de más en más de manera “experta”, ha podido favorecer la emergencia de la práctica de experimentación municipal.
Palabras clave:
- Experimentación,
- participación,
- planificación urbana,
- calles,
- infra-estructuras
Article body
Introduction
Dans les villes du Québec, autant que dans celles où s’est structurée une gestion municipale avancée, le dossier de la qualité du milieu de vie est propice à l’émergence d’un leadership de la part des groupes et organismes locaux (Sénécal, 2016), mais aussi de la part des citoyens qui ne sont pas associés aux cadres programmatiques habituels (Aylett, 2014 ; Cloutier et al., 2015). À l’échelle microlocale du quartier et du voisinage, des résidents agissent de concert pour verdir leur îlot, leur rue, leur ruelle, etc. Ils s’organisent et mettent à profit leurs ressources personnelles (biens, temps, réseau social) et professionnelles pour agir dans et sur la ville. Ces acteurs locaux ont des ressources techniques et pratiques particulières sur lesquelles ils s’appuient pour réaliser des interventions concrètes sur l’espace. Ils savent s’exprimer et connaissent bien les rouages administratifs et politiques.
Dans cet article, nous recourons à la notion d’expérimentation pour examiner comment les citoyens participent aux processus de transformation des villes sans passer par la contestation. [1] L’expérimentation est de plus en plus mobilisée dans des travaux en sciences humaines, autour du problème posé par les changements climatiques, pour désigner les tentatives de planification de la ville autrement, dans un contexte de transition sociotechnique (Evans, 2011 ; Bulkeley et al., 2015 ; Ferchaud et Dumont, 2015). Elle nous sert, ici, pour saisir la portée de l’ouverture à une plus grande participation des représentants de la société civile en aménagement du territoire et en urbanisme. Notre perspective repose sur le principe que, pour adapter la ville aux changements climatiques, il faut aussi adapter les modes de planification des infrastructures publiques, y compris en ce qui concerne la participation publique. Plus particulièrement, le caractère expérimental d’initiatives citoyennes de participation, d’une part, et de projets municipaux participatifs, d’autre part, nous permet d’observer une transformation de la représentation que les citoyens, les professionnels et les gestionnaires locaux se font de la rue.
Dans un premier temps, nous revenons sur la notion d’expérimentation et sur les motivations qui poussent des représentants de la société civile à devenir acteurs de l’aménagement des espaces publics urbains. Nous faisons ensuite un bref historique de la mobilisation citoyenne à Québec, avant de présenter la mise en parallèle d’expérimentations citoyennes avec une expérimentation municipale. Toutes les expérimentations ont comme dénominateur commun une volonté de revoir les manières de faire la ville.
Expérimenter pour passer à l’action
Le processus expérimental est motivé notamment par la volonté de faire face à une certaine part d’inconnu, à une incertitude, en proposant une solution « bricolée » à partir des connaissances et des ressources (humaines, réseaux, financières) disponibles. Dans le champ du génie urbain et de l’architecture, par exemple, on expérimente des systèmes de distribution locale d’énergie, ou encore une manière itérative de planifier le quartier (Kivimaa et al., 2017). Lorsque les acteurs qui expérimentent – les expérimentateurs – le font à titre de résidents d’un quartier, leur action peut aussi correspondre à une manière inédite de s’organiser pour s’exprimer collectivement ou réaliser une intervention précise sur la rue, comme des installations temporaires, des corvées de nettoyage, etc.
Les motivations des expérimentateurs sont de nature variée. La lutte aux changements climatiques, la sécurité alimentaire, l’exclusion sociale sont autant de raisons qui invitent les individus à s’organiser pour passer à l’acte sans attendre l’aval des différents niveaux de gouvernement (Brenner et al., 2009 ; Deslandes, 2013). Les questions qui touchent au cadre de vie immédiat des gens, à des échelles microlocales, comme la qualité de l’air, la gestion des eaux de pluie ou le patrimoine, ont également un effet mobilisateur (Sénécal, 2012).
Le processus d’expérimentation suppose que les expérimentateurs fassent eux-mêmes la démonstration, à leurs voisins comme à l’administration municipale, de ce qui peut être fait autrement et simplement. Ils interviennent par des gestes, de verdissement notamment, pour que le quartier soit un cadre de vie confortable, qu’il donne un accès ou une proximité accrue à la nature. Plus spécifiquement, nous abordons ici l’expérimentation locale comme étant associée à : 1) une intervention dans le cadre urbain ne découlant pas d’une programmation gouvernementale ; 2) une exploration de nouvelles façons d’atténuer des problèmes environnementaux en milieu urbain, ou de s’y adapter, à partir de l’expertise citoyenne ou professionnelle des individus ; 3) un processus s’appuyant sur de nouvelles interactions pour ouvrir des espaces politiques municipaux, du cadre microlocal jusqu’au palier métropolitain (Hoffmann, 2011 ; Broto et Bulkeley, 2013).
Qu’elle soit relative à une nouvelle production ou à une nouvelle manière de collaborer, l’expérimentation s’inscrit dans une perspective de transformation des façons de faire, sans grande rupture. Elle vise un changement de manière incrémentale et non radicale (Geels et Kemp, 2007). Le fait d’appliquer une gouvernance plus expérimentale pour faire face à un enjeu multiforme, mouvant et sans précédent, comme les changements climatiques, permettrait un ajustement progressif des façons de faire, qui est en phase avec les modes contemporains de production et de gestion (Bulkeley et al., 2015).
En outre, les expérimentations qui s’appuient sur la participation d’acteurs diversifiés contribuent à une compréhension bonifiée et partagée des enjeux urbains (Ferchaud et Dumont, 2015). En misant sur les savoirs techniques de ceux et celles qui posent les gestes habituels, sur les savoirs politiques de ceux et celles qui prennent les décisions et sur les savoirs des citoyens, une expérimentation peut permettre une mise en commun de multiples ressources, dont la connaissance vécue du territoire. Ces différents types de savoir gagnent à être collectivisés, par une mise en débat répondant à un « impératif délibératif » (Blondiaux et Sintomer, 2002). À ce titre, l’expérimentation favorise une telle mise en commun et motive le passage à l’action, en plus de valoriser le savoir citoyen comme ressource pertinente et légitime (Sintomer, 2007 ; Nez, 2011).
Ainsi, la notion d’expérimentation renvoie pour nous à un ensemble de processus mis en place à l’échelle locale, combinant les expériences et les ressources de plusieurs acteurs individuels (issus des domaines publics ou privés ou de la société civile), pour amorcer un changement dans les pratiques traditionnelles de gestion du milieu et pour démontrer la pertinence de ce changement. Cette notion sert de porte d’entrée pour mettre en question le caractère nouveau d’opérations qui reconnaissent au citoyen une compétence à assumer dans l’amélioration l’espace public, surtout là où l’administration locale ne comble pas toutes les attentes sociales.
Le projet pilote de réfection de la rue Anna, réalisé entre 2014 et 2016 dans le quartier Saint-Sauveur à Québec, nous apparaît constituer un moment clé qui incarne une rencontre entre les expérimentations citoyennes et le choix de la Ville de Québec d’aborder autrement les réfections de rues. Nous ferons d’abord un survol du contexte et des théories ayant influencé la planification urbaine au cours des 50 dernières années. Cette évolution est mise en relation avec les réactions de la société civile aux pratiques planificatrices, avec une attention particulière pour le cas de Québec. Nous aborderons ensuite les réfections de rues comme des occasions instigatrices de changement dans la manière dont les citoyens se mobilisent au sein de leurs quartiers et parviennent à faire réfléchir l’administration municipale sur ses pratiques. La réfection de la rue Anna sera finalement examinée comme une résultante de cette évolution des pratiques municipales.
La notion d’expérimentation nous est particulièrement utile pour cette étude de cas, dans la mesure où elle nous offre une grille de lecture qui s’applique autant à l’action citoyenne qu’à l’action municipale, dans une perspective d’ajustement mutuel. Distincte de la lecture inspirée de la sociologie des mouvements sociaux ou de la mobilisation citoyenne, la lecture articulée à la notion d’expérimentation permet également de saisir les bricolages qui émergent quand les acteurs qui collaborent visent avant tout à passer à l’action, à apprendre en faisant (Loorbach, 2010 ; Chu et al., 2017).
Du béton à l’incertitude : une évolution de la planification urbaine
Au milieu du XXe siècle, la planification dite rationnelle est érigée en paradigme (Merlin et Choay, 2005). Elle s’appuie sur la considération de toutes les options possibles, avec leurs impacts selon différents scénarios, et la mise en pratique de celle jugée favorable à l’atteinte d’objectifs préalables (Banfield, 1955). Ce modèle rationnel prend l’urbanisme comme outil de croissance et de contrôle sur l’ordre urbain. Au Québec, comme dans le reste de l’Amérique du Nord, les nouveaux immeubles sont de plus en plus imposants et la priorité est donnée à l’automobile dans le cadre bâti. Les usages sont répartis dans l’espace et l’urbanisme est conçu comme une façon de réguler les rapports entre les individus et les fonctions urbaines. Les villes changent de visage, souvent de façon radicale.
Au tournant des années 1960, dans les quartiers centraux nord-américains, la logique rationnelle est mise en application dans des opérations de rénovation urbaine. La banlieue est la nouvelle « terre promise » des ménages de classes moyennes et supérieures. L’accroissement de la prospérité individuelle suscite un vif intérêt pour les espaces plus grands et distincts des lieux de travail et de consommation des quartiers centraux. L’exode de vitalité commerciale et résidentielle du centre-ville vers les banlieues d’alors réduit considérablement la possibilité pour Québec de compter sur des revenus fonciers permettant d’assurer son développement. Il devient de plus en plus difficile pour la capitale de tirer son épingle du jeu, et le centre-ville subit les conséquences de cette dévitalisation.
Les projets de rénovation urbaine, qui se poursuivent jusque dans les années 1970, ont pour objectif de remplacer les habitations vieillissantes des quartiers centraux par des immeubles et des équipements modernes. Cette nouvelle façon de concevoir le développement urbain, qui a cours jusqu’à aujourd’hui, favorise les projets qui permettent aux administrations locales de maximiser leurs revenus fonciers. Il y a souvent un réel besoin, à l’époque, de reconstruire certaines portions des quartiers ouvriers historiques. Cependant, les projets issus des programmes de rénovation font peu de place à la préservation de l’identité culturelle et du patrimoine bâti des anciens faubourgs. Le renouvellement du cadre bâti implique aussi parfois le remplacement d’une population jugée dérangeante (Marcuse, 1989). Une part considérable de la population vit cette période comme un réel traumatisme, au Québec comme aux États-Unis (Dansereau et L’Écuyer, 1987 ; Fainstein, 2005).
Le sentiment des résidents d’avoir été lésés par les grandes ambitions rénovatrices motive les groupes sociaux à militer pour une plus grande intégration des préoccupations sociales. À partir des années 1960 et plus fortement dans les années 1970, des mouvements sociaux émergent pour remettre en question le développement urbain fondé sur des critères techniques plutôt que sur des aspirations collectives (Hall, 1992). L’enjeu de l’accès au logement structure cette contestation des manières de faire la ville (Hamel, 1983). Cette contestation s’articule également à une vaste remise en question des modes de prise de décision et de planification du développement urbain. La remise en question est double : il y a, d’une part, une contestation des façons de faire des élus municipaux, mais aussi, d’autre part, un questionnement sur « l’expertise » des praticiens de l’urbanisme.
Dans les quartiers centraux de la ville de Québec, des comités citoyens sont formés dès cette époque. Comme ailleurs, ils émergent en réaction aux opérations de rénovation urbaine qui menacent les quartiers populaires de la Basse-Ville avec la construction d’autoroutes urbaines. Une des premières préoccupations de ces comités est de protéger un nombre convenable de logements pour les familles. Le Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur (CCCQSS), fondé en 1969, est l’instigateur de plusieurs projets de logements sociaux durant les années 1970. Ceux-ci ont pris la forme d’habitations à loyer modique (HLM) ou de coopératives d’habitation dans des édifices qui ont poussé dans certains secteurs du quartier qui avaient été rasés (Gilbert, 2015).
Dans le quartier Saint-Roch, le Comité des citoyens de l’Aire 10 (CCR-10) est actif dès 1966. Il a des préoccupations semblables et durcit le ton auprès de l’administration municipale pour protéger l’accessibilité au logement. Le Comité populaire du quartier Saint-Jean-Baptiste (Com Pop) a un historique qui remonte à la même époque, dans le contexte des transformations radicales qui ont accompagné l’aménagement de la Colline du Parlement à partir du milieu des années 1970. Ainsi, à un moment de l’histoire du Québec où les institutions municipales jouissaient d’un pouvoir essentiellement discrétionnaire sur l’aménagement du territoire, des comités de citoyens se sont formés pour prendre une place qui ne leur était pas reconnue autrement.
Au cours de la décennie 1980, le contexte est différent (Beauregard, 2003). L’économie mondiale connaît d’importantes crises. Le ralentissement du système de production et de consommation intensifie la remise en question des méthodes planificatrices du passé et favorise l’application de nouvelles approches, laissant une plus large place à la population et aux partenaires sociaux, tant pour émettre des idées que pour financer leur mise en oeuvre. D’une part, les administrations publiques manquent de ressources et s’en remettent aux acteurs privés, en misant sur une plus grande latitude accordée au marché pour développer certains créneaux particuliers et pour stimuler le développement économique des villes. D’autre part, certaines initiatives populaires et communautaires émergent qui valorisent les particularités et les atouts existants dans les quartiers centraux, comme le patrimoine, la proximité des services, la diversité ethnique et culturelle, etc.
Petit à petit, la conception du fait urbain à cette époque se détache d’une compréhension restreinte du « progrès » et assimile la complémentarité, d’un point de vue territorial, des aspects sociaux et techniques. Du même élan, la perspective d’agir par eux-mêmes se présente aux organismes et aux groupes, pour améliorer leurs milieux de vie et rejeter les approches hiérarchisées de l’époque. La planification urbaine peut s’adapter et être autre chose qu’un urbanisme de spécialistes. Elle peut devenir un espace d’interaction et de recherche collective de nouveaux fondements pour l’ordre et pour l’action.
À Québec, les quartiers centraux sont en déclin et l’administration municipale voit échouer ses efforts de revitalisation. Par exemple, à la fin de la décennie 1970, la transformation de la rue Saint-Joseph en mail – une rue piétonne et couverte – ne parvient pas à freiner l’exode des consommateurs vers les nouveaux centres commerciaux. Tandis qu’à Montréal plusieurs tables de concertation de quartier sont mises sur pied (Sénécal et al., 2008), à Québec, l’administration municipale persiste à vouloir revitaliser les quartiers centraux en s’appuyant sur des projets de développement économique de grande envergure. La perspective change à partir de l’élection de Jean-Paul L’Allier en 1989.
Avec l’entrée du Rassemblement populaire à la mairie de Québec, l’administration municipale demande aux organismes communautaires de se pencher formellement sur la crise que vivent les quartiers centraux. On apprend, de l’étude menée par le Comité pour la relance de l’économie et de l’emploi pour le centre de Québec (CRÉECQ), que la population de Saint-Roch, de Saint-Sauveur, du Vieux-Limoilou et d’une partie des quartiers adjacents a diminué d’environ 4 % au cours de la décennie 1980, qu’elle est vieillissante, peu scolarisée et considérablement plus pauvre qu’ailleurs dans la région (CRÉECQ, 1993). À un niveau plus global, ce rapport témoigne de l’intention de l’administration L’Allier d’intégrer les préoccupations des acteurs sociocommunautaires dans la programmation publique, d’une part, et même d’intégrer ces acteurs dans les dispositifs de planification, d’autre part.
Ainsi, des conseils de quartier sont mis sur pied officiellement en 1993 pour permettre une représentation des citoyens et de leurs préoccupations dans le débat local sur l’aménagement et le développement urbain. Ils assurent l’animation des consultations publiques obligatoires et ont un pouvoir d’initiative locale (Bherer, 2006). Ce changement de rapport entre l’administration municipale et les organismes locaux est en phase avec le contexte global des théories et des pratiques de la planification, qui voit l’approche centralisée et les grands projets de démolition / reconstruction faire place à une approche plus ouverte à la participation des représentants de la population, au développement communautaire et économique des milieux et à la requalification des espaces centraux.
En effet, influencés par les théories prônant la réflexivité et la délibération comme outils de rationalité (Habermas, 1987 ; Giddens, 1991), différents théoriciens de la planification valorisent, à partir des années 1990, une approche de l’urbanisme qui serait davantage interactionniste que technique (Healey, 1992 ; Forester, 1999). Les théories dites communicationnelles ou collaboratives influencent, jusqu’à aujourd’hui, les pratiques de planification. Elles invitent à voir cette dernière comme un moment favorable à la gouvernance de la vie collective locale par une diversité d’acteurs, et d’une manière intégrée (Healey, 2003 ; Innes et Booher, 2010). Toutefois, les tentatives « communicationnelles » mises en oeuvre à partir de la décennie 1990 soulèvent aussi plusieurs critiques.
Au plan théorique, l’idée que les processus participatifs soient vecteurs d’émancipation tend à évacuer les rapports de force que les situations de délibération peuvent reproduire. Elle tend également à fixer l’attention sur le processus au détriment du contenu (Tewdwr-Jones et Allmendinger, 1998 ; Mouffe, 1999). En outre, le peu de ressources et de temps accordé aux processus de participation publique évacue souvent les débats de fond, ce qui ne manque pas de faire perdurer les polarisations dont la délibération cherche pourtant à se sortir (Bherer, 2011).
Au plan pratique, la société civile québécoise peut compter, au tournant du XXIe siècle, sur plusieurs dispositifs pour s’exprimer en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire. Les revendications des groupes, dans les années 1970, ont permis d’ouvrir le cadre institutionnel de prise de décision, de formaliser le rapport entre les décideurs et les habitants des milieux locaux et de reconnaître une légitimité aux savoirs citoyens. Cela dit, cette ouverture et cette reconnaissance ne se traduisent pas toujours par la prise en compte réelle des arguments exprimés. Les dispositifs participatifs ne s’accompagnent pas forcément d’une répartition équitable du pouvoir et de l’influence entre gouvernants et gouvernés (Godbout, 1987). Il n’est pas rare de constater que la délibération qui a lieu lors des séances de consultation ne se répercute pas dans la prise de décision (Hamel, 1999 ; Fournis et Fortin, 2017).
Cela dit, quand on regarde attentivement ce que cette ouverture du cadre institutionnel à la participation publique entraîne comme effets à l’extérieur du cadre, il est possible d’apprécier la portée transformative de la participation. Si l’on s’intéresse à la mise en place de nouveaux dispositifs participatifs, on constate que la participation publique traditionnelle peut susciter des ajustements, tant de la part des représentants municipaux que des représentants des individus et des groupes. Ces ajustements ont trait au renforcement de l’adhésion de la population à des projets municipaux d’intervention, mais aussi à l’adhésion des professionnels et gestionnaires municipaux à des manières de faire qui laissent plus de place à l’expertise citoyenne.
Dans les quartiers centraux de la Ville de Québec, les projets de réfection des rues locales sont particulièrement intéressants pour illustrer le « moment expérimental » (Dumont, 2014) contemporain, en termes de partage des rôles et des responsabilités dans la production de la ville à l’échelle des quartiers. À partir d’entretiens semi-dirigés auprès de 23 répondants clés, nous nous proposons ici de montrer comment la mise en place de processus participatifs ad hoc, que nous désignons comme des expérimentations citoyennes, a pu influencer le choix de l’administration municipale d’aborder les réfections de rues autrement. Nous nous servons de l’analyse de ces entretiens pour établir les dénominateurs communs entre les expérimentations citoyennes et municipales, afin de saisir comment elles s’influencent mutuellement et dégager les défis qui restent à relever.
Rue partagée et partage de la fabrique de la ville
À Québec, des travaux sur les rues ont suscité ces dernières années des mobilisations citoyennes originales. Si la réfection de rue est, a priori, une opération routinière pour une municipalité, elle entraîne néanmoins un dérangement considérable de la vie des résidents, qui voient leur mobilité bouleversée pendant un moment et qui vivent des dérangements pendant les travaux. En même temps, un tel projet peut être vu comme une occasion de « reconquérir la rue » (Soulier, 2012) afin de la rendre plus pratique, agréable et confortable pour tous ses usagers.
C’est ce que se disent les représentants du Com Pop et les citoyens à l’origine des regroupements Verdir et divertir et Bien vivre à Saint-Roch. En examinant les caractéristiques des dispositifs participatifs issus des expérimentations de ces trois groupes citoyens, de même que la place réservée à l’expertise citoyenne dans ces dispositifs, nous pourrons faire un parallèle avec l’expérimentation mise en place par la Ville de Québec pour refaire la rue Anna, dans le quartier Saint-Sauveur.
En février 2006, le comité sur l’aménagement urbain du Com Pop tient une assemblée avec les résidents de la rue Sainte-Claire pour connaître leur intérêt d’en faire une rue « partagée ». Des bulletins de rue semestriels sont publiés par le Com Pop entre 2006 et 2008, dont l’un (mai 2006) invite les résidents à installer des bacs à fleurs devant leurs logements pour montrer que la rue est « habitée ». Le verdissement à petite échelle est promu comme une manière de marquer le territoire et les esprits afin d’appuyer, le moment venu, les revendications auprès de l’administration municipale visant à modifier l’aménagement de la rue. Au fil des mois, plus de 400 lettres d’appui sont envoyées à la Ville de Québec et des représentations sont faites auprès du conseiller municipal et des fonctionnaires municipaux. Au printemps 2008, le Com Pop apprend de la Ville que plusieurs rues du quartier seront refaites au cours des trois années suivantes, dont la rue Sainte-Claire. En mars 2009, le plan triennal d’immobilisations de la Ville comporte un budget spécial pour faire de Sainte-Claire une rue partagée.
Ainsi, trois ans après le lancement par le Com Pop de l’idée d’une rue Sainte-Claire différente, l’administration municipale se lance dans une opération de transformation pour en faire une rue où piétons, cyclistes et automobilistes sont placés sur un pied d’égalité. Ce projet pilote municipal est mené par le service d’ingénierie, rapidement, sans être arrimé différemment qu’à l’habitude avec les autres services. La Ville de Québec réalise plus tard, un peu malgré elle, que certains aspects techniques de la rue partagée ne sont pas tout à fait au point. Dès l’hiver 2012-2013, on constate que la présence des bacs de plantation sur le trottoir empêche la circulation de la machinerie de déneigement. L’accumulation de neige et les voitures stationnées devant les immeubles compliquent la mobilité des citoyens.
Dans le contexte, des ajustements s’imposent. Une consultation publique est convoquée en décembre 2014, cette fois par le conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste. Elle traite spécifiquement du problème de déneigement et de stationnement de la rue Sainte-Claire et met en dialogue les résidents avec le service de l’aménagement et du développement urbain de la Ville de Québec. Au terme des discussions, il est décidé de maintenir le principe de rue partagée sur Sainte-Claire, de préserver le stationnement sur rue en tout temps et de déneiger les bandes de refuge avec la machinerie municipale (Arrondissement de La-Cité-Limoilou, 2015).
Ce premier exemple autour de la rue Sainte-Claire rend compte de la portée que peut avoir un mécanisme de consultation des citoyens structuré, de manière assez classique, par un organisme local. Le Com Pop, jouissant de sa légitimité auprès des résidents, a su encourager les citoyens à témoigner à l’administration municipale de leur intérêt à voir la rue Sainte-Claire transformée en rue partagée. Le conseil de quartier a emboîté le pas au comité citoyen pour porter la demande et l’administration municipale a vu la possibilité de combiner cette demande sociale au besoin avéré de refaire l’infrastructure pour tenter de faire les choses autrement.
L’exemple de la rue Sainte-Claire ne peut cependant pas être considéré comme une expérimentation telle que nous l’entendons. Le projet constitue un « pilote » et ne découle donc pas directement d’une programmation gouvernementale (critère 1). Il permet aussi d’explorer de nouvelles façons de renforcer le milieu à partir d’idées citoyennes (critère 2). Néanmoins, il suscite une interaction plutôt traditionnelle entre les représentants de la société civile et ceux de l’administration municipale. Les premiers s’organisent pour formuler une demande aux seconds, qui posent ensuite les gestes attendus. En outre, les services municipaux n’ont pas saisi l’occasion de tester une nouvelle façon de collaborer afin d’intégrer les préoccupations techniques, urbanistiques et sociales au projet de réfection de la rue Sainte-Claire.
Le rapport à l’action est différent dans les exemples provenant du quartier Saint-Roch. Ces expérimentations de verdissement se distinguent de l’exemple de la rue Sainte-Claire par le fait qu’elles valorisent des logiques d’actions spatiales individuelles pour influencer l’organisation de l’espace. En effet, les expérimentateurs se saisissent de l’espace du quartier à la fois comme une scène d’action, comme un instrument et comme un objet chargé de valeur, en adoptant un registre d’action démonstratif plutôt que contestataire. Ils se servent de la rue, du voisinage et du quartier comme scène de leur « action collective individualisée » (Bennett et Segerberg, 2011 ; Bennett, 2012).
La participation par l’action
En novembre 2009, naît l’association Verdir et Divertir qui, comme son nom l’indique, se donne pour mission de verdir et d’animer l’îlot des Tanneurs, dans la partie ouest du quartier Saint-Roch. Cette portion du quartier, qui doit son identité ouvrière aux entreprises de transformation du cuir qui y avaient pignon sur rue au tournant du XXe siècle, se caractérise par son cadre bâti compact et fortement bétonné, conséquemment sujet aux îlots de chaleur. En 2010, la Ville de Québec choisit d’entreprendre des travaux sur les infrastructures souterraines de la rue Jérôme, au coeur du territoire couvert par l’organisme. Les plans prévoient que la rue soit refaite comme à l’origine, sans changement.
Verdir et Divertir décide de réaliser un exercice de consultation populaire dans son secteur afin de soumettre un plan de réfection de rechange à la Ville de Québec. L’exercice se fonde sur des sondages menés auprès des riverains ainsi que sur des rencontres d’échange. Le dispositif participatif mené par Verdir et Divertir aboutit à une proposition de rue partagée, sans trottoirs et permettant de conserver un certain nombre de places de stationnement, avec l’installation de bacs de plantation disposés de manière à faire ralentir les voitures. L’idée est soumise à la Ville par un des organisateurs de Verdir et Divertir, lui-même ingénieur, qui entretient des contacts avec certains professionnels municipaux.
Bien que jugée intéressante, la proposition de Verdir et Divertir n’est pas réalisée, pour un ensemble de raisons. Le calendrier des travaux municipaux est peu flexible et ne permet pas l’intégration d’ajustements. Également, l’expérience récente de la rue Sainte-Claire, dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, invite les fonctionnaires à la prudence : une rue mal refaite peut engendrer des ajustements coûteux, en termes de temps et d’argent. En même temps, autant les citoyens que les professionnels municipaux admettent qu’une occasion leur a échappé dans le cas de la rue Jérôme.
En juin 2012, la rue de la Reine, dans Saint-Roch, fait l’objet d’une annonce de travaux. Informés par un dépliant municipal, les résidents sont encouragés, selon la procédure habituelle, à profiter de l’excavation pour faire des travaux sur les fondations de leurs édifices s’ils le souhaitent. Les voisins discutent pour se coordonner et échanger des informations sur les réparations à faire, des contacts avec des entrepreneurs, etc. Les échanges sont ponctués de réflexions sur l’aménagement de la rue.
Dans ce contexte, les citoyens à l’origine de Bien Vivre à Saint-Roch réalisent une enquête dans le voisinage et des propositions d’intervention sont soumises en porte à porte à plus de 300 résidents du quartier. Sur ce nombre, 34 personnes répondent à un sondage sur les interventions à mener. Le sondage montre que les résidents souhaitent des interventions permettant l’amélioration d’espaces ciblés (l’accès au parc linéaire de la rivière Saint-Charles, l’aménagement d’un parc au coin de la rue de la Reine et de la Couronne, etc.). Les recommandations font aussi l’objet d’un mémoire déposé dans le cadre d’une consultation, en novembre 2012, pour le Programme particulier d’urbanisme (PPU) du secteur Nord du quartier Saint-Roch. La rue de la Reine n’est pas non plus refaite suivant les demandes de Bien Vivre à Saint-Roch, mais le groupe continue de promouvoir l’embellissement du quartier en organisant ponctuellement des corvées de nettoyage et de verdissement.
Ainsi, une volonté des citoyens de transformer leur milieu de vie émerge et se fait entendre lors de ces moments clés de la gestion urbaine que constituent les réfections de rues. Obtenant comme réponse de l’administration municipale que les manières de faire ne permettent pas de tels ajustements, les citoyens impliqués dans Verdir et Divertir comme dans Bien Vivre à Saint-Roch poursuivent leur expérimentation : ils profitent de ces moments pour s’organiser, pour mobiliser leurs voisins et pour poser des gestes dans la lignée de l’urbanisme tactique (Douglas, 2015). Avec leurs ressources personnelles, ils construisent des bacs qu’ils installent en bordure des rues et qu’ils garnissent de végétaux. Ils misent sur leur savoir-faire pour assurer et faire durer la mobilisation citoyenne, de même que pour se positionner en interlocuteurs sérieux auprès de l’administration municipale.
Dans les deux expérimentations citoyennes, le dispositif participatif ne se limite pas à la création d’une interface avec l’administration municipale : il se poursuit et s’incarne dans l’espace physique du quartier. Le modus operandi des deux groupes, qui évoluent séparément même s’ils se connaissent, implique un certain nombre de tâches récurrentes : des corvées de nettoyage, la plantation de végétaux et l’entretien régulier des espaces publics durant l’année. Aux yeux des expérimentateurs citoyens de Québec comme ceux d’ailleurs, le verdissement est vu comme un projet positif, rassembleur, qui favorise la socialisation et le sentiment d’appartenance au quartier (McPherson et al., 2010 ; Mees et Driessen, 2011 ; Ulmer et al., 2016).
Par contre, pour les décideurs municipaux (élus et professionnels), la révision des façons de faire ne va pas de soi. De fait, à Québec comme ailleurs, les pratiques de planification et de mise en oeuvre sont encore souvent compartimentées (Burch et al., 2014). Par ailleurs, les groupes citoyens abordés précédemment utilisent avec beaucoup d’efficacité des savoirs professionnels et militants collectivisés, mais il y a potentiellement beaucoup de savoirs d’usage individuels, portés par des « citoyens ordinaires », qui échappent encore à l’action collective (Sintomer, 2008 ; Nez, 2011). En ce sens, l’annonce par la Ville de Québec d’un projet pilote pour la réfection de la rue Anna, dans le quartier Saint-Sauveur en 2014, se présente comme une ouverture de l’action publique à une perspective citoyenne de plus en plus structurée autour de l’espace public local.
Refaire la rue autrement
En 2013, l’arrondissement de La Cité-Limoilou lance un plan de verdissement intitulé Verdir La Cité-Limoilou, avec l’intention d’agir sur les îlots de chaleur urbains dans les quartiers centraux selon une approche par territoires prioritaires d’intervention. Ces derniers correspondent aux secteurs les plus compacts et associés à un indice de défavorisation sociale. Le quartier Saint-Sauveur en fait partie et la rue Anna, à l’ouest du quartier, se trouve dans la liste de projets du service d’ingénierie, maître d’oeuvre traditionnel des réfections de rue. Ainsi, cette rue résidentielle, dont l’aménagement ne posait pas de problèmes jusqu’alors aux citoyens riverains, est choisie pour un projet pilote de réfection. La question climatique fait partie de la réflexion municipale, mais est abordée avec le public en lien avec des notions de qualité de vie, de verdissement et d’embellissement du milieu.
Le projet pilote rassemble une équipe regroupant plusieurs services municipaux, en plus de celui de l’ingénierie : aménagement du territoire, environnement, travaux publics, développement économique, de même que des conseillers en consultation publique issus de l’arrondissement. Cette mise en commun des ressources de différents services est sans précédent. Habituellement, ces services sont consultés, mais seulement en fin de processus et d’une façon qui favorise la validation des réfections de rues à l’habituel.
Dans l’expérimentation relative à la rue Anna, quatre options sont à l’étude. Elles vont d’une réfection à l’identique jusqu’à la récupération d’une voie de circulation, pour planter un maximum d’arbres, en passant par un élargissement des trottoirs, une réduction des espaces de stationnement et divers degrés de verdissement. Elles sont présentées lors de deux consultations publiques, l’une en février et l’autre en mars 2014, animées par un tiers, Agoralab, embauché par la Ville de Québec. Ces consultations sont l’occasion pour les professionnels impliqués dans le projet d’échanger avec les résidents de la rue, de même qu’avec les représentants du conseil de quartier et du CCCQSS, sur les attentes et les craintes relatives au projet. Au terme de l’exercice, les participants s’entendent sur un compromis entre le verdissement et la conservation des cases de stationnement. Les travaux sont réalisés à l’été 2015 et un total de 19 arbres et 36 arbustes sont plantés en mai 2016.
Le cas de la rue Anna répond aux trois critères de définition de l’expérimentation présentés en introduction : (1) il est conçu explicitement comme un projet pilote et ne découle d’aucun programme ; (2) il a sollicité une mise en commun d’expertises différentes ; (3) il concrétise un type d’échange ville-citoyens déjà amorcé. Dans le contexte de Québec, il fournit à la Ville l’occasion de tester une nouvelle approche participative, entre les services municipaux, d’une part, et entre l’administration et les habitants, d’autre part.
Dans le cas de la rue Anna, l’expérimentation concrétise un ajustement dans les façons de faire et les représentations de la ville. Les citoyens continuent d’expérimenter autour des réfections de rues pour faire la démonstration des résultats désormais attendus en termes d’aménagement. Quant à l’administration municipale, elle expérimente avec les réfections de rues pour prouver une ouverture aux demandes sociales et démontrer une capacité de faire les choses autrement. Il nous apparaît clair que la conception des rues est en train de devenir autre chose qu’un champ d’application exclusif à l’expertise des services d’ingénierie et des travaux publics. Dans ce sens, les rues constituent des espaces de contact, au sein desquels peuvent se prendre diverses initiatives, qui marquent « des retrouvailles avec des échelles mineures d’aménagement » (Choay, 1994).
Le choix de tester une nouvelle façon de faire a amené les fonctionnaires municipaux à plonger dans l’inconnu. Aussi, le recours à un tiers pour organiser les consultations publiques relevait d’une volonté de situer les professionnels municipaux au niveau des citoyens dans une dynamique plus collaborative. Certains aspects du projet pilote ont moins bien fonctionné. Plusieurs représentants municipaux ont souligné un manque de vision commune, par manque d’habitude des différents services à travailler conjointement. De même, la rue Anna avait déjà été déterminée au moment de rassembler l’équipe de travail municipale, ce qui n’a pas permis aux professionnels de se concerter pour choisir une rue « idéale », présentant davantage de possibilités techniques pour améliorer l’aménagement.
Cela dit, il demeure que la rue Anna a profité d’un traitement essentiellement nouveau pour l’administration municipale de Québec. De plus, l’intégration de certains aspects du plan Verdir La Cité-Limoilou dans le plan Place aux arbres, adopté à l’échelle municipale en décembre 2015, peut être soulignée comme une réussite. Le projet de la rue Anna ne fut peut-être pas l’ultime élément déclencheur de cette intégration, mais des fonctionnaires y ont vu l’occasion de tester une application concrète de leurs objectifs de verdissement urbain et sont parvenus à prouver quelque chose.
Plus largement et au plan substantiel, l’expérimentation s’est avérée positive pour aborder le phénomène d’îlot de chaleur urbain, en liant l’enjeu climatique à des questions de santé publique et de qualité de vie. Cette liaison est un pas en faveur d’une adhésion citoyenne à l’adaptation urbaine, dans une ville où les climatosceptiques sont peut-être plus nombreux qu’ailleurs : une étude, parue en 2015, nous apprenait que 44 % des résidents de la grande région de Québec se définissaient comme tels (De Marcellis-Warin et al., 2015).
Conclusion
L’expérimentation est un concept révélateur de la motivation qu’ont les acteurs locaux à sortir des sentiers battus. D’un côté, les professionnels municipaux souhaitent susciter une plus grande adhésion des citoyens à leurs projets, à plus forte raison lorsque ceux-ci vont dans le sens d’une transition écologique recherchée. De l’autre côté, les citoyens n’hésitent pas à sortir des processus institutionnels pour prendre part à l’aménagement, en agissant directement et par eux-mêmes sur le cadre urbain.
Les différentes formes d’expérimentation que nous avons abordées, et qui culminent avec le projet pilote de réfection de la rue Anna, diffèrent par leur origine, citoyenne ou institutionnelle, mais partagent comme dénominateur commun une volonté de revoir la façon d’aborder le cadre bâti des villes. À cet égard, des ajustements sont en train de se réaliser. Ces ajustements techniques et organisationnels sembleraient, bien que cela reste à vérifier de façon plus systématique, de plus en plus en phase avec les attentes sociales pour des milieux de vie favorables à la santé, au bien-être et à la vitalité.
La réfection des infrastructures urbaines, en particulier les rues, constitue une occasion unique de transformer durablement les milieux de vie, et cela, pour des décennies à venir. Il s’agit d’un moment clé, qui force le retour sur les apprentissages. C’est aussi une circonstance qui marque le pas de l’évolution de la ville : l’expérience vécue des résidents qui connaissent leurs rues, y ont fait des observations, doit permettre aux administrations municipales de tirer quelques constats pertinents.
À cet égard, la prise de contact qui se fait entre les citoyens et les représentants de l’institution municipale permet une meilleure compréhension des enjeux avec lesquels chacun doit composer. Il nous semble aussi que la participation informelle des citoyens rend service aux administrations municipales. Elle permet de partager le fardeau du renouvellement des infrastructures de rues, en tant qu’espaces publics à la frontière du privé, et ce, en intervenant sur l’acceptabilité sociale des projets. En même temps, cette dynamique impose une réflexion sur l’ouverture des processus d’aménagement à tous les citoyens. Le dialogue qui s’établit entre les municipalités et les citoyens « experts », qui ont tendance à professionnaliser leurs interventions, risque de ne pas toujours bien intégrer le point de vue de citoyens moins engagés, mais qui n’en sont pas moins porteurs d’une forme d’expertise de leur milieu de vie.
Le questionnement demeure, mais l’expérimentation permet justement de trouver des voies alternatives. Elles nous apparaissent essentielles pour mettre en oeuvre concrètement les objectifs de revitalisation, de verdissement et d’adaptation du milieu qui sont au coeur des défis contemporains pour les villes. Les grands plans municipaux, par exemple en faveur du transport en commun ou de l’adaptation aux changements climatiques, sont souvent vertueux. Il faut cependant réfléchir à la manière de les mettre en oeuvre, ce qui impose une réflexion sur les pratiques de planification urbaine. Dans ce contexte, l’exemple de la rue Anna nous apprend qu’il est possible d’amorcer un mouvement, en ce qui concerne l’adaptation du milieu, en liant l’enjeu climatique à des enjeux terre-à-terre comme le verdissement, la qualité de vie et la révision des infrastructures urbaines. En se permettant d’expérimenter, de sortir du cadre et de rompre avec les habitudes, les villes et acteurs urbains pourraient probablement parvenir à traduire en solutions leurs grands objectifs d’adaptation.
Appendices
Note
-
[1]
Cette recherche a reçu un appui financier du Fonds de recherche du Québec et du consortium Ouranos.
Bibliographie
- ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU (2015) Séance d’information et d’échange. Déneigement et stationnement de la rue Sainte-Claire. Compte-rendu [En ligne]. https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/conseils_quartier/saintjeanbaptiste/Visualiser.ashx?id=1446
- AYLETT, Alexander (2014) Progress and challenges in the urban governance of climate change: Results of a global survey. Cambridge, Massachusetts Institute of Technology Press.
- BANFIELD, Edward C. (1955) Note on conceptual scheme. Dans Martin Meyerson et Edward C. Banfield (dir.) Politics, planning, and the public interests. New York, Free Press, p. 303-329.
- BEAUREGARD, Robert A. (2003) Voices of decline: The postwar fate of US cities. New York, Routledge.
- BENNETT, W. Lance (2012) The personalization of politics: Political identity, social media, and changing patterns of participation. Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol. 644, no 1, p. 20-39.
- BENNETT, W. Lance et SEGERBERG, Alexandra (2011) Digital media and the personalization of collective action: Social technology and the organization of protests against the global economic crisis. Information, Communication & Society, vol. 14, no 6, p. 770-99.
- BHERER, Laurence (2006) Le cheminement du projet de conseils de quartier à Québec (1965-2006). Lien social et Politiques, vol. 25, no 1, p. 31-56.
- BHERER, Laurence (2011) Les relations ambiguës entre participation et politiques publiques. Participations, vol. 1, no 1, p. 105-133.
- BLONDIAUX, Loïc et SINTOMER, Yves (2002) L’impératif délibératif. Politix, no 57, p. 17-35.
- BRENNER, Neil, MARCUSE, Peter et MAYER, Margit (2009) Cities for people, not for profit. City, vol. 13, nos 2-3, p. 176-184.
- BROTO, Vanesa C. et BULKELEY, Harriet (2013) A survey of urban climate change experiments in 100 cities. Global Environmental Change, vol. 23, no 1, p. 91-102.
- BULKELEY, Harriet, BROTO, Vanesa C. et EDWARDS, Gareth A. S. (2015) An urban politics of climate change. Experimentation and the governing of socio-technical transitions. Londres, Routledge.
- BURCH, Sarah, SHAW, Alison, DALE, Ann et ROBINSON, John (2014) Triggering transformative change: A development path approach to climate change response in communities. Climate Policy, vol. 14, no 4, p. 467-487.
- CHOAY, Françoise (1994) Six thèses en guise de contribution sur les échelles d’aménagement et le destin des villes. Dans Augustin Berque (dir.) La maîtrise de la ville. Urbanité française, urbanité nippone. Paris, Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, p. 221-227.
- CHU, Eric, ANGUELOVSKI, Isabelle et ROBERTS, Debra (2017) Climate adaptation as strategic urbanism: Assessing opportunities and uncertainties for equity and inclusive development in cities. Cities, vol. 60, p. 378-387.
- CLOUTIER, Geneviève, JOERIN, Florent, DUBOIS, Catherine, LABARTHE, Martial, LEGAY, Christelle et VIENS, Dominique (2015) Planning adaptation based on local actor’s knowledge and participation: A climate governance experiment. Climate Policy, vol. 15, no 4, p. 458-474.
- CRÉECQ (Comité pour la relance de l’économie et de l’emploi du centre de Québec) (1993) Stratégie d’intervention pour le développement économique et communautaire des quartiers centraux de Québec, 1993-1998. Québec, Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre.
- DANSEREAU, Francine et L’ÉCUYER, Daniel (1987) Réanimation, reconquête, conversion.Revue de la littérature et bibliographie sélective annotée. Montréal, Institut national de la recherche scientifique – Urbanisation.
- DE MARCELLIS-WARIN, Nathalie, PEIGNIER, Ingrid, BUI, Minh Hoang, ANJOS, Miguel F., GABRIEL, Steven A. et GUERRA, Carla (2015) L’énergie et les changements climatiques. Perceptions québécoises. Montréal, Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations et Institut de l’énergie Trottier.
- DESLANDES, Ann (2013) Exemplary amateurism: Thoughts on DIY urbanism. Cultural Studies Review, vol. 19, no 1, p. 216-227.
- DOUGLAS, Gordon C. C. (2015) Do-it-yourself urban design: The social practice of informal “improvement” through unauthorized alteration. City & Community, vol. 13, no 1, p. 5-25.
- DUMONT, Marc (2014) L’expérimentation en aménagement urbain. Rennes, Université de Rennes 2, Département de géographie et d’aménagement de l’espace, mémoire d’habilitation à diriger des recherches.
- EVANS, James P. (2011) Resilience, ecology and adaptation in the experimental city. Transactions of the Institute of British Geographers, vol. 36, no 2, p. 223-237.
- FAINSTEIN, Susan (2005) Cities and diversity. Should we want it? Can we plan for it? Urban Affairs Review, vol. 41, no 1, p. 3-19.
- FERCHAUD, Flavie et DUMONT, Marc (2015) Les « échappées » des expérimentations, une forme de design social des espaces ? Le cas du réaménagement du quartier du Blosne à Rennes (France). Lien social et Politiques, no 73, p. 199-214.
- FORESTER, John (1999) The deliberative practitioner: Encouraging participatory planning processes. Londres, Massachusetts Institute of Technology Press.
- FOURNIS, Yann et FORTIN, Marie-José (2017) From social “acceptance” to social “acceptability” of wind energy projects: Towards a territorial perspective. Journal of Environmental Planning and Management, vol. 60, no 1, p. 1-21.
- GEELS, Frank W. et KEMP, René (2007) Dynamics in socio-technical systems: Typology of change processes and contrasting case studies. Technology in Society, vol. 29, no 4, p. 441-455.
- GIDDENS, Anthony (1991) Modernity and self-identity. Self and society in the late modern age. Redwood City, Stanford University Press.
- GILBERT, Dale (2015) Vivre en quartier populaire. Saint-Sauveur, 1930-1980. Québec, Septentrion.
- GODBOUT, Jacques T. (1987) La démocratie des usagers. Montréal, Boréal.
- HABERMAS, Jürgen (1987) Théorie de l’agir communicationnel. Paris, Fayard.
- HALL, Peter (1992) Urban and regional planning. Londres, Routledge.
- HAMEL, Pierre (1983) Logement et luttes urbaines à Montréal, 1963-1976. Montréal, Cahier de recherche de la Faculté d’aménagement de l’Université de Montréal.
- HAMEL, Pierre (1999) La consultation publique et les limites de la participation des citoyens aux affaires urbaines. Recherches sociographiques, vol. 40, no 3, p. 435-466.
- HEALEY, Patsy (1992) Planning through debate: The communicative turn in planning theory. The Town Planning Review, vol. 63, no 2, p. 143-162.
- HEALEY, Patsy (2003) Collaborative planning in perspective. Planning Theory, vol. 2, no 2, p. 101-123.
- HOFFMANN, Matthew J. (2011) Climate governance at the crossroads. Experimenting with a global response after Kyoto. New York, Oxford University Press.
- INNES, Judith E. et BOOHER, David E. (2010) Planning with complexity. An introduction to collaborative rationality for public policy. Londres, Routledge.
- KIVIMAA, Patricia, HILDÉN, Mikael, HUITEMA, Dave, JORDAN, Andrew et NEWIG, Jens (2017) Experiments in climate governance – A systematic review of research on energy and built environment transitions. Journal of Cleaner Production, vol. 169, p. 17-29.
- LOORBACH, Derk (2010) Transition management for sustainable development: A prescriptive, complexity-based governance framework. Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions, vol. 23, no 11, p. 161-183.
- MARCUSE, Peter (1989) Who / what decides what planners do? Journal of the American Planning Association, vol. 55, no 1, p. 79-80.
- McPHERSON, E. Gregory, SIMPSON, James R., PEPER, Paula J., CROWELL, Aaron M. N. et XIAO, Qingfu (2010). Northern California coast community tree guide: Benefits, costs, and strategic planting. Albany, United States Department of Agriculture, U.S. Forest Service, Rapport technique.
- MEES, Heleen et DRIESSEN, Peter (2011) Adaptation to climate change in urban areas: Climate-greening London, Rotterdam, and Toronto. Climate Law, vol. 2, no 2, p. 251-280.
- MERLIN, Pierre et CHOAY, Françoise (2005) Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement. Paris, Presses Universitaires de France.
- MOUFFE, Chantal (1999) Deliberative democracy or agonistic pluralism? Social Research, vol. 66, no 3, p. 745-58.
- NEZ, Héloïse (2011) Nature et légitimités des savoirs citoyens dans l’urbanisme participatif. Une enquête ethnographique à Paris. Sociologie, vol. 2, no 4, p. 387-404.
- SÉNÉCAL, Gilles (2012) Community development and social actor theories: A case study in Montréal (Canada). Social Geography, vol. 7, no 1, p. 37-46.
- SÉNÉCAL, Gilles (2016) La société des acteurs. Les voix du monde vécu. Montréal, Liber.
- SÉNÉCAL, Gilles, CLOUTIER, Geneviève et HERJEAN, Patrick (2008) Le quartier comme espace transactionnel : l’expérience des Tables de concertation de quartier à Montréal. Cahiers de géographie du Québec, vol. 52, no 146, p. 191-214.
- SINTOMER, Yves (2007) Le pouvoir au peuple. Paris, La Découverte.
- SINTOMER, Yves (2008) Du savoir d’usage au métier de citoyen ? Raisons politiques, vol. 3, no 31, p. 115-133.
- SOULIER, Nicolas (2012) Reconquérir les rues : exemples à travers le monde et pistes d’actions. Paris, Ulmer.
- TEWDWR-JONES, Mark et ALLMENDINGER, Phil (1998) Deconstructing communicative rationality: A critique of Habermasian collaborative planning. Environment and Planning A, vol. 30, no 11, p. 1975-1989.
- ULMER, Jared M., WOLF, Kathleen L., BACKMAN, Desiree R., TRETHEWAY, Raymond L., BLAIN, Cynthia J., O’NEIL-DUNNE, Jarlath P. M. et FRANK, Lawrence D. (2016) Multiple health benefits of urban tree canopy: The mounting evidence for a green prescription. Health & Place, vol. 42, p. 54-62.

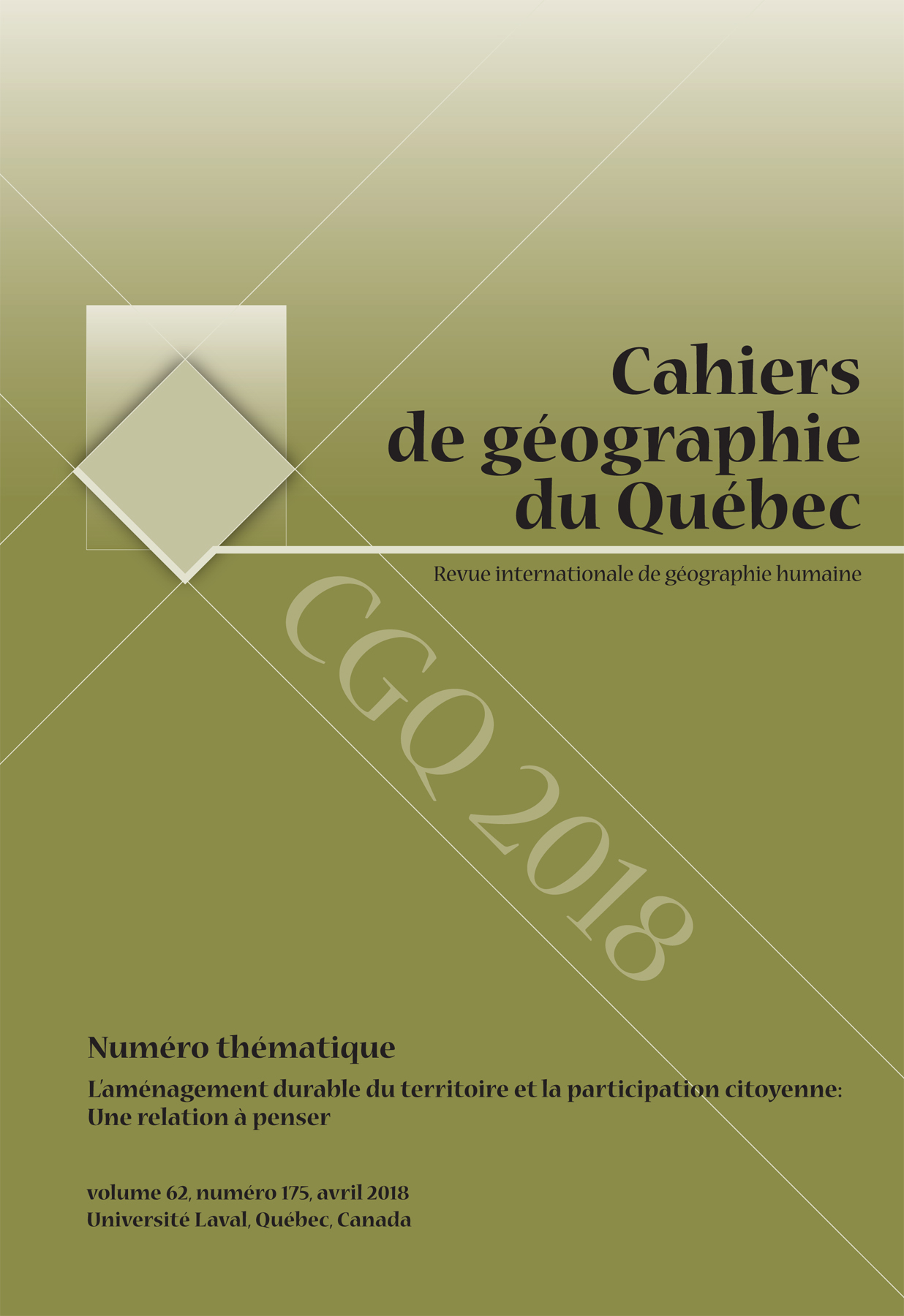
 10.7202/1030958ar
10.7202/1030958ar