Abstracts
Résumé
Un article-récit qui illustre le fait que la traduction littéraire encourage un acte de performativité, dans la durée et la répétition, par l’entremise d’un processus traductif collaboratif, pour le cas présent du récit de vie d’une femme autochtone, They Called Me Number One de Bev Sellars. Cette identification à l’Autre agit à titre de savoir-être voire d’approche traductologique pour la traduction du récit de vie, et d’exercice d’émancipation et de guérison chez les différentes personnes investies dans la production du texte d’arrivée vers le français Matricule « Numéro 1 » : secrets et survie dans un pensionnat autochtone. Leur intimité se voit en partie « déconstruite », et ce, d’un point de vue discursif, linguistique et traductologique. Ce travail de collaboration Autochtone / Allochtone contribue à la conversation nationale entre les diverses communautés autochtones, dont les enfants de plusieurs générations ont fréquenté un pensionnat et y ont subi de la maltraitance.
Mots-clés :
- Traductologie,
- traduction littéraire,
- récit de vie,
- collaboration autochtone,
- empathie
Article body
Nous sommes actuellement en mars 2022. Il y a une semaine, j’ai terminé la traduction française de They Called Me Number One: Secrets and Survival at an Indian Residential School[1] de Bev Sellars, et je réfléchis au présent article depuis déjà longtemps. Il a tenu diverses formes : journal de la traductrice, postface, notes jetées sur papier, ici et là, et discussions. Je puiserai quelques passages de ma thèse intitulée : Pistes décoloniales pour la traduction de récits autochtones : l’exemple de They Called Me Number One de Bev Sellars, parue en décembre 2019, un texte qui porte justement sur le processus de traduction du récit de vie de Bev Sellars, exemple de l’expérience d’une femme – une ancienne élève de pensionnat autochtone – pour la production d’une traduction décoloniale de récits autochtones.
Entre la théorie et la performance
Une des interrogations relatives au présent article concerne le ton adéquat à emprunter pour relater le processus traductif. Comment aborder cette expérience de traduction, comme j’ai fréquenté ce texte pendant des années? J’avais moi aussi envie de raconter une histoire, celle de la traduction de ce récit, de me distancier de la théorie quelque peu (même en contexte universitaire) afin de faire, à mon tour, le récit d’une expérience. Aujourd’hui, je me rends compte que cette expérience de traduction va bien au-delà du transfert linguistique d’un anglais, « teinté » (Berman, 1999) de secwepemc vers le français. Ainsi, lorsque je mentionnerai le mot « théorie », ce sera afin de produire une traduction décoloniale en tant que « chercheure non autochtone de descendance coloniale », terme proposé par Marie Leconte, stagiaire post-doctorale à McGill, afin de désigner les settler scholars en français, mieux connus et définis sur la scène de la théorie littéraire canadienne-anglaise. La communication de Marie Leconte, à l’occasion du colloque virtuel Écrire et (auto-)traduire des langues autochtones : engagement et créativité, organisé par l’ESIT, Sorbonne-Nouvelle, le 23 juin 2021, a d’ailleurs en quelque sorte légitimé le choix de ton pour cet article, celui de le rendre plus personnel, de le rédiger au « je » en majorité, sans pour autant qu’on ait l’impression de passer outre à ce qui est traditionnellement acceptable ou souhaité lors de la rédaction d’un essai. Dans sa communication, Marie Leconte traitait de la difficulté pour le sujet traduisant de définir sa position et son rôle. À mon sens, son ton notamment s’est distingué des autres communications entendues à ce colloque. Cependant, Leconte n’est pas la première à s’être exprimée de la sorte, comme en témoigne la citation suivante, tirée de Travelling Knowledge: positioning the im/migrant reader of aboriginal literatures in Canada, de la regrettée Renate Eigenbrod, sommité en études autochtones canadiennes :
From the point of view of orally communicates knowledge, [Lee Maracle] argues in favour of the contextualized story, or “oratory”, instead of decontextualized theorizing. Aligning myself with her reasoning, I introduce my own work in the personal storytelling mode, this “way” of speaking to you, the reader, not just through persuasiveness of my intellectual argument but also through my lived experience.
Eigenbrod, 2005 : XII
Je suis heureuse d’avoir l’occasion de m’exprimer de façon plus personnelle car, dans le cadre de la thèse, avant de commencer la rédaction, il avait été question justement que je documente mon (auto)réflexion effectuée lors du processus traductif par l’entremise d’un journal de la traductrice. Cette idée a par la suite été abandonnée ; j’y reviens donc ici avec cet article que je considère, quelque part, comme tenant lieu de journal de traduction.
Abordons également cet article en tant qu’acte de performance de ma part – moi, la traductrice –, et considérons ma voix comme faisant partie de l’expression d’une identification à l’Autre, puisque comme le disait notamment Garry Sherbert dans l’introduction à son Cultural Canadian Poesis : « Identity is performed, and not a naturally occurring essence. » (2006 : 8) Ainsi, cet article me situe face à la traduction, et crée un espace où je peux raconter mon expérience – un lieu qui rende la traductrice visible – tout en procédant à un exercice de comparaison entre la théorie de ma thèse et la pratique du processus traductif collaboratif. Cette performance, dont parle Sherbert, et mise en pratique dans le processus traductif, s’inspire grandement du travail des traductrices féministes québécoises et canadiennes des années 1970 et 1980, qui se distinguaient notamment par le caractère explicite de leurs interventions linguistiques, comme à l’occasion de lectures publiques ou d’ateliers de traduction simultanée. Au cours de ma traduction, des performances linguistiques ont été réalisées[2] ainsi qu’un autre type de performance, celui de s’identifier au texte autrement, dans un espace-continuum en mouvement et dynamique, où les émotions sont ressenties et les choses sont dites : et c’est exactement ce que je souhaite poursuivre ici.
Un contexte idéal
Grâce à ma formation en littérature canadienne comparée, cheminement en traduction littéraire et traductologie, j’ai compris l’importance de produire une traduction qui se veut décoloniale dans le contexte d’un récit produit par un ou une Autochtone. En conséquence, lors de la rédaction de ma thèse, les lectures se bousculaient dans mon esprit ; j’ai donc dressé une liste des éléments qui me semblaient incontournables, et dont je devais absolument tenir compte au cours de l’exercice. Cette liste est plus tard devenue le plan de ma méthodologie décoloniale en traductologie – spécifiquement pour la traduction du récit de Bev Sellars – que j’ai eu la chance d’expérimenter dans le cadre de ma thèse.
They Called Me Number One: Secrets and Survival at a Indian Residential School de Bev Sellars, publié chez Talonbooks en 2013, est un récit autochtone féminin à voix singulière, mais représentante du collectif. Ce récit met en lumière les événements marquants de la vie de l’auteure dans leur contexte, en portant une attention particulière à la fréquentation de la Mission Saint-Joseph, un pensionnat catholique pour jeunes autochtones. Le récit détaille également sa vie après qu’elle a eu fréquenté ce pensionnat. En effet, l’auteure y raconte la vie dans sa communauté, ses relations amoureuses et familiales, la naissance de ses enfants, ses études, les différentes étapes de sa guérison et celle des membres de sa communauté, de même que la rencontre de son mari actuel, le chef Bill Wilson.
Bev Sellars a entamé l’écriture de ses pensées sous forme de journal intime et de réflexions personnelles pour, par la suite, décider de publier une oeuvre littéraire, catégorisée sous le genre « récit de vie », récit qui, selon Todorov, engendre une force expressive littéraire accrue en raison de l’expression d’événements véridiques : « L’écrivain ne doit jamais oublier, au moment où il façonne son personnage, que la force expressive de l’oeuvre littéraire dépend dans une très large mesure de ce qu’il y a de vérité de la vie en elle », écrivait-il pour le roman (1981 : 298). Et pourrions-nous penser que cette affirmation est d’autant plus vraie dans le cas où le récit a passé par l’épreuve de la réalité, lorsque l’auteure se base sur des souvenirs? Il va sans dire que la force expressive du texte de Bev Sellars est bien présente à la lecture, et cela est vrai à la fois dans l’expérience de la traductrice et du lectorat. J’émets toutefois l’hypothèse que cette vérité est ressentie de façon accentuée chez les acteurs et actrices ayant participé à la traduction du texte. Ce n’est évidemment pas comparable à ce que peuvent ressentir les personnes qui sont ou ont été personnellement touchées, de près ou de loin, par l’expérience du pensionnat autochtone.
Entre 2015 et 2019, j’ai traduit les six premiers chapitres du texte, lesquels ont servi à l’élaboration de ma méthodologie décoloniale pour ce projet. Je tentais alors d’évaluer s’il était possible de mettre en pratique les théories décoloniales et féministes/neutralisantes dans ma traduction et, le cas échéant, je m’y appliquais. Les six premiers chapitres ont été revus et corrigés par ma directrice, la professeure Nicole Côté, puis par la professeure Patricia Godbout, membre de mon jury, une fois la thèse déposée. Ainsi, ces traductrices chevronnées ont procédé à la révision bilingue et linguistique de ces six premiers chapitres, dans l’optique de la réalisation de ma thèse. Je gardais mon hypothèse en tête et conservais ma conscience décoloniale, empreinte d’empathie et de respect pour l’auteure, les enfants ayant fréquenté ce pensionnat autochtone et les membres de leurs communautés. Afin de clarifier le contexte, en voici l’hypothèse :
L’hypothèse de ma recherche est la suivante : Grâce à la traduction française du récit de pensionnat autochtone de Bev Sellars et de sa collectivité, They Called Me Number One: Secrets and Survival at an Indian Residence School, il me sera possible de raconter / rédiger en français, par la sauvegarde de l’oralité du texte de départ dans le texte d’arrivée, ce récit de vie, où sera mise en évidence une relationalitéautoréflexive, subjective, émancipatrice, interculturelle et collaborative, exprimée par une voix singulière, mais représentante du collectif, à la fois pour l’auteure et pour moi, la traductrice. Ce processus me permettra d’élaborer les premières étapes d’une méthodologie décoloniale/autochtoniste en traductologie.
Théberge, 2019 : 5-6
Le présent article tentera donc de démontrer qu’en effet, une partie de l’hypothèse se vérifie dans le fait que la traduction complète (14 chapitres) de They Called Me Number One m’a permis de procéder à une autoréflexion, puis à un certain positionnement en tant que chercheure non autochtone de descendance coloniale.
Pour la traduction des six premiers chapitres, j’ai tenté autant que possible de faire preuve d’empathie rationnelle, comme le suggère brillamment Isabelle Collombat[3], dans son article « L’empathie rationnelle comme posture de traduction », où elle définit l’empathie comme une compréhension chez la traductrice de la manière dont l’auteure pense, et non pas de la manière dont elle se sent (2010 : 57). Il s’agit là d’une activité où la traductrice fait particulièrement preuve d’agentivité, car ce n’est pas parce qu’on traduit un texte qu’il faut nécessairement tout savoir de l’auteur.e ou appartenir à la même culture ou au même groupe ethnique. Par contre, à mon humble avis, une identification à l’auteure doit tout de même avoir lieu, d’une manière ou d’une autre, car cette identification favorise la production d’une traduction encore plus fidèle à la voix de l’auteure. Et cela est vrai, selon l’hypothèse qu’une association ou une identification se fait au niveau discursif, dans un contexte d’interaction puisque la traduction est une activité d’ordre culturel fondée dans la langue. D’un point de vue linguistique, le processus d’identification est d’ordre discursif – plutôt que psychanalytique ou racial –, ce qui exclut, en partie, le « problème » du positionnement de la chercheure non autochtone sur l’axe (dé)colonial. L’analyse reposerait plutôt sur la théorie de Bakhtine qui stipule que, dans une interaction, le destinataire répond nécessairement à l’énoncé entendu, peu importe son origine ethnique ou ses caractéristiques identitaires[4] :
Toute parole, quelle qu’elle soit, est orientée vers une réponse compréhensive, mais cette orientation ne se singularise pas par un acte autonome, et ne ressort pas de la composition. La compréhension réciproque est une force capitale qui participe à la formation du discours : elle est active, perçue par le discours comme une résistance ou un soutien, comme un enrichissement.
Bakhtine, 1978 : 103
Sous le jour de la traductologie, nous pourrions affirmer que la traductrice répond nécessairement à l’interaction, à l’énoncé lu : un énoncé qui se voit teinté d’oralité dans le présent texte, étant donné le genre littéraire du récit de vie et la volonté consciente d’utiliser le pronom « on » dans la traduction plutôt que le « nous » afin de mieux transposer l’oralité du récit original dans le texte d’arrivée. De ce fait, une association se forme par l’entremise d’une interaction entre le sujet discursif – ou le texte de départ – et le sujet traduisant. En effet, à l’égard de ce rapport intersubjectif entre le destinateur et le destinataire, ou entre l’auteure et la traductrice, selon Judith Butler aucun sujet ne peut être son propre point de départ (Butler, 1990 : 9-15), c’est donc dire que l’intersubjectivité – ou la réaction/relation à l’Autre – est fondamentale dans l’interaction, et que l’Autre se situe à la source de l’identité dans le contexte du processus d’identification de la traductrice à l’auteure. En conséquence, la traductrice réagit au discours de l’auteure et à ses propos, à son récit porté à l’écrit, et elle en fait l’analyse avec agentivité et ouverture envers la différence. À ce sujet, Jessica Benjamin, dans Shadow of the Other, Intersubjectivity and Gender in Psychoanalysis, affirme : « In order to go beyond a conception of a self-enclosed self, to recuperate difference and respect for otherness along with agency, we have to account for the impact of the other on the self. » (1998 : 94). Il s’agit là d’une prise de conscience qui peut parfois exposer la traductrice à un Autre qui saura sainement déstabiliser son équilibre identitaire ou émotionnel, en évoquant des réflexions ou des expériences qui auront pour effet de créer un sentiment de vulnérabilité, par exemple, qui aurait pu avoir été refoulé par un mécanisme de protection (1998 : 95), au même titre, peut-être, que cela a pu être le cas pour certains survivants et survivantes des pensionnats autochtones. Bien sûr, tel que mentionné plus haut, la traductrice en tant que professionnelle langagière saura faire preuve d’agentivité et ne s’identifiera pas en totalité à son auteure ; bien que l’on puisse argumenter que l’utilisation répétée du pronom « je » dans le récit de vie favorise ce processus d’identification et la montée de certaines blessures émotionnelles, par exemple.
En effet, « les mots d’ordre » sont « agentivité » et « professionnalisme » à l’intérieur de l’interaction, sans oublier le recours aux stratégies de traduction plus traditionnelles, mais est-ce toujours possible? Personnellement, dans ce processus de traduction de certaines parties du récit de Bev Sellars, il en a été autrement. Pour moi, les six premiers chapitres ont été abordés de manière plus « intellectuelle », puisque ces chapitres agissaient à titre d’exemple pour la méthodologie décoloniale/autochtoniste en traduction, mais aussi par le fait que les propos traités tenaient principalement à la Mission Saint-Joseph, où les événements qui se sont produits m’étaient personnellement étrangers[5]. Je m’identifiais alors à l’auteure, mais il m’était alors toujours possible de faire preuve d’une grande agentivité malgré la montée d’une grande empathie envers l’expérience dévastatrice de ces enfants. Qui d’ailleurs n’aurait pas été empathique en traduisant ce récit d’événements souvent aussi monstrueux? J’en étais alors toujours « au début » de la traduction ; les variables « temps » et « répétition » ne faisaient pas encore partie de l’équation.
Une fois la thèse complétée, j’en étais au chapitre sept. Je me suis alors retrouvée seule pour la première fois devant le texte et j’ai ressenti une certaine liberté : j’avais l’impression de pouvoir laisser aller ma créativité. À cette partie du texte, la thématique demeurait la même et l’action se déroulait encore principalement à la Mission Saint-Joseph, et ce, pour deux chapitres supplémentaires.
Les chapitres suivants traitent de la vie de Bev Sellars à sa sortie du pensionnat, au cours de sa vie d’adolescente et de femme, et elle y relate de nombreuses situations négatives qui se sont manifestées en conséquence de sa vie à la Mission Saint-Joseph : elle a personnellement vécu des traumatismes relatifs à des blessures intergénérationnelles observées dans la communauté de Xats’ūll (Soda Creek), pour ne nommer que celle-ci, où elle habitait dans sa jeunesse. Bev Sellars fait la description d’un nombre important d’événements de sa vie, ce qui fait en sorte qu’à un point ou à un autre, dans le texte, le traducteur ou la traductrice peut nécessairement établir des liens avec sa vie personnelle.
C’est alors que je suis devenue l’Autre, pour reprendre la formule de Nerval, avec son « Je suis l’autre ». Gérard Macé le cite sur la page couverture de son ouvrage, qui souligne que : « L’intérêt des mémoires, des confessions, des autobiographies, écrit Nerval à propos de Restif, tient à ce que la vie de chaque homme devient ainsi un miroir où chacun peut s’étudier, dans une partie du moins de ses qualités ou de ses défauts. » (2007 : 13) L’image du miroir est peut-être aujourd’hui surfaite, et le récit de vie tend à se distinguer de l’autobiographie, mais il reste que la recollection de souvenirs personnels à la lecture du texte de Bev Sellars me semble à peu près immanquable au cours du processus de traduction.
Donc, pour ainsi dire, l’entreprise de traduction et de publication (révision bilingue/linguistique et collaboration autochtone) de ce récit autochtone féminin permet à l’auteure ainsi qu’à la traductrice de bénéficier d’une expérience émancipatrice : l’auteure, par le désir de libération de traumas grâce à l’acte d’écriture, et la traductrice, par cet exercice d’autoréflexion face aux éléments relatés, la probable reconnaissance de certaines blessures émotionnelles et son positionnement sur l’axe de pouvoir (dé)colonial. En fait, c’est ce qui s’est passé pour moi. Je me suis souvent retrouvée dans un espace de compassion et parfois de vulnérabilité ; il ne s’agissait plus d’un travail dont je pouvais me distancier complétement ; j’étais davantage investie dans cette interaction avec l’auteure, rendue possible grâce au texte. Ma capacité à ressentir cette compassion a fait en sorte que le positionnement sur l’axe de pouvoir (dé)colonial occupait de moins en moins de place dans mon expérience. Il s’agissait désormais d’un exercice d’émancipation – qui a contribué à des prises de conscience et à une guérison. Mon rôle outrepassait-il celui de « l’experte » langagière? Étais-je devenue à mon tour sujet de recherche?
Dans un contexte d’études universitaires sur les Maoris, qui peut être comparé aux études autochtones canadiennes en milieu universitaire, Linda Tuhiwai Smith décrit : « We have a history of people putting Maori under a microscope in the same way a scientist looks at an insect. The ones doing the looking are giving themselves the power to define. » (2012 : 61) En fait, plus je travaillais à cette traduction et moins je me situais dans cet espace d’analyse et d’observation, comme si le propos était trop sensible pour le traiter de façon entièrement rationnelle. En traduction littéraire, et particulièrement lorsqu’il est question du récit de vie, on ne peut travailler de façon objective comme c’est le cas dans les domaines de la traduction spécialisée et même générale.
Dès lors a débuté, en quelque sorte, l’« analyse », la « déconstruction » de mon intimité en tant qu’« Autre », malgré la distanciation provoquée par le travail intellectuel nécessaire à l’accomplissement du transfert linguistique. À ce stade, on pourrait affirmer que la force du texte, en termes de réception, résidait dans le fait que l’interaction avec l’auteure activait ma mémoire et faisait ressurgir des souvenirs – ainsi que les émotions associées à ces souvenirs (pas nécessairement toujours négatifs) – d’événements vécus par une personne de mon entourage, une connaissance ou par moi-même. Et, au-delà des souvenirs, j’étais désormais habitée en cours de travail par une forte compassion envers l’auteure et les autres personnes impliquées dans le récit. De plus, je crois que certains souvenirs et émotions font également surface lors de la traduction et à la lecture d’un texte comme celui de Bev Sellars en raison de sa façon très franche de raconter les événements traumatiques. À titre d’exemple, voici un passage « récapitulatif » et difficile tiré du texte de Bev Sellars, traduit vers le français :
Je ne savais pas de quelle manière gérer les situations où je n’étais pas à l’aise, alors je me retirais. Je ne pouvais pas me défendre. J’ai aussi souffert de nombreuses phobies pendant ma jeunesse. J’avais des attaques de panique si je pensais être en retard pour quoi que ce soit et lors de nouvelles situations sociales. Je ne pouvais recevoir le moindre compliment ou la moindre critique avec grâce. Je faisais des cauchemars régulièrement, j’ai dû dormir avec une lampe allumée jusqu’au début de la trentaine. Jusqu’à sa mort, mon frère Ray a aussi dormi avec une lumière. J’avais peur des espaces fermés, et tout particulièrement des ascenseurs. J’avais peur des hauteurs et de rester seule. Les migraines m’accompagnaient toujours. J’aimais la sensation de la faim et, à un moment, je suis devenue très maigre, presque anorexique. Pour tout dire, j’étais handicapée émotionnellement et socialement, limitée dans ma capacité à entrer en relation avec le monde.
Sellars, 1993 : 112, ma traduction
À ce moment, j’avançais toujours seule dans la traduction, et ce, sans collaborateur pendant quelques mois. Pour la première fois, je me retrouvais dans cet espace privé et intime avec le texte et ses propos. Le travail d’émancipation pour moi débutait alors de façon active mais modérée, car j’en étais également alors à planifier la suite : l’organisation d’une collaboration autochtone pour m’assurer qu’une terminologie adéquate soit utilisée dans la description des années passées au pensionnat et autres précisions culturelles qui demeuraient incertaines.
Heureusement, j’ai pu entrer en contact avec mon collaborateur autochtone, Alex Cheezo, travailleur social Anishnabe à Lac-Simon, traducteur et ancien pensionnaire autochtone. C’est à cet instant, lors d’une première rencontre avec lui, que l’interaction – orientée par le texte où d’ailleurs toute trace d’oralité avait été conservée – a pris la forme d’un dialogue, d’une « véritable » interaction. La collaboration de mon réviseur autochtone, que l’on pourrait également qualifier d’« Autre », a été fondamentale alors que des clarifications terminologiques ou conceptuelles étaient nécessaires[6]. Mais, au-delà des recherches terminologiques, ce qu’il m’importe de souligner dans le présent article, c’est la relation qui s’est développée entre lui et moi, une relation qui se définit d’ailleurs dans mon hypothèse. Il s’agit en effet d’une relationalité autoréflexive puisque, pour ma part, lors de mes rencontres virtuelles avec Alex Cheezo[7], je me voyais en constante évaluation de ma position en tant que chercheure/traductrice/traductologue ; je choisissais bien mes interventions et je pratiquais une écoute active. Dans ces échanges interculturels et collaboratifs, nous sommes vite passés au vif du sujet : la vie dans un pensionnat autochtone et ses répercussions. Malgré la distance qui les séparait, ces enfants autochtones devenus adultes, Bev et Alex, membres de nations différentes, situées à deux extrémités du pays, ont vécu une expérience du pensionnat où se partagent de nombreux points communs ; Alex me l’a confirmé. Ce sont ces similitudes dans l’expérience qui permettraient aux anciens et anciennes élèves de pensionnat autochtone de revisiter leurs souvenirs et mémoires à la lecture du texte, en anglais ou en français, pour faire de nouveau face à leurs blessures – intergénérationnelles – ou traumatismes, ce qui pourrait ainsi peut-être engendrer un processus de guérison[8]. Il s’agit là, en effet, de l’un des objectifs principaux de ce projet de traduction.
Je constate que cette similitude de l’expérience entre Bev et Alex, vécue à des milliers de kilomètres, répond aussi partiellement à l’un des objectifs de ma thèse, dont le but premier était de contribuer à amorcer un dialogue entre les Autochtones francophones et anglophones de nations différentes ; ce dialogue pourrait prendre la forme, en premier lieu, d’une compréhension de l’« Autre » et d’un lien qui pourrait se créer par la reconnaissance de nombreux points communs dans l’expérience. Voici le passage de la thèse qui exprime cet objectif :
a) Contribution à la création d’un dialogue entre Autochtones canadiens
J’aimerais contribuer à faire connaître l’histoire de Bev Sellars parmi les communautés autochtones francophones du pays. Par le fait même, j’espère que ma traduction permettra aux Autochtones francophones de prendre conscience de la similitude entre leur expérience du pensionnat catholique et celle des autres Premières Nations du pays dans d’autres pensionnats. […]
Effectuer ce rapprochement permettrait la création d’une empathie et d’une compréhension de l’expérience de l’Autre, et mettrait l’accent sur l’abus du pouvoir religieux. Ce qui était intolérable pour les Autochtones qui ont vécu en pensionnat, c’est que la maltraitance était augmentée en raison d’une discrimination raciale. Cette association partielle dans l’expérience permet aussi de mettre à jour une vision plus globale de la réalité coloniale du Canada contemporain et d’en identifier les acteurs principaux.
Théberge, 2019 : 3
Lors de ces rencontres avec Alex Cheezo, comme il a été mentionné précédemment, le propos est devenu rapidement somme toute intime, de par le partage d’une partie de son expérience au pensionnat (qui était d’ailleurs constituée, tout comme Bev, de quelques bons souvenirs entre ami.es) et la mention générale de la souffrance toujours ressentie par certains membres de la communauté de Lac-Simon en conséquence des blessures intergénérationnelles. J’étais alors, pour une deuxième fois, en mesure de mettre un visage sur ces événements de maltraitance relatés dans They Called Me Number One : le premier a été celui de Bev, et le deuxième, celui d’Alex. Malgré ma formation de traductrice et mon vouloir constant et bien ancré de pratiquer l’empathie rationnelle, je n’ai pu faire autrement qu’être profondément touchée par la nature de nos discussions et de porter en moi ces émotions lors du processus traductif.
C’est à ce moment que je me suis rendu compte de la pertinence de cet exercice de collaboration avec mon réviseur autochtone. Ce texte, l’histoire de Bev, a servi de catalyseur pour ce dialogue interculturel, intergénérationnel entre cet homme (d’environ 20 ans mon aîné) et moi. Je n’aurais peut-être jamais eu la chance de le rencontrer et d’avoir ces conversations enrichissantes avec lui n’eût été du courage de Bev Sellars de publier son histoire. Ce texte a également servi d’intermédiaire pour entamer un certain dialogue de guérison entre lui et moi. Ce récit de vie a fait sortir de l’oubli certaines blessures, et cela est vrai probablement davantage vrai – étant donné l’expérience relatée dans le texte – du côté de mon collaborateur. Il y avait interaction, interculturalité mais aussi une « déconstruction » des mémoires et d’une certaine intimité de l’Autre. En effet, je crois qu’il est justifié ici d’utiliser le mot « intimité » plutôt qu’« intersubjectivité », plus couramment utilisé en études culturelles, en études autochtones et en traductologie. Mais pourquoi cette nuance, ce choix?
L’étymologie du substantif « intime » tient à une évolution des plus intéressantes, notamment en raison du changement de sens que le mot a subi au cours du XVIIIe siècle. En voici l’explication tirée dans l’article « Intimé et lien intime », de Marie-Paule Chevalérias :
L’analyse étymologique de Intimität1, montre que ce terme est apparu au XIXe siècle. Il dérive de intim qui avait dès 1600, par son origine latine intimus, la signification d’ami confiant, c’est-à-dire d’ami dont on est sûr, en qui l’on a foi. Est contenue dans cette expression la particularité du lien à cet ami pour le sujet qui le désigne ainsi. Puis un glissement de sens au XVIIIe siècle a connoté intim de superlatif : est intim, ce qui est au plus profond, le plus intérieur, le plus en dedans, le plus familier. Ceci rejoint ce que nous dit Freud de heimlich en opposition à unheimlich, termes qu’il met en lien avec les idées d’étrangeté, de secrets contenus dans l’histoire, et que le refoulement tente habituellement de mettre à distance.
Chevalerias, 2003 : 14
Il est intéressant de noter ce glissement de sens au XVIIIe siècle, qui est d’ailleurs également mentionné par d’autres ouvrages de référence, dans lesquels on signale que le mot « intime » devient superlatif et revient à ce qu’il y a de plus intérieur, de plus profond chez une personne, sans oublier la mention antérieure de l’ami confiant, qui rappelle l’importance de tisser des liens affectifs entre collaborateurs. Et, quelle serait la nature de cet élément situé au plus profond de nous? Les définitions suivantes nous mèneraient peut-être vers une piste :
On peut lire à l’intérieur de cette définition tirée du Gaffinot, dictionnaire latin, que les mots « secret », « sanctuaire » et « coeur » sont mentionnés à deux, une et quatre reprises, respectivement, sans oublier encore une fois le mot « ami », qui représente la notion de l’amitié. Ces mentions voudraient-elles suggérer que l’utilisation du mot « intimité », plutôt qu’« intersubjectivité » (et peut-être même compassion au lieu d’empathie) tiendrait du domaine de l’affect, du coeur, plutôt que de l’intellect? Jusqu’alors, dans mon processus de traduction de They Called Me Number One vers Matricule « Numéro 1 » : secrets et survie dans un pensionnat autochtone, on aurait pu penser que seul l’intellect et le savoir-faire auraient pu accomplir le travail, mais j’avance qu’une telle entreprise tient de l’ordre de l’impossible, et ce, pour les deux raisons suivantes, brièvement mentionnées auparavant : la « durée » du processus traductif et le phénomène de la répétition. En effet, je devais alors entreprendre le travail de révision bilingue et linguistique…
Le processus de révision bilingue et linguistique
Puisqu’il s’agit d’un récit de vie, l’intimité « augmentée » de l’auteure a agi, une fois de plus, à titre de catalyseur. Revoyons le processus ensemble. Puisque cette traduction a fait partie de mon doctorat, j’ai révisé les six premiers chapitres de trois à quatre fois. Puis, pour les chapitres 7 à 14, sans oublier l’épilogue et les notes, qui, en quelque sorte, constituaient un chapitre supplémentaire, j’ai produit un bon premier jet de la traduction et effectué une révision linguistique sommaire pour ensuite entreprendre la collaboration avec ma réviseure, embauchée par mon université, qui aurait alors déjà procédé à une révision bilingue et linguistique. J’ai retravaillé le texte, et ce, à plus d’une reprise ; seule ou accompagnée de ma directrice de thèse, de ma réviseure et/ou de mon collaborateur autochtone. En effet, pour parvenir à compléter le transfert linguistique et la mise en pratique de la méthodologie décoloniale, j’ai dû me replonger dans le récit à de nombreuses reprises et le relire plusieurs fois, ce qui a fait en sorte que je suis entrée en contact encore et encore avec les maltraitances et les blessures vécues par Bev Sellars ou les autres survivants et survivantes de pensionnats autochtones.
De plus, immanquablement, cette révision bilingue avec ma réviseure, qui s’est tenue de façon virtuelle, a initié bon nombre de conversations entre nous, et a également fait remonter une multitude de souvenirs – de mémoires – partagés à voix haute ou non. Encore une fois, le texte a provoqué une interaction ; un dialogue supplémentaire dans mon cas. Pour donner un exemple rapide et concret, lorsque Bev Sellars parlait de Gram et de ses habitudes, ma réviseure et moi revoyions aussi nos grands-mères, et nous partagions quelques souvenirs. Nos témoignages étaient souvent émouvants et l’expérience de ces femmes, à plus d’un égard, similaire.
Grâce au texte, qu’elles aient été prononcées ou non, ces mémoires se sont manifestées sous forme de dialogue « extérieur » ou « intérieur » ; on ne pouvait s’y attarder trop longtemps, il fallait reprendre le travail, mais l’émotion était omniprésente et occupait un espace que l’on pourrait qualifier de sous-jacent à l’activité de transfert linguistique. Ainsi, nous avons ouvert une fenêtre sur notre intimité, en partageant des souvenirs mais aussi à travers certains silences. Le récit de vie de Bev Sellars a favorisé un engagement, le nôtre : nous, ces Autres, car le texte détient cette qualité de rejoindre ces espaces secrets. Nous étions alors davantage investies dans cette démarche de mettre en lumière le récit de Bev Sellars, et de le rendre accessible aux différentes communautés francophones, autochtones ou non. Quoi qu’il en soit, un commentaire qui revenait souvent lors de nos séances de révision faisait référence à la difficulté de traduire tous ces événements traumatiques, pour encore y revenir au cours de la révision bilingue, c’est-à-dire à la fois en anglais et en français. Alors que nous étions presque à la fin de la révision des notes, à la fin du récit, nous devions revoir une scène d’agression sexuelle subie par une jeune Autochtone. En vérité, le travail est alors devenu plutôt difficile[9], mais la conscience de l’importance de ce travail – de notre mission, si l’on veut – faisait passer les émotions au second plan même si ces dernières sont demeurées très présentes.
L’acte de performance que je souligne dans cet article – celui de traduire en laissant l’affect prendre une place importante dans l’activité linguistique – s’est répété comme je viens de le démontrer à de nombreuses occasions et par diverses personnes au cours de la traduction du récit de Bev Sellars et du travail de réflexion qui l’accompagne.
And by performativity we mean (following Judith Butler and others) not just consciousness performance, but the unconscious repetition and citation of gender and sexual norms. For it is through such repetition that those identities become naturalized and reified, as these scripts are reproduced on the surface of (and through the actions and gestures of) one’s own body
Rayter & McLeod, 2008 : 38-39
J’ose donc parler de performativité, pas seulement sur le plan linguistique, mais également sur le plan d’une approche empreinte d’empathie et de compassion envers le texte. Une compassion envers l’expérience féminine et masculine qui devient « naturelle » avec le temps et la répétition, et qui a fait graduellement partie intégrante de la production de Matricule « Numéro 1 » : secrets et survie dans un pensionnat autochtone. Cette performativité – qui se situe tant au niveau linguistique qu’au niveau des émotions – devient presque une stratégie de traduction dans le cas d’un récit de vie : elle a été mise en pratique au cours de la traduction, de la révision et des dialogues émancipateurs, et ce, dans la durée et avec répétition.
La « déconstruction » des intimités
L’approche décoloniale utilisée de façon omniprésente tout au long de la traduction a eu pour effet de prioriser l’utilisation d’une rédaction épicène autant que possible – dichotomie féminin/masculin, vers une neutralité – et une explicitation autochtone de certains concepts mentionnés dans le texte – dichotomie colonisateur/colonisé, grâce à la collaboration d’Alex Cheezo. Ces dichotomies sont intéressantes à observer, car le traitement qui en a été fait diffère, dans le degré de neutralité, en particulier. Il est clair que la dichotomie colonisateur/colonisé a été traitée de manière à tendre vers la variable « colonisé » étant donné l’intention de produire une traduction décoloniale/autochtoniste, appuyée par les suggestions et explications d’Alex Cheezo. De plus, le fait de travailler le texte à plusieurs reprises, dans le cadre de quatre étapes, lors du premier jet de la traduction, de la révision bilingue et linguistique, puis de la révision collaborative, a déconstruit le discours, le récit, et donc l’intimité de l’auteure puisque chaque mot a été choisi et étudié, après moultes réflexions, que ce soit relativement à la méthodologie décoloniale, à la musicalité du texte – au style, à la parole – ou au niveau de l’émotion.
L’acte de traduire They Called Me Number One en français s’est récemment inscrit dans le mouvement d’éveil national à la maltraitance portée envers les enfants qui ont fréquenté les pensionnats autochtones et à la disparition inexpliquée de certains d’entre eux ; des disparitions qui ont d’ailleurs été mentionnées au tout début du récit de Bev Sellars. Puis, malheureusement, le 25 février dernier, un article intitulé « 93 potential burial sites found near former B.C. residential school », publié sur le site Internet de la CBC, annonçait la macabre découverte de sépultures « potentielles » – et anonymes – d’enfants ayant fréquentés la Mission Saint-Joseph. Sur les 470 hectares identifiés comme étant d’intérêt à la découverte de sépultures anonymes, seulement 14 ont été fouillés jusqu’à présent, au cours de la première phase des recherches. Bev Sellars a d’ailleurs été citée dans cet article. Elle y affirme : « We need to make sure that Canada knows about the atrocities that were made at these schools. » (dans Lindsay et Watson, 2022).
En effet, de telles divulgations s’inscrivent dans la volonté d’informer, notamment, tout comme les appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada soulignent l’importance du dialogue et de la collaboration entre les différentes nations canadiennes et le recours aux arts pour y parvenir. L’appel à l’action 83 du sixième volume du rapport final de la Commission, intitulé La Réconciliation, en témoigne :
Nous demandons au Conseil des arts du Canada d’établir, en tant que priorité de financement, une stratégie visant à aider les artistes autochtones et non autochtones à entreprendre des projets de collaboration et à produire des oeuvres qui contribueront au processus de réconciliation.
Commission de vérité et réconciliation, 2015, vol. 6, emplacement Kindle 5973-5974
Il est à souhaiter que ce recours aux arts mène à une réelle compassion, qui donnerait aux émotions la place qui leur revient lors de la production de traductions décoloniales – collaboratives – de récits de femmes autochtones. Des textes qui demandent un courage incommensurable : écrire et surtout publier, un don de soi pour la collectivité, un acte qui vient du coeur.
Appendices
Note biographique
Sarah Théberge est professeure adjointe et directrice du Département d’études françaises et québécoises à l’Université Bishop’s. Elle est membre du Collectif de recherche sur la continuité des apprentissages en lecture et en écriture et membre du Centre de recherche collaborative autochtone – Atalwijokadimek. Ses recherches portent sur l’approche plurilingue en acquisition du français langue additionnelle, la traduction de récits de vie autochtone et les stratégies de traduction décoloniales / autochtonistes et inclusives.
Notes
-
[1]
Le titre en français : Matricule « Numéro 1 » : secrets et survie dans un pensionnat autochtone.
-
[2]
Voir ma thèse soutenue à l’Université de Sherbrooke pour une explication de la méthodologie décoloniale, spécifiquement pour la traduction de They Called Me Number One (https://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/16346/Theberge_Sarah_PhD_2019.pdf?sequence=5&isAllowed=y).
-
[3]
Pour faire suite au travail de Françoise Wuilmart, voir les références dans la bibliographie.
-
[4]
J’affirme cela sans pour autant vouloir minimiser l’importance d’une appartenance à une nation autochtone et/ou la pertinence du savoir ancestral lorsqu’il est question de procéder à l’analyse de l’interaction entre deux ou plusieurs personnes autochtones et allochtones. L’idée de s’en remettre à la réciprocité du discours me paraît intéressante dans la mesure où deux personnes se retrouvent en situation de communication.
-
[5]
Je n’ai pas vécu cette expérience, puisque le pensionnat que j’ai fréquenté au début des années 1990 était tenu par les Ursulines, mais ne se destinait pas aux élèves autochtones.
-
[6]
Ce qui fera l’objet d’un autre article, où les exemples de difficulté de traduction seront analysés en détail.
-
[7]
Voir la bibliographie pour les dates et la durée de ces rencontres.
-
[8]
Ici, il ne faut pas négliger les maux physiques chroniques dont souffrent des générations d’Autochtones, mentionnées dans le récit, et qui témoignent des rituels chrétiens ainsi que des punitions corporelles imposées aux enfants. Le fait que ces blessures physiques soient ressenties tout au long d’une vie confirme leur gravité, tant sur le plan physique que psychologique.
-
[9]
Évidemment, nous étions bien conscientes qu’il est beaucoup moins pénible de traduire ce genre d’événements que de les vivre dans la réalité.
Bibliographie
- BAKHTINE, Mikhaïl (1978), Esthétique et théorie du roman, trad. D. Olivier, Paris, Gallimard.
- BENJAMIN, Jessica (1998), Shadow of the Other, Intersubjectivity and Gender in Psychoanalysis, New York, Routledge.
- BERMAN, Antoine (1999), La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain, Paris, Seuil.
- BUTLER, Judith (1990), Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, Londres, Routledge.
- CHAKRAVORTY SPIVAK, Gayatri (1988), « Subaltern Studies: Deconstructing Historiography », dans Guha, Ranajit [et al.] (dir.), Selected Subaltern Studies, Oxford, Oxford University Press.
- CHEVALÉRIAS, Marie-Paule (2003), « Intimité et lien intime », Le Divan familial, vol. 11, no 2 : 11-23.
- COLLOMBAT, Isabelle (2010), « L’empathie rationnelle comme posture de traduction », Translation and Impersonation, vol. 1, no 3 : 56-70 [en ligne], https://hal-univ-paris3.archives-ouvertes.fr/hal-01402655/document (consulté le 2 juin 2019).
- COMMISSION DE VÉRITÉ ET RÉCONCILIATION DU CANADA (2015), « Pensionnats du Canada : La réconciliation », Rapport final de la commission de vérité et de réconciliation du Canada, [Kindle], vol. 6, emplacement Kindle 5973-5974.
- DICTIONNAIRE GAFFIOT (1934), latin-français : 848, [en ligne], https://www.lexilogos.com/latin/gaffiot.php?q=intimit%C3%A9 (consulté le 1er mars 2022).
- EIGENBROD, Renate (2005), Travelling knowledges: positioning the im/migrant reader of aboriginal literatures in Canada, Winnipeg, University of Manitoba Press.
- LECONTE, Marie (2021), « La traductrice non autochtone et l’éthique du traduire : que dit la recherche autochtone? », Colloque : Écrire et (auto-)traduire des langues autochtones : engagement et créativité, ESIT, La Sorbonne-Nouvelle, 23 juin.
- LINDSAY, Bethany et Bridgette WATSON (2022), « 93 potential burial sites found near former B.C. residential school », CBC News [en ligne], https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/williams-lake-st-josephs-residential-school-1.6326467 (consulté le 20 mai 2022).
- MACÉ, Gérard (2007), Je suis l’autre, Paris, Gallimard, coll. « Le Cabinet des Lettrés ».
- RAYTER, Scott [et al.] (2008), Queer CanLit: Canadian Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) Literature in English, Toronto, Thomas Fisher Rare Book Library.
- SELLARS, Bev (2013), They Called Me Number One: Secrets and Survival at an Indian Residential School, Vancouver, Talonbooks.
- SHERBERT, Garry (2006), « Introduction », dans Garry SHERBERT, Annie GÉRIN et Sheila PETTY (dir.), Canadian Cultural Poesis, Essays on Canadian Culture, Waterloo, Wilfrid Laurier University Press : 1-23.
- THÉBERGE, Sarah (2019), « Pistes décoloniales pour la traduction de récits autochtones : l’exemple de They Called Me Number One de Bev Sellars », thèse de doctorat, Université de Sherbrooke [en ligne], https://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/16346/Theberge_Sarah_PhD_2019.pdf?sequence=5&isAllowed=y (consulté le 19 juillet 2022).
- THÉBERGE, Sarah (2021), Entretien avec Alex Cheezo [en ligne, plateforme Zoom], 22 janvier, 47 min.
- THÉBERGE, Sarah (2021b). Entretien avec Alex Cheezo [en ligne, plateforme Zoom], 6 février, 55 min.
- THÉBERGE, Sarah (2021c). Entretien avec Alex Cheezo [en ligne, plateforme Zoom], 20 février, 60 min.
- THÉBERGE, Sarah (2021d). Entretien avec Alex Cheezo [en ligne, plateforme Zoom], 24 mars, 52 min.
- THÉBERGE, Sarah (2021e). Entretien avec Alex Cheezo [en ligne, plateforme Zoom], 13 mai, 40 min.
- THÉBERGE, Sarah (2021f). Entretien avec Alex Cheezo [en ligne, plateforme Zoom], 10 juin, 57 min.
- THÉBERGE, Sarah (2022). Entretien avec Alex Cheezo [en ligne, plateforme Zoom], 12 janvier, 70 min.
- TODOROV, Tzvetan (1981), Mikhaïl Bakhtine. Le Principe dialogique, suivi de Écrits du Cercle de Bakhtine, Paris, Seuil, coll. « Poétique ».
- TUHIWAI SMITH, Linda (2012), Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples, 2e édition, Londres, Zed Books Ltd.
- VINAY, J. P. et J. DARBELNET (1964), Stylistique comparée du français et de l’anglais, Montréal, Beauchemin.
- WUILMART, Françoise (1984), « L’empathie dans la traduction littéraire », Équivalences, vol. 15, no 1 : 13-20.
- WUILMART, Françoise (1990), « Le traducteur littéraire : un marieur empathique de cultures », Meta, vol. 35, no 1 : 236-242.

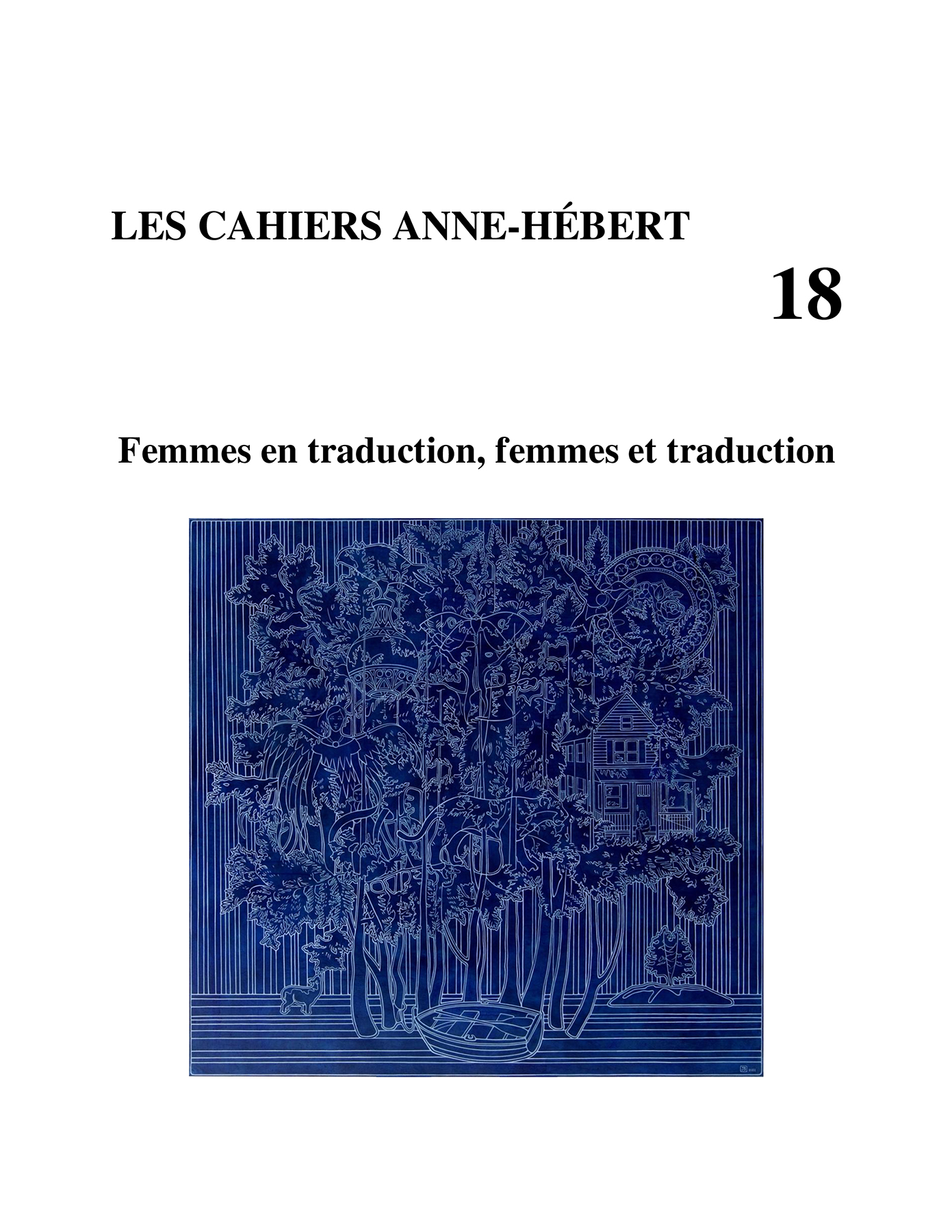


 10.7202/004621ar
10.7202/004621ar