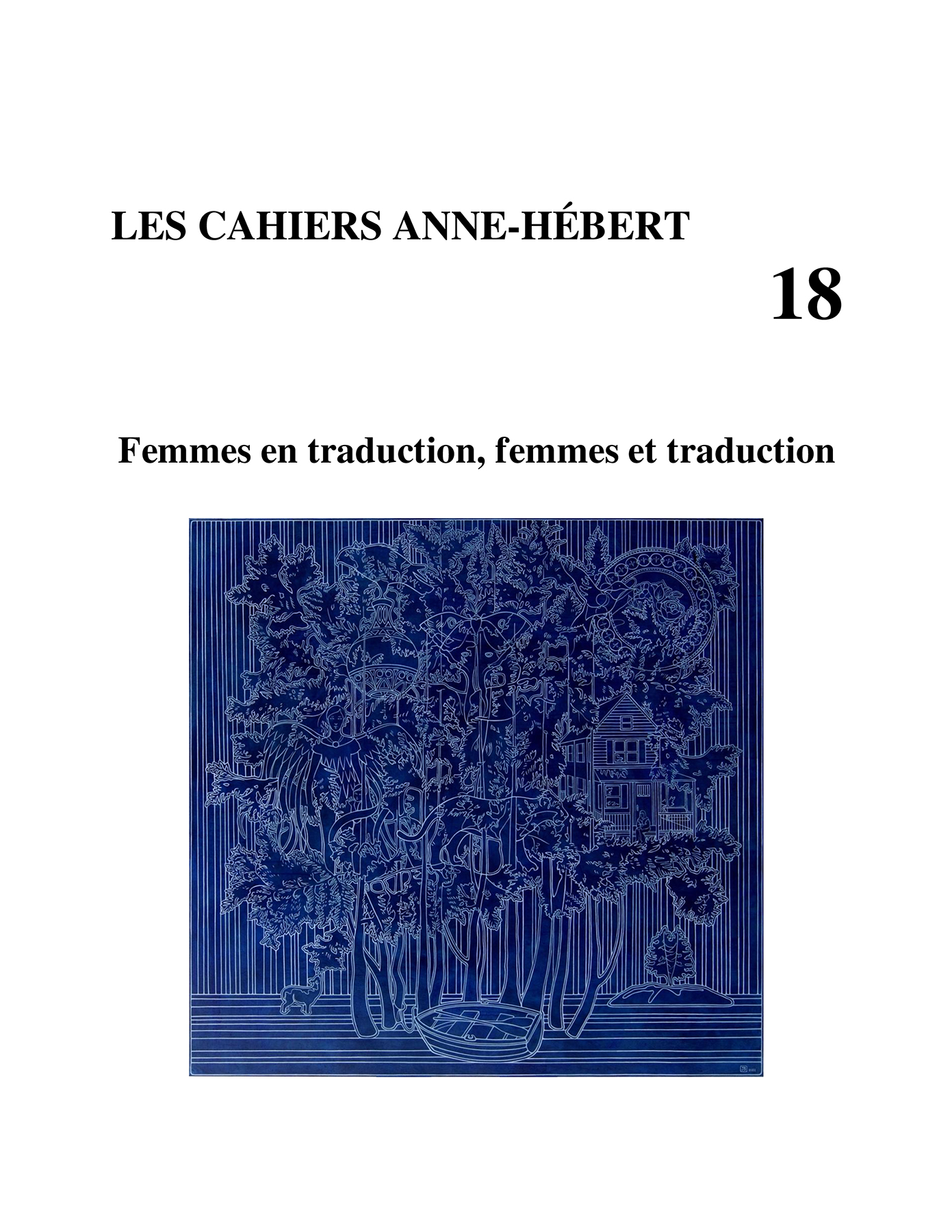Abstracts
Résumé
Il s’agit d’un essai libre sur les femmes dans le monde de la traduction, réflexion menée à partir de la première grande traductrice littéraire française, Anne Dacier, helléniste de renom. Les mécanismes d’amoindrissement et d’oubli qui ont régi sa trajectoire n’ont pas disparu, comme le montre l’étude du traitement médiatique actuel des traductrices, des disparités entre le nombre de textes d’hommes et de femmes traduits, des métaphores utilisées pour évoquer l’acte de traduire et de la situation relative des traductrices dans le monde. L’article associe ce questionnement sur le genre à une brève réflexion sur le racisme, la situation (post-)coloniale et d’autres dimensions de l’effacement avant de boucler la boucle en évoquant la traduction des oeuvres de l’Antiquité grecque, d’Anne Dacier à Emily Wilson.
Mots-clés :
- Femmes et traduction littéraire,
- sexisme,
- langue,
- Anne Dacier
Article body
Ceci est une histoire d’amour : j’aime Anne Lefèvre Dacier (1645[1]-1720)[2]. Latiniste et helléniste, elle crée un style de traduction novateur, nettement plus près des textes originaux que le travail de ses prédécesseurs et contemporains. C’est pour elle qu’on aurait forgé la forme féminine « traductrice », dans un éloge qu’on lui consacre (Garnier, 2002 : 15) : mis en italiques et en doute (« s’il est permis de hasarder ce terme »), le mot s’imposera, on le sait, par la suite. Elle traduit Sappho (je rêve!), Plaute, Térence, Aristophane et, surtout, Homère, qu’elle défend avec fougue contre les accusations de grossièreté et d’immoralité qui ternissent alors sa réputation. De son vivant, elle est largement célébrée, saluée par Ménage, par exemple, comme « la femme la plus savante qui soit et qui fût jamais[3] ». Ses Iliade et Odyssée connaissent de multiples éditions à son époque et jusqu’au seuil de la nôtre (dernière impression 1948)[4].
Qui la connaît, aujourd’hui ?
Tout en perpétuant sa mémoire, l’article de Bernard Croquette dans l’Encyclopédie Universalis illustre et réactualise certains mécanismes de rabaissement des créatrices. D’abord, Croquette définit Anne Dacier en fonction des hommes de son entourage : « Fille de l’érudit français Tanneguy Lefèvre et femme de l’érudit André Dacier – elle-même célèbre érudite ». Après une brève description de son travail, l’article se termine par l’éloge de sa personnalité modeste :
« Elle n’était savante, écrit Saint-Simon, que dans son cabinet ou avec les savantes ; partout ailleurs simple, unie, avec de l’esprit, agréable dans la conversation, où on ne se serait pas douté qu’elle sût rien de plus que les femmes les plus ordinaires. » On appréciera à sa juste valeur cet éloge adressé à une femme qui, à vingt et un ans (trois ans après la première représentation des Femmes savantes), avait déjà traduit Florus en français, Callimaque en latin
Croquette, sans date
Une femme cesse d’être « agréable » si elle étale son savoir en public (la mention, assez gratuite, des Femmes savantes de Molière va dans ce sens), alors que personne ne songerait à féliciter un érudit de se confondre dans les salons avec les hommes « les plus ordinaires ». Croquette consacre huit des vingt-deux lignes de son article à la personnalité d’Anne Dacier et à ses liens avec les hommes, et ne la cite jamais, nous privant ainsi de sa voix (son article sur le rival de Dacier, Houdar de la Motte, qu’on verra à l’instant, adopte l’approche inverse : il ne dit rien de la vie privée de l’homme, mais le cite d’abondance). Croquette trouve enfin qu’Anne Dacier « ne manqu[e] pas d’audace » en se proposant de traduire Aristophane et Térence. Même la traduction, pour une femme, est osée.
Plus inacceptable encore pour beaucoup d’hommes sera la polémique qu’engagera Anne Dacier contre un critique et dramaturge, Antoine Houdar de la Motte. En 1714, celui-ci fait grand bruit dans le monde des lettres en présentant sa « traduction » de L’Iliade, réalisée à partir de la traduction d’Anne Dacier, qu’il prétend corriger et améliorer (rappelons qu’il ignorait le grec et qu’elle était une helléniste émérite[5]). Une critique moderne, Éliane Itti, juge la version de Houdar de la Motte « complètement dénaturée » (Itti, 2015 : para. 23). Comme l’affirme Itti après étude des réactions des contemporains, Anne Dacier aurait eu un grand tort, son manque de discrétion féminine : « De toute évidence, un savant de sexe masculin, s’il est offensé, peut se livrer à des écarts de langage, tandis qu’une savante doit respecter les règles établies par des hommes pour les femmes, ou se taire à jamais » (Itti, 2015 : para. 35). Voici un exemple du style d’Anne Dacier, vigoureuse combattante du monde des lettres (ici et ailleurs, je reprends l’orthographe originelle) : « Je ne sçay pas dans quelle Escole M. de la M. a appris à raisonner de cette maniere, si on la connoissoit il faudroit la fermer, car elle est tres dangereuse. » (cité dans Itti, 2015 : para. 30)
Dans son « Discours sur Homère », Houdar de la Motte défend son travail ainsi, brillant par son absence de modestie :
C’est par ces raisons que j’ai réduit les vingt-quatre livres de l’Iliade en douze, qui sont même de beaucoup plus courts que ceux d’Homère. On croirait d’abord que ce ne peut être qu’aux dépens de bien des choses importantes que j’ai fait cette réduction ; mais si l’on considère que les répétitions, à bien compter, emportent plus de la sixième partie de l’Iliade, que le détail anatomique des blessures, & les longues harangues des combattants, en emportent encore bien davantage, on jugera bien qu’il m’a été facile d’abréger, sans qu’il en coûtât rien à l’action principale. Je me flatte de l’avoir fait, & je crois même avoir rapproché les parties essentielles de l’action, de manière qu’elles forment dans mon abrégé, un tout plus régulier & plus sensible que dans Homère.
Que le poète grec, ce médiocre, s’incline : le grand Houdar de la Motte « se flatte » de le surpasser. En contraste, Anne Dacier ne se vante pas, ne se met pas en avant ; au lieu de refaire Homère, elle propose de s’en rapprocher :
Quand je parle d’une traduction en prose, je ne veux point parler d’une traduction servile ; je parle d’une traduction généreuse & noble, qui en s’attachant fortement aux idées de son original, cherche les beautés de sa langue, & rend ses images sans compter les mots. La première, par une fidélité trop scrupuleuse, devient très-infidelle, car pour conserver la lettre, elle ruine l’esprit, ce qui est l’ouvrage d’un froid et stérile génie ; au lieu que l’autre, en ne s’attachant principalement qu’à conserver l’esprit, ne laisse pas, dans ses plus grandes libertés, de conserver aussi la lettre ; & par ses traits hardis, mais toujours vrais, elle devient non seulement la fidelle copie de son original, mais un second original même.
citée dans d’Alq, 1983
Le langage n’est pas le nôtre, mais cette esthétique, qui est aussi une éthique, cette vision de la traduction comme une oeuvre au sens fort (« un second original »), a fini par l’emporter. Bien qu’elle fasse des concessions au goût de son époque – n’oublions pas que son but est de réhabiliter Homère, vu par ses contemporains comme un auteur violent et vulgaire –, sa traduction, « visionnaire » (Garnier, 2002 : 35), est d’une fidélité remarquable par rapport aux versions libres, voire aux contrefaçons, qu’on connaît alors. Garnier y voit « la traduction la plus fidèle qui ait été publiée d’Homère au XVIIe siècle et il ne pouvait pas s’en publier alors de plus fidèle » (Garnier, 2002 : 37).
Dans un compte rendu de la réédition en 2006, par la Société de littératures classiques, de L’Iliade par Houdar de la Motte (qui, répétons-le, ne connaissait pas le grec et a pris comme point de départ la traduction d’Anne Dacier en changeant, comme il le dit encore dans sa Préface, « ce que j’y trouvais de désagréable »), on relève cette affirmation consternante : « L’éditeur a le mérite de réhabiliter La Motte en montrant combien il est moderne, lui qui ne se contente pas de traduire, à l’instar de Mme Dacier, mais préfère procéder à une réécriture de l’oeuvre d’Homère […] qui répond aux aspirations et aux attentes du public cultivé du siècle de Louis XIV » (Foulon, 2008). « Se contenter de traduire »? Le mépris envers la traduction, connotée comme féminine et servile, ainsi qu’envers les traductrices, saute aux yeux ici. Et en quoi adapter une oeuvre pour la rendre conforme aux attentes du public est-il un geste créateur ou novateur, supérieur à celui de produire un langage nouveau comme le fait Anne Dacier? Cette deuxième Querelle des Anciens et des Modernes est un exemple précoce de manipulation des images médiatiques : Anne Dacier, pourtant classée parmi les « Anciens » en raison de son admiration pour la littérature gréco-romaine classique, est nettement plus moderne, par son respect du texte d’origine, qu’un Houdar de la Motte. L’Histoire lui a donné raison ; l’Histoire l’a aussi complètement effacée. Houdar de la Motte est oublié aussi, mais Anne Dacier ne figure pas, comme elle le mériterait, parmi les pères fondateurs (sic) de la traduction.
•
Avant de quitter à contre-coeur Anne Dacier, je propose deux extraits de L’Anthologie féminine de « Madame Louise d’Alq » (1893) qui illustrent à merveille la tension entre féminité et connaissance, autant chez la conférencière que chez son sujet :
Mme Dacier est au XVIIe siècle ce que fut Christine de Pisan au XIVe : femme de lettres dans le sens propre du mot, sérieuse, instruite, plus même, savante, ce qui ne l’empêcha pas d’être, comme sa devancière, une vertueuse épouse, une tendre et excellente mère de famille.
Homère était son poète de prédilection. La Mothe eut la prétention de traduire l’Iliade sans connaître un mot de grec, en l’arrangeant et la raccourcissant, sous le prétexte d’en rendre la lecture plus agréable, ce qui lui attira la risée des savants, tout en lui valant une pension de huit cents livres ; outrée de ce crime littéraire, Mme Dacier, avec une indignation toute virile, écrivit comme réfutation son très célèbre ouvrage : les Causes de la corruption du goût, auquel La Mothe riposta par quelques réflexions spirituelles sur la critique ; ce qui fit dire aux témoins de cette lutte littéraire que La Mothe avait discuté en « femme spirituelle » et Mme Dacier en « homme savant ».
d’Alq, 1983
Femme de lettres, mais excellente épouse et mère, femme savante, mais aussi vertueuse : l’équilibre est délicat, le public doit être rassuré. Cependant, « Madame Louise d’Alq », par son ironie cinglante, par sa fermeté et son aisance, fait preuve elle aussi d’une vigueur « toute virile », selon les critères de l’époque. Son dernier commentaire sur la traductrice en « homme savant » explique sans doute à quel point Anne Dacier était menaçante et devait être reléguée à l’oubli.
•
Si j’ai insisté sur Anne Dacier, c’est parce que je suis grisée par ce nouvel amour, mais aussi parce que son cas illustre le rôle pionnier que des femmes ont joué dans l’histoire de la traduction et la persistance des préjugés à leur sujet. Fille de, femme de… Les femmes existent « par rapport à », elles sont secondaires. Un silence modeste rehausse leur valeur, une prise de parole ferme ternit leur réputation. Au XIXe siècle, Stendhal écrira encore que les femmes auraient tort de vouloir édifier une oeuvre propre, mais qu’une veuve méritante, soucieuse de faire vivre ses fils, peut s’adonner sans honte à la traduction[6]. Prêter ses mots à d’autres, en somme (« se contenter de traduire », disait Foulon), sans tenir un discours propre ; la traduction est vue comme service et soutien, comme moyen de faire rayonner les grandes oeuvres, qui – il va sans dire – sont le fait des grands hommes. Le domaine est également théorisé par les grands hommes, même aujourd’hui : à titre d’exemple, l’anthologie de Translation Studies publiée par Lawrence Venuti comprend 27 hommes et cinq femmes dans l’édition de 2004. L’édition révisée de 2012 comporte encore 27 hommes et… quatre femmes[7]! En somme, l’histoire de la traduction, jusqu’à tout récemment, est l’histoire d’hommes blancs bien nantis se traduisant entre eux ou traduits par des femmes.
•
Trois cents ans nous séparent de la mort d’Anne Dacier en 1720. Les choses ont bien changé, et pourtant… Voyons un article du Figaro[8] qui fait l’éloge de la traduction littéraire comme acte de création. Au premier regard, il offre une parité admirable : deux traductrices et deux traducteurs y sont portraiturés. Mais l’apparente égalité disparaît vite : le traducteur, déclare d’entrée de jeu Anthony Palou, « est l’homme de l’ombre, celui qui met ses pas dans ceux de l’écrivain » (je souligne, sidérée). Et il enchaîne avec les deux traducteurs qui, de fait, sont des hommes, des hommes qu’il hisse immédiatement au rang d’écrivains. Bryce Matthieussent « est une marque, un label de qualité » ; il « fait depuis longtemps autorité dans le domaine américain des lettres françaises ». Quant à Claro, le « nouveau phénomène de la traduction anglais-français est un écrivain [qui] renoue avec cette tradition d’écrivains traducteurs qui va de Baudelaire à Claudel en passant par Boris Vian, Vialatte ou Sébastien Japrisot ». Sa dernière traduction, du « livre-culte » de William Gass, constitue « un exploit sportif » admirable (notons au passage l’équivalence entre grande traduction et virilité).
Valoriser la traduction, quoi de mieux? Des stars, des maîtres, de grands sportifs, voilà qui nous change de l’anonymat habituel. Quand on en arrive aux femmes, le ton se transforme. D’Anouk Neuhoff, on apprend qu’elle « se pose d’emblée en “cancre” de la bande. Elle porte son humilité en écharpe et n’a jamais eu la prétention de traduire Finnegans Wake, de James Joyce, ou autres Cantos, d’Ezra Pound. » D’Anne Dacier à nos jours, le trope de l’effacement féminin demeure, voire s’est accentué : Neuhoff est même plus humble, puisqu’Anne Dacier s’est bel et bien mesurée aux grands maîtres de l’Antiquité. Neuhoff précise : « En traduction, n’est pas Baudelaire qui veut. La “re-création” est une chose que je laisse à d’autres, plus audacieux... » La lignée des grands hommes demeure ininterrompue ; là où Neuhoff s’exclut, mais du même coup raille au passage ceux qui se confondent avec Baudelaire, Palou prend son affirmation au pied de la lettre et en profite pour rehausser l’image de Claro qui, lui, a cette audace heureuse.
Enfin, d’Aline Schulman – qui, depuis les années 1970, a bâti une grande oeuvre de traductrice et qui a publié de la fiction –, on apprend ceci :
Aline Schulman est connue dans la profession depuis sa traduction du Quichotte [1997], qui, désormais, fait autorité – même en Espagne! Il fallait un sacré courage – culot? – pour s’attaquer à un tel mythe littéraire. Elle se souvient du jour où les Éditions du Seuil lui ont proposé ce chantier colossal : J’ai accepté avec réticence. J’ai commencé par traduire la deuxième partie parce que je ne pouvais pas me résoudre à traduire la toute première phrase du livre connue de tous : « En un lugar de la Mancha »...
Curieux mélange d’« autorité » et de doute de soi, ce passage confère plus de prestige à Aline Schulman qu’à Anouk Neuhoff (la première traduit presque exclusivement des hommes, la seconde beaucoup de femmes, différence qui n’est pas innocente), mais bien moins qu’aux deux hommes. « Audace » d’Anne Dacier, « culot » (plutôt que « courage ») d’Aline Schulman, « humilité » chez Anouk Neuhoff : qu’elle s’affirme ou qu’elle s’efface, la posture de la traductrice la disqualifie.
Le « label de qualité » et le « nouveau phénomène » contre le « cancre » et la « réticente » ; l’article du Figaro, sous prétexte de célébrer quatre personnes, crée une hiérarchie artiste/artisane qui joue en faveur des hommes. Les dichotomies – se fier à son flair/accéder avec hésitation aux demandes des autres, croire en soi/douter de soi ou, comme dans le cas d’Anne Dacier, recréer/« se contenter de traduire » – sont claires : eux, écrivains inscrits dans une tradition prestigieuse ; elles, tâcheronnes isolées.
À part les quatre personnes dont le travail est à l’honneur, le texte de Palou mentionne trente-trois hommes et quatre femmes (deux traductrices et deux autrices traduites par Anouk Neuhoff). Malgré l’impression d’égalité initiale, le monde des lettres – y compris celui de la traduction – demeure donc essentiellement masculin. Et les femmes restent dans la modestie (ou ont du « culot » – et non du courage – quand elles osent une grande entreprise), la prudence, l’autodépréciation… Elles se placent d’emblée, ou on les place – en retenant tel propos plutôt que tel autre – au second rang. Imaginez l’importance historique relative qu’on donnera à chacun de ces artisans de la traduction dans trente ou dans trois cents ans, si on se base sur des articles comme celui de Palou.
Je n’ai pas cherché un article sexiste pour étayer mon propos ; ravie d’être tombée, parmi les textes journalistiques consacrés à l’art de traduire, sur un reportage où les traductrices étaient aussi présentes que les traducteurs, j’ai rapidement déchanté. À trois siècles d’intervalle, on reconduit les mêmes tropes que du temps d’Anne Dacier : grandeur masculine, modestie féminine. Les femmes ont beau avoir des connaissances, elles n’accèdent pas aux mêmes hauteurs que leurs collègues masculins, et le monde de la traduction, et surtout celui des personnes traduites, demeure masculin.
•
Autre exemple, tout récent, de cette fameuse modestie féminine : Marie-Louise, la fille d’Amélie Audiberti, première traductrice de 1984 (une nouvelle traduction, de Josée Kamoun, est parue en 2018), affirme que sa mère « était “une traductrice idéale”, c’est-à-dire que non contente d’être invisible de nature, elle s’en satisfaisait absolument, elle était “extrêmement discrète et n’avait aucun besoin de reconnaissance”[9]. » Celle qui a été capable de donner une traduction qui a duré près de soixante-dix ans est même décrite comme une « “petite main grattant le papier dans l’ombre de son mari et du géant Orwell” ». « Elle tapait très très bien, cela faisait l’admiration de mon père », se rappelle encore Marie-Louise Audiberti. Anne Dacier jouissait de plus de retentissement. Là où la fille évoque avec tendresse les mots et l’attitude de la mère, la postérité tranche, cruelle : l’image de la petite souris sans revendication aucune rabaisse, voire efface les femmes comme intellectuelles et comme créatrices.
Si les traductrices ne s’effacent pas d’emblée, on les force parfois à la modestie. La traductrice française Carine Chichereau (Les Imposteurs, 2018) raconte l’histoire suivante, survenue en 2017 : lors de la remise d’un prix in absentia à l’une des autrices qu’elle a traduites, elle a lu un discours d’acceptation de la romancière qui, dit-elle, « se terminait par des propos très élogieux à mon égard. Quand j’ai eu terminé de lire, devant toute l’assemblée, Patrick Poivre-d’Arvor [président du jury] m’a lancé : “C’est vous qui l’avez rajouté, ça ?” Je me suis demandé si j’avais mérité cette bonne blague parce que j’étais une femme ou bien une “simple” traductrice… » Un homme chargé de lire le même texte n’aurait sans doute pas eu droit à une telle accusation, à cette humiliation sous couvert d’humour ; l’incident offre une illustration concrète de la dévalorisation conjointe du féminin et de la traduction.
•
La traduction est-elle dévalorisée parce qu’elle est pratiquée par des femmes ou les femmes la pratiquent-elles parce qu’elle est dévalorisée? Une longue tradition occidentale associe textes traduits et femmes, de manière peu glorieuse pour les deux. Les oeuvres adaptées aux normes littéraires du pays d’arrivée au point d’en être dénaturées portent depuis longtemps le nom de « belles infidèles ». D’où des mots d’esprit sans fin du style « La traduction est comme une femme. Si elle est belle, elle n’est pas fidèle. Si elle est fidèle, elle n’est pas belle. » Lori Chamberlain (1988) a montré combien, au cours des siècles, un modèle fondé sur la paternité des textes et sur l’autorité masculine a donné lieu à une hiérarchie genrée : l’original est masculin, la traduction féminine ; une mauvaise traduction « émascule » l’original et le prive de sa puissance et de son autorité viriles. La traduction est connotée comme féminine et donc secondaire, même quand elle est pratiquée par un homme. Cette rhétorique perdure, comme en témoignent deux exemples assez récents.
Le premier est attribuable à Dieter Hornig, lors du colloque sur la traduction de la Société des gens de lettres de France : « Si à la suite des Belles infidèles, nous filons la métaphore, l’auteur serait le mari, l’oeuvre l’épouse, le traducteur l’amant, la scène du traduire étant une scène oedipienne, riche en métaphores sexuelles » (Hornig, 2011). Penser la traduction « en métaphores sexuelles », on le voit, c’est aussi la penser en termes d’une hiérarchie sexiste. Le texte-épouse — aucune agentivité féminine n’est imaginable ici – est l’enjeu d’une lutte entre hommes, et les femmes sont évacuées non seulement comme autrices, mais aussi comme traductrices, alors qu’on sait au contraire que la profession est largement féminine. Mais voilà, l’Art, la Création, toutes ces belles abstractions à majuscules, sont masculines. Autre exemple, plus récent encore, plus absurde et plus offensant, tiré d’un livre de Carlos Battista : « Tout traducteur est une dame qui reçoit la semence de monsieur l’original pour mettre au monde cet enfant métis d’autant plus légitime qu’il sera le portrait de son père. » (2014 : 19). Par où commencer? Par le fou rire ou la rage folle? Cette déclaration est un beau charabia transphobe (les identités de genre ne doivent tout de même pas se mêler), homophobe (il faut une dame pour recevoir cette précieuse semence), raciste (l’enfant « métis » et donc peut-être illégitime) et incroyablement sexiste, sans parler du fait qu’elle ne nous apprend absolument rien sur la traduction. L’original est un homme riche en fluide séminal, la personne qui fait le passage est aussi un homme (« tout traducteur »), mais un homme « féminisé » (traduire, c’est se faire ensemencer et concevoir un enfant). Les femmes sont éliminées et comme autrices, et comme traductrices, elles ne sont là que comme une sorte d’espace passif convoqué par l’image de la conception, ou plutôt du réceptacle (« recevoir », « mettre au monde »). La possibilité que des textes écrits par des femmes soient traduits (« madame l’originale »?) n’est pas envisagée. On trouve plusieurs autres perles dans le même recueil, dont celle-ci : « traduire de la poésie, c’est comme embrasser une femme à travers un drap… » (Battista, 2014 : 60) Aucun doute sur le sexe du traducteur (ni celui du poète), ni sur ses prouesses viriles autour d’un texte bien féminin. Ou encore : « Une traduction mot à mot est une belle à qui il manque un oeil » (46). La beauté d’un texte féminin dépend de l’adresse de son créateur ; la hiérarchie est claire et immuable. Soyons justes, ce livre est une suite de boutades qu’il ne faut pas trop prendre au sérieux ; mais l’ensemble traduit une vision des rapports entre masculin et féminin qui, lui, n’est ni piquant ni nouveau.
•
Malgré leur humeur de surface, toutes ces images sont d’une grande violence. Parfois, l’exclusion des femmes est moins explicite, mais tout aussi efficace. Dans Écrire, traduire, en métamorphose, textes publiés en 2014 mais recueillis après la mort de leur auteur en 2001, Bernard Simeone offre de belles réflexions sur l’art de traduire la poésie. Or son monde de références est presque entièrement masculin. Il nomme plus d’une centaine d’hommes – poètes, prosateurs, traducteurs, théoriciens de la traduction, compositeurs, éditeurs – mais ne mentionne que six femmes : Francesca Spada, journaliste et suicidée, Maria Callas, Catherine de Sienne, Monica Lewinsky et la figure mythique de Cassandre. Une seule écrivaine, Ana Maria Ortese, est nommée (deux fois) dans le livre. À cette unique exception près, aucune poétesse, traductrice ou penseuse n’a droit de cité chez Simeone. On peut parler d’une exclusion soft : aucune déclaration explicite ne disqualifie les femmes, elles sont tout simplement absentes. Tout en se donnant pour ouvert, pluriel, universel, le monde de la traduction est ici entièrement, agressivement masculin. Les traces de la violence ont été effacées, mais la violence demeure.
De façon similaire, dans son livre sur la traduction en Espagne, Javier Calvo, parlant de l’émergence, dans les années 1970, d’une génération de traducteurs littéraires particulièrement distingués, nomme six traducteurs qu’il considère comme exceptionnels, deux femmes et quatre hommes (2016 : 119). La proportion paraît relativement honnête, surtout si on sort à peine du livre de Simeone (bien qu’il y ait fort à parier que parmi les traducteurs « ordinaires », les traductrices soient plus nombreuses). Mais tout se gâte quand, pour soutenir la réputation des traducteurs, Calvo nomme les auteurs et autrices qui forment leur « oeuvre ». Sur les trente et un auteurs traduits qu’il mentionne, on dénombre seulement six femmes, ou 16,1 %. Comme chez Palou, le jeu est circulaire : les auteurs « importants » sont des hommes, la preuve en est qu’ils sont traduits ; les traducteurs importants le sont parce qu’ils traduisent des hommes. Des quatre traducteurs hommes, deux, selon l’énumération de Calvo, n’ont traduit aucune femme ; les deux autres en ont traduit une seule (entre 12,5 et 14,3 % de leur total). Dit d’une autre manière encore, moins d’un auteur sur dix traduit par les hommes est une autrice (9,1 % du total), et sur les cinq femmes traduites mentionnées par Calvo, trois l’ont été par la même traductrice, Clara Janés, par ailleurs poète et autrice d’anthologies d’écrits de femmes. On le voit, quelques femmes se consacrent ainsi à faire rayonner les textes de femmes. Le cercle vicieux se poursuit : ce qui est important – donc masculin – se traduit, et ce qui se traduit gagne encore en prestige. Ce qui est fascinant, ici, c’est que j’ai moi-même tiré ces conclusions des informations fournies par Javier Calvo qui, pour sa part, ne « voit » pas (ou du moins ne relève pas) l’éclatante disparité que son palmarès révèle. Comme Simeone, il met le masculin au centre de sa réflexion, probablement sans s’en rendre tout à fait compte.
•
La traduction a un caractère circulaire : au niveau international, les mêmes oeuvres canoniques sont reconduites, les mêmes auteurs reconfirmés sans fin dans leur statut de géants, de grands maîtres. Et ce monde est presque exclusivement masculin : la « communauté des traducteurs » dont parle de façon émouvante Yves Bonnefoy (2013 : 307-326) se compose pour l’essentiel d’hommes se traduisant entre eux (et, de loin en loin, une femme traduisant un grand homme, comme Jacqueline Risset, traductrice de Dante). Si quelques femmes ont droit de cité dans le livre de Bonnefoy comme traductrices, tous les livres qu’il a traduits ou se propose de traduire, sur plus de trois cents pages et quarante ans d’articles et de conférences, ont été écrits par des hommes. L’admiration, la fascination, la complicité, la curiosité, la main tendue par-dessus la barrière des langues, des pays, des générations, des styles : entre hommes seulement.
•
L’immense majorité des oeuvres du passé, qu’elles soient le fait d’un homme ou d’une femme, ont sombré dans l’oubli. Mais la traduction, l’un des vecteurs de la survie littéraire, a massivement favorisé les hommes et continue de le faire, comme le montrent les panoramas tout récents présentés par Calvo, Simeone et Bonnefoy. Beaucoup de femmes, depuis au moins le Livre de la Cité des dames de Christine de Pizan (1405), cherchent à sauver les écrivaines de la grande vague d’oubli qui les submerge très rapidement (le cas d’Anne Dacier est tristement exemplaire à cet égard). Le théâtre de Jovette Marchessault célèbre beaucoup de créatrices, des pionnières québécoises (Conan, Guèvremont, Roy, Hébert) à Anaïs Nin, Renée Vivien et Emily Carr, en incorporant des fragments de leur oeuvre à même le texte. Socialiste, nationaliste catalane et féministe convaincue, Maria-Mercè Marçal (1952-1998) traduit des poétesses et, dans ses propres oeuvres, incorpore des fragments de celles qu’elle admire, dont Sappho, Renée Vivien, Anna Akhmatova et Sylvia Plath. Comme les hommes que je viens de mentionner, elle a traduit les personnes « avec lesquelles elle partageait des intérêts et des sensibilités » (Riba, 2020 : 169), mais comme elles sont presque toutes des femmes, son travail, y compris ses oeuvres poétiques et son roman, La passió segons Renée Vivien (La passion selon Renée Vivien, non traduit en français), a peu de retentissement hors des cercles féministes[10].
•
Voici une question différente, mais qui fait ressortir une autre facette de la violence : parmi les livres traduits dans le monde, combien ont été écrits par des femmes? À défaut d’avoir trouvé des statistiques canadiennes et québécoises ou françaises, soulignons qu’aux États-Unis, entre 2011 et 2019, selon la Three Percent Data Base, ressource électronique sur la traduction littéraire aux États-Unis, les femmes étaient très largement sous-traduites : seulement 32 % des titres traduits vers l’anglais avaient été écrits par des femmes[11]. Allons plus loin : mises à part les pratiques décoloniales et féministes très récentes, l’immense majorité des personnes traduites et diffusées dans le monde, hommes ou femmes, sont des personnes blanches occidentales, hétérosexuelles et cisgenres, qui écrivent en plus dans des langues dominantes, celles des anciennes puissances coloniales européennes.
Donnons quelques exemples. Le « boom » latinoaméricain, qui impose dans le monde entier une poignée de romanciers (Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa et quelques autres), ne comprend aucune écrivaine ; faute d’être traduites et diffusées aussi systématiquement, des autrices importantes de la même époque (Cristina Peri Rossi, Luisa Valenzuela, Elena Garro, Silvina Ocampo) sont restées dans l’ombre. Plus près de nous, prenant l’exemple du canon de la littérature écrite en yiddish, Madeleine Cohen (2020) parle d’une soixantaine d’écrivains masculins dont les oeuvres ont fait l’objet de belles éditions, parfois en dix tomes et davantage ; seulement trois ou quatre femmes ont eu droit au même honneur, et chacune a fait l’objet d’un seul volume. Quand on cherche des livres à étudier dans les cours, à analyser ou à traduire, souligne Cohen, ces éditions, d’où les femmes sont presque absentes, sont souvent un point de référence : si elles ne sont pas là, c’est qu’elles n’ont pas écrit, estimera-t-on, ou n’ont rien écrit qui vaille la peine. De même, sur les 117 romans traduits du chinois à l’anglais entre 2012 et 2018, seulement trente-cinq (29,9 %) étaient écrits par des femmes (Harman, 2020). Et le cycle continue : indépendamment des langues d’origine et d’arrivée, la traduction (ou la non-traduction, qui confine presque, quand on écrit dans une langue minoritaire comme le yiddish ou peu étudiée par les étrangers comme les langues asiatiques, à la non-existence dans le monde) est un important facteur de discrimination entre écrivains et écrivaines.
En effet, un projet de traduction et de création destiné à faire rayonner des oeuvres de femmes passe souvent pour sectaire, pour un ghetto, un enfermement, alors que le monde de l’entre-hommes est riche et ouvert, est la Littérature même. Voilà le signe justement d’une invisibilisation des créatrices, d’un effacement, d’un meurtre dont on a effacé les traces ; les quelques femmes qui restent (une ou deux par siècle avant notre époque), traitées comme de magnifiques exceptions, « prouvent » en quelque sorte la médiocrité des femmes en général (ce n’est pas que la Tradition exclut les femmes, c’est que les femmes ne sont pas dignes de la Tradition). Or si traduire les femmes exclusivement est un projet féministe, traduire les hommes exclusivement devrait être considéré comme un projet machiste.
•
Jusqu’ici, il a été question d’auteurs – le masculin s’impose – déjà culturellement dominants. Les personnes doublement ou triplement dominées, sans surprise, se tirent encore moins bien d’affaire : dans ses vingt premières années d’existence, l’African Writers Series (AWS), fondée en 1962 par la maison d’édition londonienne Heineman, a publié plus de deux cents auteurs, dont seulement quatre femmes, soit un scandaleux 2 % du total. Alors que l’écrivain nigérian Chinua Achebe affirmait que l’AWS était le « signal de l’arbitre qu’attendaient les écrivains africains rassemblés sur la ligne de départ », les femmes ont été exclues de la course au moment précis où la littérature africaine de langue anglaise gagnait enfin en prestige et en visibilité dans le monde. Une compatriote de Chinua Achebe, Flora Nwapa, fonde dans les années 1970 Tana Publishing Co., la première presse africaine dirigée par une femme et visant un vaste public féminin, mais, on s’en doute, son prestige et sa capacité de distribution sont nettement moindres[12]. Gisèle Shapiro (2012 : 214) l’a noté, le poids des mécanismes sociaux qui jouent à l’encontre des personnes non dominantes se fait encore plus fortement sentir sur la scène internationale : davantage encore lors de la traduction que de la publication, par exemple. Les femmes africaines ont donc été doublement marginalisées.
Au-delà des cas particuliers, l’observation vaut pour l’ensemble des langues et des pays. Seulement un tiers des romans et un cinquième des essais français traduits aux États-Unis en 2019 étaient des oeuvres de femmes (Cultural Services French Embassy in the United States). En 2013, Alison Anderson demandait : « Where Are the Women in Translation? » Citant les ressources de la Translation Database (Université de Rochester), elle soulignait qu’au cours des deux années précédentes, 26 % des livres de fiction ou de poésie publiés aux États-Unis étaient écrits par des femmes.
L’année suivante, Meytal Radzinski fondait « Women in Translation Month ». Sur son blog, Biblibio, elle montre une échelle d’invisibilisation croissante des femmes. Moins traduites (à peine 30 % des livres traduits, selon Radzinski), elles sont ensuite moins recensées dans la presse : dans The Guardian, en 2016, 22 % des comptes rendus des livres traduits portaient sur le travail d’une femme. Malgré un engagement explicite envers la parité, Words Without Borders, site consacré à la littérature mondiale en traduction, publie 35 % de textes écrits par des femmes. Les chiffres de 2019 sont à peine plus réjouissants : malgré de petits gains çà et là, le seuil du tiers semble indépassable, et 12 presses sur 20 ont publié entre 0 et 30 % d’oeuvres de femmes. Les anthologies d’oeuvres traduites incluent à peine 15 % de femmes[13]. Or le rayonnement à l’étranger – notamment par le biais de la traduction – conditionne l’obtention des grands prix nationaux. Les femmes sont donc doublement, triplement défavorisées : moins publiées en traduction, moins recensées, moins primées. Bref, « l’exclusion est un choix », dit Radzinski (2018 ) : on ne donne qu’aux riches, aux pauvres on ne prête même pas.
Que faire? Quand j’ai posé la question sur « Literary Translation », groupe Facebook où on trouve surtout des traductrices états-uniennes, quelques-unes ont dit avoir pris la décision de ne traduire que des femmes pour contribuer à établir l’équilibre, ou du moins de proposer aux éditeurs des livres écrits par des femmes. L’une d’elles ajoute : « Avant de prendre cette décision, je n’avais traduit que des hommes, mais étrangement je ne m’en étais pas rendu compte. » Une traductrice dit avoir refusé deux livres à cause de leur sexisme pour « éviter d’être en colère tous les jours ». Beaucoup croient à la présence de hiérarchies de genre dans le monde de l’édition des traductions, malgré la grande présence des femmes dans le domaine : ainsi, il y aurait aux États-Unis et en France, pour certaines langues, un marché à deux niveaux, au sein duquel les hommes se réservent les auteurs les plus prestigieux et reconnus, tandis que les femmes traduisent davantage de littérature populaire. Une traductrice mentionne qu’à l’étape de la révision, elle reçoit des commentaires neutres ou favorables quand elle signe ses traductions de ses initiales et des remarques plus critiques si elle donne son prénom complet[14]. En somme, les traductrices font état à la fois du sexisme de leur milieu et de leurs stratégies de résistance.
•
Au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada et en France, pays à propos desquels on obtient aisément des statistiques, traduire est une activité féminine. Les femmes forment une majorité, souvent une écrasante majorité, des étudiantes, des traductrices (commerciales et littéraires) et des interprètes de conférence ; en Amérique latine, pour María Ortiz Takacs, la traduction est « une affaire de femmes » (2019). Peut-être parce que c’est un travail mal rémunéré (le commentaire vient du Mexique) ; seule la personne qui apporte un « revenu d’appoint » peut se permettre de l’exercer. Judith Woodsworth s’indigne avec raison d’un commentaire similaire entendu en Amérique du Nord :
Not long ago, a senior executive of a translation organization publicly opined that translation was a good business for a woman to go into because she could stay at home, with the kids, bid on contracts when she liked, and do translation on her own time and in her home office. Doesn’t that sound like the piecework women once did for appallingly low rates of pay?
2019
Qu’en est-il au Canada et au Québec? Les tarifs, fixés par le Conseil des arts, ne varient pas selon le sexe de la personne qui traduit (ni selon les années d’expérience : à son centième livre, on touche le même montant par mot qu’à son premier). Par ailleurs, les traductrices québécoises que j’ai consultées – une petite dizaine – affirment pour l’essentiel ne pas avoir vécu le sexisme dans leur vie professionnelle. Le fait réjouit, mais surprend : par quel miracle la traduction littéraire serait-elle l’exception à la règle parmi les métiers culturels dont on a dénoncé les partis pris discriminatoires dans les médias (cinéma, théâtre, musique, jeux vidéo, etc.)? Parce que les femmes y dominent largement? Parce que c’est un domaine moins prestigieux au départ? Quoi qu’il en soit, il semble plus urgent, pour elles, de mener d’autres combats qui touchent tous les membres de la profession : les droits d’auteur (très rarement consentis), la visibilité professionnelle (nom de la traductrice en couverture, mention dans les recensions médiatiques et dans le matériel promotionnel) et, plus largement, la reconnaissance des traductrices en tant que créatrices, toutes mesures destinées à rehausser le statut subordonné de la profession, qu’il soit lié ou non aujourd’hui, comme il l’a certainement été dans le passé, à la grande présence des femmes.
•
Emily Wilson, traductrice du grec ancien, note la quasi-absence des femmes (qui comptent pourtant pour 40 % des professeurs de lettres classiques) dans la traduction des classiques de l’Antiquité, le sous-champ le plus prestigieux de la traduction littéraire (elles sont 5,5 % dans la série Oxford World’s Classics, dont une équipe mixte). Wilson ajoute ceci : bien que le simple fait d’être une femme ou une personne jeune ou issue d’une minorité ne garantisse pas qu’on fera une traduction plus originale ou meilleure, la diversification, comme stratégie globale, finira par enrichir notre compréhension des textes et des contextes. Autre élément important, croit-elle, l’introduction qui accompagne la traduction et en propose une lecture est, encore de nos jours, souvent sexiste et peu inclusive : une bibliographie publiée en 2019, par exemple, ne mentionne aucun livre écrit par une femme, alors que la critique féministe a renouvelé depuis dix ans notre vision des classiques ; un commentaire critique loue la démocratie athénienne sans signaler que les femmes et les personnes immigrantes, notamment, en étaient exclues. La traduction et les notes d’accompagnement perpétuent donc la réduction des femmes au silence et imposent une lecture étroite et convenue de l’Antiquité gréco-latine.
D’Anne Dacier à Emily Wilson, toutes deux traductrices d’Homère, tout a changé, peu de choses ont changé : la place des femmes, dans ce monde raréfié, demeure marginale et précaire. Grande différence toutefois : la prise de conscience féministe, l’émergence de communautés de femmes alors qu’Anne Dacier était seule de son espèce. Une chose est certaine : trois cents ans après sa mort, dans un monde encore marqué par les asymétries liées au genre, mais aussi à la « race » et à l’origine géographique, notamment, Anne Dacier, première à porter le nom de « traductrice », demeure d’une brûlante actualité.
Appendices
Note biographique
Professeure au département d’études littéraires de l’Université du Québec à Montréal, Lori Saint-Martin est essayiste, romancière et nouvelliste. En collaboration avec Paul Gagné, elle a traduit de l’anglais au français quelque 130 romans, essais et recueils de poésie et a remporté le prix John-Glassco, quatre prix du Gouverneur-général (traduction anglais-français), quatre prix de traduction de la Quebec Writers’ Federation et le prix de la traduction de la Bibliothèque juive de Montréal. Elle traduit aussi de l’espagnol. Ses livres les plus récents sont Pour qui je me prends et Un bien nécessaire, éloge de la traduction littéraire (Boréal).
Notes
-
[1]
Elle naît en 1645 selon Huma-Num (https://madamedacier.huma-num.fr/) et d’autres sites, en 1654 selon Croquette et en 1647 selon Garnier.
-
[2]
C’est un court article de Judith Woodsworth (2019) sur les femmes et la traduction qui m’a mise sur la piste d’Anne Lefèvre Dacier.
-
[3]
Voir la présentation d’Éliane Itti sur Huma-Num (https://madamedacier.huma-num.fr/).
-
[4]
Les données biographiques proviennent de Croquette (sans date), d’Itti (2015) et de Garnier (2002).
-
[5]
Bien sûr, les notions de plagiat et de l’auteur propriétaire de son texte sont récentes, mais il y a quelque chose de choquant à préférer l’ignorance au savoir.
-
[6]
La citation complète, tirée de De l’amour, se lit comme suit : « Imprimer, pour une femme de moins de cinquante ans, c’est mettre son bonheur à la plus terrible des loteries ; si elle a le bonheur d’avoir un amant, elle commencera par le perdre. Je ne vois qu’une exception : c’est une femme qui fait des livres pour nourrir ou élever sa famille. Alors elle doit toujours se retrancher dans l’intérêt d’argent en parlant de ses ouvrages et dire, par exemple à un chef d’escadron : “Votre état vous donne quatre mille francs par an, et moi, avec mes deux traductions de l’anglais, j’ai pu, l’année dernière, consacrer trois mille cinq cents francs de plus à l’éducation de mes deux fils” » (cité par Herrmann, 1976 : 32-33).
-
[7]
Ces statistiques sur l’anthologie de Lawrence Venuti, l’une des plus influentes, sont tirées de Schäffner (2013 : 144-151).
-
[8]
Toutes les références de cette section proviennent de Palou (2007).
-
[9]
Toutes les citations de ce paragraphe sont tirées de Viennot (2020).
-
[10]
J’ai découvert Maria-Mercè Marçal grâce à l’article de Caterina Riba (2020 : 59-70). Marçal a été peu traduite en français : un recueil de poèmes, Trois fois rebelle, a vu le jour en 2013 (Paris, Bruno Doucey, trad. Annie Bats). Son grand roman sur Renée Vivien a paru en 2020 en Angleterre (The Passion According to Renée Vivien, Londres, Francis Boutle Publishers, trad. Kathleen McNerney et Helena Buffery). Beaucoup de ses livres sont épuisés ou difficiles à trouver dans leur catalan original ou même en traduction espagnole.
-
[11]
La Chine, l’Italie, la Russie, le Japon, l’Espagne et la Norvège se trouvaient sous la barre du 30 %, avec la France à 30,61 %. Les pays avec le meilleur score sont le Canada à 45 %, la Suède et le Danemark (http://www.rochester.edu/College/translation/threepercent/2019/08/19/women-in-translation-by-country/).
-
[12]
Les données sur l’African Writers’ Series et le commentaire de Chinua Achebe sont tirés de Nwankwo (2020). Pour Flora Mwapa, voir aussi Anonyme (2020).
-
[13]
Ces chiffres sont tirés du Three Percent Podcast, épisode 167.
-
[14]
Bien que consciente que ce sondage aux dimensions très modestes n’a aucune valeur scientifique, j’ai retenu certains commentaires qui me semblaient révélateurs.
Bibliographie
- Alq, Louise de (1893), « Mme Dacier (Anne Lefebvre) », L’Anthologie féminine, Bureau des causeries familières : 115-124 [en ligne], https://fr.wikisource.org/wiki/Anthologie_f%C3%A9minine/Mme_Dacier (consulté le 18 juillet 2022).
- Anderson, Alison (2013), « Where Are the Women in Translation? », Words Without Borders, 14 mai [en ligne], https://www.wordswithoutborders.org/dispatches/article/where-are-the-women-in-translation (consulté le 18 juillet 2022).
- Anonyme (2020), « Meet the Formidable Flora Nwapa, Woman Author, Entrepreneur, Freedom Fighter », The Lagos Review, 13 janvier [en ligne], https://thelagosreview.ng/meet-the-formidable-flora-nwapa-woman-author-entrepreneur-freedom-fighter/ (consulté le 18 juillet 2022).
- Batista, Carlos (2014), Traducteur, auteur de l’ombre, Paris, Arléa.
- Bonnefoy, Yves (2013), « La communauté des traducteurs », L’autre langue à portée de voix, Paris, Seuil, coll. « La librairie du XXIe siècle » : 307-326.
- Calvo, Javier (2016), El fantasma en el libro. La vida en un mundo de traducciones, Madrid, Seix Barral, Los Tres Mundos Ensayos.
- Chamberlain, Lori (1988), « Gender and the Metaphorics of Translation », Signs, vol. 13, no 3, printemps : 454-472.
- Croquette, Bernard (sans date), « Dacier Anne, née Lefèvre (1654-1720) », Encyclopaedia Universalis [en ligne], https://www.universalis.fr/encyclopedie/anne-dacier/ (consulté le 18 juillet 2022).
- Croquette, Bernard (sans date), « Houdar de la Motte Antoine-Lamotte-Houdar dit (1672-1731), Encyclopaedia Universalis [en ligne], https://www.universalis.fr/encyclopedie/houdar-de-la-motte/ (consulté le 18 juillet 2022).
- Cohen, Madeleine (2020), « The Feminine Ending: On Women’s Writing in Yiddish, Now Available in English », Los Angeles Review of Books, 10 avril [en ligne], https://lareviewofbooks.org/article/the-feminine-ending-on-womens-writing-in-yiddish-now-available-in-english?fbclid=IwAR2D_MddiUdab3JpFCgGMBxB6p1YkQnII_IOBYOTQt1oQnFS3tzSc_P7dsQ (consulté le 18 juillet 2022).
- Cultural Services French Embassy in the USA, « French Books in the U.S — The 2019 Edition », Books & Ideas [en ligne], https://frenchculture.org/books-and-ideas/9668-french-books-us-2019-edition (consulté le 18 juillet 2022).
- Pizan, Christine de (1986 [1405]), Le livre de la Cité des dames, trad. Éric Hicks et Thérèse Moreau, Paris, Stock/Moyen Âge.
- Foulon, Éric (2008), « Antoine Houdar de la motte, L’Iliade, poème avec un Discours sur Homère », Anabases, no 7 [en ligne], http://journals.openedition.org/anabases/2557https://doi.org/10.4000/anabases.255 (consulté le 18 juillet 2022).
- Garnier, Bruno (2002), « Anne Dacier. Un esprit moderne au pays des Anciens », dans Jean Delisle (dir.), Portraits de traductrices, Ottawa et Arras, Presses de l’Université d’Ottawa et Artois Presse Université : 13-55.
- Harman, Nicky (2020), « Interviews with Chinese Women Writers », Paper Republic, 13 octobre [en ligne], https://paper-republic.org/pers/nicky-harman/interviews-with-chinese-women-writers-2019/?fbclid=IwAR13wwYFUQunU-EjFSOpnelFH4s_j-y2iqbfnAzip5jA9XU-f30OjLkj-ZIWomen Writers (consulté le 18 juillet 2022).
- Herrmann, Claudine (1976), Les voleuses de langue, Paris, Des femmes.
- Hornig, Dieter (2011), « L’actualité de la traduction », Actes du forum de la traduction littéraire de la SGDL (Société des gens de lettres) [en ligne], https://www.sgdl.org/sgdl-accueil/presse/presse-acte-des-forums/la-traduction-litteraire/1517-lactualite-de-la-traduction-par-dieter-hornig (consulté le 18 juillet 2022).
- Les Imposteurs (2018), « Entretien avec Carine Chichereau », Chroniques des Imposteurs, 31 août [en ligne], https://chroniquesdesimposteurs.wordpress.com/2018/08/31/interview-de-carine-chichereau/ (consulté le 18 juillet 2022).
- Itti, Éliane (2015), « Madame Dacier : de la traduction d’Homère à la défense d’Homère », dans Michèle Coltelloni-Trannoy (dir.), La traduction : sa nécessité, ses ambiguïtés et ses pièges, Paris, Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques : 48-56 [en ligne], https://books.openedition.org/cths/1047?lang=fr#:~:text=35De%20toute%20%C3%A9vidence%2C%20un,39%20S (consulté le 18 juillet 2022).
- Motte, Houdar de la (1714), « Discours sur Homère », Paris, chez Grégoire Dupuis [en ligne], http://iliadeodyssee.texte.free.fr/aatexte/houdar/discour/discourhomera.htm (consulté le 18 juillet 2022).
- Nwanko, Emeka Joseph (2020), « How Women Are Changing the Face of African Publishing », Literary Hub, 8 juin [en ligne], https://lithub.com/how-women-are-changing-the-face-of-african-publishing/ (consulté le 18 juillet 2022).
- Palou, Anthony (2007), « Le métier de traduire », Le Figaro, 13 avril [en ligne], https://www.lefigaro.fr/lefigaromagazine/2007/04/13/01006-20070413ARTMAG90421-le_metier_de_traduire.php (consulté le 18 juillet 2022).
- Radzinski, Meytal (2018), « Exclusion is a Choice », Biblibio: Life in letters [en ligne], http://biblibio.blogspot.com/2018/07/exclusion-is-choice-bias-in-best-of.html (consulté le 18 juillet 2022).
- Riba, Caterina (2020), « Traduction et canon littéraire : la généalogie féminine de Maria-Mercè Marçal », Marianne Lederer et Madeleine Stratford (dir.), Culture et traduction, Paris, Classiques Garnier : 59-70.
- Schäffner, Christina (2013), « Women as translators, as translation trainers, and as translation scholars », Women’s Studies International Forum, 40 : 144-151 [en ligne], https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277539513001167?casa_token=O1_3fnGAPSEAAAAA:mfOlPa8Db2IrVYnw3BJOsPGyrrdKlhvhndUCHoCxtVxxIn25e7mjojRPxZ16ga3qnUg-3ZSCC7E (consulté le 18 juillet 2022).
- Shapiro, Gisèle (2012), « Gérer la diversité : les obstacles à l’importation des littératures étrangères en France », Traduire la littérature et les sciences humaines : conditions et obstacles, Paris, Ministère de la Culture-DEPS : 199-247.
- Simeone, Bernard (2014), Écrire, traduire, en métamorphose, Paris, Verdier.
- Takacs, María Ortiz (2019), « En América Latina la traducción es cosa de mujeres », Circuit, dossier « Le traducteur est une traductrice comme les autres », no 114, automne [en ligne], https://www.circuitmagazine.org/dossier-144/en-america-latina-la-traduccion-es-cosa-de-mujeres (consulté le 18 juillet 2022).
- Three Percent Podcast (2019), « We Could All Do Better », Three Percent, épisode 167, 22 août [en ligne], http://www.rochester.edu/College/translation/threepercent/category/three-percent-podcast/ (consulté le 18 juillet 2022).
- Translation Database/Three Percent Index, University of Rochester [en ligne], http://www.rochester.edu/College/translation/threepercent/index.php?s=database (consulté le 18 juillet 2022).
- Viennot, Bérengère (2020), « La retraduction de 1984 est une idée fabuleuse », Slate, 30 mai [en ligne], http://www.slate.fr/story/191001/traductrices-1984-orwell-metier-traduction-josee-kamoun-amelie-audiberti?fbclid=IwAR0XFfXMCFj6hYLYuxp7x6tOPremtEIv0HSPWMe1C6l4pp3ic51qPzn99ec (consulté le 18 juillet 2022).
- Wilson, Emily (2020), « Ah, how miserable! », London Review of Books, vol. 42, no 19, 8 octobre [en ligne], https://www.lrb.co.uk/the-paper/v42/n19/emily-wilson/ah-how-miserable (consulté le 18 juillet 2022).
- Woodsworth, Judith (2019), « A Woman’s Place », Circuit, dossier « Le traducteur est une traductrice comme les autres », no 114, automne [en ligne], https://www.circuitmagazine.org/dossier-144/a-woman-s-place (consulté le 18 juillet 2022).